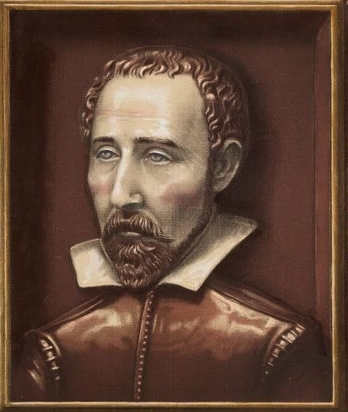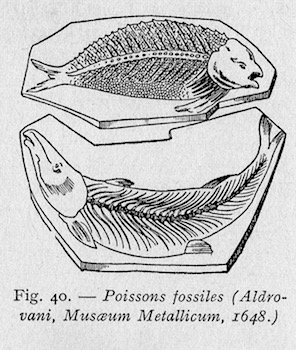|
| Cliquez ci-dessus
pour revenir à la page d'accueil |
|
|
La Renaissance à
Paris
(première
partie)
Quand
on aborde cette période de l'histoire de Paris, plus largement du
royaume et d'ailleurs, de toute évidence on y
découvre une vie culturelle riche. François Premier en 1539 remplaçait
le
latin dans les textes officiels par le français, mais ce fut aussi la
propagation de l'imprimerie moderne.
|

|
|
|
|
|

Vue générale de Paris aux XVe et XVIe siècles |
|
| Ce fut à
Montmartre que le jésuitisme prenait source et allait devenir le fer de
lance d'une centralisation de la culture et de ses moyens de
transmissions, de même un agent de la contre-Réforme. La bourgeoisie
parisienne s'avéra pour sa part très influencée par le protestantisme
et les idées nouvelles. L'essor
intellectuel allait connaître un développement
notoire à Paris, la
ville être une place universitaire incontournable. Cette époque pour
beaucoup sublimée façonna le monde intellectuel et politique du
royaume. Sinon, nous devons cette appelation de Renaissance à l'historien Jules Michelet. Celui-ci marquait un rejet pour ce qui avait été antérieur, c'est-à-dire le mal nommé Moyen Âge, et un retour aux mondes et aux philosophies Antiques. Michelet toujours à la limite du roman n'a pas caché dans son Histoire de France ses préférences pour les Protestants. |
|
|
La Renaissance est aujourd'hui étudiée et intégrée à l'époque dite
Moderne (ou première modernité),
celle-ci se terminant à la fin du XVIIIe siècle. Cependant cette
période allait conserver une bonne part des structures légales et
politiques
apparues les siècles précédents, même si les monarques tentèrent de les
mettre au goût du jour, à l'exemple de la police et de la surveillance
et protection de la cité parisienne. Les confrèries et métiers
continuaient à
évoluer au gré des nouveaux édits et ordonnances royales, la langue
française loin de dominer s'organisait à petit pas, le latin restait la
langue des écrits médicaux ou sciences novatrices de ces temps-là.
« Paris,
excède toutes les villes de la chrétienté en grandeur et étendue, en
multitude d'hommes, bâtiments et maisons, en religion chrétienne, en
temples, en bienfaits, en justice, en police, en science, en bons
esprits, en marchandise, en arts et métiers, en commodités humaines, en
vivres et viandes et en tout ce que le cœur peut souhaiter. »
Antiquitez de Paris,
Gilles Corrozet (1550)
|
|
 |
|
| 1500-1501
:
Découverte(s) de l'hydrogène (Paracelse), des côtes du Brésil par les
Portugais, et c'est le premier envoi d'esclaves
africains aux Amériques. Le futur Charles Quint, Charles de
Habsbourg nait à
Gand en Flandre. Le 22 mai un édit
promulgue l'expulsion des Juifs de Provence. Ce décret est reitéré un
an plus tard par Louis XII le 31 juillet, et appliqué en
septembre. |
| 1504
: Deuxième sacre à la basilique de St-Denis
et
entrée d'Anne de Bretagne dans Paris (elle était l'épouse de Charles
VIII avant son second mariage avec Louis XII en 1499). Traité de Blois,
le royaume français cède Naples à l'Espagne. |
1506 :
A Tours, se tiennent des États Généraux, où le roi est proclamé Père
du Peuple.
Louis XII favorise l'union de François d'Angoulême
avec Claude, duchesse de Bretagne contre Charles Quint, présumée un
temps comme sa future épouse, en juin ils se fiancent. (Ci-contre les
fiançaillles enluminées par Guillaume Leroy de Lyon, vers 1507). A Paris, une « taxe des boues et des lanternes » est instaurée pour financer le ramassage des ordures et l’éclairage des rues sans grande réussite...
|
1509
: Henri VIII monte sur le trône comme roi
d'Angleterre et d'Irlande. A Paris, la Tour Saint-Jacques est édifiée en complément de l'église St-Jacques de la Boucherie, fin des travaux en 1523.
|
| 1510
: Climat du royaume, des chaudes périodes
printanières et estivales se succèdent jusqu'en 1560. |
| 1511
:
Le théologien Érasme de Rotterdam publie Eloge de la folie. |
| 1512 :
En septembre, se termine le reconstruction du pont Notre-Dame avec 68
maisons, et pour la première fois des numéros sont donnés aux
habitations, mais cette initiative n'est pas suivie. |
| 1514
: Mort
d'Anne de Bretagne et union de Louis XII avec Marie Tudor. De même, son cousin François épouse Claude de France à
Saint-Germain -en-Laye. Nicolas Machiavel
(1469-1527) donne à Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, le manuscrit du Prince, mais publié en 1532. |
|
|
|
| Paris
possédait un centre religieux, Notre-Dame et un centre politique, la
résidence royale se trouvait dans l'île de la Cité, le palais du roi allait
passer de
nouveau au
Palais du Louvre qu'avait rénové Charles V, mais la résidence du
roi avait été détruite pour cause de
guerre de Cent
ans. Le Palais, non loin de la cathédrale
Notre-dame,
exerçait sous François 1er un rôle d'apparat ou de réception, comme
lors de
son second mariage avec Eléonore de Habsbourg en 1530, et de même lors de la venue de
Charles Quint dans la capitale en 1540. |
|
| Paris en
son enceinte fortifiée datant de l'époque médiévale ou ce qui a été
antérieur au XVIe siècle, ce fut une cité plutôt anarchique dans ses
aménagements urbains, sans réels plans ou conduites hors des remparts,
ou une organisation réglementaire propre aux
constructions privées.
Même si Henri II tenta de limiter les constructions nouvelles dans les
faubourgs. Autour du
noyau central se
développaient en rive droite les Halles, qui servirent de grand marché
d'approvisionnement des parisiens (le Champeaux). Non loin ou à
coté du port de Grève (là où l'on allait chercher du travail).
La ville était principalement desservie par voie
fluviale. Rive gauche ou sud, des
faubourgs monastiques se
façonnaient : Sainte-Geneviève,
Saint-Germain, Saint-Sulpice, etc. Rive droite ou nord, des faubourgs
commerciaux et marchands se
dressaient : Saint-Merri,
Saint-Denis ; plus tardivement Saint-Antoine. |
|
Les espaces publics
s'avéraient
peu nombreux en dehors des Halles et de l'hôtel municipal qui allaient
connaître des transformations notables, et
il existait de rares ponts
pour circuler d'une rive à l'autre, l'on pouvait toutefois traverser
par des barques à fond plat ou sur de simples embarcations fluviales,
mais à titre payant. Les rues étaient étroites, un mètre
parfois ou deux, jusqu'à six mètres de largeur pour les plus larges,
pour les ruelles à peine de quoi faire passer
un cavalier ou une charrette à bras. Il existait peu d'espaces où l'on
n'échappait pas à un sentiment d'enfermement, il y avait peu de monuments,
d'ornementations, en dehors des édifices religieux. Les cartes ne
tenaient pas compte des échelles, elles peuvent donner l'idée d'une
ville aérée, ce qui ne fut pas vraiment le cas en sa partie centrale.
|
|

|
|
|
« Ces
maisons, en général fort élevées, bordaient des rues mal alignées,
étroites, tortueuses, sans air et sans soleil, encombrées de gravois,
de boues, d'ordures et d'eaux stagnantes qui faisaient des voies les
plus fréquentées des cloaques ou des fondrières (lieu souvent envahi
par l'eau). Montaigne écrivait alors : « Le
principal soin que j'aie à me loger, c'est de fuir l'air puant et
pesant. Ces belles villes, Venise et Paris, altèrent la faveur que je
leur porte par l'aigre senteur, l'une de son marais, l'autre de sa boue
». (...) On s'était décidé aussi
à donner plus de largeur aux rues, et celles qui furent percées à
cette époque suffirent pour longtemps à toutes les exigences du
commerce et de l'industrie. L'ambassadeur vénitien Marino Giustiniano
écrivait à son gouvernement en 1535 : « Les rues sont
encombrées par les charrettes, les mulets et d'autres bêtes de somme,
et par toutes sortes d'embarras
(embouteillages) ». Mais la mode des carrosses, qui commençait alors
à s'établir, fit comprendre plus impérieusement encore la
nécessité d'élargir les voies de communication. »
Moeurs et
coutumes des Parisiens au XVIe siècle, pages, 13, 14 et 41,
Alfred Franklin
(1876)
|
|
|
L'élan
culturel plus une volonté d'embellissement des souverains à la
Renaissance s'amorça sous Louis XII et changea par touche la ville
médiévale. Toute la construction de la ville
allait s'engager désormais autour d'un pouvoir royal centralisé et d'un
espace public réorganisé selon les vœux des monarques, tendant peu à
peu vers l'absolutisme. On trouve chez les Valois et les
Bourbon une cohérence certaine à vouloir une ville moins dense et plus
ouverte, par l'importation d'un monde intellectuel où l'Italie ouvrait
la voie d'un renouveau artistique et architectural considérable.
|
|
| Pour la
ville capitale, une fois de plus sa vocation ou
source d'inspiration latine nouvelle se profilait, et politiquement la
venue de la famille Médicis en France augura d'une période très trouble
et d'une volonté de laisser des traces patrimoniales de grandes
envergures. Telle que la mise en perspective de Paris, qui
allait aussi s'étendre à partir de la Renaissance vers l'Ouest, par la
voie royale, jusqu'au Louvre. Puis suivirent les jardins royaux, les
Tuileries et le prolongement vers les Champs Elysées. Cet ensemble
urbanistique prendra seulement fin au XXe siècle à la Défense, sous
François Mitterrand. |
|
Paris a été un lieu de
marchés, un centre industriel et commercial. La ville restait une forteresse organisée
autour d'un système défensif. La cité de la "Renaissance" a été assez
semblable à la ville médiévale et conservait de nombreuses similitudes
dans ses fonctions économiques, mais les différences ont été
importantes dans le droit foncier et son application. En ville,
normalement les terres allaient être en vente libre et transmissibles
par héritage.
« L'air de
la ville rend libre » : l'unité juridique est celle
de l'individu et non du lignage. Pour
se regrouper, les parisiens selon les quartiers avaient un saint patron
comme emblème évoquant les grands patronages de l'époque, mais la ville
par endroit était un véritable labyrinthe où l'on se perdait et où l'on
tournait le plus
souvent en rond, rien n'indiquait en dehors de très rares enseignes où
l'on se trouvait.
Ci-contre : le quartier des Halles
marchandes dit Champeaux
comprenant le cimetière des saints innocents clôturé
|
|

|
|
|
| Les propriétaires des terrains à Paris étaient le
clergé
et le roi pour grande part, et une bourgeoisie
parisienne prospère et très politisée. Il
ne s'agissait plus de quelques milliers d'habitants que
l'on recensait au début du Haut Moyen Âge,
la population avoisinait près de trois
cent mille citadins, comme résidents permanents à l'intérieur et à
l'extérieur des murailles de Paris. A noter toutefois que le nombre
d'habitants a pu varier et retomber à 200.000 habitants, en raison des
guerres, famines et épidémies de peste. Le tout sur un espace limité
sur
peu de kilomètres carrés, la promiscuité à l'intérieur ou au centre de
la ville fut très grande,
la
densité des habitations devenir un problème majeur pour une bonne
circulation, en bref on étouffait déjà dans Paris (rien de très
neuf...). |
|
| Pour la saleté, les plans
envisagés par le prévôt Hugues Aubriot au XIVe siècle de doter
Paris d'un réseau d'égout n'avait pas pu aboutir, les percements
accomplis finirent en des larges réservoirs d'immondices, nommés
"trous". Selon Sauval, il existait un trou-Bernard non loin de
Saint-Germain-l'Auxerrois, un trou-Gaillard près des Célestins, et de
nombreux trous-punais dans la plupart des quartiers. « Nous
sommes serrés, pressés, envahis, bouclés de toutes parts, et ne prenons
air que l'air puant d'entre nos murailles, de nos boues et de nos
égouts. » (Satire Ménippée, des écrits
politiques et satyriques de 1594). |
|
Le fonctionnement
de la Prévôté parisienne
Alfred Franklin, bibliothécaire et historien
Ci-contre : le prévôt en roube rouge
|
|  |
« Le prévôt des marchands présidait à tout ce qui concerne la
sûreté́ des personnes, la défense, la petite voirie, les
approvisionnements et le commerce de la ville. Il était assisté de
quatre échevins, un procureur du roi, un greffier, un receveur, un
clerc, vingt-quatre conseillers, dix sergents, seize quarteniers,
quatre cinquanteniers et deux-cent-cinquante-six dizainiers. Le prévôt
des marchands devait être né à Paris et bourgeois de cette ville. Il
était élu pour deux ans, suivant les formes prescrites par un arrêt
du 8 août 1500, et qui peuvent se résumer ainsi.
Chaque quartenier dressait une liste des principaux habitants de son
quartier, et la soumettait au prévôt et aux échevins. Ceux-ci
choisissaient sur la liste douze bourgeois, qui élisaient à leur tour
six notables pour chaque quartier (16 en tout), soit quatre-vingt-seize
pour tout Paris ; on tirait au sort trente-deux d'entre eux, qui
procédaient, au scrutin secret, à l’élection du nouveau prévôt.
Son costume était une robe de satin noir, mi-partie rouge et tanné.
Un édit de janvier 1577 conféra à tous les prévôts des marchands
et échevins la noblesse avec le titre de chevalier. Les échevins
restaient également deux ans en charge, et portaient des robes
semblables à celle du prévôt, mais en drap.
Les dix sergents de la ville avaient une robe mi-partie bleu et rouge.
Une fois par an au moins, ils vérifiaient les poids et mesures de tous
les marchands et les poinçonnaient de la fleur de lys.
Les quartiniers étaient élus par les cinquanteniers et les
dizainiers. Ils étaient chargés de la police et de la défense d'un
quartier ; mais, vers la fin du XVIe siècle, le commandement de la
milice bourgeoise leur fut enlevé et confié à un colonel.
Les cinquanteniers transmettaient aux dizainiers les ordres des
quartiniers, et, dans l’origine, commandaient cinquante hommes de la
milice. Ils veillaient à la conservation des chaînes destinées à
barrer les rues, et devaient posséder une liste de tous les habitants
de leur circonscription. Les dizainiers commandaient dix hommes de la
milice.
Trois compagnies soldées, une d'archers (120 hommes), une
d'arbalétriers (60 hommes) ; et une d'arquebusiers (100 hommes),
placées depuis 1550 sous les ordres d'un capitaine général,
dépendaient aussi de l'Hôtel de ville et obéissaient aux deux
prévôts. La garde bourgeoise était composée des corps des métiers,
et formait, vers le milieu du siècle, soixante et une compagnies ;
François 1er les passa en revue en 1540, et vit défiler devant lui
quarante mille hommes bien armés.
La police nocturne était faite par le guet, composé du guet royal et
du guet dit assis, dormant ou bourgeois. Le guet voyais composé de
quarante sergents à pied et de vingt sergents à cheval, faisait des
rondes pendant toute la nuit ; « ceux-ci, dit l'ambassadeur Lippomano,
vont chevauchant dans la ville, et ils font un si grand tapage qu'ils
donnent aux malfaiteurs le signal et le temps de se sauver. »
Le guet assis était formé de bourgeois et d'artisans, les hommes de
garde, prévenus la veille par les « notaires ou clercs du guet, » se
rendaient, à la nuit tombante, dans des postes désignés, d'où ils
pouvaient, en cas d'alerte, se porter un mutuel secours. Étaient seuls
exempts de ce service les gardes des clefs des portes, ceux qui
conservaient le rouet des chaînes, les bedeaux et les messagers de
l'Université, les ouvriers employés au monnayage, les estropiés et
les hommes qui avaient passé soixante ans.
Les rues n'en
étaient pas moins fort peu sûres pendant la nuit,
malgré́ le é́loges emphatiques dont Paris était toujours l'objet. »
Source : Moeurs
et coutumes des Parisiens au XVIe siècle, Alfred
Franklin, pages 67 à 70 (Paris, 1876)
|
|
|
|
1515, avènement de
François 1er : chronologie de la vie politique, cultuelle et culturelle
|
|
|
|
François Ier fut à la fois un guerrier
et un homme qui s'ouvrit à la culture de son temps, et
incontestablement un bâtisseur.
On l'a dit sous l'influence de sa mère, Louise de Savoie, qui a tenu
manifestement un rôle politique non négligeable ; il y a surtout à
remarquer qu'au XVIe siècle de nombreuses femmes au sein des élites
nationales ont pu accéder à des rôles majeurs et même de premier rang,
notamment outre-Manche. La Renaissance
italienne a
tenu une influence considérable
dans le renouveau
du XVIe siècle français. Paris retrouvait symboliquement ses origines
latines. La
famille Médicis
représenta la première lignée d'italiens célèbres en France, qui a tenu
au sein du royaume un rôle conséquent. La Renaissance à Paris, c'est
un peu tout le concentré qui donna au royaume de France un grand
prestige artistique, mais aussi ce qui propulsa le pays à devenir la
première puissance européenne jusqu'à la fin du dix-huitième siècle.
|
|

|
|
|
1515 : Décès
de Louis XII, le 1er janvier, à la fin du mois François d'Angoulême âgé
de 20
ans est sacré à Reims. Le 23ème jour de février, le Parlement de Paris
rend un arrêt qui donne aux enfants nés dans le royaume de parents
étrangers la qualité de sujet du roi de France, ou plus communément ce
que l'on nomme le droit du sol (jus soli). Puis en septembre, le 13 et 14, c'est
l'incontournable bataille de Marignan (Italie) et une des rares
victoires de François Ier. Sinon les conflits en Italie vont s'étendre
sur près de 17 années. Le nombre d'habitants du royaume est estimé à 16
millons de Français. Le poète Clément Marot publie Le Temple de Cupido.
|
| 1516 :
En février, le Parlement de Paris ordonne aux autorités de la ville de
chasser les "vagabonds oisifs" et de les mettre au travail à des
travaux « de réfection des murailles, curer et vider les fossés, rues et égouts. » François
Ier et le pape Léon X de la famille Médicis signent le concordat de
Bologne, qui donne au souverain français le droit de nommer les évêques
et les abbés. Ce traité sera en activité jusqu'en 1790. Le roi
fait appel à Léonard de Vinci, celui-ci se rend en
France, il dresse les plans d'un nouveau palais, et s'intéresse à la
navigation fluviale. Le Prince de
Machiavel est mis sous presse. L'Utopie
de Thomas More ou Morus et Institution du Prince
Chrétien d'Érasme
sont
éditées. |
| 1517 :
Les troupes ottomanes de Sélim 1er battent militairement les Mamelouks
du sultan égyptien, et ce dernier est exécuté en avril. Le 1er avril, « fut
tué Fluraut, le bourreau de Paris, par ce qu'il faillit à couper la
tête à un homme au pillori, par justice ; dont, après ce, fut tant
oppressé de pierres, qu'il lui convint s'en aller mucer (se cacher) en
la cave du dit pillori. Quoi voyant le peuple, mît le feu dedans la
dite cave ; par quoi fut celui-ci bourreau était et trouvé mort. Dont
après furent un ou deux des mauvais garçons, qui avaient mis le feu,
pris par justice et battus par les carrefours de Paris » (* - source voyez l'année 1522). Début mai, Claude,
duchesse de Bretagne est couronnée à Saint-Denis et fait le 12 son
entrée solonnelle dans Paris. Le
Parlement et de l'Université de
Paris protestent contre le concordat de Bologne ; et les 95 thèses
de Martin
Luther contre les indulgences sont publiées : début de
la
Réforme. François 1er décide de la création du port et de la ville du
Havre sur le littoral cauchois. |
| 1518 : Le Pape Léon X condamne Martin Luther et ses écrits.
Le conquistador espagnol Cortez arrive
au Mexique depuis les Antilles. Est annoncée la naissance de François
de Bretagne,
dauphin du royaume (il meurt en 1535). |
| 1519 : A Paris, il est
constaté l'apparition des premiers Protestants ou Réformés. Francois
1er présente sa candidature pour devenir l'empereur du Saint-Empire
romain Germanique, il est battu par Charles Quint avec qui le roi de
France va entretenir une très grande rivalité. Charles V nommé empereur
du Saint-Empire, il remplace son défunt grand-père Maximilien 1er
de
Habsbourg. Naissance de Catherine
de Médicis à Florence, et Claude de France donne
vie au futur Henri II. Magellan depuis Lisbonne part pour son tour du monde
(qu'il ne finira pas et décédera en route).
Disparition de Léonard de Vinci au château du Clos-Lucé après avoir
rédigé son testament (sénéchaussée d'Amboise) et laissé des carnets de
notes et une quinzaine d'œuvres picturales magistrales (3 tableaux sont
au musée du
Louvre). Nous commémorions en 2019, le peintre, l'architecte,
l'inventeur et l'aménageur, et ce mystérieux génie de la Renaissance,
très impliqué dans les questions hydrauliques. (Une vie, une œuvre, France Culture,
2019) |
|

Tableau relatant les déplacements de la cour sous François 1er et les
ré-aménagements stylistiques
|
|
| 1520 :
C'est la fameuse rencontre du camp du Drap
d'or où vont se rencontrer
pour des questions diplomatiques Henri VIII d'Angleterre et François
1er, près de Calais : la rencontre tourne à l'échec. Editions d'Arithmétique
de E. de la Roche, et Appel à
la Noblesse Chrétienne de Martin Luther.
|
| 1521 : L'excommunication
de Martin Luther et de ses partisans hérétiques est prononcée par la
bulle
papale "Decet romanum ponticem", ce qui pousse Luther à traduire la
Bible en allemand. Le canton de Zurich devient le premier état en
Europe à devenir réformé. Au début
« de
mai jusqu'à longtemps après, fut quasi à Paris une famine, tellement
qu'on ne pouvait trouver blé et pain en la ville de Paris pour argent.
Et fut le blé si cher, que, pour vrai, il vallut de six à sept livres
le septier, mesure de Paris. » Et pareillement en Normandie, l'envol des prix à 10
livres le septier de blé provoque une famine selon l'auteur. (* source
voyez l'année 1522). Les Psaumes de
Lefèvre d'Étaples sont édités.
|
1522 : Dans une
grotte en Espagne, près de Montserrat, Igniacio Lopez de
Loloya ou Ignace de Loloya (1491-1556)
- père
spirituel des Jésuites et futur fondateur de la Compagnie de Jésus -
commence en mars une retraite spirituelle et mystique de plusieurs
mois.
Les premières
rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris vont dans les caisses de l'état et
arrivée du libre penseur et
poète Étienne Dolet (1509-1546) dans la ville. Dolet suivra les
cours
d'éloquence et de rhétorique de Nicolas Béraud jusqu'en 1526. En
février, suite à la déclaration de guerre de l'Angleterre et après
avoir mené des combats en Picardie, François 1er de retour à Paris
convoque une assemblée et harrangue le prévôt et les échevins pour
obtenir plus d'argent et 500 hommes de troupes. Le monarque français crée une charge de maître de
librairie qu'il
attribue
à Guillaume Budé (1467-1540), et que celui-ci occupera jusqu'à son décès. Dans Paris,
« le
quatrième jour de décembre, furent mis prisonniers dedans la Bastille,
de par le Roi, trois conseillers en la cour de Parlement. C'est à
savoir messieurs Virmaistre, docteur prêtre, Seguyer, aussi prêtre, et
monsieur Turquan, homme laïc ; et fut parce qu'ils avaient remontré au
chancelier Du Prat le désordre qui était à cause des emprunts que le
Roi faisait à Paris, qui étaient par trop excessifs ; et y furent
jusqu'au quatorzième jour du dit mois, et en furent mis hors à leurs
cautions ; dont on leur fît tort et à la cour de Parlement, mais ce fut
le chancelier de France qui leur fit ces choses de par le Roi. » (* Source Gallica-Bnf : Journal d'un bourgeois
de Paris sous le règne de François Ier, 1515-1536).
|
| 1523 : A
Paris, au mois d'août, le premier martyr huguenot et moine augustinien
Jean Vallières est brûlé au marché des pourceaux. François Rabelais est accusé par la Sorbonne d'hérésie. De
institutione feminae christianae
de Vivés est publiée.
|
| 1524 : En juin, sont « enrégimenteś les
vagabonds pour leur faire nettoyer
les fossés de la porte Saint-Honoré. » Le Parlement de Paris défend aux habitants d'apporter des vivres aux vagabonds emprisonnés et employés aux travaux publics. Le chevalier « sans
peur et sans
reproche » et Lieutenant général du
Dauphiné, Pierre Terrail de Bayard décède sur un champ de bataille,
près
de Rosavenda en Italie. Naissance de
Pierre de Ronsard et se produit une rupture des relations entre Érasme
et Luther. |
1525 : Le
roi après une bataille est fait prisonnier à Pavie (Italie). Louise de
Savoie en raison
de l'emprisonnement de François Ier en Italie - puis à Madrid - devient
la
régente, et
négocie un traité avec l'Angleterre d'Henri VIII. La reine-mère sera à
l'origine
de la libération de son fils contre deux de ses petits-enfants. Dans
Paris, il est interdit de jouer aux « quilles, contreboulle et
bille, » sous peine de la hart (la corde). Cette mesure d'interdiction
sera proclamée une nouvelle fois en 1560 incluant les jeux de dés. Le
prévôt des marchands de Paris déclare la même année : « Et faut nécessairement donner ordre que les gens de bien et d'état soient les plus forts et qu'ils dominent le menu peuple »
|
| 1526
: A Paris, le 17 janvier, un sieur Nicolas
est « par
arrêt de la cour brûlé au marché aux pourceaulx, parce qu'il avait
renié, blasphémé et maugréé Dieu et la glorieuse Vierge Marie.
» Traité
de Madrid, François 1er est
libéré, les états de Bourgogne qui devaient être cédés à Charles Quint
s'y refusent. C'est l'année de fondation des
Capucins en Italie, cet ordre prêche peu, il ne prend pas en charge
les confessions et les moines vivent en petite communauté sur des
principes de pauvreté. |
|
|
|
PERMISSION AU PRÉVÔT DE PARIS
DE COMMETTRE UN LIEUTENANT ET VINGT ARCHERS
POUR RECHERCHER LES VAGABONDS
ET GENS SANS AVEU QUI SE CACHENT À PARIS
 Francois, par la grâce de Dieu roi de France,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Francois, par la grâce de Dieu roi de France,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
« Comme nous avons été depuis longtemps avertis et informés qu'en nôtre
bonne ville et cité de Paris, faubourgs et banlieue de celle-ci, se
retiraient par chacun jour, grand nombre d'aventuriers et vagabonds,
oisifs et malvivants, en sorte que plusieurs larcins et pillages s'y
commettent, et plusieurs meurtres, forcements de filles, et autres
grandes insolences en procèdent, et soit ainsi que nôtre aimé et fidèle
conseiller, chambellan et premier gentilhomme de nôtre chambre, le
comte d'Estampes, bailli et prévôt de Paris, soit de présent et
ordinairement occupé près et alentour de nôtre personne en aucun nos
principales affaires, au moyen de quoi il ne savait vaquer et entendre
à chasser, punir et corriger ceux malversants (fauteurs) et vagabonds,
et que ses lieutenants au dit lieu n'ont la conduite de la force telle
qu'il serait requis et nécessaire pour l'exécution de tels actes, et
qu'un personnage bien nourri, instruit et adroit au fait des armes et à
la guerre pourrait avoir ; bien mémoratifs aussi, et records, que par
plusieurs fois nous a été remontré, par nôtre Cour de parlement, qu'il
était besoin que tinssions en la dite ville de Paris un gentilhomme
vertueux et de fait à faire les princes et exécutions des dits
aventuriers, vagabonds et malvivants, à quoi des lors eussions pourvu
et commis personnage à nous sûr et fiable, lequel gardât les habitants,
tant de la ville que dehors, de la vexation qu'ils avaient auparavant
des dits aventuriers et autres malvivants et en fait plusieurs exécuter
à mort, jusqu’à ce qu'il est puis naguère décédé en nôtre service, par
quoi soit très utile, requis et nécessaire, pour entretenir, préserver
et garder les bourgeois, échevins, manants et habitants de nôtre dite
bonne ville et cité de Paris à la meilleure sûreté et repos, donner
pouvoir et autorité a nôtre dit bailli et prévôt de Paris, qui à
présent est, et à ses successeurs prévôts du dit lieu, de commettre et
instituer un lieutenant, avec certain nombre d'archers pour
l'accompagner, qui ne s'entremettront du fait de la justice, ainsi
seulement de visiter par jour les lieux et places de la dite ville,
carrefours, cabarets, maisons, tavernes et autres endroits dissolus ou
tels gens malvivants (de mauvaise vie), vagabonds et sans aveu ont
accoutumé converser et eux retirer, et lesquels archers seraient
ordonnés au dit bailli et prévôt pour ordinairement l'accompagner, et
en son absence le dit lieutenant de robe courte, montés et armés de
hacquebutes (petits canons), javelines (armes de jet), brigandines
(armures) ou autres harnais à la discrétion et ordonnance du dit bailli
et prévôt, pour avec le dit lieutenant vaquer et entendre ordinairement
aux choses dessus dites, selon nôtre vouloir et intention ; savoir
faisons que nous, désirant nôtre dite bonne ville, cité, faubourgs et
banlieue de Paris, et les environs de celle-ci, être et demeurer en
bonne sûreté, repos et pacification, et la soulager du travail, ennui
et suggestion que chacun jour peuvent venir et procéder de ceux
aventuriers, vagabonds et malvivants, pour ces causes et autres bonnes
raisons et considérations à ce nous mouvants, avons au dit comte
d'Etampes, bailli et prévôt de Paris, et à ses successeurs prévôts du
dit lieu, donné et donnons par ces présentes plein pouvoir, puissance
et autorité, de commettre et députer un lieutenant de robe courte,
vertueux et bon personnage, nourri et expérimenté au fait de la guerre
et des armes pour visiter par chacun jour accompagné de vingt archers,
qui pour ce y avons commis, ordonnés et établis, commettons, ordonnons
et établissons par ces dites présentes, les rues, carrefours, tavernes,
cabarets et autres maisons dissolues ou ont accoutumé se retirer ceux
vagabonds, oisifs, malvivants, gens sans aveu (sans foi, ni loi),
joueurs de cartes et de des quilles et autres jeux prohibés et
défendus, blasphémateurs du nom de Dieu, ruffians (hommes débauchés),
mendiants sains de leurs corps, pouvant autrement gagner leur vie, et
gens qui seront trouvez en présent méfait, pour les dits vagabonds,
malvivants, joueurs, blasphémateurs, et autres dessus dits, prendre au
corps par le dit lieutenant et archers ; et auquel lieutenant, ainsi
par le dit bailli et prévôt commis, et ses dits successeurs, nous avons
donné et donnons pouvoir et autorité de ce faire, et ceux-ci mener et
faire mettre en prisons du Châtelet de Paris, pour en être faite la
justice et punition par le dit prévôt, ou son lieu-tenant criminel,
telle que de raison, et avec ce aura pouvoir et puissance celui-ci
lieutenant d'exécuter tous mandements, lettres et commissions portant
main forte, soit de nôtre chancellerie ou de nôtre Parlement, et toutes
autres qui leur seront adressées, exerçant continuellement son office
et commission sans soi longuement absenter de nôtre dite bonne ville de
Paris ; et pourra davantage, en cas de plus grande nécessité et
contrainte, pour l'exécution des choses dessus dites, appeler au dedans
nôtre dite bonne ville et dehors, selon que les choses le requièrent,
les vingt quatre sergents des douzaines du bailliage et prévôté, et
autre telle et si grande assemblée de gens, pour sa force, que bon lui
semblera, et que besoin sera, outre les dits vingt archers, lesquels y
seront ores (maintenant) et pour l'avenir, quant vacation y échoira,
mis, établis et institués par ledit prévôt et ses dits successeurs,
sans ce que leur soit besoin avoir de nous, avec les lettres du don de
nôtre dit prévôt, autres lettres que cette nôtre présente déclaration
et ordonnance, aux gages et pension qui seront ci-après par nous
ordonnés au dit lieutenant, et les dits vingt archers, et ce pour faire
assister et exercer les choses dessus dit.
Si donnons en mandement par ces dits présentes à nos aimés et féaux les
gens de nôtre Cour de parlement au dit Paris, et à tous nos autres
justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants, présents et avenir, et
à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes
lettres, ordonnances et déclaration, et de tout l'effet et contenu en
celles-ci, ils fassent, souffrent et laissent les dits bailli et
prévôt, son lieutenant et archers susdit, jouir et user patiemment et
paisiblement, sans, en ce, leur donner ne souffrir donner aucun trouble
ou empêchement ; et celles-ci fassent lire et enregistrer en nos dites
cours, chacun en son endroit, en la forme et manière accoutumée, car
tel est notre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, et nôtre ordonnance par laquelle est dit que les baillis
et sénéchaux de nôtre royaume n'auront que deux Lieutenants, l'un
général et l'autre particulier, à laquelle quant à ce avons dérogé et
dérogeons, et sans préjudice de celles-ci, en toutes choses et
quelconques autres ordonnances, restrictions, mandements ou défenses à
ces contraires. En témoin de ce, nous avons fait mettre nôtre sceau à
ses dites présentes. »
Donné a Cognac, le septième jour de mai,
l'an de grâce mille-cinq-cent-vingt-six, et de nôtre règne le douzième.
Sic signatum (ainsi signé) : Par le roi.
NB : le texte a été mis dans un français plus moderne, texte original en source.
|
|
Source : Gallica-Bnf, Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier.
Levasseur, Émile. Pages 232 à 234, tome 4. Éditeur : Impr. nationale (Paris,1902-1940)
|
|
|
|
| 1527 :
La septième guerre d'Italie est déclenchée par Charles Quint et
naissance de Philippe II. La ville de Rome est pillée pendant un mois
et le pape Clément VII se réfugie au château fortifié Saint-Ange, et le
ghetto juif est ravagé. A Florence, les Médicis sont renversés et la
République proclamée. Le Parlement de Paris ordonne la confiscation des
biens du duc Charles de Bourbon, décédé lors de l'attaque de Rome.
Mexique, colonie de l'Empire hispanique tous les livres aztèques sont
détruits (autodafé). |
| 1528 : Paris
redevient la capitale politique ou administrative du royaume de France
jusqu'en 1682 avant de partir à Versailles, sauf une courte parenthèse
de 1594 à 1598 de nouveau à Tours. François
Ier engage la destruction de la vieille forteresse de Philippe
Auguste, rénovée par Charles V, le donjon est détruit et il lance ainsi
l'édification du nouveau
Louvre : «
Connaissant
notre chastel du Louvre être un lieu plus commode et à propos pour nous
loger, à cette cause avons délibéré faire réparer et mettre en ordre le
dit chastel ». Le roi s'y installera avec la cour en 1534 et
les
travaux s'achèveront sous Napoléon III (consultez cette
vidéo de 2 minutes sur les différentes constructions ou ailes du Louvre
: Cliquez ici). Ignace
de Loloya arrive à Paris pour étudier. Le château de Fontainebleau est
en partie détruit et
reconstruit, et celui de Madrid dans le bois de Boulogne est en voie
d'édification. |
1529 : Suite
à de mauvaises récoltes et la hausse des prix du blé, à
Lyon éclate fin avril la "grande rebeyne" (émeute), qui est une révolte
frumentaire (ou de la faim) d'un millier de personnes. Les meneurs
seront pendus ou envoyés aux galères. En août, la paix de Cambrai
est approuvée et contresignée par Louise de Savoie pour son fils
François Ier, et Marguerite d'Autriche pour son neveu Charles
Quint. Le 16 août des lettres patentes du roi (ci-contre)
ordonnent l'exécution de la bulle pontificale, qui prescrit la levée de
quatre décimes sur les biens ecclésiastiques pour la rançon du Dauphin
et du duc d'Orléans, retenus en otage par Charles-Quint. Guillaume Budé fait éditer les Commentarii
linguae graecae.
Ignace de Loyola rencontre Pierre Favre et
François-Xavier à Paris. Le 21 octobre les frères Jean et Raoul Parmentier arrivent à Sumatra (actuelle Indonésie) avec deux navires armés par Jean Ango de la ville de Dieppe.
|
|
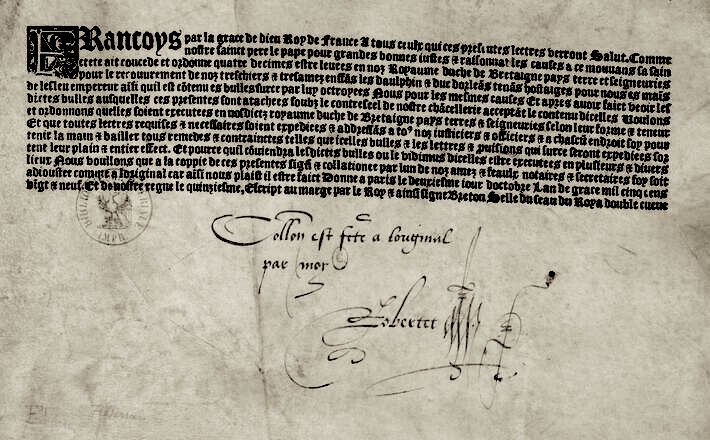 |
|
| 1530
: Fondation
de l'Institution du Collège royal par Guillaume
Budé, libraire de François 1er.
Le 4 juillet, le roi épouse la sœur de l'empereur Charles
Quint, Eleonore de la dynastie des Habsbourg (Saint Empire et Espagne).
C'est le retour en
France des deux enfants, Henri et
François, les fils de François Ier retenus prisonniers en échange de leur père et libérés
contre 2 millions d'écus.
|
|
 |
|
Plan de Paris
de 1530
de Georg
Braun
La rive Nord est à gauche
&
La rive sud
est à droite :
Lutetia vulgari nomine
Paris, urs Galliae maxima, Sequana navigabili flumine irrigatur, nobili
gente, mercator, frequentia universitate excellente stupendi operis
templo B. Mariae, Palatio Regio aliisque praestantissimis aedificiis
|
|
|
| 1531
:
En février, le royaume anglais rompt ses liens avec Rome, c'est la
naissance de
l'anglicanisme, Henri VIII devient le chef suprême de l'Eglise
d'Angleterre. La mère du roi Louise de Savoie décède en
septembre. Marguerite de Navarre, la soeur du roi publie Le Miroir de l’âme pécheresse. Et
sont annoncées dans la capitale Les Ordonnances faites et publiées à son de trompe
par les carrefours
de cette ville de Paris pour éviter le danger de peste : « De
même est enjoint très-expressément dorénavant et pour l'avenir, à
toutes personnes quelconques et de quelque état qu'elles soient de ne
vider et mettre en plein de rue aucunes, (...) charges de charrettes, boues, ou autres
immondices, » etc.
L'épidémie perdurera jusqu'en 1533 et l'ordonnance ne sera pas
appliquée.
|
| 1532
: Un
arrêt du 22 avril impose une aumône volontaire pour les "pôvres", en
son article 6, dans chaque paroisse des quêtes publiques doivent se
mettre en oeuvre, et il est demandé aux « prélats
et autres gens d’église et tous autres qui ont accoutumé de faire
aumônes et charités publiques et secrètes de bailler ce qu’ils voudront
et auront dévotion de donner par charité et aumônes aux pauvres. » A
Paris, il est fait défense «
à tous ceux qui manient deniers et
finances du roi de jouer à aucun jeu, sous peine de privation de leurs
offices, d'être fustigés et bannis ».
La
première pierre est posée par le prévôt des marchands, Jean (II) de la
Barre, pour la construction de l'église Saint-Eustache (actuel
1er arrondissement). C'est la naissance à
Paris du mouvement de
Réforme de Jean Calvin. Est formalisée l'union administrative
de la Bretagne au royaume de France. Gilles
Corrozet historien de Paris publie La
Fleur des antiquitez,
singularitez et excellences de la plus que noble et triomphante ville
et cité de Paris avec la généalogie du roy Françoys premier de ce nom ...
|
| 1533 :
Faute d'aumone volontaire suffisante, il est pris un arrêt qui demade
aux chapitres et couvents de la capitale de nourir les pauvres, sous
peine de voir leurs biens confisqués. Le 15 juillet, la première pierre
est
posée pour la
construction d'un nouvel Hôtel-de-Ville, en remplacement de l'ancien
devenu trop exigu (il était nommé
Le parloir aux bourgeois
et
se situait au 20, rue Soufflot, où a été apposée une plaque). Catherine
de Médicis épouse le futur dauphin Henri. Devant un grand nombre de morts de
la peste, la Ville ou prévôté de Paris est dans l'obligation
d'acheter 6 arpents
(environ 2 hectares) de terre pour enterrer les morts dans la plaine de
Grenelle. Le poète et valet de chambre du
roi,
Clément Marot (1496-1544) fait publier Les
œuvres de Françoys Villon,
par l'éditeur Galiot du Pré.
|
| 1534 :
A
l'initiative d'Ignace de Loyola, sept étudiants du collège
Sainte-Barbe prononcent leurs vœux de pauvreté et chasteté, dont
Pierre
Favre, Savoyard et (saint) François-Xavier, Navarrois (1506-1552), le
15 août dans la
crypte de Saint-Denis à
Montmartre. Ils créent ainsi la Compagnie
de Jésus. Affaire des placards
: des écrits
injurieux et séditieux sont collés sur
les murs de la capitale et d'autres villes (17 et 18 octobre). Henri VIII devient en
novembre le chef spirituel de
l'Église d'Angleterre par l'Acte
de Suprématie.
Le navigateur
Jacques Cartier entreprend son premier voyage vers le continent
américain. Etienne Dolet quitte Lyon pour rejoindre Paris. Dans la
capitale, du mois de
novembre de l'année en cours à mai 1535, 22 personnes sont brûlées
place Maubert pour
hérésie. L'hôpital des Enfants-Dieu,
est créé rue Portefoin (actuel 3ème
arrond.), par
le roi à la demande de Marguerite de
Navarre, il a pour but de secourir les
orphelins de parents morts à l'Hôtel-Dieu, surnommés les Enfants-rouges, en raison de leur
vêtement en drap rouge, ainsi que le nom d'une rue de la ville depuis
disparue. Gargantua
de Rabelais est édité par François Juste.
Est aussi imprimé le premier
traité réformateur en langue française
de l'institution de la
Religion Chrétienne de Jean Calvin (1509-1564) et achèvement
de la
traduction de la Bible par Martin Luther. |
|

|
|
| 1535 : Le 5 mars, est signé un traité d'alliance
avec
Soliman dit le Magnifique (1494-1566), souverain de l'empire
Turc ou Ottoman présent en Europe de l'Est depuis le XIIIe siècle, et
qui va déboucher sur l'ouverture d'ambassades et d'échanges
commerciaux. A Constantinople
s'ouvre une ambassade et une chapelle française et sont accordés des
privilèges commerciaux dans l'empire Ottoman (et ouvre à l'autre voie
des épices). Un
édit royal prohibe l'imprimerie et les
librairies, la mesure est abandonnée un mois plus tard, parce
qu'inapplicable. François Ier signe l'ordonnance d'Is-sur-Tille (Bourgogne), il est précisé
que les actes doivent être rédigés « en
français ou à tout le moins en (langue) vulgaire du dit pays ». L'ambassadeur vénitien Giustiniano écrit que « Paris n'est guère plus vaste que Venise,
et on en fait le tour en trois heures, en allant à pied et assez
doucement ». Le 6 juillet, l'ancien lord chancelier Thomas More est décapité sur ordre du roi Henri VIII à la Tour de Londres. |
1536
: La compétence des prévôts avec la déclaration du 25
janvier est étendue à certains crimes et visent : «
les gens de guerre de cheval et de pied, de nos ordonnances, et autres
vagabonds et domiciliés... tenant les champs, pillant, robant
(dérobant) leurs
hôtes, forçant et violant femmes et filles, détruisant et
meurtrissant les paysans... soit qu'ils aient domiciles ou se fussent
retirés en ceux-ci, où qu'ils fussent errants ou vagabonds ». Un édit du 6 juillet ordonne la levée d'un impôt de 12.000 livres sur les habitants de Paris, pour « subvenir à la nourriture et soulagement des pauvres. » L'édit du
30 août ordonne que les
mendiants valides « seront
contraints de labourer et besogner pour
gagner leur vie ; »
s'ils s'y refusent, ils seront punis du fouet. Les Parisiens apprennent
l'entrée en France de l'armée impériale. Ordre est donné de
construire des tranchées, des fossés et des boulevards sur tout le
périmètre de la rive droite sous la conduite de l'architecte
Boccador. Le fils aîné du roi, François de
France décède, son
frère
Henri d'Orléans devient dauphin. Le philosophe Erasme décède à Bâle (Suisse). Et décés au château de Tournon du dauphin François de France, le titre passe à Henri.
|
| 1537
: Un édit depuis Montpellier est signé
par François 1er,
le 28 décembre, il est promulgué que pour tout imprimeur ou éditeur
est dans l'obligation de déposer au château de Blois l'ensemble de
leurs
publications (début du contrôle du contenu des éditions et des
censures légales). Michel de l'Hospital (vers 1503-1573) acquiert un
office de conseiller auprès du Parlement de Paris, il est issu d’une
famille de marranes (juifs convertis) expulsés d’Espagne. Depuis Rome,
le pape Paul III condamne l'esclavage des Indiens (par la bulle Sublimis deus puis par la lettre Veritas ipsa). |
1538 : Les
récoltes dans le bassin Parisien sont
mauvaises. Anne
de Montmonrency (1493-1567) est nommé connetable de France (commandant
en chef des armées du roi). En juin est conclu un traité de paix dit de
Nice entre François 1er et Charles Quint sous l'égide du pape Paul III.
A Paris, à la mi-juillet la foudre s'abat sur la tour de Billy, et
touche par la même occasion les munitions qui y sont entreposées, cette
tour datant des enceintes de Charles V est totalement détruite par
l'explosion (l'édifice se situait à proximité de la Seine au lieu dit
de l'Arsenal, proche de la Bastille).
|
|
 |
|
1539 : A Lyon et Paris surviennent des grèves. Il est signé
un édit contre les Réformés,
et publication en France de l'Atlas en projection planisphérique, le
plan Mercator (ci-dessus). Étienne de la Boétie
nait près de la
ville de Bordeaux. Le
théologien et dominicain Matthieu Ory (1482-1557) est nommé inquisiteur
de Paris. Comme répercution de l'Affaire des placards, le roi signe un édit, où l'état
s'approprie le monopole de l'affichage et « interdit l'arrachage sous peine de
punition corporelle » le 13 novembre. En août,
l'ordonnance générale sur le fait de
justice, police et finances de Villers-Cotterêt préparée par son
chancelier Guillaume Poyet est paraphée par François
1er, il y est question à l'article 51 des
actes de baptême (ce qui était jusqu'alors presque inexistant, soit un
tout début d'état-civil, mais sous la
conduite des paroisses),
à l'article 168, il est fait état de la légitime défense, et aussi à la
"langue maternelle française", qui ainsi remplace le latin dans les
actes officiels. Les deux articles parmi plus
d'une centaine précisent :
article
110. Afin
qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts de nos
cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et
écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir ambiguïté ou
incertitude, ni lieu à demander interprétation.
art.
111. Nous
voulons donc que dorénavant tous arrêts, et ensemble toutes autres
procédures, soient de nos cours souveraines ou autres subalternes et
inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, testaments et
autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent,
soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage
maternel "françoys" et non autrement. (mis en français moderne)
|
|
| 1540 : Charles
Quint doit se rendre à Gand, François 1er invite son beau-frère à
traverser la France et le convie à Paris pour obtenir ses faveurs (peinture ci-contre). Les
deux
monarques entrent dans la capitale le 1er janvier. En mars, à son retour en Espagne Bartolomé Las Casas revient dénoncer les crimes commis contre les Amérindiens. En juin
est promulgué l'édit de Fontainebleau contre les Luthériens, ils sont
proscrits du royaume. La fondation de la
Compagnie de Jésus
est reconnue par le pape Paul III. Edition
et impression à Lyon de La
manière de bien traduire d'une langue en
aultre d'Étienne Dolet. |
|
 |
|
|
| 1541 : Ignace de Loyola devient le premier Supérieur
général des Jésuites. Le peintre de cour Jean Clouet, père de
François, et originaire du Hainaut (Belgique actuelle) décède à Paris.
L'Institution Chrétienne de Jean
Calvin est traduite en français par lui-même de l'édition latine de
1539 (première édition à Bâle en latin en 1536, il y en aura plusieurs
et des versions plus nombreuses en chapitres jusqu'en 1559). |
| 1542
: Le pape Paul III en réponse aux thèses de Martin Luther
convoque le concile dit de Trente au mois de
mai, l'événement
le plus déterminant du siècle et mis en pratique à partir du XVIIe
siècle dans la "reconquête des esprits" ou sous l'empreinte du
classicisme. Un
édit royal du 7 juillet ordonne aux curés de dénoncer
publiquement les Luthériens, ou ceux et celles qui niaient le
purgatoire, les saints et leurs miracles, et d'avertir leurs fidèles
dans les
paroisses. Des révoltes éclatent contre la gabelle en Aunis, Saintonge
et Guyenne, elles sont réprimées par François 1er, qui fait son
entrée à La Rochelle fin décembre. La Guerre en Italie redémarre,
neuvième conflit (jusqu'en 1544). Et sont
édités Pantagruel,
roy des dipsodes etc. et de La
Vie très honorifique du grand Gargantua, etc. de
François Rabelais, à Lyon. Ainsi que la première traduction de la Vie de Demetrios
(manuscrit) du moraliste grec Plutarque (vers 46 - vers 120) par
Jacques Amyot, enseignant, maître de librairie, évêque et précepteur
des enfants d'Henri II. Ses traductions de l'oeuvre de Plutarque auront
une influence certaine pour Michel de Montaigne, et ses vifs
remerciements. |
1543 : Dans
la capitale, les halles marchandes en rive droite sont entièrement
reconstruites (jusqu'en 1572). La couronne a racheté tout
l'emplacement, puis l'a revendu par lots, exigeant des acquéreurs que
les bâtiments nouveaux soient construits suivant les plans adoptés par
la ville. En
août, le corsaire Barberousse et sultan de Tunis, au service de Soliman
Ier, et ses troupes attaquent et assiègent la ville de Nice, dépendant
du duché de Savoie. Barberousse et ses hommes prennent leur hivernage à
Toulon et le roi François Ier invite le corsaire à dîner. Publication
un peu avant
son décès de De revolutionibus orbium coelestium (Des
révolutions des sphères célestes) de l'astronome polonais Nicolas
Copernic (document en latin).
|
|  |
|
1544
:
Le 19 janvier, c'est la naissance du dauphin François à Fontainebleau. A la fin du mois de mai, le corsaire Barberousse
quitte la côte d'azur après avoir reçu de François Ier un dédomagement
et pillé sur son passage. Par lettres
patentes du roi du 7
novembre, le Grand Bureau des pauvres
est fondé à Paris, il a pour but de réorganiser la mendicité, de
distribuer des aumônes, d'apporter de l'aide
aux malades et aux insensés, de donner
du labeur aux démunis ou indigents, voire d'imposer du travail. Les
pouvoirs sont délégués au Prévôt des marchands, jusqu'alors de la
compétence du Parlement ; et les plus aisés de la capitale sont taxés
pour assurer le budget de fonctionnement de cette nouvelle
institution. Le Grand Bureau des
pauvres aura pour charge deux hôpitaux, en 1545 celui de la Trinité
en rive nord (rue St-Denis) consacré aux enfants et des Petites Maisons
au sud de Paris en 1557 pour les insensés (actuel 7ème arrond.) à
l'emplacement d'une ancienne maladrerie (ou léproserie). Son activité perdurera
jusqu'à la Révolution de 1789 avant de devenir le "Bureau de
la charité". Il est décidé le déménagement et la réunion à
Fontainebleau de deux bibliothèques royales, environ 2.000 ouvrages
dans un
cabinet privé du château (l'autre bibiliothèque était à Blois). Pierre Lescot architecte,
sous sa direction et ses plans
est contruit l'hôtel Carnavalet.
|
| 1545
: La
déclaration du 16 janvier veut que, par préférence à tous autres,
les pauvres soient employés aux travaux de la ville, et y fassent «
bonnes et entières journées, étant payés des premiers et plus
clairs deniers de la dite ville ». « François Ier, à la suite
d’une
broutille, prit le fameux arrêt de Mérindol, qui visait à arrêter,
juger puis brûler, vifs et en public, dix-neuf habitants de Mérindol.
L’arrêt fut pris le 18 novembre 1540, mais ne fut “exécuté” qu’en avril
1545. Les troupes du sinistre Jean Meynier, baron d’Oppède, en ont
d’ailleurs largement extrapolé les termes, et ont littéralement réglé
leur compte aux Vaudois du Luberon (document
radiophonique),
avec une barbarie inouïe... ». Se tient
la
première session du Concile
de Trente
(sur 25) et le lancement de la Contre-Réforme catholique (fin des
travaux dits œcuméniques en 1563). Le corsaire Barberousse décède à 70
ans. Publication à Paris de la Méthode pour traicter les plaies etc.
d'Ambroise Paré. |
1546 :
Après deux années de procès et de
prison à la Conciergerie,
Étienne Dolet, écrivain, imprimeur et philologue est reconnu coupable
de blasphème, de sédition, et il est condamné à la damnation pour ses écrits par le
Parlement de Paris. Le 3 août, le poète est étranglé et brûlé vif
en place Maubert (actuel 5ème arrondissement) avec ses ouvrages. Le
libre penseur Dolet aurait dit avant de mourir : « Non pie turba
dolet
sed Dolet ipse dolet, ou «
Non, ce n'est pas Dolet qui gémit sur
lui-même, mais ce bon peuple ».
Une statue sera édifiée par la
Ville
de Paris en son honneur en 1889 sur cette même place parisienne (et une
conférence à la mairie du Ve arrondissement) : Étienne Dolet : sa vie,
ses oeuvres, son martyre (39 pages) par le docteur
Bourneville. A Meaux, au sein de la
communauté réformée après un office religieux 40
personnes sont arrêtées sur 400 fidèles, et se tient un procès à Paris, 14 d'entre-eux
sont ramenés à Meaux et brûlés sur la place du Marché (plaque dans le
temple actuel). Pierre
Lescot est désigné comme surintendant
du Louvre par lettres patentes, on lui doit aussi plusieurs
réalisations et constructions dans Paris, et le style d'architecture
classique à la française.
|
| 1547 : François Ier meurt en
mars à Rambouillet, le 31 mars de la syphilis ou de la vérole (voire
grande ou petite vérole). La
rénovation du Louvre est entreprise par l'architecte Pierre Lescot,
fils de l'ancien Prévôt de Paris (1518-1520), portant le même prénom
que son père (ce qui était très fréquent).
Et il
deviendra moine dix ans après, Lescot
restera au service des monarques successifs jusquà sa disparition en
1578, puis sera enterré dans une des chapelles
de la cathédrale de Notre-Dame. Michel de l'Hospital est envoyé par le nouveau roi
Henri II comme ambassadeur au concile de Trente. La population du
royaume est estimée à 17 millions de personnes.
Est édité, Le
Tiers Livre des Faictz & Dictz Héroïques du noble Pantagruel de
Rabelais. |
|
|
|
Réglementation
ou réorganisation de
l'ancienne Police
Le Guet de Paris sous
François 1er
(ou milice bourgeoise)
d'après René
Lespinasse
|  |
« Le Guet (ou celui qui surveille ou tient la garde) prend date sous
Hugues Capet au XIe siècle, son origine remonte
à l'empire romain. La police dit du "Guet
de Paris" est à distinguer du
"Guet royal" pour son autorité
tutélaire ou directe. Dans la capitale
la
protection et surveillance sont dévolues à une milice bourgeoise depuis
Louis IX. Cette police encore embryonnaire a été particulièrement
détestée par
les parisiens pauvres, et marginaux, et bourgeois inclus. Ces derniers
étaient réquisitionnés ou pas selon les critères établis au fil des
siècles, pour défendre et surveiller les remparts de nuit de comme de
jour, comme les entrées dans la cité, et assurer si nécessaire la
tranquillité
ou la sûreté des urbains.
Une administration connue pour avoir été l’objet
de nombreuses plaintes, grognes ou colères contre sa forte corruption
ou la tentation d'y échapper, voire de s'en prémunir dans ses aspects
louches ou délictueux. Elle était aussi rattachée à la justice du
"Chastelet", un tribunal servant aussi de lieu de dépôt des
contrevenants. La police de la capitale avec ses guets "assis ou
dormants", plus ses
sergents, lieutenants et le chef ou "chevalier du Guet" (créé par louis
IX), cette
administration se restructure difficilement sous le règne de François
1er, la présente ordonnance est datée de janvier 1540 depuis
Saint-Quentin
(dans l’Aisne).
Cet édit sera supprimé sous henri II en 1559 et
laissera place à l'Édit
de Henri II portant suppression du guet des gens de métier,
établissement d'un corps spécial d'hommes d'armes, et fixation d'une
imposition particulière pour le guet sur tous les artisans, sans tenir
compte des anciens privilèges, selon René de Lespinasse. »
Edit du roi
François 1er sur les règlements du
guet des gens de métier, à faire la nuit dans les seize
quartiers de la
ville de Paris, avec des prescriptions spéciales pour assurer une
meilleure exécution du service.
« François par la
grâce de Dieu, roi de France (1), comme pour la continuation du dit
guet ont été faîtes plusieurs ordonnances et sont intervenus plusieurs
arrêts au moyen des fautes trouvées en l'exercice et fait du dit guet.
Ce néanmoins ont été et sont faits plusieurs abus fautes et
négligences, en ce que dit est, tant par les officiers que par autres,
ayants la charge du dit guet et au moyen de ce nôtre peuple fort foulé
(piétiné ou écrasé) et travaillé, à notre très grand regret. (sic)
1. Pour ces causes, et pour la
conservation de notre dite ville et cité de Paris et des habitants de
celle-ci et aussi pour obéir aux inconvénients dessus dits et pourvoir
à l'entretien des dites ordonnances et arrêts sur ce intervenus, nous
avons statué et ordonné, statuons et ordonnons - que le guet de cette
ville sera fait et constitué, c'est a savoir (c'est-à-dire) par le
chevalier du dit guet et sa compagnie, qui sont vingt hommes de cheval,
et quarante hommes de pied, en ce compris le lieutenant celui-ci
chevalier (noble), pour faire le dit guet, par dix hommes à cheval, et
vingt hommes de pied, en chacune nuit, par tour et alternativement.
2. Item (idem), que le guet
assis, autrement appelé le guet dormant,
fait par les gens de métier de la dite ville de Paris, sera
pareillement continué les nuits qui seront commandées par deux
sergents, en la manière accoutumée. Et seront les dits gens de
métier
tenus eux présenter, dedans le Châtelet de Paris, pour être enregistrés
et envoyés par nombre de personnes certain et compétant, à la place des
carreaux, outre le guichet des prisons, comme au lieu appelé la pierre
qui est a la barrière et alentour du dit Châtelet, pour la garde
des
prisonniers, du geôlier et de ses gens et aussi dedans la cour du
palais, pour la garde des saintes reliques du geôlier, des prisonniers
et des choses qui sont dedans le dit palais, et pareillement au
carrefour du bout du pont Saint Michel, sur le quai des Augustins, et
au carrefour de Saint-Côme, au carrefour de Saint-Yves, au carrefour
Saint Benoît, a la croix des Carmes, au carrefour Saint Séverin, au
Petit-Pont, près l'église de la Madeleine, aux planches de Mibray, à la
croix de Grève, à l'hôtel de Sens, à la porte Baudier, au coin
Saint-Paul, à la traverse Quadier, a l'échelle du Temple, à
Saint-Nicolas-des-champs, à Saint-Jacques de l'hôpital, à la fontaine
Saint-Innocent, à la pointe Saint-Eustache, à la croix du Tiroir, à
l'école Saint-Germain, à la place aux Chats (2), et aussi les autres
lieux et places nécessaires, par les seize quartiers de la ville de
Paris ; seront déclarés par chacun jour aux dits gens de métier par les
clercs du dit guet, selon l'ordonnance qui leur en sera faite par
notre prévôt de Paris ou soit lieutenant criminel, qui pourra
muer et changer les dites places et augmenter le dit guet, selon les
cas et nécessités qui viendront à connaissance.
3. Lesquels lieux et places, les
dits gens de métier seront tenus demeurer et eux tenir toute la nuit,
par les temps et saisons ci-après déclarés, c'est à savoir
(c’est-à-dire) depuis le premier jour du mois d'octobre jusqu’au
dernier jour de mars, à commencer entre sept et huit heures du soir,
jusque entre quatre et cinq heures du matin; et depuis le premier jour
d'avril jusqu’au dernier jour de septembre, à commencer entre huit et
neuf heures, jusque entre trois et quatre heures du matin.
4. Et pour faire l'assiette et
la retraite de ce guet, sera tenu celui qui a charge de la guette
(endroit d'où l'on surveille) du dit Châtelet, de sonner la trompette
par chacune nuit, selon les heures dessus dites. Et après ladite
trompette sonnée, le dit guet partira pour marcher et se retirera, et
non plutôt ; toutefois en cas nécessaire et urgent le guet royal
pourra partir plus tôt, selon qu'il sera pour le mieux avisé.
5. Item (idem), que pour faire
registre des gens du dit guet tant royal que des gens de métier, seront
tenus les dits clercs du guet assister par chacun jour au dit Châtelet,
aux heures assignées pour l'assiette de celui guet, et faire registre
des comparants et défaillants. Et seront les dits gens du guet,
tant du Roi que des métiers, tenus de comparoir (se présenter ou
comparaître) à faire le dit guet aux jours et heures à eux assignés,
selon que dessus, sur peine de dix sols parisis d'amende, pour chacun
défaut; pour laquelle amende seront les défaillants contraints dès le
lendemain du défaut qui sera expédié, sur le rôle et certification des
dits clercs du guet et sur le rapport du sergent qui aura donné
l'assignation : Et ce tant par prise et vente sommaire des biens
de ceux défaillants, que par emprisonnement de leurs personnes, si
métier est.
6. Et afin que le dit guet assis
ne puisse partir des dits lieux et places, avant les heures dessus
dites, nous ordonnons que le dit guet royal ira et viendra les dites
places, pour savoir ceux du dit guet assis qui serviront ou
défendront. Et de ce (ceci ou cela) le dit chevalier du guet et ses
lieutenants feront rapport qui sera enregistré par les dits clercs,
pour être procédé contre les dits défaillants, et qui se seront
absentés, selon que dessus; et afin de savoir ceux qui se seront ainsi
absentés, enjoignons aux autres qui auront été livrés avec eux, de le
relever, sur (sous) peine de prison et de l'amende.
7. Toutefois si les dits gens de
métier ont excusation (excuses) de maladie, d'absence, de mariage ou
autre exoine (ou essoine : empêchement) recevable, les dits clercs du
guet commettront autres personnes fidèles et suffisantes, et dont les
dits clercs seront responsables, pour faire guet au lieu des absents,
tant défaillants qu'excusés, et seront payés ceux qui serviront, au
lieu de ceux qui auront fait défaut, sur les dits défauts et amendes.
Et pour les autres ils seront payés aux dépens des excusés, le tout au
prix de deux sols parisis pour chacune nuit, et s'il advenait que, pour
aucune cause nécessaire, fut besoin assembler plus grand nombre de
gens, le dit chevalier du guet ou ses lieutenants pourront appeler avec
eux la totalité de gens du guet royal avec les gens de métier, en
nombre compétant et raisonnables.
8. Et pour ce que par ci-devant
plusieurs personnes se sont voulu exempter de servir audit guet, les
aucuns (certains) alléguant privilèges, et les autres disants n'être
point de métier, et, par ce, le dit guet a été diminué, et le peuple
qui a servi au dit guet foulé et trop chargé, nous ordonnons que tous
marchands gens de métier, artisans ou autres tenants boutiques et
ouvroirs, dedans la dite ville de Paris, seront tenus et contraints de
servir audit guet, par la manière et ainsi que dessus est déclaré,
soient exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, jusqu’à
ce que par nous autrement en soit ordonné exceptés toutefois les
personnes qui ont été excusées par l'arrêt donné en nôtre cour de
Parlement, en l’an 1484, c'est à savoir les six vingt archers, soixante
arbalétriers, et cent arquebusiers de nous et de la ville de Paris,
gardes des clefs des portes, ceux qui ont le rouet des chaînes,
quarteniers, dizainiers, cinquanteniers de ladite ville de Paris,
bedeaux ordinaires de l'Université de Paris, messagers de nous et de la
dite Université, durant leurs absences, monnayer pour le temps qu'on
œuvre à la monnaie et les personnes âgés de soixante ans ou qu'ils
aient meshaings (blessures graves) ou mutilation de membres, dont soit
apparu a nôtre dit prévôt de Paris ou son dit lieutenant : toutes
lesquelles personnes nous voulons et entendons être francs et exempts
d'aller audit guet, selon le dit arrêt.
9. Item, nous ordonnons que les
deniers des dits défauts amende et autres qui proviendront, à cause de
ce que dit est, seront levés et reçus par les dits deux sergents,
lesquels seront tenus rendre compte par chacun an d'eux deniers à notre
receveur de Paris appelle notre procureur au dit Châtelet. Et
enjoignons aux dits gens du guet, tant royal que des gens de métier, de
biens et dûment vaquer à faire celui guet, selon ce que dessus et de
faire les captions (arrestations) des malfaiteurs qu'ils trouveront en
présent méfait et les emprisonner au dit Châtelet ; et aussi de
traiter humainement les habitants de la ville de Paris, et leur donner
confort et aide sans leur faire ne souffrir être fait aucun opprobre ou
moleste (gêne), le tout sur peine de punition corporelle.
10. Et pour faire entretenir le
contenu ci-dessus et ce qui en dépend, enjoignons au dit prévôt de
Paris ou son lieutenant criminel, d’y entendre soigneusement et
contraindre les dits gens et officiers tant de guet royal, que de
métiers et toutes autres personnes. Savoir est; les dits officiers, sur
peine de privation de leurs offices, et les autres par amende et
punition corporelle, selon l'exigence des cas, le tout nonobstant
oppositions ou appellations quelconques.
11. Et pour ce que le dit prévôt
de Paris ou son dit lieutenant ne pourra vaquer a l'assiette dudit
guet, en faisant laquelle se sont par ci-devant faits plusieurs excès,
rebellions et désobéissances, par les dits gens de métier, tant entre
eux que pour les haines qu'ils ont les uns contre les autres, comme
aussi à l'encontre des clercs et officiers du dit guet, le dit
prévôt de Paris ou son dit lieutenant criminel pourra commettre l'un
des examinateurs du Châtelet pour informer promptement et faire son
rapport, et aussi (si métier est) pour procéder par emprisonnement
contre les rebelles et délinquants, en présent méfait, afin d'y
être pourvu sommairement par nôtre dit prévôt de Paris ou son
lieutenant criminel.
12. Et ordonnons que les dits
clercs du guet, sergents et examinateurs seront payés pour l'exécution
des choses dessus dites, c'est à savoir les dits sergents et
collecteurs, à la raison de deux sols parisis; les clercs du dit
guet, de deux sols huit deniers parisis, et le dit examinateur, de
quatre sols parisis. Le tout par chacun jour et pour chacun d'eux;
le tout pris et levé sur les deniers provenant des dits défauts et
amende. »
Donné à Saint Quentin, au
mois de janvier l'an de grâce mille-cinq-cent trente-neuf et de nôtre
règne le vingt-sixième.
Notes :
Ce texte a été mis dans un
français plus moderne et avec des notes sur les termes aujourd'hui
disparus ou relevant d'une langue en mouvement et loin d'être figée
dans le marbre, ou une orthographie très relative et fluctuante selon
les auteurs.
(1) Ici trouvait place en préambule la charte du roi Jean du 6 mars
1364 sur la sûreté, guets et sergents de la ville de Paris, lire en
page 44 l’ouvrage de René de Lespinasse (en source).
(2) La situation topographique de tous ces endroits ne saurait être
déterminée ici et rentre dans le sujet de la « Topographie de Paris ».
|
|
|
|
Création du Collège royal ou de France
|
|
|
|
A
ses débuts, cette école se vit attribuer le titre en 1545 de Collège des lecteurs royaux, puis plus couramment de Collège royal,
cette appellation allait perdurer jusqu'à la Révolution française, avant de devenir le Collège de France.
Cette
institution fut créée en 1530 à la demande de
Guillaume Budé, Maître de
librairie de François 1er, et furent nommés six lecteurs royaux
chargés d'enseigner des disciplines jusqu'à là non transmises au sein
de l'Université de Paris :
-
Trois pour l'hébreu (François Vatable, Agathias Guidaccerius, Paul
Paradis).
- Deux pour le grec (Pierre Danès, Jacques Toussaint).
- Un pour les mathématiques (Oronce Finé).
|
|
Les cours furent ouverts à
tous et gratuits, ce qui est toujours le cas de cette honorable
institution. En
1534, Barthélemy Latomus
enseigna l'éloquence latine, en 1538, Guillaume Postel enseignait à la
fois le grec, l'arabe et l'hébreu. Les cours furent d'abord donnés en
latin, puis à partir de 1573 apparurent les premiers enseignements en
français.
En
1551 Henri II élargissait le champ d'enseignement du Collège à la
philosophie en confiant une chaire à Ramus (Pierre de la Ramée),
anti-aristotélicien notoire et contesté, qui, à partir de 1559, fit le
choix
d'enseigner les mathématiques. C'est en
1567 qu'un document mentionna pour la première
fois le Collège, il s'agissait du certificat d'aptitude à
l'enseignement du
grec délivré à Nicolas Goulu.
Ci-contre, portail
du Collège de France
| |  |
|
|
En 1539, François 1er envisagea la construction d'un « grand et beau collège »
juste en face du Louvre en rive gauche (ou sud), là où se trouve
aujourd'hui l'Institut de France, mais l'idée resta en friche, et les
plans se perdirent. Les
bâtiments du Collège royal à sa création n'étaient pas encore
construits, car sur l'actuel emplacement se trouvait deux collèges,
celui de Cambrai et de Tréguier, rachetés en 1612. Ces établissements
servirent plusieurs décennies avec le collège Cardinal Lemoine de lieux
pour la transmission des savoirs qui y étaient délivrés.
|
|
| C'est avec Henri IV que fut prise la décision d'y bâtir un espace spécifique. La mort de ce dernier aurait pu repousser un nouvelle fois l'édification des locaux, mais
la première pierre fut néanmoins posée en août 1610 par la régente
Marie de Médicis, qui a eu à coeur de faire poursuivre les travaux. En
1639, le chantier n'en était qu'à la moitié de la surface envisagée et
il fallut attendre des lettres patentes de Louis XV, en raison de
l'exiguïté des locaux, pour que de 1772 à 1775 s'achèva l'ouvrage concu
à l'origine par l’architecte Claude Chastillon (1559-1616). A remarquer
que le portail date seulement de l'année 1775... |
|
| NB
: Le Collège royal se chargea aussi des premiers dépôts légaux
des publications : livres, revues et journaux. Aujourd'hui ce dépôt se
fait auprès de la BNF sans censure préalable ou interdiction, mais
requiert une autorisation de publication ou un numéro d'attribution.
Depuis
François 1er, la censure des textes relevait des lecteurs royaux de ce
même collège (édit de 1537 et ses suites légales dont la mention de
l'auteur et de l'imprimeur, etc.). |
|
|
La
Renaissance et le goût du monde : cliquez ici !
|
|
Jean-Marie
Le Gall et Frank Lestringant, professeurs des universités
France Culture -Tout un monde par Marie Hélène Faissé - 12/05/2015 -
Durée : 35 minutes
|
|
|
|
|
| Les villes de la Renaissance |
|
|
Les villes
de la Renaissance furent le résultat de
l'expansion au Moyen Âge des centres urbains, le commerce fleurissant,
elles allaient évoluer aux XVe et XVIe siècles en raison des progrès ou
évolutions
techniques.
Ci-contre le cimetière des saints Innocents
|
|

|
|
|
| Gilles
Corrozet,
libraire, éditeur et imprimeur, dans son ouvrage : La fleur
des antiquitez de la noble et triomphante ville et cité de Paris
édité en 1555, nous apprend qu'il existait : « Dans la Cité, 32
rues, sur la rive
gauche, 112 rues ; sur la rive droite, 241 rues ; culs-de-sac, 73 ;
rues non nommées, 37 ».
Ce qui donne un total de 496 rues
incluant les faubourgs. SIx années
auparavant l'on avait recensé les maisons et l'on en trouva environ
10.000 (sans compter les fauxbourgs).
Il existait dans la ville pour l'approvisionnement hors l'apport de la
Seine en eau seulement
dix-sept fontaines, et pour certaines en très mauvais état. |
|
« Paris
ne possédait encore que dix-sept fontaines publiques, toutes alimentées
par deux aqueducs, celui du Pré Saint-Gervais et celui de Belleville.
Elles étaient réparties sur la rive droite de la Seine ; la rive gauche
et la Cité devaient donc se contenter de l'eau que leur fournissaient
la Seine et les puits. L'aqueduc de Belleville alimentait les fontaines
situées place Baudoyer, rue Saint-Julien, rue Barre-du-Bec, rue
Sainte-Avoye, rue Maubuée et rue Salle-au-Comte . Cette dernière, qui
tombait en ruines, fut reconstruite en 1578. On la nommait aussi
fontaine de Marie, parce qu'elle était adossée à l'hôtel qu'habitait le
chancelier Henri de Marie, massacré en 1418. L'aqueduc du Pré
Saint-Gervais fournissait de l'eau aux fontaines de Saint-Lazare, des Filles-Dieu, Reine, du Temple, des Halles, de la Culture
Saint-Martin, de la Croix du Trahoir et du Ponceau, toutes deux
rebâties en 1529 ; de Sainte-Catherine, élevée en 1579 par le cardinal
René de Birague dans la rue Saint-Antoine, en face de l'église
Saint-Paul ; enfin, à l'angle des rues Saint-Denis et au Fer, la
fontaine des Innocents, qui datait du XIIIe siècle, mais qui fut
entièrement reconstruite par Pierre Lescot et Jean Goujon vers 1550 ».
|
|
| Le
monde urbain allait disposer de meilleures voies de communication, des
aménagements urbanistiques et la naissance d'une architecture plus
luxuriante : places et rues plus grandes, maisons bourgeoises, et
hôtels
de ville. De
plus, les villes importantes en Europe disposaient et proposaient de
répondre au savoir des habitants
avec des écoles, des collèges et des universités. Avec la croissance
démographique qui s'engagea au XVIème siècle, les villes attiraient de
fait les populations pauvres des campagnes. Ce qui favorisa le
développement des commerçants : boulangers, bouchers, tenanciers, etc.,
Et démontre un dynamisme économique longtemps ignoré ou méconnu. |
|
|
« Le
commerce de Paris avait pris, en effet, un développement
considérable, et il faisait régner en tout temps dans la ville le
luxe et l'abondance. « A tout
prendre, dit Philipppe de Comines, cette cité de Paris est la cité
que je visse environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est
chose presque incroyable des biens qui y arrivent.
L'ambassadeur Lippomano n'est pas moins enthousiaste : "Paris
a en abondance tout ce qui peut être désiré. Les marchandises de tous
les pays y affluent ; les vivres y sont apportés par la Seine, de
Normandie, d'Auvergne, de Bourgogne, de Champagne et de Picardie. Aussi
rien n'y manque, tout semble tomber du ciel ; cependant le prix des
comestibles y est un peu élevé... Les bouchers, les marchands de
viande, les rôtisseurs, revendeurs, les pâtissiers, les
cabaretiers, les taverniers s'y trouvent en une telle quantité que
c'est une vraie confusion ; il n'est rue tant soit peu remarquable qui
n'en ait sa part ". »
Moeurs et coutumes des Parisiens au XVIe
siècle, Alfred Franklin, pages 90 et 91 (1876)
|
|
| À
Paris l'activité de l'imprimerie a eu une place conséquente dans
l'activation et la circulation des idées de "progrès" (le sens était
différent à l'époque procédant des victoires ou batailles militaires
gagnées).
Il
s'agit surtout de se référer à des progrès ou évolutions techniques
sans rapport
premier avec des questions sociales, outre des améliorations
fonctionnelles en relation avec certains travaux du quotidien.
L'artisanat perdait peu à peu du terrain avec ses produits de facture
en
nombre limité face à la manufactorisation ou une démultiplication des
produits par des fabrications en série. |
|
| Comme activités
qui devaient tenir un rôle
plus prépondérant, on trouvait en particulier les professionnels du
droit
: notaires,
procureurs et juges. Subsistaient les différents artisans en corps de
métiers avec une
organisation sociale spécifique ou codifiée avec les maîtres en haut de
la pyramide. (regarder la vidéo, ci-dessous de 6 minutes sur les
structures et le
fonctionnement de cette codification d'une centaine de métiers). |
|
Au service des "maistres",
les
apprentis et les ouvriers étaient organisés dans les codes de leur
corporation ou selon le principe de jurer fidélité.
Une
organisation spécifique et légale que l'on nommait
la jurande : « Charge
de juré sous l'ancienne monarchie française conférée par élection à un
(ou plusieurs) membre(s) d'une corporation, choisi pour la représenter,
défendre ses intérêts, veiller à l'application du règlement intérieur ». (Source
: dictionnaire du CNRS en ligne) |
|
|
|
|
|
Le
bas de l'échelle
sociale était composé de petits échoppiers, des modestes commerçants ou
ambulants des rues, des
salariés à la tâche ou journaliers, les bras-nus des villes n'entraient
toujours pas dans les
métiers bien codifiés.
Le grand nombre d'individus qui circulaient sur les routes comme
errants ou
vagabonds commençaient à inquiéter, car sans statuts autre que "oisifs"
au regard des lois et des pouvoirs politiques. L'enjeu et la morale
publique changeait,
l'errance devenait suspecte, alors qu'elle fut en d'autres temps
acceptée, voire un mode de vie. Cette main d'œuvre
d'hommes (ou des familles) recherchaient des conditions moins
misérables. Ils étaient les
premiers exposés aux crises économiques et a subir les transformations
des
techniques, pouvant faire appel à des ouvriers très qualifiés, comme à
des bras occasionnels. En France se créa pour aider les plus
démunis des
structures charitables comme le Grand Bureau des Pauvres à
Paris,
son rôle était de distribuer de la nourriture, d'aider selon l'activité
économique à
trouver du travail (forcé) aux sans labeurs.
|
|
| La vie
urbaine favorisa des différences sociales au sein des populations, et
les crises sociales et économiques les amplifier. Il
n'y a pas eu pour autant de très grandes tensions
sociales et économiques dans ces temps dits renaissants en dehors de
rares tensions de 1420 à 1548, mais les guerres ont favorisé
l'augmentation des impôts comme la taille. La bourgeoisie gérait
le quotidien, et elle était de plus en plus intéressée par l'exercice
du pouvoir et de la justice. Et le sera de moins en moins par le
commerce, c'est
aussi parmi eux que la Réforme allait trouver ses partisans les plus
actifs.
|
|
La
Renaissance a été un tournant culturel, architectural décisif, et Paris
la ville latine reprenait ses droits ; vers 1527, la cité parisienne
redevenait la capitale de la France, mais pas obligatoirement le lieu
de séjour le plus fréquent des monarques.
A l'exemple de François 1er,
celui-ci a été un roi itinérant, avec une cour suivant les déplacements
royaux et qui fit les beaux jours des pays de Loire pour son
patrimoine. Il a été à l'origine de nombreuses re-constructions ou
rénovations d'anciennes demeures fortifiées, comme à Fontainebleau et à Saint-Germain -en-Laye en île
de France.
|
|

|
|
|
|
|
Le nouvel Hôtel de Ville
Les travaux allaient
durer jusqu'en
1628. Une partie été édifiée sous François Ier, Henri II, puis
sous Henri IV et Louis XIII s'élargissait la bâtisse, deux ailes (ou
pavillons) sur sa gauche et sur sa droite furent rajoutées.
« En
l'an 1533, le 15 juillet, fut posée la
première pierre du
nouveau bâtiment de l'hôtel de ville par MM. Maistre, Pierre Viole,
sieur d'Athis, conseiller du roy, notre sire en sa cour de parlement à
Paris, prévost des marchands et Maistres Gervais Larcher, Jacques
Boursier, Claude Daniel, et Jean Barthélémy, échevins, lesquels avaient
chacun une truelle argentée pour prendre du mortier fait de sable et de
chaux. Sur laquelle pierre étaient gravées les armes du roi, et aux
deux côtés les armes de la ville avec cet écrit : facta fuerunt
haec fondamenta (ces fondations ont été faîtes) ;
pendant que l'on faisait l'assiette de cette pierre sonnaient les
fifres, tambourins, trompettes et clairons, artillerie, cinquante
arquebusiers à crocq de la ville avec les arquebusiers d'icelle ville
qui sont en grand nombre et aussi sonnaient à carillon les cloches de
Saint Jean de Grève, du Saint-Esprit et de Saint-Jacques de la
Boucherie. Aussi au milieu de la grève, il y avait vin défoncé, tables
dressées, pain et vin pour donner à boire à tous venants en criant par
le menu peuple à haute voix : Vive le roi et Messieurs de la ville.
».
 L'hôtel de Ville sous Henri IV L'hôtel de Ville sous Henri IV
Source et
illustrations, Gallica-BnF, Paris
à travers les siècles,
tome I, d'après Henri Gourdon de
Genouillac, en cinq volumes -1882-1889
|
|
|
| Sous
le règne de François 1er sont apparues des institutions
prestigieuses, à l'exemple du Collège royal (ou de France), et plus
tardivement de la
Bibliothèque royale ou nationale, et selon les époques.
Les différents religieux de la fin du XVIe siècle firent surgir des
tensions jusque-là contenues, en raison des dispendieuses
modernisations, pour exemple à l'intérieur des enceintes fortifiées.
Les prix
grimpaient, provoquaient chômage et misère, quand le travail venait à
manquer. Plus tardivement, en 1533 débutait la construction en
lieu et place de l'Hôtel-de-Ville, la construction d'un palais, des
plans
commandés quatre ans auparavant à l'architecte italien Boccador. Des
travaux qui prirent fin sous Louis XIII. L'Hôtel-de-Ville sera en parti
détruit par un incendie en 1871, puis il fut reconstruit
sous la conduite de l'architecte Théodore Ballu, tel que nous le
connaissons. |
|
Durant
cette période dite de la Renaissance, les relations commerciales
s'intensifièrent
entre les villes et les campagnes. Les
premières offraient aux secondes de vendre leur
production et facilitaient le passage d'une agriculture de subsistance
à
une agriculture productrice de richesse. Les campagnes restaient
en population largement majoritaires. Nous sommes encore loin d'un
exode de
population qui intervint tardivement et moins massivement qu'en
Allemagne ou en Angleterre. L'on vivait des cultures qui aidaient à
accroître les revenus comme
la vigne, l'île de France a été propice à cette plantation et être la première région viticole du royaume.
|
|
| Si la paysannerie française a pu connaître quelques
évolutions techniques, toutefois les habitudes, coutumes
locales et superstitions restaient tenaces et l'opposition
ville-campagne a été longtemps une contradiction bien connue entre
traditions et progrès. La
césure avec le temps resta toujours très vivante. Dans les
campagnes, pour les plus riches s'esquissa une aristocratie
provinciale, ce furent la plupart des propriétaires terriens qui
louaient leurs
instruments aux paysans. Pour les plus pauvres, les gages ne suivirent
pas le prix des denrées, les métairies remplacèrent le servage, mais
demeura un asservissement pour les uns et des rentrées régulières pour
les autres possédants. | |

|
|
|
| A
Noter :
Apparition du maïs au pays basque ; du tabac vers 1560, il a été
introduit par Jean Nicot. Les cultures dominantes étaient le froment ou
le seigle pour les humains, le sarrasin (ou blé noir), l'orge et
l'avoine pour le
bétail.
|
|
En bref de 1547 à 1572,
à Paris et dans le monde des idées
|
|
|
En 1547, Henri II était
sacré roi, le 26 juillet à Reims, le 8 octobre, il créait au Parlement
de Paris une chambre exclusivement compétente en matière d'hérésie, qui
a eu pour nom la « Chambre Ardente », nommée ainsi parce que décorée de tentures noires avec de grands chandeliers, et elle visait tout particulièrement
les Réformés.
La première Chambre de ce
type fut instituée sous François 1er en 1535,
puis a continué sous Henri II et François II. Matthieu Ory (1482-1557)
fut nommé pour la diriger comme Inquisiteur de Paris (dès 1539). Trois
ans après son accession au trône la dite Chambre rendait plus de 500
arrêtés contre l'hérésie et fit de nombreuses victimes, et des
prisonniers par milliers.
Ci-contre, portrait d'Henri II par François Clouet
|
|

|
|
|
|
Le roi
fit refaire « en grande partie les fortifications de la rive
droite, mais ne furent pas reculées et suivirent à peu près le même
tracé qu'à l'époque de Charles V, c'est-à-dire, la ligne du boulevard
du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, etc. »
Guide
pratique de Paris, par A.M, Lyon, 1913
|
|
| 1547 : Une ordonnance rendue le 9 Juillet, par « Henry
par la grâce de Dieu Roy de France etc. Nous voulons toutes sortes de
pauvres valides habitués et demeurants en notre ville et fauxbourgs de
Paris, être reçus et admis aux oeuvres publiques, avec inhibitions et
défenses à toutes personnes de quelque qualité et sexe qu'ils soient,
de ne plus quêter, mendier, ou demander l'aumône par les rues, portes
des églises, ni autrement en public, sous peine, quant aux femmes, du
fouet, et d'êtres bannies de notre Prévôté et Vicomté de Paris : Et
quant aux hommes, être envoyés en Galères, pour là y tirer la force à
la rame. »
|
| 1548 : L'édit
pris par Henri II en janvier, défend « d'ores
en avant édifié ni bâti de neuf les fauxbourgs de Paris (...)
sur
peine de confiscation du fonds et du bâtiment qui sera incontinent (tout
de suite) démoli ».
Il
est interdit « au
non noble
d'usurper le titre de noblesse et de porter l'habit de Damoiselle »,
au sein de la Déclaration
du Roy, sur le faict et reformation des habits. Il s'agit
de l'ordonnance d'Henry II faites à Paris, le 12 juillet, et de la
déclaration de Folembray du 17 octobre 1549, etc.
Un traité est signé entre les royaumes d'Ecosse et de France, Marie
Stuart est promise au dauphin et le royaume écossais passe sous
protection de la royauté française. Publication des Exercices
Spirituels d'Ignace
de Loloya. |
| 1549 :
Décès de Marguerite de Navarre ou d'Angoulême, femme de lettres et
sœur de François 1er. Sous la direction de l'architecte Pierre Lescot
et avec des bas reliefs du sculpteur Jean Goujon est constuite la
fontaine des
Innocents (actuel 1er arrondissement). Rédigé l'année précédente,
Etienne de la Boétie publie De
la Servitude Volontaire (manuscrit original). |
1550
:
A Paris sont estimés à seulement soixante-douze les médecins. Henri II
accorde le droit d'entrée sur la royaume aux Juifs et
Musulmans convertis (dits "Portugais"), ils arrivent notamment dans les
villes et ports de Bordeaux et Bayonne. En Espagne, Charles
Quint et le Pape Jules III convoquent une disputation à Valladolid avec
une quinzaine de théologiens, où notamment les thèses de Juan de
Sepulveda et de Bartolomé Las Casas s'affrontent pour savoir si les
"Indiens" ont une âme? Il y est question plus exactement de savoir si
la colonisation par la force est nécessaire et si l'évangélisation est
une mission de l'Eglise, sur ce dernier point les deux religieux sont
en accord et favorables à la christianisation des populations
"indiennes". Au château de Saint-Germain-en-Laye naît le 27 juin le futur Charles IX.
|
| 1551
: Paris, le 3e jour de septembre est publié par le Parlement l'Édict du Roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques, appartenans à tous juges royaux et présidiaulx. A Fontainebleau nait le 19 septembre le quatrième fils des époux
royaux, le futur Henri III. Bartolomé
de Las Casas fait publier l'Histoire générale des
Indes en espagnol & parution de De Scandalis, de
Jean Calvin, où il dénonce l'athéisme de
Rabelais, de Des Périers, d'Etienne Dolet, etc. |
| 1552 : En janvier, Le
traité de Chambord scelle un accord entre Henri II et les princes
réformés. Le duc d'Albe pour Charles Quint fait le siège avec ses
troupes en octobre de la ville de Metz, sous les ordres de François de
Guise, il dure 4 mois sans succès. Sont publiés le Guide
des Chemins de France de Robert Estienne & Le
Quart Livre de François Rabelais. |
1553
: Pierre de Ronsard
forme une nouvelle Pleiade (depuis l'Antiquité)
avec six autres poètes français : Joachim Du Bellay, Jacques Peletier
du Mans, Rémy Belleau, Antoine de Baïf (le musicien du groupe), Pontus
de Tyard et Étienne
Jodelle. Les
Amours
de Ronsard sont publiés chez la Veuve Maurice de la Porte à
Paris. Henri de Navarre, fils de Jeanne d'Albret et d'Antoine de
Bourbon, nait le 13 décembre, celui-ci est baptisé catholique.
|
|
|
 Notice sur
Etienne Jodelle,
Notice sur
Etienne Jodelle,
retour de la tragédie antique au-devant de la scène...
Estienne
Jodelle a été un des auteurs de la nouvelle pléiade et le seul Parisien du
groupe, il n’a pas été retenu pour son œuvre poétique, plutôt ennuyeuse
ou déclamatoire, mais pour avoir relancer un style théâtral oublié : la
tragédie. Ce petit texte de Louis Viollet-le-Duc (1781-1857) est son
introduction aux pièces sauvegardées de ce dramaturge précurseur d’une
écriture en alexandrin et adaptée en français en vers de douze pieds
puisés auprès des auteurs de l’antiquité grecque et latine.
« Etienne Jodelle, né à
Paris en 1532 mort en 1573, passe
généralement pour le premier qui osa substituer aux mystères, moralités
et sotties (ou soties : piécettes de théâtres à caractère
politico-sociales), des ouvrages dramatiques français faits selon le
système des anciens. Il est cependant vrai de dire que déjà Baïf, en
1537, et Ronsard, en 1549, avaient fait représenter et imprimer l'Electre
de Sophocle et le Plutus
d'Aristophane, traduits en vers français ; mais Jodelle ne se contenta
pas d'une traduction il composa, en effet, le premier, une véritable
comédie et deux tragédies de son invention, s'assujettissant seulement
à la forme adoptée par les Grecs et les Latins. L'Eugène,
comédie, et Cléopâtre captive furent représentées le même jour,
en 1552, Didon en 1558.
Cette sorte
de spectacle parut tellement insolite, nouvelle, que, dans
l'impossibilité de trouver des acteurs capables de jouer ces pièces, et
peut-être même de les comprendre Jodelle et ses amis Remy Belleau et
Jean de la Péruse qui, plus tard, furent auteurs dramatiques aussi,
furent obligés de prendre dans ces pièces les rôles principaux. On
prétend que ce fut Jodelle, alors âgé de vingt ans, et d'une figure
agréable, qui joua Cléopâtre.
Un théâtre
fut élevé, pour cette représentation, dans la cour de l'hôtel de Reims,
à Paris où assistèrent Henri II et ses courtisans. Pasquier, dans ses Recherches
de la France, nous donne lui-même ces détails, assez curieux pour
être reproduits ici : « Cléopâtre
fut jouée devant le roi Henry II, avec de grands applaudissements de
toute sa compagnie, et, depuis encore, au collège de Boncourt, où
toutes les fenêtres étaient tapissées d'une infinité de personnages
d'honneur, et la cour si pleine d'écoliers, que les portes du collège
regorgeaient. Je le dis comme celui qui y était présent avec le grand
Tournebus (Turnèbe), en une même chambre. Le roi lui donna (à Jodelle)
cinq cents écus de son épargne et lui fit tout plein d'autres grâces,
d'autant que c'était chose nouvelle et très belle et très rare. »
Pasquier, en portant plus loin un jugement sur Jodelle, ajoute pourtant
« Je me doute qu'il ne demeurera que la mémoire de son nom en l'air. »
Et cependant nous voyons que Regnier (Mathurin 1573-1613, poète), plus
de vingt ans après la mort de Jodelle, le cite encore avec éloge
(satire IV, vers 108).
Non
seulement les poètes antérieurs à Jodelle et ses contemporains
négligeaient l'entrelacement des rimes dans leurs poésies mais, que le
sujet qu'ils traitaient fût grave ou léger, la mesure leur semblait
indifférente. Jodelle, le premier, consacra le grand vers alexandrin à
la tragédie, sauf les chœurs. Seulement, le premier acte de Cléopâtre
est en grands vers, (…). C'est évidemment un essai. Didon est
écrite toute en grands vers, et cette mesure a été adoptée par tous les
successeurs de Jodelle. Eugène, Cléopâtre et Didon
sont les seules pièces de Jodelle qui nous aient été conservées par
l'éditeur de ses œuvres posthumes, Charles de la Mothe, son ami (*),
quoi qu'il en eût d'autres dit-il, « achevées ou pendues au
croc ; attendant » pour les publier des temps meilleurs. Elles
sont perdues.
Ce même
éditeur nous apprend que tout ce qui a été composé par Jodelle « n'a
jamais été fait que promptement ; la plus longue et difficile tragédie
ou comédie ne l'a jamais occupé à composer et écrire plus de dix
matinées ; même sa comédie d'Eugène fut faite en quatre traites.»
Nous savons que le temps ne fait rien à l'affaire ; toutefois, ne
pourrait-on pas attribuer cette précipitation blâmable d'abord à l'état
de gêne et de désordre dans lequel vivait Jodelle, ensuite à
l'incertitude du succès de ses poèmes dramatiques et aux difficultés
sans nombre qu'il pressentait pour leur représentation?
Un fait consigné par Jodelle
lui-même peut en donner une idée. Dans un ballet des Argonautes,
qu'il fut chargé par le prévôt des marchands de faire exécuter à
l'Hôtel-de-Ville de Paris, obligé de diriger, d'organiser tout, arcs de
triomphe, trophées emblématiques, décors de toute sorte, compositions
de devises, d'emblèmes, d'inscriptions, en place de deux rochers (les
Cyannées probablement) qu'il avait commandés au peintre, Jodelle
exprime son dépit de voir arriver, durant la représentation, deux
clochers, entre lesquels Jason dut passer. On conviendra que cela était
décourageant.
Il faut
faire la part du temps. Jodelle vivait dans un siècle d'examen, où tout
était tenté ou mis en doute. Il fut novateur. Jamais, dit-il de
lui-même dans un chapitre à sa muse : Jamais l'opinion ne sera
mon collier.
Son style,
souvent barbare, est rempli de locutions neuves, hasardées pour la
plupart, mais dont quelques unes ont pris droit de cité. Sa comédie,
dont le prologue indique des idées dramatiques, offre des caractères
bien tracés, entre autres celui de Guillaume, la perle des maris. Cléopâtre
captive, la plus faible de ces trois pièces, ne doit être
considérée que comme une tentative heureuse qu'il importe de consigner.
Didon prise tout entière du quatrième livre
de l'Enéide
de Virgile contient des morceaux remplis d'âme et de chaleur pour qui
saura soulever la rude écorce qui les recouvre. Enfin c'est l'art dans
l'enfance ; mais c'est un enfant vivace, et qui promet un avenir.
(Corneille, Molière, etc.) »
Note :
(*) Charles de la Mothe
né et mort au XVIe siècle fut l’éditeur et il est « l’auteur d'un
propos liminaire intitulé De la poésie françoise, et des œuvres
(poétiques) d'Estienne Jodelle, sieur du Lymodin ».
Source : Gallica-Bnf, Ancien théâtre françois ou Collection des ouvrages
dramatiques
les plus remarquables depuis les mystères jusqu'à Corneille.
Avec des notes et éclaircissements de M. Viollet le Duc, édité en 1855
au Liechtenstein.
|
|
|
|
| 1554 : Est rétabli le régime des greniers et
du sel en particulier. Michel de l'Hospital est nommé surintendant des
finances du royaume. |
| 1555 : Sont publiées les Oeuvres (Les
Soupirs et Sonnets) de la poétesse
Louise Labbé (ou Labé, vers 1524-1566) dite la "Belle
Cordière" (issue une famille de fabriquant de cordes et épouse d'un cordier), et imprimé à
Lyon, sa ville natale. Nicolas
de Villegagnon part en mai du port du Havre avec deux navires et six
cent hommes, ils arrivent en octobre au Brésil. La colonisation
française échouera et durera que cinq années. Est éditée la Cosmographie
universelle, selon les
navigateurs tant anciens que modernes de Guillaume Le Testu. |
| 1556 :
Charles Quint abdique de son titre d'empereur du Saint-Empire en
janvier et Ferdinand 1er lui succède en août. Ce dernier ratifie et confirme dans l'année
les règles de
loi de 1547 sur la "pureté de la race" (ni juif, ni mulsulman). Ignace
de Loloya décède à Rome. En février, il est pris deux édits par le roi Henri II, un sur "les mariages clandestins" et l'autre sur "le fait des femmes grosses (enceintes) et des enfants morts-nés" (extraits ci-dessous). |
|
|
Edit sur le fait des femmes grosses (enceintes)
et des enfants morts-nés  |
Le présent édit d'Henry II (ci-dessus) obligeait les
femmes non mariées ou veuves à déclarer leur grossesse. Il s'agissait
de condamner les avortements, les infanticides, les abandons, les
enfants nés sans baptême et les sépultures non religieuses. Cet édit
fut renouvelé sous Henri III en 1583 et Louis XIV en 1708, qui demanda à ce
qu'il soit lu dans les paroisses par les curés tous les 3 mois et dans
l'ensemble du royaume.
« Etant dument averti d'un crime très énorme
et exécrable, fréquent en notre Royaume, qui est que plusieurs femmes
ayant conçue un enfant par des moyens déshonnêtes, ou autrement,
persuadées par un mauvais vouloir (mauvaise volonté) et conseil,
déguisent, occultent et cachent leurs grossesses, sans en rien
découvrir et déclarer. Et advenant le temps de leur part, et délivrance
de leur fruit, occultement s'en délivrent, puis le suffoquent,
meurtrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le
saint sacrement de baptême. Ce fait les jettent en des lieux secrets et
immondes ou enfouissent en terre profane, les privant par tel moyen de
la sépulture coutumière des Chrétiens. De quoi étant prévenues accusées
par devant nos juges, s'excusent, disant avoir eu honte de déclarer
leur vice, et que leurs enfants sont sortis de leurs ventres morts, et
sans aucune apparence, ou espérance de vie, tellement que par faute
d'autre preuve, les gens tenants tant nos cours de parlements,
qu'autres nos juges, voulant procéder au jugement des procès criminels
faits à l'encontre de telles femmes, sont tombés et entrés en diverses
opinions : les uns concluants au supplice de mort, les autres à la
question extraordinaire (torture) : afin de savoir et entendre par leur
bouche si à la vérité le fruit issu de leur ventre était mort ou vif.
Après laquelle question endurée pour n'avoir aucune chose voulu
confesser, leur sont les prisons le plus souvent ouvertes qui a été la
cause de les faire retomber, récidiver et commettre tels et semblables
délits, à notre très grand regret, et scandale de nos sujets.
A quoi pour l'avenir, nous avons bien voulu pourvoir. Faisons savoir,
que nous désirant extirper et ci u tour faire cesser les dits
exécrables et énormes crimes, vices, iniquités et déliés qui se
commettent en notre dit royaume et ôter les occasions et racines de
ceux-ci dorénavant commettre, avons (pour à ce obuier : faire obstacle)
dit, statué et ordonné, et par édit perpétuel, loi générale et
irrévocable, de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité
royal, disons, statuons, vouIons, ordonnons et nous plait que toute
femme qui se trouvera dument atteinte et convaincue d'avoir celé
(caché), couvert et occulté tant sa grossesse que son enfantement, sans
avoir déclaré l'un ou l'autre, et avoir pris de l'un ou l'autre
témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant lors de
l'issue de son ventre, et qu'après se trouve l'enfant avoir été privé,
tant du sein et sacrement de baptême, que de sépulture publique et
accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d'avoir homicidé son
enfant. Et pour réparation est punie de mort et au dernier supplice, et
de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : afin
que ce soit un exemple à tous. »
Source : Gallica-Bnf (texte mis dans un français moderne)
|
|
|
|
| 1557
: Le 24 juillet est promulgué un édit (en latin et français) depuis le château de Compiègne par le roi Henri II : Édict du Roy portant reiglement pour le pouvoir des inquisiteurs de la foy,
ce texte condamne à mort les hérétiques, donc les Réformés et augure
des guerres civiles à venir. En septembre, à la sortie de la messe de
la Sainte Chapelle, Henri II subit une tentative d'assassinat par un
certain Caboche, clerc à la Chancellerie. Le cadet Caboche a voulu se
venger de la condamnation à mort de ses deux frères l'année précédente
à Meaux pour « injures atroces, libelles diffamatoires, menaces, blasphèmes, exaction. » ; il finira lui aussi par être condamné et exécuté. Le livre La
deffence & illustrastion de la langue françoise de
Joachim Du Bellay (décès en 1560) est édité à Paris. |
| 1558 : Le
24 avril, Marie Stuart, reine d'Ecosse épouse le dauphin François à la
cathédrale Notre-Dame et devient à son tour roi d'Ecosse, et il est
précisé dans le contrat de mariage qu'en cas de décès de Marie,
François peut réclamer le trône d'Angleterre. Le
13 mai, les Incidents du Pré-aux-Clercs provoquent des
heurts entre Catholiques et Protestants, ces derniers manifestent
régulièrement
par la lecture et le chant des psaumes, ils s'attirent l'ire du roi et
l'indignation
de la Sorbonne. En juillet, suite
à des négociations avec le royaume d'Ecosse et un accord de protection,
le Parlement de Paris naturalise les Ecossais (et inversement). Sont
publiées Le premier livre des Antiquitez de Rome & Les
Regrets et autres œuvres poétiques de Joachim Du Bellay. En
Espagne, Charles Quint meurt dans un monastère. |
| 1559 :
S'achève après deux années d'affrontements la onzième guerre d'Italie
avec le traité de Cateau-Cambrésis. S'engage la mode des portraits
grandeur nature par François Clouet, le
portraitiste d'Henri
II. Anne du Bourg, juriste protestant, est depuis deux ans devenu
conseiller au Parlement de Paris, lors d'une réception avec le roi (une
mercuriale), il
se prononce contre les exactions menées contre les huguenots et pour la
tolérance religieuse. Henri II le fait embastiller. Le 30 juin Henri II
est mortellement blessé, d'un pieu fiché dans son œil, suite à une joute
avec le comte Gabriel de Lorges, dans la rue Saint-Antoine à Paris intra-muros et dans la plus large
rue de la capitale (ci-dessous une gravure du combat). Le roi décède 10 jours après de ses blessures. Commence
le court règne de François II, qui est sacré roi en septembre à Reims sous le contrôle de ses oncles de Guise, à l'âge de 15
ans. Le
21 décembre, dans la capitale le conseiller Anne du Bourg est condamné
à mort en place St-Jean de Grève et pendu à la vue du public. Il nous
laisse pour mémoire : Confession
sur les principaux poincts de la religion chrestienne (...).
Plus l'histoyre de
la mort et martyre du mesme seigneur Du Bourg, par lequel il a signé de
son sang la susdite confession. Edition
de L'Heptaméron
de la princesse Marguerite de Valois, reyne de Navarre à
Lyon et sont traduites les Vies de
Plutarque par Amyot. |
|
Place St-Jean
de Grève,
exécution
publique de Anne du Bourg
|
|
|

30 juin 1559, joute entre Henri II et le comte de Montgommery rue
Saint-Antoine (illustrations de Frans
Hogenberg)
|
| 1560 : La
population du royaume français est estimée à environ 20 millions
d'habitants, et elle atteint le même chiffre et son plus haut niveau
d'avant la guerre de Cent ans (début du quatorzième siècle). Les actes
notariés doivent obligatoirement être signés. Le
17 mars se déroule la conjuration
d'Amboise, Louis de Bourbon, prince de Condé et
d'Antoine de Bourbon
(père du futur Henri IV, qui est catholique, mais il fini par renoncer
à y participer) sont à l'origine d'un complot contre François II, qui
échoue et préfigure des suites. Environ 1.200 conjurés huguenots se
font massacrer
par
les troupes du roi. Les conjurés ont cherché à enlever François II, le
trouvant trop sous l'influence de la famile de Guise. De son côté, Jeanne d'Albret,
reine de Navarre, choisie la religion réformée. En mai la Chambre Ardente
(l'inquisition) est supprimée par l'édit
de
Romorantin, en juillet le Parlement l'enregistre. Après le décès de François II,
le 5 décembre débute le règne
de Charles IX et la régence de
Catherine de Médicis. Antoine de Bourbon est
intégré au Conseil royal. Michel de
l'Hospital
prend la charge
de chancelier de France (justice) jusqu'en 1568, il est désigné pour
conduire une politique de réconciliation
entre Catholiques et Protestants. Celui-ci
est aussi l'auteur le 7
septembre, de l'Harangue au Parlement de Paris (au sein de
ses oeuvres complètes édition de 1825). André Vésale (1514-1564),
médecin et père
de l'anatomie moderne est publié à Lyon pour sa Description
et demonstration des membres interieurs de l'homme & de la femme,
en onze tables, tirées au naturel, selon la vraye anatomie. |
| 1561 :
Fin janvier, Charles IX clos les Etats généraux à Orléans et il est
sacré roi à Reims, le 5 mai. Vers la fin du
mois de mai la peste est de retour dans la capitale. L'épidémie fera
25.000 morts et s'arrêtera en 1562. Fin
décembre, le 27, au sein du quartier
Mouffetard, les Huguenots attaquent l'église Saint-Médard, les cloches
de
cette dernière empêchent le pasteur de se faire entendre. Il est envoyé
dans un premier temps une ambassade, s'engagent des heurts violents
entre des partisans des deux cultes. Le lendemain, les Catholiques
répliquent et s'en prennent au temple du Patriarche
et l'incendie. Antoine de Bourbon est nommé gouverneur de Guyenne et
Lieutenant général du royaume par Catherine de Médicis. Le livre
de l'architecte
Philipbert de l'Orme (ou Delorme) est imprimé sous le
titre : Nouvelles
inventions pour bien bastir et à petits fraiz. |
| 1562
: Le
22 février, l'amiral de Coligny quitte la cour. Le 1er mars, sont
massacrés une centaine de Huguenots à Wassy (Haute-Marne), au nom du
duc de Guise et précipite l'enclenchement des guerres de religion : 8
conflits jusqu'en 1598. Quinze jours après François de Guise entre dans
Paris. A Pâques, au Havre les Protestants expulsent les Catholiques de
la ville sous la conduite de Coligny, en octobre l'Angleterre avec sa
marine s'empare de la ville. Fin avril, la ville de Lyon est mise à sac
par les calvinistes (La rumeur pendant les guerres de religions de Passion modernistes avec Gauthier Mingous). Lors du siège de la ville de Rouen
occupée par les huguenots, à la mi-octobre, Antoine de Bourbon est mortellement blessé, il décède en
Normandie un mois plus tard. En décembre,
François de Guise à son tour devient Lieutenant général du royaume. |
| 1563 : En
février, lors du siège de la ville d'Orléans, François 1er de Guise,
duc de Lorraine est visé et touché par la balle d'un gentilhomme
protestant, Poitrot de Méré, il meurt quelques jours après. Et son
assassin sera écartelé. Fin du
premier conflit, le
19 mars est signé et
publié l'édit d'Amboise, qui assure la liberté
de conscience pour les Réformés, le culte est néanmoins limité à
leurs domiciles. Le 28 juillet, la ville du
Havre est reprise aux Anglais suite à un siège entrepris depuis mai par
les troupes françaises. Le 17 août, Charles IX est
déclaré majeur devant le
Parlement de Rouen. Le 1er octobre, à Paris dans la rue St-Jacques un
collège des Jésuites est ouvert suite à l'achat en début d'année par la
Compagnie de Jésus, de l'hôtel de La Cour de Langres (qui
deviendra le collége royal Louis-le-grand).
En décembre, le concile de Trente s'achève. L'on remarque la
réalisation de poteries et
d'assiettes
ornementales par le savant et autodidacte Bernard Palissy, celui-ci
obtient le titre d’« inventeur des rustiques figurines du roi ». Et
puis
survient la disparition d'Etienne de la Boétie
à 33 ans, ami de Michel de Montaigne. |
|
|
Bernard Palissy
et
les fossiles ?
Richard Lewinsohn
Ci-contre, Bernard Palissy, autoportrait en faïence
|
| 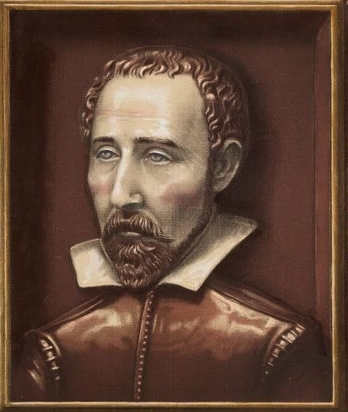 |
|
|
« Les
recherches effectuées sur les animaux marins amènent aussi dans la
deuxième moitié du XVIe siècle, une découverte, ou plutôt une
redécouverte qui, sans faire sensation à l'époque, figurera plus tard
au tableau d'honneur des grands faits de la science naturelle. Le
célèbre potier-émailleur Bernard Palissy a examiné les roches qu'il a
trouvées pleines de coquillages. Jusque-là, quand on tombait sur de
tels phénomènes, on ne les regardait pas comme fortuits, mais on n'y
voyait qu'une simple curiosité. La Nature, selon la doctrine dominante
au Moyen Âge, a une prédilection pour certaines formes, indépendamment
de la matière, une « vis plastica ». Tel est le sens du terme
technique « lusus naturae » — jeux de la Nature — qui s'est
conservé jusqu'à nos jours.
Parfois il est vrai, la Nature pousse ce jeu très loin. Jean de
Joinville, chroniqueur des dernières croisades, raconte qu'à Sidon on
apporta au roi Louis IX une pierre qui, intérieurement, avait la forme
parfaite d'un poisson : « Le poisson était de pierre, mais il ne
manquait rien à sa forme, ni yeux, ni arêtes, ni couleur, ni autre
chose qui empêchât qu'il fût tel que s'il fût vivant. Le roi me donna
une pierre et je trouvai dedans une tanche, de couleur brun et de telle
façon qu'une tanche doit être » (1). C'était certes étonnant, mais
ni le pieux roi ni son savant conseiller ne s'en préoccupèrent
davantage.
Le potier Palissy ne voulut pas admettre l'explication courante de tels
phénomènes. Dans une série de conférences qu'il fit entre 1575 et 1584
à Paris, il attaqua la vieille formule des jeux de la Nature :
« Quand j'ai eu regardé de bien près aux formes de pierres,
disait-il, j'ai trouvé que nulle d'icelles ne peut prendre la forme de
coquilles, ni d'autre animal, si l'animal même n'a bâti sa
forme. » Combattant en même temps l'hypothèse que les fossiles
auraient été apportés par le Déluge, Palissy arrivait à la conclusion
que les roches pleines de coquillages furent autrefois des vases
marines qui se pétrifièrent lorsque l'eau se retira.
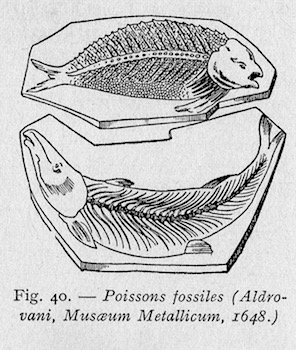 |
|
Évidemment, l'idée n'était pas neuve.
On n'aurait eu qu'à consulter les textes d'Hérodote, de Strabon,
d'Albert le Grand, de Boccace, de Fracastoro et de maint autre (2) pour
trouver les mêmes observations et explications. Cependant, ce n'étaient
là que de simples hypothèses, alors que Palissy, se basant sur sa belle
collection de fossiles, en tirait une véritable théorie. De plus,
c'était à l'époque un acte courageux que de professer publiquement des
idées aussi contraires aux opinions des docteurs de la Sorbonne,
sévères gardiens de la tradition. Les petits animaux pétrifiés
faillirent être impliqués dans les guerres de religion. Palissy avait
fait ses conférences, protégé par les médecins et gentilshommes de la
Cour. Lorsque le vent tourne, il est arrêté comme huguenot et finit ses
jours misérablement à la Bastille, où on l'a enfermé quoique
octogénaire. |
L'œuvre de Palissy tomba dans l'oubli. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle
qu'on reconnut les mérites de ce grand naturaliste (3) dont les
recherches ont jeté une nouvelle lumière sur la préhistoire du monde
animal. Jusqu'alors, les vestiges du passé lointain qui apportaient la
preuve de la thèse de Palissy restaient de simples curiosités pour les
cabinets d'amateurs, soigneusement cataloguées et absurdement
interprétées. »
Notes de l'auteur :
(1) Joinville, Histoire de saint Louis (1309), chap. CXVIII.
(2) Raymond Furon, La Paléontologie (Paris, 1943), pp. 16-37.
(3) Bernard Palissy Œuvres, publiées par Faujas de Saint Fond et Gobet (Paris, 1777), d'après les originaux de 1557, 1563 et 1580. Mémoires de l'Académie royale des sciences pour 1720 (Paris), p. 5
Source : Richard Lewinsohn, Histoire des animaux, pages 160 à 162, éditeur Plon (Paris, 1953)
|
|
|
| 1564 : En
janvier, le roi Charles IX avec sa famille (dont Catherine sa mère), le
jeune monarque avec sa cour quitte la capitale pour un tour de France pendant deux ans et
demi, suivi par 8.000 personnes allant parcourir 4.000 kilomètres.
Catherine de Médicis décide de la construction du château des Tuileries
ou du futur Palais-Royal sous la conduite de Philibert Delorme (fin des
travaux 10 ans plus tard). Jean Calvin décède à Genève. |
| 1565
: Suite à l'ordonnance royale prise deux ans plus tôt, le mois de
janvier devient le premier mois de l'année. Charles IX confie à Pierre de Ronsard
le Prieuré de Saint-Côme en Touraine, saccagé deux ans plus tôt par
les Huguenots. Où le poète résidera jusqu'à ses derniers jours en 1685
comme Prieur et sera inhumé dans l'église. Est éditée La
Bergerie de Rémy Belleau, poète du
groupe de la Pléiade. |
| 1566 : Le 1er mai le tour de
France du roi et sa cour s'achève. En août les Pays-Bas se révoltent
contre l'Espagne. |
1567 :
En juin, le pape Pie V condamne les huguenots.
Les chefs des réformés, Louis de Condé, Gaspard de Coligny
et François d’Andelot partent de la cour, décidés à reprendre les
armes. A l'automne s'engage la deuxième guerre de religion jusqu'en
1568, en raison de l'inquiétude de la noblesse
réformée à l'origine du nouveau conflit. L'influence du cardinal
Charles de Lorraine sur le roi et l'idée d'une alliance avec
l'Espagne de Philippe II met le feu aux poudres, l'on va même chercher
à enlever le jeune Charles IX. Ce que l'on désigne comme La surprise de Meaux (ou
bien la bataille de Meaux), il s'agit d'une conspiration menée dans cette localité
le 26 septembre qui échoue. Le roi prévenu, il évite cette
tentative et depuis Meaux rejoint Paris au plus vite sous protection
des gardes Suisses. Se déroule, le 10 novembre, la bataille de Saint-Denis (estampe ci-dessous) entre Catholiques et Huguenots, le connétable et duc
Anne de Montmorency blessé par une balle décède le surlendemain, et victoire du camp royal ou catholique.
|
|
 |
Bataille de Sainct-Denis donnée la veille de la St-Martin, 1567, estampe de Jean-Jacques Perrissin
|
|
| 1568
:
Les camps catholiques et réformés signent le traité de paix de
longjumeau le 23 mars avec la confirmation de l'édit d'Amboise et met
fin au deuxième conflit. En septembre éclate la troisième guerre de
religion jusqu'en 1570, suite aux ordonnances de Saint-Maur qui
révoquent l’édit de Longjumeau, déclarant les huguenots « criminels de lèse-majesté et perturbateurs du repos public ». Une importante procession est organisée à Paris et Charles IX prouve son grand attachement au catholicisme. Dans la capitale le
collège créé en 1439 par M. Nicolas Coqueret d'Amiens,
chanoine et bachelier en théologie, c'est-à-dire l'école qui a
accueilli Du Bellay
et Pierre de Ronsard (professeur M. Jean de Dorat, 1508-1588) et
d'autres auteurs de la Pléiade est fermée (quartier Latin ou des
Ecoles). Michel de l'Hospital est destitué, faute de conciliation entre
huguenots et catholiques. Le conseiller et aumonier ordinaire du roi,
Philipbert de l'Orme (ou Delorme) est édité pour son premier tome de l'Architecture. |
| 1569
: Se déroule le 13 mars la bataille de
Jarnac, et différents combats dans le cadre de la troisième guerre civile religieuse. Qui sera suivie en octobre,
d'une nouvelle victoire du duc d'Anjou, le futur Henri III, à
Montcontour (aujourd'hui dans le département de la Vienne), sur
les troupes de l'amiral de Cologny. Et qui fera dire au duc d'Anjou à
son sujet : « Qu’il se souvienne qu’il est périlleux
de heurter contre la fureur française! ». Le 13 septembre, sur la requête de
Gilles Bourdin, procureur
général au Parlement de Paris, la tête de l'amiral de Coligny est mise
à prix pour 50.000 écus d'or. Publication post-mortem à Paris Des
Portraicts anatomiques de toutes les parties du corps humain, gravez en
taille douce... Ensemble l'Abrégé (d'anatomie en français moderne) d'André Vésale et
l'explication d'iceux,
accompagnée d'une déclaration anatomique, par Jacques Grevin. |
| 1570
: Fin
novembre, Charles IX épouse Elisabeth d'Autriche, fille de l'empereur
du Saint Empire Germanique Maximilien II, en vue de présenter le roi
français comme successeur et éligible au titre d'empereur. Faits déjà
produit à Paris en
1544,1564 et 1570 avec les débordements de la Seine, il a été possible
de se rendre
jusqu'à la
place Maubert en bâteau et dans les grandes rues de la ville, idem en
1573. Michel de l'Hospital adresse un
Mémoire sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile à la
reine-mère : Le but de la guerre et de la paix. Le 8 août est signé le traité de
Saint-Germain-en-Laye par Catherine de Médicis, qui met fin à la
troisième guerre et autorise le culte protestant sans aucune
restriction. La
Bibliothèque royale présente à Fontainebleau
depuis 1544, est transférée à Paris. La Bibliothèque royale
s'installera dans le "Quadrilatère Richelieu" en 1720 et elle deviendra la Bibliothèque nationale lors de la Révolution
française. |
| 1571
: En mars, Les époux royaux Charles et Elisabeth font leur entrée dans la capitale et donne lieu à des festivités. Les Amérindiens au Pérou se révoltent et
l'avant dernier empereur Inca Titu
Kusi Yupanqui décède et marque
le début du règne de Túpac Amaru. Celui-ci sera exécuté l'année
suivante par les colons Espagnols. L'on dénombre à Paris 16.400
maisons, chiffre établi selon les taxes prélevées. |
| 1572
: Un édit du 19 mars suite à l'ordonnance d'Orléans oblige les « notaires de faire signer
les parties sur tous les actes, ou de mentionner qu'elles ne savent pas
écrire » (par une croix peut-on présumer).
Le 18 août est célébré
à Notre-Dame le mariage d'Henri de Navarre avec
la fille de la reine-mère, Marguerite de Valois (surnommée, la reine
Margot par Alexandre Dumas), et à cette occasion de nombreux huguenots
sont venus à la capitale, dont 800 personnes dans l'entourage d'Henri
le Béarnais et sont estimés à 8.000 les huguenots dans la ville (sur
300.000 habitants). Développement de la médecine en France, il
est édité les Cinq
livres de chirurgie par Ambroise
Paré (document en latin). Michel de Montaigne fait éditer Vers
françois de feu Estienne de La Boétie. C'est à partir de
cette année là que Montaigne entreprend la rédaction des Essais.
Son travail prendra fin un peu avant sa disparition en Dordogne en
1592,
son œuvre acceptée dans un premier temps, sera mise à l'index par
l'Église en 1666. |
|
|
| Montaigne
et les historiens? |

Statue de Montaigne en face de la Sorbonne du sculpteur Michel
Landowski (1933)
« Paris a mon coeur dès mon enfance. Je ne suis français que par
cette grande cité. Grande surtout et incomparable en variété. La gloire
de la France et l’un des plus nobles ornements du monde ».
|
|
En ce genre
d'étude des histoires, il faut feuilleter, sans distinction, toutes
sortes d'auteurs et vieils et nouveaux, et barragouins et français,
pour y apprendre les choses de quoi diversement ils traîtent. (...)
J'aime les historiens ou fort simples, ou excellents. Les simples, qui
n'ont point de quoi y mêler quelque chose du leur, et qui n'y apportent
que le soin et la dilligence de ramasser tout ce qui vient à leur
notice, et d'enregistrer, à la bonne foi, toutes choses sans choix et
sans triage, nous laissent le jugement entier pour la connaissance de
la vérité : tel est entre autres, pour exemple, le bon Froissard, qui
a marché, en son entreprise, d'une si franche naïveté, qu'ayant fait
une faute, il ne craint aucunement de la reconnaître et corriger en
l'endroit où il en a été averti, et qui nous représente la diversité
même des bruits qui couraient, et les différents rapports qu'on lui
faisait : c'est la matière de l'histoire nue et informe ; chacun en
peut
faire son profit autant qu'il a d'entendement.
Les biens excellents ont la suffisance de choisir ce qui est digne
d'être su ; peuvent trier, de deux rapports, celui qui est plus
vraisemblable ; de la condition des princes et de leurs humeurs, ils en
concluent les conseils, et leur attribuent les paroles convenables :
ils ont raison de prendre l'autorité de régler nôtre créance à la leur
; mais, certes, cela n'appartient à guêre de gens. Ceux d'entre-eux
(qui est la plus commune façon) nous gâtent tout ; ils veulent nous
mâcher les morceaux ; ils se donnent loi de juger, et par conséquent
d'incliner l'histoire à leur fantasie ; car, depuis que le jugement
pend
d'un côté, on ne se peut garder de contourner et tordre la narration à
ce biais (1) : ils entreprennent de choisir les choses dignes
d'être sues, et nous cachent souvent telle parole, telle action privée,
qui nous instruirait mieux ; objectent, pour choses incroyables, celles
qu'ils n'entendent pas, et peut-être encore telle chose, pour ne la
savoir dire en bon latin ou français.
Qu'ils étaient hardiment leur éloquence et leur discours, qu'ils jugent
à leur poste : mais qu'ils nous laissent aussi de quoi juger après eux
;
et qu'ils n'altèrent ni dispensent, par leurs raccourcissements et par
leur choix, rien sur le corps de la matière, ainsi qu'ils nous la
renvoient pure et entière en toutes ses dimensions.
(le texte a été mis dans un
français plus moderne)
(1) « Les faits changent de forme dans la tête de l'historien ; ils
se moulent sur ses intérêts ; ils prennent la teinte de ses préjugés. »
J-J. Rousseau, Emile, livre IV.
Source : Gallica-Bnf - Essais de Michel de
Montaigne (1533-1592)
Avec des notes de tous les commentateurs. Livre II - chapitre X, page
233 - Éditeur, Lefèvre - Paris, 1834
|
|
|
|
|
| Les massacres de la Saint Bathélemy, la fin
d'une énigme ? |
|
|
Suite
au mariage de Marguerite de Valois le 18 août 1572 avec son cousin
Henri de Navarre étaient présents dans la capitale de nombreux réformés
en raison des festivités. Il est diificile se douter que peu de jours
après, une situation aussi exceptionnelle allait se produire, qui a été
longtemps sous le coup d'une énigme, faute d'éléments suffisants pour
en tirer toutes les causes, responsabilités et surtout le déroulement
de cette grande affaire criminelle. Il était difficile d'imaginer que
si peu de personnes avaient pu agir aussi froidement et l'on imaginait
la participation plus importante des Parisiens. Dans la nuit
du 23 au 24 août
se produisit un des pires drames
de l'époque, son annonce était lancée au son des cloches de
l'église
Saint-Germain-de l'Auxerrois. Des Parisiens du peuple, des bourgeois de
religion
catholique appuyèrent l'exaction qui provoqua environ 3.000 victimes
Protestantes ou assimilées à des hérétiques (à l'échelle du pays 10.000
morts).
|
|

Tableau de François Dubois, protestant, qui échappa
aux massacres et se réfugia à Genève.
|
|
|
Quelques heures plus tôt s'était tenu le Conseil du roi Charles IX en
présence de dignitaires et de la reine mère. Cette nuit de la
Saint-Barthélemy
fut
suivie d'autres atrocités dans une bonne partie du royaume et perdura
plusieurs jours dans la capitale, jusqu'au 29 août. Les massacres à Orléans commencèrent le lendemain et durèrent de même,
et la même chose dans une dizaine de grandes villes, dont Lyon et
Toulouse.
|
Ce fut ainsi l'occasion
d'éliminer ses voisins, ses parents ou ses proches indésirables, et qui
furent les commanditaires? Ce
qui a été longtemps une énigme commence à trouver des réponses et des
éléments de preuve à travers les actes notariés, et des travaux
récents (*).
Catherine de Médicis a été plutôt et tout au long de sa vie,
vecteur d'unité
et de paix
pour le royaume, et la responsable toute désignée, du moins
très surestimée dans les guerres civiles.
Il est toutefois possible
qu'elle fut, du moins son fils Charles à l'origine du massacre. Après
avoir été donné l'ordre
d'éliminer une vingtaine de chefs militaires huguenots, il n'avait pas
été prévu que les meurtres pouvaient prendre une telle ampleur et aller
très au-delà des consignes.
« Jour qui avec horreur parmi les
jours se comptent,
Qui se
marque de rouge et rougit de sa honte ».
Les tragiques d'Agripa d'Aubigné (1552-1630)
|
|
Il fut question d'une Seine
rougeoyant du sang des cadavres (et peut renvoyer à d'autres pages
sombres de la ville), et ce fut à la hauteur de l'île Maquerelle
(des Cygnes aujourd'hui) qu'un bon millier de cadavres s'agglutinèrent
sur un méandre du fleuve. A noter que les corps subirent de nombreuses
mutilations ou un acharnement particulier. Cela a été l'œuvre d'une
vingtaine de miliciens Parisiens qui agirent et tuèrent sans trouver de
résistance, pour la simple raison que les Protestants étaient habitués
à être
persécutés par les mêmes et envoyés en prison si besoin était, et ils
n'avaient
pas envisagé d'être si lâchement attaqués. Certains trouvèrent de
l'aide et furent cachés durant les massacres. A Clermont,
il ne fut procéder qu'à
des arrestations et il n'a été occasionné aucun crime pour fait de
religion. Il
s'ensuivit cependant qu'un nombre important à l'échelle du royaume de réformés se convertirent
au
catholicisme, environ 100.000 personnes. Les huguenots représentaient environ
10% de la population
française sur 20 millions d'âmes et ils étaient environ 15.000 à vivre dans la capitale.
|
|
 |
|
« Le
lendemain de la Saint-Barthélemy, environ midi, on vit une aubépine
fleurie au cimetière Saint-Innocent. Si tôt que le bruit en fut répandu
par la ville, le peuple de Paris y accourut de toutes parts en si
grande foule, qu'il fallait y poser des gardes à l'entour on commença
aussi à crier miracle, et à carillonner et sonner les cloches de joie.
Le peuple mutiné, pensant que Dieu par ce signe approuva leurs
massacres, recommencèrent de plus belle sur les huguenots et s'en
allant au logis de l'Amiral (Gaspard de
Coligny) après avoir coupé le nez, les
oreilles et parties honteuses à ce pauvre corps, le traînèrent
furieusement à la voirie ; et parce qu'il y avait tout plein de
catholiques qui interprétaient le reverdissement de l'aubépine pour le
reverdissement de l'état de France, et embrouillaient le papier, un
méchant huguenot caché, qui se fut volontiers aidé s'il eût pu d'autre
chose que de la plume, (...) qui nonobstant le temps coururent
incontinent par tout Paris et ailleurs ».
Ci-contre,
tableau du meurtre de l'amiral de Coligny
|
|
« Un
coquin nommé Thomas, vulgairement appellé le Tireur d'or, tua en sa
maison un nommé Rouillard, conseiller en la cour de parlement, et
chanoine de Notre-Dame, encore qu'il fut bon catholique, témoin son
testament trouvé après sa mort ; et après l'avoir gardé trois jours lui
couppa la gorge, et le jeta en l'eau par une trappe qu'il avait en sa
maison. Ce bourreau, autorisé du Roi et des plus grands, chose horrible
à voir, se vantait publiquement des grands meurtres qu'il faisait
journellement des huguenots, et d'en avoir tué de sa main pour un jour
jusques à quatre-vingts mangeait ordinairement avec les mains et bras
tout sanglants, disant que ce lui était honneur, pour ce que ce sang
était sang d'hérétique. (Ce qui serait mal aisé à croire si on ne
l'avait vu et entendu de sa propre bouche) La Reine mère, pour
repaître ses yeux, fut voir le corps mort de l'amiral pendu au gibet de
Montfaucon, et y mena ses fils, sa fille et son gendre. »
Mémoires et journal de Pierre de l'Estoile
(1546-1611)
|
|
|
Denis
Crouzet, prof. d'histoire moderne à l'Université Paris-Sorbonne - FMSH
Productions - durée 48 minutes
|
|
Jérémie Foa, maître de conférences à Aix-Marseille Université (laboratoire TELEMMe) - durée 46 minutes
|
|
|
|
|
|
|
|
Cet espace d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|











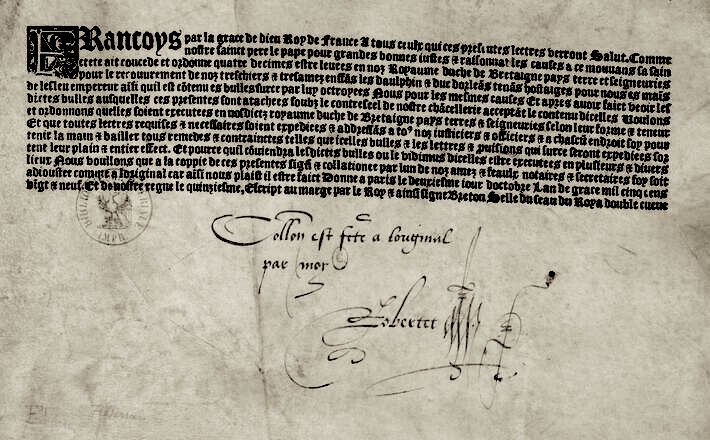







 L'hôtel de Ville sous Henri IV
L'hôtel de Ville sous Henri IV
 Notice sur
Etienne Jodelle,
Notice sur
Etienne Jodelle,