|
|
|
|
| Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil |
|
|
 Sommaire
de la page, Sommaire
de la page,
- Courte biographie d'Eduardo
Galeano
- L'empire de la
consommation, par
Eduardo Galeano
- Découverte de
l'Amérique et histoire officielle, par
Eduardo Galeano
- Nuestra
America : pour une
Amérique latine solidaire, par Jean St-Victor
- Les
"oublis" de l'histoire officielle, mémoires et
malmémoires, par
Eduardo Galeano
- Tous les mondes
d'Eduardo Galeano, propos
recueillis par par
Niels Boel
|
|
|
|
|
Courte
Biographie d'Eduardo
Galeano
Il
est
né à Montevideo (photo
ci-contre),
en Uruguay, en 1940.
Il étaut
écrivain et journaliste. Il a
fondé et dirigé plusieurs journaux et revues en
Amérique
latine . En 1973, il s’était exilé en Argentine puis
en Espagne. Il était
retourné vivre en Uruguay en 1985. Son
œuvre la plus connue, "Les veines ouvertes de
l'Amérique latine" est un
ouvrage retraçant depuis le XVe siècle
l'exploitation sociale et
économique de l'Amérique latine, par l'Europe et
plus tardivement des Usa. Il a collaboré au sein de magazines: The
Progressive
(Usa) et
New Internationalist (GB). Il a aussi publié dans Monthly
Review et
The Nation, (Usa). Il faisait partie des 19 personnalités qui
ont proposé
et signé le manifeste de Porto Alegre. Il est décédé le 13 avril
2015.
|
 |
|
|
L’empire
de la consommation
par Eduardo Galeano

photo : vrm.org.uy
La
société de consommation est un piège
pour attrape nigauds.
La
bamboche étourdit et trouble la vue ; cette immense ivresse
universelle semble sans limites dans le temps et dans
l’espace.
Mais la culture de la consommation fait beaucoup de bruit, comme le
tambour, parce qu’elle est creuse et quand vient
l’heure de
vérité, quand cesse le charivari et que
s’achève la fête, l’ivrogne se
réveille, seul, en compagnie de son ombre et des pots
cassés qu’il lui faut payer. L’expansion
de la
demande butte contre les frontières que lui impose ce
même
système qui la génère. Le
système a besoin
de marchés de plus en plus ouverts et de plus en plus vastes
comme les poumons ont besoin d’air et, en même
temps, le
système a besoin de voir se traîner à
ras de terre,
comme ils se traînent effectivement, les prix des
matières
premières et de la force de travail humain. Le
système
parle au nom de tous, c’est à tous qu’il
s’adresse, c’est à tous qu’il
donne
l’ordre impératif de consommer, qu’il
communique la
fièvre acheteuse, mais pas moyen : presque pour tout le
monde,
cette aventure commence et se termine sur l’écran
du
téléviseur. La majorité des gens, qui
s’endettent pour avoir des choses, finissent par
n’avoir
rien d’autre que des dettes qui
génèrent de
nouvelles dettes et ils finissent par consommer des rêves que
parfois ils matérialisent en sombrant dans la
délinquance.
Le
droit au gaspillage, qui est le privilège d’une
minorité, prétend être la
liberté de tous.
Dis-moi combien tu consommes et je te dirai combien tu vaux. Cette
civilisation prive de sommeil les fleurs ; les poulets, les gens. Dans
les serres, les fleurs sont soumises à un
éclairage
permanent pour qu’elles poussent plus vite. Dans les
élevages industriels de poulets, les poules pondeuses aussi
ignorent ce qu’est la nuit. Et les gens sont
condamnés
à l’insomnie à cause de
l’anxiété que leur causent leur envies
d’achats et de l’angoisse que leur cause la
nécessité d’avoir à les
payer. Ce mode de
vie n’est pas bon pour les gens, mais il est excellent pour
l’industrie pharmaceutique.
Les Etats-Unis
consomment la
moitié des sédatifs, des anxiolytiques et autres
drogues
chimiques vendues légalement dans le monde et plus de la
moitié des drogues interdites vendues
illégalement, ce
qui n’est pas de la roupie de sansonnet si on
considère
que les Etats-Unis comptent pour à peine 5 % de la
population
mondiale.
"Malheureux ceux qui vivent en se
comparant", dit avec
regret une dame du quartier du Buceo, à Montevideo. La
douleur
de n’être plus, chantée jadis dans le
tango, a fait
place à la honte de ne pas posséder. Un homme
pauvre est
un pauvre homme. « Quand tu n’as rien, tu penses
que tu ne
vaux rien », dit un jeune du quartier Villa Fiorito,
à
Buenos Aires. Et un autre, dans la ville dominicaine de San Francisco
de Macorís, constate: «Mes frères
travaillent
pour les marques. Il passent leur vie à acheter des
étiquettes et ils suent sang et eau pour payer les
mensualités».
Invisible
violence du marché
: la diversité est l’ennemie de la
rentabilité et
l’uniformité commande. La production en
série,
à une échelle gigantesque, impose partout ses
obligatoires règles de consommation. Cette dictature de
l’uniformisation obligatoire est plus dévastatrice
que
n’importe quelle dictature à parti unique : elle
impose,
dans le monde entier, un mode de vie qui reproduit les êtres
humains comme autant de photocopies du consommateur modèle.
Le
consommateur modèle c’est l’individu
immobile. Cette
civilisation qui confond la quantité avec la
qualité,
confond l’obésité avec la bonne
alimentation.
D’après la revue scientifique The Lancet, durant
la
dernière décennie, le nombre de cas d’
«
obésité sévère »
ont augmenté
de presque 30 % parmi la population jeune des pays les plus
développés. Chez les enfants
nord-américains,
l’obésité a augmenté de 40%
au cours des 16
dernières années, selon une enquête
récente
du Centre des Sciences de la Santé de
l’Université
du Colorado. Le pays qui a inventé la nourriture et les
boissons
light, les diet food et les aliments fat free, a le plus grand
pourcentage d’obèses au monde. Le consommateur
modèle ne descend de sa voiture que pour travailler et pour
regarder la télévision. Assis devant le petit
écran, il passe 4 heures, chaque jour, à
dévorer
une nourriture en plastique.
C’est le
triomphe de la
saleté déguisée en nourriture : cette
industrie
est en train de conquérir les palais du monde entier et elle
réduit en miettes les traditions culinaires locales. Les
coutumes du bien manger qui viennent de loin, sont le
résultat,
dans certains pays, de milliers d’années de
raffinement et
de diversité et elles sont un patrimoine collectif qui se
trouve
en quelque sorte sur les fourneaux de tous et pas seulement sur la
table des riches. Ces traditions, ces signes
d’identité
culturelle, ces fêtes de la vie, sont en train
d’être
liquidées, de façon foudroyante, par
l’imposition
du savoir chimique et unique : la mondialisation du hamburger, la
dictature du fast-food. La plastification de la nourriture à
l’échelle mondiale, ouvre de McDonald’s,
Burger King
et autres usines, viole avec succès le droit à
l’autodétermination de la cuisine : droit
sacré
parce ce que c’est dans la bouche que se trouve une des
portes de
l’âme.
Le championnat mondial de
football de 1998
nous a confirmé, entre autres choses, que la carte de
crédit MasterCard tonifie les muscles, que Coca-Cola donne
la
jeunesse éternelle et que le menu de McDonald’s ne
saurait
être absent de l’estomac d’un bon
athlète.
L’immense armée de McDonald’s bombarde
de hamburgers
les bouches des enfants et des adultes sur toute la surface de la
planète. La double arche de ce M a servi de
bannière dans
la récente conquête des pays de l’Europe
de
l’Est. Les queues devant le McDonald’s de Moscou
ouvert en
1990, en grande pompe, ont symbolisé la victoire de
l’Occident aussi éloquemment que la chute du Mur
de Berlin.
Signe
des temps : cette firme qui incarne les vertus du « monde
libre
» refuse à son personnel le droit de se syndiquer
à
un syndicat quelconque. McDonald’s viole, ainsi, un droit
légalement reconnu dans beaucoup des pays où il
opère. En 1997, quelques travailleurs, membres de ce que la
firme appelle la Macfamille, on essayé de se syndiquer.
C’était dans un restaurant MacDonald’s
de
Montréal, au Canada : le restaurant a fermé.
Mais, en
1998, d’autres employés de McDonald’s,
dans une
petite ville près de Vancouver, ont réussi cet
exploit
digne du Guide Guinness des records.
Les masses des
consommateurs reçoivent des ordres dans une langue
universelle :
la publicité a réussi ce que
l’espéranto
avait voulu faire mais n’a pas réussi à
faire.
N’importe qui, partout dans le monde, comprend les spots
publicitaires émis par le téléviseur.
Au cours de
ce dernier quart de siècle, les dépenses
publicitaires
ont été multipliées par deux dans le
monde.
Grâce à cela, les enfants pauvres boivent de plus
en plus
de Coca-Cola et de moins en moins de lait et le temps de loisir se
transforme en temps de consommation. Temps libre, temps prisonnier :
dans les maisons très pauvres, il n’y a pas de
lit, mais
il y a une télévision et la
télévision est
douée de la parole. Acheté à
crédit, cet
animal familier prouve la vocation démocratique du
progrès : il n’écoute personne, mais il
parle pour
tous. Les pauvres et les riches connaissent, de ce fait, les
qualités des automobiles dernier modèle et les
pauvres et
les riches sont informés des avantageux taux de
crédit
que propose telle ou telle banque.
Les experts
savent
transformer les marchandises en panoplies magiques contre la solitude.
Les choses ont des attributs humains : elles caressent, accompagnent,
comprennent, aident ; le parfum te donne son baiser et la voiture est
ton amie qui jamais ne te trahira. La culture de la consommation a fait
de la solitude le plus lucratif des commerces. Les trous de la
poitrine, on les colmate en les bourrant de choses ou en
rêvant
de le faire.
Et les choses peuvent faire plus
qu’embrasser
: elles aussi peuvent être des symboles d’ascension
sociale, des laissez-passer pour franchir les barrières
douanières de la société de classes,
des
clés qui ouvrent des portes interdites. Plus elles sont
exclusives, plus c’est parfait : les choses te choisissent et
te
sauvent de l’anonymat de la multitude. La
publicité ne
nous renseigne pas sur le produit qu’elle vend, sauf
exception.
C’est sans importance. Sa fonction première
consiste
à compenser des frustrations et à nourrir des
rêves. Qui voulez-vous devenir en achetant cette lotion
«
après rasage »?
Le
criminologue Anthony Platt a
remarqué que la délinquance urbaine
n’est pas
seulement la conséquence de la pauvreté
extrême.
Elle est aussi le fruit de la morale individualiste.
L’obsession
sociale du succès de la réussite, dit Platt, a
une
incidence décisive sur l’appropriation
illégale des
choses.
J’ai toujours entendu dire que
l’argent
n’apporte pas le bonheur, mais tout
téléspectateur
pauvre a bien plus de raisons qu’il ne lui en faut pour
croire
que l’argent procure quelque chose de tellement ressemblant
au
bonheur que seuls des spécialistes peuvent voir la
différence.
Selon l’historien
Eric Hobsbawm, le
XXº siècle a mis fin à sept mille ans de
vie humaine
centrée sur l’agriculture depuis que sont apparues
les
premières cultures, à la fin du
paléolithique. La
population mondiale s’urbanise, les paysans deviennent
citadins.
En Amérique Latine, nous avons des campagnes sans personne
et
d’énormes fourmilières urbaines : les
plus grandes
villes du monde et les plus injustes. Expulsés par
l’agriculture moderne d’exportation et par
l’érosion de leurs sols, les paysans envahissent
les
faubourgs. Ils croient que Dieu est partout, mais ils savent
d’expérience qu’il n’est en
service que dans
les grandes villes. Les villes promettent du travail, la
prospérité, un avenir pour les enfants. Dans les
champs,
les êtres en attente regardent passer la vie et meurent en
baillant ; dans les villes, la vie est là et elle vous
appelle.
Entassés dans des taudis, la première chose que
découvrent les derniers arrivés c’est
que le
travail n’est pas là et que les bras sont de trop,
que
rien n’est gratuit et que les articles de luxe les plus chers
sont l’air et le silence.
A
l’aube du XIVº
siècle, fray Giordano da Rivalto prononça,
à
Florence, une apologie des villes. Il déclara que
« les
villes grandissent parce que les gens aiment s’assembler
»
S’assembler, se rencontrer. Aujourd’hui, qui
rencontre qui
? Est-ce que l’espoir rencontre la
réalité ? Le
désir, rencontre-t-il le monde ° ? Et les gens,
rencontrent-ils les gens ? Si les relations humaines ont
été réduites à des
relations entre des
choses, combien de gens rencontrent-ils des choses ?
Le
monde
tout entier tend à se transformer en un immense
écran de
télévision où on regarde les choses
sans les
toucher. Les marchandises exposées à la vente
envahissent
et privatisent les espaces publics. Les gares routières et
les
gares de chemin de fer qui, il y a peu encore, étaient des
lieux
de rencontre entre les gens, deviennent désormais des
espaces
d’exposition commerciale. Le shopping center, ou shopping
mall,
vitrine de toutes les vitrines, impose sa présence
envahissante.
Les foules accourent en procession dans ce grand temple des messes de
la consommation. La majorité des dévots
contemplent, en
extase, les choses que leurs poches ne peuvent pas payer pendant que la
minorité acheteuse se soumet au bombardement de
l’offre
incessante et exténuante. La foule qui monte et descend par
les
escalators, voyage à travers le monde : les mannequins sont
habillés comme à Paris ou à Milan et
les machines
à sous tintent comme à Chicago et, pour voir et
entendre,
nul besoin de payer un billet d’avion. Les touristes venus
des
villages de l’arrière pays ou des villes qui
n’ont
pas encore mérité ce don du ciel de la
félicité moderne, posent pour la photo au pied
des
marques internationales les plus célèbres comme
elles
posaient, jadis, au pied de la statue du personnage illustre au centre
de la place. Beatriz Solano a observé que les habitants des
quartiers périphériques se rendent au center, au
shopping
center, comme, jadis, ils allaient au centre ville. Le traditionnel
paseo (promenade) du dimanche après-midi sur la grande place
centrale de la ville tend à être
remplacé par
l’excursion à ces centres commerciaux.
Lavés,
repassés et peignés, habillés avec
leurs plus
beaux atours, les visiteurs se rendent à une fête
à
laquelle ils ne sont pas invités, mais où ils
peuvent
être voyeurs. Des familles entières font le voyage
dans le
vaisseau spatial qui parcourt l’univers de la consommation
où l’esthétique du marché a
dessiné
un paysage hallucinant de modèles, de marques,
d’étiquètes.
La
culture de la consommation,
culture de l’éphémère,
condamne tout
à l’oubli médiatique. Tout change au
rythme
vertigineux de la mode mise au service de la
nécessité de
vendre. Les choses vieillissent en un clin d’oil pour
être
remplacées par d’autres choses de vie
éphémère. Aujourd’hui
où la seule
chose qui demeure c’est
l’insécurité, les
marchandises fabriquées pour ne pas durer,
résultent
aussi volatiles que le capital qui les finance et que le travail qui
les produit. L’argent vole à la vitesse de la
lumière : hier il était là-bas,
aujourd’hui
il est ici, demain qui sait ?, et tout travailleur est un
chômeur
en puissance. Paradoxalement les shoppings centers, royaumes de
l’éphémère, offrent la plus
excitante
illusion de sécurité. Ils résistent
hors du temps.
Sans âge et sans racines, sans nuit et sans jour et sans
mémoire, ils existent hors de l’espace, au
delà des
turbulences de la dangereuse réalité du monde.
Les
maîtres du monde se servent du monde comme si on pouvait
l’éliminer : une marchandise
éphémère
qui s’évanouit comme
s’évanouissent, à
peine sont-elles nées, les images avec lesquelles la
télévision nous mitraille et les modes et les
idoles
lancées sur le marché, sans trêve, par
la
publicité.
Mais dans quel autre monde
allons-nous
déménager ? Sommes-nous tous obligés
de gober la
fable selon laquelle Dieu a vendu notre planète à
un
petit nombre de firmes parce qu’un jour de mauvaise humeur il
a
décida de privatiser l’univers ? La
société
de consommation est un piège attrape nigauds. Ceux qui sont
aux
manettes font semblant de l’ignorer, mais quiconque a des
yeux
pour voir peut voir que l’immense majorité des
gens
consomment peu, très peu ou nullement de manière
nécessaire, pour préserver l’existence
du peu de
nature qu’il nous reste encore. L’injustice sociale
n’est pas une erreur qu’il faut corriger, ni un
défaut qu’il faut surmonter : c’est une
nécessité essentielle. Une nature capable
d’approvisionner un shopping center de la taille
d’une planète n’existe pas.
Source
: février
2007 - traduction
: Manuel Colinas, visions alternatives
|
|
|
|
12
octobre 1492 :
Découverte
de
l’Amérique
& Histoire
officielle :
Faces
et masques

par Eduardo Galeano
Christophe
Colomb a-t-il découvert l’Amérique en
1492 ? Ou bien ce sont les
Vikings qui l’ont découverte avant lui ? Mais,
avant les Vikings, ceux
qui vivaient là, n’existaient-ils donc pas ?
L’Histoire
officielle
nous raconte que Vasco Núñez de Balboa a
été le premier qui a vu les
deux océans du haut d’une montagne du Panama. Mais
ceux qui vivaient
là, étaient-ils donc aveugles ?
Qui
a donné leurs premiers noms au
maïs ; et là la patate, et à la tomate,
et au chocolat, et aux
montagnes, et aux fleuves de l’Amérique ? Hernan
Cortés ? Francisco
Pizarro ? Mais ceux qui vivaient là, étaient-ils
donc muets ?
On
nous a dit et on continue de nous dire que les émigrants du
Mayflower
sont venus peupler l’Amérique. Mais
l’Amérique était-elle donc
inhabitée ?
Comme Christophe Colomb ne
comprenait pas ce que les Indiens lui disaient, il a cru
qu’ils ne savaient pas parler.
Comme
ils étaient nus, comme ils étaient pacifiques et
comme ils donnaient
tout en échange de rien, il a cru qu’ils
n’avaient pas d’intelligence.
Et
comme il était sûr d’être
entré en
Orient par la porte de derrière, il a cru qu’il
était en présence d’Indiens de
l’Inde.
Ensuite,
au cours de son second voyage, l’Amiral a dicté un
arrêté qui stipulait que Cuba était une
partie de
l’Asie.
Ce
document est daté du 14 juin 1494 et il stipule que les
équipages de
ses trois caravelles reconnaissent que telle est la
vérité et que
quiconque osera soutenir le contraire sera condamné
à cent coups de
fouet, à dix mille maravédis d’amende
et à avoir la langue tranchée.
Le
notaire, Hernan Pérez de Luna, a signé
l’acte et au
bas de la page ont signé aussi les marins qui savaient
signer.
Les
conquistadors exigeaient que l’Amérique
fût ce qu’elle n’était pas.
Ils
ne voyaient pas ce qu’ils voyaient, mais ce qu’ils
voulaient voir : la
fontaine de jouvence, la ville de l’or, le royaume des
émeraudes, le
pays de la cannelle. Et ils ont décrit les
Américains comme ils avaient
cru, auparavant, qu’étaient les païens
d’Orient.
Christophe Colomb a
vu, sur les côtes de Cuba, des sirènes avec des
visages d’homme et des
plumes de coq, et puis il a été convaincu que,
non loin de là, les
hommes et les femmes avaient tous une queue.
En Guyane, selon
Sir Walter Raleigh, les gens avaient les yeux sur les
épaules et la bouche au milieu de la poitrine.
Au
Venezuela ; selon Frère Pedro Simón, il y avait
des
Indiens avec des oreilles si longues qu’elles
traînaient
par terre.
Sur
les rives du fleuve Amazone, selon Cristóbal de
Acuña, les natifs
avaient les pieds à l’envers, avec les talons
devant et les orteils
derrière et, selon Pedro Martín de
Anglería, les femmes se mutilaient
un sein pour pouvoir tirer à l’arc plus facilement.
Anglería
qui a
écrit la première histoire de
l’Amérique, mais qui n’y a jamais mis
les
pieds, a aussi affirmé que dans le Nouveau Monde il y avait
des gens
avec des queues, comme Christophe Colomb l’avait dit, et que
leurs
queues étaient si longues qu’ils ne pouvaient
s’asseoir que sur des
sièges percés.
Le Code Noir
interdisait la torture des esclaves des
colonies françaises. Mais si les maîtres
fouettaient leurs noirs ce
n’était pas pour les torturer, mais pour les
éduquer et quand ils
s’enfuyaient, ils leur coupaient les tendons.
Elles
étaient
émouvantes les lois des Indes qui protégeaient
les indiens dans les
colonies espagnoles. Mais bien plus émouvants encore
étaient le pilori
et le gibet plantés au centre de chaque Grand Place du
Centre Ville.
Elle
était rudement persuasive la lecture de la sommation qui
à la veille de
tout assaut livré à toute bourgade expliquait aux
Indiens que Dieu
était venu sur Terre et qu’il avait mis
à sa place Saint Pierre et que
Saint Pierre avait pour successeur le Saint Père et que le
Saint Père
avait fait don à la reine de Castille de tout ce territoire
et que
c’était pour cela qu’ils devaient
quitter les lieux ou payer un tribut
en or et que s’ils refusaient ou s’ils tardaient
à s’exécuter bataille
leur serait livrée et qu’ils seraient faits
esclaves, eux, mais aussi
leurs femmes et leurs enfants. Malheureusement cette sommation
était
lue en rase campagne, à l’extérieur du
bourg, en pleine nuit, en langue
castillane et sans interprète, en présence du
notaire, mais sans la
présence d’un seul Indien parce que les Indiens,
à cette heure-là, ils
dormaient à quelques lieues de là sans se douter
le moins du monde de
ce qui allait leur tomber dessus.
Jusqu’à
il n’y a pas très longtemps, le 12 octobre
c’était le Jour de la Race. Mais est-ce
qu’une telle
chose existe?
Qu’est ce que la race ?
Est-ce autre chose qu’un mensonge utile pour
dépouiller et exterminer son prochain ?
En
1942, quand les Etats-Unis sont entrés en guerre, la Croix
Rouge de ce
pays a décidé que le sang noir ne serait pas
accepté dans ses banques
du sang. On évitait ainsi que le mélange des
races, interdit au lit, se
fît par voie d’injection. Mais quelqu’un
a-t-il jamais vu du sang noir ?
Ensuite,
le Jour de la Race est devenu le Jour de la Rencontre. Est-ce que les
invasions coloniales sont des rencontres ? Celles de hier et celles
d’aujourd’hui, ce sont des rencontres ? Ne faut-il
pas les appeler
plutôt des viols?
Peut-être
l’épisode le plus révélateur
de
l’histoire de l’Amérique est-il advenu
en l’année 1563, au Chili. Le
fortin de Arauco était alors assiégé
par les Indiens ; la garnison
n’avait plus ni vivres ni eau, mais le capitaine, Lorenzo
Bernal,
refusait de se rendre. Du haut de la palissade, il cria :
-
Nous,
nous serons de plus en plus nombreux !
- Avec
quelles femmes ? demanda
le chef indien.
- Avec les vôtres.
Nous
leur ferons des enfants qui
deviendront vos maîtres.
Les envahisseurs
ont appelé cannibales les
anciens Américains, mais plus cannibale encore
était le Cerro Rico de
Potosí dont les puits de mine dévoraient de la
chair indienne pour
alimenter le développement du capitalisme de
l’Europe.
Et on les a
appelés idolâtres parce qu’ils croyaient
que la nature est sacrée et
que nous sommes tous frères de tout ce qui a des jambes, des
pattes,
des ailes ou des racines.
Et on les a
appelés sauvages. Sur ce point
au moins ils ne se sont pas trompés, car ces Indiens
étaient tellement
ignorants qu’ils ne savaient pas qu’il leur fallait
demander un visa,
un certificat de bonne conduite et un permis de travail à
Christophe
Colomb, à Cabral, à Cortés,
à Alvarado, à Pizarro et aux émigrants
du
Mayflover.
Source
: Traduction
Manuel Colinas -
Rebellion.org
|
|
|
Nuestra
América
:
Pour
une
Amérique latine
solidaire
Par
Alain St.-Victor
|

|
Il
y a trente-cinq ans, l’écrivain uruguayen, Eduardo
Galeano, publiait Les veines ouvertes de
l’Amérique Latine [1],
ouvrage percutant,
dont le titre seul résume la grande tragédie des
peuples
du continent ibérique. Ce livre, traduit dans plusieurs
langues
et publié à plusieurs millions
d’exemplaires,
retrace l’histoire des peuples de ce «
sous-continent
», dont les luttes pour la liberté, la
dignité, la
souveraineté se renouvellent sans cesse, et, cela,
malgré
les génocides et les massacres.
Galéano
nous dit avoir écrit ce livre pour « converser
avec chacun
¦avec l’intention de divulguer certains faits que
l’histoire officielle, racontée par les
vainqueurs, cache
ou déforme » (p.363). L’histoire
officielle jouit
jusqu’à présent d’une
certaine
pérennité, mais ces faits cachés ou
déformés « sortent maintenant au grand
jour
», sautent aux yeux et s’imposent comme une
évidence
: « l’Amérique Latine a
été
l’objet depuis plus de cinq cents ans d’un pillage
systématique depuis la découverte
jusqu’à
nos jours, tout s’y est toujours transformé en
capital
européen ou, plus tard nord-américain. Tout : la
terre,
ses fruits et ses profondeurs riches en minerais, les hommes et leur
capacité de travail et de consommation, toutes les
ressources
naturelles et humaines. Les modes de production et les structures
sociales de chaque pays ont été successivement
déterminés de l’extérieur en
vue de leur
incorporation à l’engrenage universel du
capitalisme
» (p.10).
Certes,
il faut éviter les formules toutes faites et ne pas tomber
dans
une analyse simpliste qui tend à vider les pays
latino-américains de leur spécificité
et les
considérer comme un bloc homogène,
indifférencié. Toutefois, la
réalité de ces
peuples relève d’une constance qui se traduit sur
le plan
économique par l’incapacité chronique
de sortir du
sous-développement, de satisfaire les besoins
élémentaires de la grande majorité, et
cela
malgré que certains pays (en particulier le Mexique,
L’Argentine, le Brésil) disposent
d’immenses
richesses naturelles et de main-d’œuvre
qualifiée.
L’histoire
récente de l’Amérique latine fourmille
d’exemples et de statistiques qui illustrent clairement cette
apparente impossibilité de créer un
système
socio-économique qui puisse satisfaire aux besoins des
populations et même de garantir sa propre reproduction. En
1978,
« une étude de l’Organisation Mondiale
du Travail
signalait qu’en Amérique latine plus
de cent dix millions de personnes vivent dans des conditions de
pauvreté grave 42% des Brésiliens, 43%
des
Colombiens, 49% des Honduriens, 31% des Mexicains, 45% des
Péruviens, 29% des Chiliens et 35% des Equatoriens
perçoivent des revenus inférieurs au prix de
l’alimentation équilibrée minimale
»(Les
veines ouvertes, postface de l’édition de 1981).
Qu’en
est-il aujourd’hui ? Selon une étude
publiée par la
Banque Mondiale (rapport annuel 2004), sur les 400 millions
d’habitants que compte l’Amérique
latine, plus de
50% vivent dans la pauvreté, 226 millions vivent avec moins
de
deux dollars par jour, un tiers des enfants ont faim, et chaque
année 190 000 d’entre eux meurent de maladies
liées
à la malnutrition.
Pour
Emir Sader, professeur de sociologie à
l’université
d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ), ces faits récents
constituent « le bilan synthétique de
l’application,
durant ces deux dernières décennies, des
politiques
libérales dans ce continent [2] ».
Ces politiques libérales imposées par le FMI
avaient pour
objectif de faire diminuer la pauvreté en
relançant la
croissance, mais, comme ce fut le cas du Mexique au début
des
années 80 [3],
croissance économique ne signifie pas
nécessairement
développement économique : ce dernier
nécessite
avant tout une certaine répartition des richesses et des
conditions de travail (juridiques et matérielles) sans
lesquelles les forces productives ne puissent se reproduire de
façon décente et efficace.
Problématique
Or,
(il est important de le répéter) le
véritable
enjeu pour les peuples de l’Amérique latine et la
plupart
des peuples du « tiers monde » est bel et bien les
questions de la répartition des richesses et de la justice
sociale. Ces questions sont d’autant plus importantes que
l’Amérique latine se trouve à un moment
historique
où tout son avenir semble dépendre du choix
fondamental
de se remettre en question, de se prendre en main,
c’est-à
-dire avant tout redéfinir sa place et sa fonction sur la
scène internationale.
Bien
entendu, les problèmes internes restent
déterminants, car
on ne peut commencer à élaborer une politique
économique visant à satisfaire les besoins
fondamentaux
des populations, sans poser du même coup le
problème des
structures sociales qui ont historiquement reproduit la
misère,
l’exploitation et l’exclusion
Toutefois,
pour comprendre ces structures internes, il est nécessaire
de
prendre en compte les mécanismes de la domination
étrangère, le colonialisme d’abord et
l’impérialisme ensuite, car elles y sont
liées de
manière structurelle, comme l’ont
montré depuis
longtemps déjà plusieurs analystes, en
particulier
André Gunder Frank. La réalité du
«
sous-développement » de
l’Amérique latine ne
renvoie pas, écrit Frank, à la
réalité
d’une Europe pré-capitaliste, laquelle
était
à cette époque
non-développée et non pas
sous-développée.
Le
« sous-développement n’est pas le
résultat de
la survivance d’institutions archaïques et de manque
de
capitaux dans des régions restées
isolées du
courant historique mondial. Au contraire, le
sous-développement
fut et est encore généré par le
même
processus historique qui a du même coup
généré le développement
économique :
le développement du capitalisme lui-même
[4] ».
Si
en Amérique latine et par extension dans tous les pays
«
sous-développés », la perception des
problèmes économiques est liée
à une
compréhension « étapiste » de
l’histoire [5], compréhension
selon laquelle les pays du « tiers monde » sont des
pays
« attardés » qui doivent «
rattraper »
les pays « avancés » de
l’Europe et de
l’Amérique du Nord (excluant le Mexique),
c’est pour
masquer le fait que dans le cadre du capitalisme mondial les
phénomènes du développement et du
sous-développement économiques sont en
réalité consubstantiels, qu’il ne
s’agit pas
de deux phénomènes isolés.
Or,
si le problème du sous-développement des pays du
Sud est
historiquement lié à l’expansion du
capitalisme et
si ces pays constituent véritablement la
périphérie des pays industrialisés
(périphérie dans le sens qu’ils servent
les
intérêts du centre que forment les pays
industrialisés), alors la compréhension des
problèmes structurels de ces pays passe avant tout par
l’analyse des formes historiques de la domination
étrangère. Plusieurs études ont
été
faites à ce sujet [6] et
il serait inopportun ici d’en rappeler toutes les
thèses ;
néanmoins aujourd’hui ce qui semble de plus en
plus
évident pour les peuples du Sud, c’est que depuis
plus de
cinquante ans, tous les programmes proposés par les pays
industrialisés pour les « sortir du
sous-développement » (aide bilatérale,
investissements, programmes d’ajustement structurel, etc.)
ont
tous échoués dans la plupart des pays
visés, et
qu’il en résulte un renforcement de la
dépendance
et de la structure qui reproduit la pauvreté et
l’exclusion.
Penser
sa propre réalité
Aujourd’hui
plus que jamais, il est devenu essentiel pour les peuples du tiers
monde de comprendre leur propre réalité,
d’en
débattre à travers leurs propres organisations et
d’avoir le courage de prendre les solutions qui s’y
imposent. Comme on le sait, la domination
étrangère
n’est pas seulement économique, elle est aussi
idéologique, et il convient de comprendre non seulement les
formes historiques de celle-ci, mais également les efforts
déployés pour combattre
l’aliénation
culturelle et de produire « une pensée pour soi
»
capable de rendre compte de sa propre réalité.
En
Amérique latine, au cours du XIXe siècle, comme
dans
beaucoup de pays qui ont été
colonisés, les
intellectuels des nouvelles classes dirigeantes s’adonnent
à un mimétisme quasi caricatural en reproduisant
de
façon éclectique les idées
à la mode en
Europe, particulièrement le positivisme (surtout dans sa
déviance scientiste), sans chercher à les adapter
à leur propre réalité : il
s’agissait pour
ces intellectuels d’absorber sans aucune critique les
idées européennes de
l’époque, malgré
une certaine volonté de leur part de dépasser la
théologie scolastique de l’époque
coloniale.
Au
cours du XXe, une nette évolution de la philosophie se fait
en
Amérique latine. La réflexion sur la question de
l’identité latino-américaine est
entamée par
certains intellectuels, notamment le Mexicain Léopoldo Zea
(auteur de L’Amérique latine face à son
histoire),
qui voient dans le métissage une particularité
latino-américaine permettant une ouverture sur le monde :
« l’Amérique est latine,
écrit Zéa,
grâce au métissage. Cette Amérique a
rendu possible
l’identité de ce type particulier
d’être
humain grâce auquel Bolivar trouvait ses réponses
relatives à l’identité de la
région un type
particulier d’être humain ouvert à
toutes les
expressions humaines, une humanité ouverte et plurielle
[7]. »
De
cette conception de l’identité
latino-américaine,
à laquelle d’ailleurs souscrivaient plusieurs
intellectuels de renom, parmi lesquels les Mexicains José
Vasconcelos, Alfonso Reyes et Antonio Caso, le Dominicain Pedro Urena,
le Péruvien Manuel Prada, l’Argentin Manuel
Ugarte, etc.,
s’est construite l’idée d’une
seule nation
latino-américaine, chère à Bolivar.
Mais la
question à ce stade reste académique
même
s’il s’agit, comme l’écrit
Zea, «
d’assimiler notre histoire et notre expérience,
quelle que
soit leur apparente négativité, et de
là projeter
notre propre future [8] ».
Pour ces intellectuels la quête de
l’identité est
avant tout une recherche liée à la «
question
ontologique » de l’homme
latino-américain, celle qui
consiste à découvrir sa singularité
dans son
existence concrète afin d’affirmer son
humanité
dans le but avoué de développer « une
relation
horizontale de solidarité avec ses semblables et de renoncer
à la relation verticale de la dépendance, qui
constitue
l’unique problème de la philosophie en
Amérique
latine[9]. »
Les
conflits sociaux qui se développent dans la
région au
cours du siècle, en particulier ceux qui ont trait
à la
justice sociale, la réforme agraire, la lutte contre
l’impérialisme nord-américain
permettent de rendre
compte des limites de cette philosophie «
indigéniste
», d’affirmation de soi. Il ne suffit plus
d’affirmer
sa singularité ; la lutte contre la dépendance
idéologique doit se transformer en une lutte de
libération, plus précisément en une
philosophie de
libération, qui considère « la culture
latino-américaine comme une culture oppressée
[…] et que la tâche
essentielle est
d’élaborer une pensée qui tient compte
des besoins
sociaux [10] ».
Dans
les années 70, particulièrement en Argentine, la
philosophie de libération se transforme en une philosophie
pour
la libération qui s’inscrit
d’emblée dans la
lutte pour les « changements sociaux, la réduction
des
injustices, la satisfaction des demandes sociales, incluant aussi bien
les besoins de base que les transformations structurelles
[11] ».
Ces
questions, bien entendu, dépassent le domaine strictement
philosophique ; elles sont également
déterminantes dans
les productions d’œuvres littéraires,
théologiques, linguistiques, etc. Tous les mouvements
révolutionnaires, toutes les tentatives de
réformer
l’Etat et d’instituer des changements sociaux
(particulièrement par la prise du pouvoir par les
élections, comme ce fut le cas, entre autres, pour les
gouvernements de Jacobo Arbenz au Guatemala et Salvador Allende au
Chili), tout l’effort d’élaborer une
théologie (celle de la libération) qui place le
«
pauvre » au centre de ses préoccupations, le
considérant comme un être oppressé et
non pas
frappé d’une quelconque fatalité, tout
cela
participe de la grande lutte de transformation des
sociétés latino-américaines.
Néanmoins,
la complexité de ces sociétés et les
différents enjeux des réalités
culturelles
hétérogènes qui s’y
rattachent sont tels que
toute approche, préconisant des changements sociaux
importants,
qui n’en tiendraient pas compte, est vouée
à
l’échec. Particulièrement, dans les
pays où
les Indiens représentent une part importante de la
population
(Bolivie, Pérou, Guatemala, Mexique, Equateur), la question
de
l’identité devient incontournable, mais elle est
abordée cette fois, comme l’écrit Yvon
Le Blot,
chercheur au CNRS, dans le cadre d’une «
contestation
culturelle, avec le rejet d’un système de
représentation qui enferme l’Indien dans une image
négative, l’objective et
l’infériorise. [12] »
Pour la première fois en Amérique latine, les
mouvements
indiens, au-delà de leur diversité, prennent part
aux
luttes de libération avec une double exigence :
d’une
part, ils rejettent l’idéologie communautariste
passéiste et du repli sur soi tout en refusant le mythe du
métissage qui est une forme
d’intégration par
assimilation, et, d’autre part, ils
s’écartent de
tous mouvements et états révolutionnaires qui
tendent
à « éliminer les différences
culturelles ou
de les instrumentaliser [13] »
Depuis
les années 90, les mouvements indiens occupent une place
importante dans les luttes de revendication et s’articulent
de
plus en plus, contrairement à ce que pensait la gauche
traditionnelle, à des mouvements
d’émancipation des
masses, comme l’a d’ailleurs remarqué
Alvaro Garcia
Linera, l’actuel vice-président de la Bolivie
[14].
C’est particulièrement dans ce pays que la fusion
entre le
mouvement de revendication des Indiens - celui qui consiste non
seulement à revaloriser la culture et les langues indiennes,
mais aussi à mettre en avant la lutte politique pour la
prise du
pouvoir – et les mouvements sociaux a
connu un
succès important. Ce qui explique d’ailleurs la
montée fulgurante du Mouvement vers le socialisme (MAS) sur
la
scène politique bolivienne et le succès
électoral
d’Evo Morales.
Perspectives
Il
est évident que les luttes populaires et
démocratiques
ont remis en question le rôle traditionnel de
l’Etat dans
certains pays de l’Amérique latine. Non seulement
des
élections libres et démocratiques sont devenues
possibles
(et l’espace politique est de plus en plus investi par les
forces
populaires), mais aussi la prise du pouvoir par certains leaders
charismatiques et populaires permet de reposer sur une base
concrète la question de la redistribution des richesses et
de la
justice sociale. Dans certains pays de l’Amérique
du sud
qui disposent d’énormes ressources naturelles,
l’Etat peut y avoir recours pour mettre en place des
réformes importantes touchant particulièrement la
santé, le logement et l’éducation.
Par
contre en Amérique centrale (particulièrement, le
Nicaragua, le Salvador, le Guatemala) et les Caraïbes
(particulièrement Haïti) la faillite de
l’Etat et la
déchéance de ses institutions, les faibles
ressources
naturelles, l’inexistence d’une bourgeoise
nationale
rendent difficiles sinon impossibles tous projets de
réformes
profondes. Dans ces pays, la crise est telle que tous les
problèmes d’ordre conjoncturel renvoient
à des
problèmes historiques profonds, structurels, et dont la
solution
passerait par une remise en question radicale de l’ordre
économique et social. Mais la déstructuration de
la
société civile, la faiblesse et
l’inorganisation
des mouvements ouvriers et paysans, la misère
endémique,
la criminalisation incontrôlée de la
société
entravent sérieusement le développement
d’un
mouvement populaire structuré qui puissent
concrétiser,
par l’instauration d’un Etat populaire et le
développement des luttes sociales, des changements
réels.
C’est
cette réalité qui constitue surtout la
spécificité des pays les plus pauvres de
l’Amérique centrale et des Caraïbes.
Cette
spécificité n’est certes pas une
fatalité :
les luttes populaires même faibles et inorganisées
restent
possibles et importantes. Mais il est aussi important de
développer entre les peuples latino-américains
des liens
de solidarité, lesquels commencent d’ailleurs
à
voir le jour au niveau des Etats sur l’initiative notamment
des
gouvernements de Cuba et du Venezuela, en particulier à
travers
le projet ALBA (Alternative bolivarienne pour
l’Amérique
latine et les Caraïbes), projet qui propose de «
compenser
les asymétries existantes entre les pays de
l’hémisphère…
corriger les
disparités…[et accorder] la
priorité
à l’intégration
latino-américaine et
à la négociation en blocs
sous-régionaux en
cherchant à identifier non seulement des espaces
d’intérêt commercial, mais aussi des
points forts et
des faiblesses pour construire des alliances sociales et culturelles
[15]. »
On
saura à l’avenir si un tel projet est fiable,
néanmoins les obstacles auxquels il fait face sont de
taille:
d’une part, les Etats-Unis cherche toujours à
mettre en
œuvre la stratégie de la Zone de
libre-échange des
Amériques (ALCA), programme qui lui permettra
d’avoir
accès plus facilement aux matières
premières, aux
ressources naturelles et à la main
d’œuvre bon
marché de l’Amérique latine ;
d’autre part,
l’énorme disparité du point de vue
économique [16] existant
entre certains pays latino-américain peut favoriser le
développement du phénomène du
«
sous-impérialisme »,
phénomène qui commence
d’ailleurs à se concrétiser
considérant
particulièrement le rôle du Brésil, la
plus
puissante nation du sous-continent, qui manifeste des tendances
hégémoniques [17].
Cependant,
on sent à travers les luttes multiformes se dessiner un
autre
horizon pour l’Amérique latine, horizon qui sera
l’œuvre de millions d’hommes et de femmes
qui auront
compris le message de José Marti: « Nous ne
pouvons plus
désormais être ce peuple de feuilles, qui vit dans
les
nuages, la cime chargée de fleurs, craquant ou bruissant
selon
qu’il est caressé par les fantaisies de la
lumière,
ou qu’il est fouetté et saccagé par les
tempêtes ; les arbres doivent former les rangs, pour barrer
la
route au géant des sept lieux ! C’est
l’heure de
l’appel, et de la marche à l’unisson, et
il nous
faut avancer en formation serrée, comme les filons
d’argent au cœur des Andes. »
Notes
:
[1] Galeano, Eduardo,
Les veines ouvertes de l’Amérique Latine,
Librairie Plon, 1981
[2] Sader, Emir,
L’héritage libéral en
Amérique latine, dans www.alencontre.org, 20juillet 2004
[3] Le
Mexique connut une croissance de 6% en 1980 (BM, rapport annuel), mais
cette même année la moitié de sa
population «
ne possédait rien, ne mangeait pas suffisamment, et 19
millions
(sur 35millions) de Mexicains souffrent gravement de la faim
»
voir : Dumont, René et Mottin, Marie-France, Le
mal-développement en Amérique latine, Editions du
Seuil,
1981
[4] Frank,
André Gunder, Capitalism and Underdeloppement in Latin
America,
New York, Monthly Review Press, 1967 (Traduction libre)
[5] L’économiste
Walt Whitman Rostow a systématisé la
théorie de la
croissance par étape. Voir : the stage of economic grow. A
non
communist Manifesto, 1960 (traduction française, Seuil,
Paris
1963)
[6] Pour
une analyse approfondie des formations sociales du capitalisme
périphériques, lire :Amin, Samir,
L’accumulation
à l’échelle mondiale, Critique de la
théorie
du sous-développement, Anthropos, Paris 1970, Le
développement inégal, essai sur les formations du
capitalisme périphérique, les Editions de Minuit,
1973 ou
encore Impérialisme et sous-développement en
Afrique,
Anthropos 1988
[7] Leopoldo
Zea, Identity : a latin american philosophical problem in The
philosophical forum, Fall-Winter 1988-89 (traduction libre)
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Cerrutti-Guldberg,
Actual situation and perspectives of latin american philosophy for
liberation, in The philosophical forum, Fall-Winter 1988-89 (traduction
libre)
[11] Ibid.
[12] Le
Bot, Yvon, Le renversement historique de la question indienne en
Amérique latine, dans Amérique latine : Histoire
et
Mémoire, Les Cahiers ALHIM, novembre 2004.
[13] Ibid.
[14] Alvaro
Garcia Linera : « Nous ne pensons pas au socialisme mais
à
une révolution démocratique
décolonisatrice
profonde » www.risal.collectifs.net , 12 juin 2006
[15] Marcello
Colussi, L’ALBA : une alternative réelle pour
l’Amérique latine, www.risal.collectifs.net , 17
mai 2005
[16] Dans
le cas d’Haïti et de la République
dominicaine, lire
Yves Michel Thomas, Relations haïtiano-dominicaines : trois
éléments de structuration, dans Alterpresse, 30
mars 2006
[17] Raul Zibechi, Le
Brésil et le difficile chemin vers le
multilatéralisme, www.risal.collectifs.net , 5mai 2006
|
|
|
Les "oublis"
de
l'histoire officielle
Mémoires et
malmémoires
On
peut brûler, mutiler, abrutir, expurger les traces du
passé. Mais la mémoire, lorsqu'elle reste
vivante, incite
à continuer l'histoire plutôt qu'à la
contempler.
Par
Eduardo Galeano
|
|
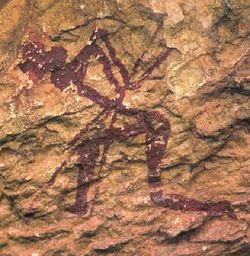
|
La
mémoire mutilée
"Tant
que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de
chasse continueront de glorifier le chasseur " (Proverbe
africain)
La
mémoire du pouvoir ne se souvient pas: elle absout. Elle
reconnaît la perpétuation des
privilèges par
héritage, permet aux oppresseurs de jouir de
l'impunité
des crimes qu'ils commettent, et trouve des alibis à leur
discours qui déguise la vérité avec
une admirable
sincérité.
La
mémoire de quelques-uns devient la mémoire de
tous. Mais
cette torche qui illumine les sommets laisse la base dans
l'obscurité. L'histoire officielle de l'Amérique
latine
accorde rarement un rôle à ceux qui ne sont ni
riches, ni
blancs, ni mâles, ni militaires: ceux-là ont
plutôt
droit à l'arrière-scène, comme les
figurants
d'Hollywood. Ce sont les éternels invisibles, qui cherchent
en
vain leurs visages dans ce miroir déformant. Mais ils n'y
sont
pas.
La
mémoire du pouvoir n'écoute que les voix qui
reprennent
l'abrutissante litanie de sa propre sacralisation. "Ceux qui n'ont pas
de voix" possèdent la voix la plus puissante, mais depuis
des
siècles ils sont condamnés au silence, et donnent
parfois
le sentiment de s'y être habitués.
Ces
tares que sont l'élitisme, le racisme, le machisme et le
militarisme nous empêchent d'être, et nous
interdisent de
nous souvenir. On nanifie la mémoire collective, en
l'amputant
de ce qu'elle a de meilleur; et on l'exploite au profit des
cérémonies d'auto-éloges des tyrans de
ce monde.
La
mémoire brisée
"
Car le sort est jongleur: il te dévoile an pays, et
aussitôt il le cache." (Abù Bakr ben
Sarim, poète
de Séville, XIIIe siècle)
La
culture de la consommation, qui pousse à l'achat, condamne
tout
ce qu'elle vend à l'obsolescence immédiate: les
choses
vieillissent en un clin d'œil, pour être
remplacées
par d'autres, tout aussi éphémères. Le
shopping
center, temple où sont
célébrées les messes
de la consommation, est un excellent symbole des messages qui dominent
notre époque: il existe en dehors du temps ou de l'espace,
n'a
ni âge ni racine, et n'a point de mémoire. La
télévision est le meilleur vecteur de diffusion
de tels
messages.
La
télévision nous arrose d'images qui naissent pour
être oubliées instantanément. Chaque
image enterre
l'image précédente et ne survit que
jusqu'à
l'image suivante. Les événements humains, devenus
objets
de consommation, meurent, comme les choses, à l'instant
même où ils sont utilisés. Chaque
nouvelle est sans
lien avec les autres, divorcée de son passé, et
du
passé de toutes les autres. A l'ère du zapping,
l'excès d'information produit un excès
d'ignorance.
Les
médias et les écoles n'aident pas, c'est le moins
que
l'on puisse dire, à comprendre la
réalité et
à reconstituer la mémoire. La culture de la
consommation,
culture de l'aliénation, nous conditionne à
croire que
les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Incapable de
reconnaître ses origines, le temps présent
projette le
futur comme sa propre répétition, demain est un
autre
aujourd'hui: l'organisation inéquitable du monde, qui
humilie la
condition humaine, appartient à l'ordre éternel,
et
l'injustice est une fatalité qu'il nous faut accepter ou...
accepter.
Le
pouvoir n'admet d'autres racines que celles nécessaires
à
l'absolution de ses crimes, l'impunité exige la
malmémoire, l'amnésie l'oubli. Des pays et des
personnes
échouent, d'autres sombrent, parce que la vie est un
système de récompenses et de châtiments
qui
privilégie les forts et punit les inutiles. Afin que les
infamies se métamorphosent en exploits, il faut briser la
mémoire: la mémoire du Nord se sépare
de la
mémoire du Sud, l'accumulation se détache du
saccage,
l'opulence n'a que faire du dépouillement.
La
mémoire brisée nous incite à croire
que la
richesse n'est pas responsable de la pauvreté et que le
malheur,
depuis des siècles ou des millénaires, n'est pas
le prix
du bonheur. Et nous fait croire que nous sommes condamnés
à la résignation.
La
mémoire brûlée
"Pour
que le Malin cesse de répandre ses tromperies."
(De
l'archevêque de Lima, qui, en 1614, ordonna de
brûler
toutes les quenas -flûtes indiennes- et tous les instruments
musicaux des Indiens.)
En
1499, à Grenade, l'archevêque Cisneros jeta aux
flammes
les livres musulmans; huit siècles d'histoire
écrite de
culture islamique en Espagne réduits en cendres.
En
1562, à Mani de Yucatan, le frère Diego de Landa
jeta aux
flammes les livres mayas; huit siècles d'histoire
écrite
de la culture indienne en Amérique réduits en
cendres.
En
1888, à Rio de Janeiro, l'empereur Pedro II jeta aux flammes
les
documents relatant l'esclavage au Brésil; trois
siècles
et demi d'histoire écrite de l'infamie
négrière
réduits en cendres.
En
1983, à Buenos Aires, le général
Reynaldo Bignone
jeta aux flammes les documents sur la "sale guerre" de la dictature
militaire en Argentine; huit ans d'histoire écrite de
l'infamie
militaire réduits en cendres.
En
1995, à Ciudad de Guatemala, l'armée jeta aux
flammes les
documents sur la "sale guerre" de la dictature militaire
guatémaltèque; quarante ans d'histoire
écrite de
l'infamie militaire réduits en cendres.
La
mémoire tenace
"Où
étais-je, moi, avant d'être ?"
(Question d'un enfant de
cinq ans à sa mère, d'après ce que
celle-ci m'a
raconté)
L'histoire
se répète? Ou se
répète-t-elle seulement
pour pénitence de ceux qui sont incapables de
l'écouter?
Il n'y a pas d'histoire muette. On a beau la brûler, on a
beau la
briser, on a beau la tromper, la mémoire humaine refuse
d'être bâillonnée. Le temps
passé continue de
battre, vivant, dans les veines du temps présent,
même si
le temps présent ne le veut pas ou ne le sait pas. De
ces livres et de ces gens brûlés vifs sur les
bûchers de la Sainte Inquisition irradie une
énergie
acharnée, une énergie de pluralité et
de
tolérance qui influence les changements actuels de
l'Espagne.
Les voix de l'Amérique précolombienne, voix mille
et une
fois étouffées, qui parlent de vie en
communauté
et de communion avec la nature, résonnent clairement de
nouveau,
ouvrant des brèches dans les voies sans issue de
l'Amérique contemporaine.
Les
Brésiliens redécouvrent le chapitre le plus
occulté de leur histoire: la résistance du
royaume de
Palmares, ce sanctuaire de liberté où les
esclaves noirs
en fuite triomphèrent de plus de quarante assauts militaires
durant un siècle, et sur cette mémoire perdue,
ils
commencent à célébrer le symbole le
plus
révélateur de la dignité nationale.
Les
Argentins reconnaissent enfin, dans ces mères que l'on
surnommait les les "Folles de la place de Mai" parce qu'elles
refusaient d'oublier, leur plus fort symbole de santé
mentale. Et
au Guatemala, l'emblème de ce pays
rénové n'est
autre que Rigoberta Menchu, la femme indienne qui, depuis des
années, mène la lutte contre l'oubli des crimes
commis au
nom de la terreur d'État.
La mauvaise
mémoire
"Il
avait une si mauvaise mémoire qu'il finit par oublier qu'il
avait une mauvaise mémoire, et se souvint de tout."
(Ramon Gomez
de la Sema)
L'amnésie,
selon le pouvoir, est saine. Selon lui, non seulement les
mères
de ses victimes étaient et restent folles, mais ses propres
instruments, les bourreaux, sont eux aussi fous, lorsqu'ils ne
parviennent pas à dormir à poings
fermés, avec
pour seule gêne les moustiques d'été.
Rares sont
les gens qui naissent dotés de cette glande encombrante que
l'on
appelle conscience, et qui sécrète le remords.
Parfois,
cela arrive: par exemple, lorsque le capitaine Scilingo, officier de
l'armée argentine, avoua que, depuis qu'il avait
jeté
à la mer trente prisonniers bien vivants, il ne pouvait
dormir
sans lexotanil ou une bonne cuite, ses supérieurs lui
recommandèrent de suivre un traitement psychiatrique; ils le
disaient fou.
Le
gouvernement argentin a renvoyé plus d'un officier nazi vers
l'Europe, appliquant l'extradition pour crimes de masse commis il y a
plus d'un demi-siècle; mais, en même temps, il
accordait
l'impunité et couvrait d'éloges les officiers
argentins
ayant perpétré des crimes de masse fort
récents.
La mémoire et la justice sont-elles des luxes que les pays
latino-américains ne pourraient s'offrir ? Sommes-nous
réduits à vivre en état de mensonge
perpétuel ? Le pouvoir associe la mémoire au
désordre et la justice à la vengeance. Au nom de
l'ordre
démocratique et de la réconciliation nationale,
on a
édicté des lois d'impunité dans des
pays
latino-américains qui sortent à peine de
dictatures
militaires. Ces lois, qui enterrent le passé, bannissent la
justice.
Lorsque,
en 1989, en Uruguay, un référendum fut
organisé
contre l'impunité, la plupart des gens sont
tombés dans
le piège de la propagande officielle qui semait la panique
en
bombardant l'opinion publique de menaces. Lavage de mémoire,
lavage de cerveau: si l'on s'avisait de punir les crimes commis par les
hommes en uniforme, ou si seulement on envisageait de le faire, alors
ce serait le retour de
la violence,
l'histoire se répéterait. L'oubli
était le prix de la paix.
L'expérience
démontre le contraire. Pour que l'histoire ne se
répète pas il faut sans cesse la
remémorer,
l'impunité qui récompense le délit,
encourage le
délinquant. Et lorsque le délinquant, c'est
l'État, qui viole, vole, torture et tue sans rendre de
comptes
à personne, alors il donne lui-même le feu vert
à
la société entière pour violer, voler,
torturer et
tuer. Et la démocratie en paie, à longue ou
courte
échéance, les conséquences.
L'impunité
du pouvoir, fille de la malmémoire, est une des maitresses
de
l'école du crime. Cette école est
fréquentée par des millions d'enfants
latino-américains; et le nombre
d'élèves augmente
chaque jour.
La
mémoire vivante
"Excusez-moi,
l'ami. J'aurais bien voulu aller avec vous , mais j'ai encore trop
à faire." (Paroles prononcées lors
de l'enterrement de
Jorge Lopez par son meilleur ami, dans la vallée du Bolson)
Lorsqu'elle
est vraiment vivante, la mémoire ne contemple pas
l'histoire,
mais elle incite à la faire. Davantage que dans les
musées, or la malheureuse s'ennuie, la mémoire
est dans
l'air que nous respirons. Et, dans l'air, elle nous respire.
Elle
est contradictoire, comme nous. Elle n'est jamais au repos. Elle
change, avec nous. Au fur et à mesure que les
années
s'écoulent, et que nous changeons, le souvenir de ce que
nous
avons vécu, vu et écouté change
également.
Et souvent, il nous arrive de loger dans la mémoire ce que
nous
désirons y trouver, à l'instar de la police lors
des
perquisitions. La nostalgie, par exemple, si savoureuse, qui prodigue
avec tant de douceur la chaleur de son abri, est, elle aussi,
trompeuse. Ne nous arrive-t-il pas, à maintes reprises, de
préférer le passé que nous inventons
au
présent qui nous défie, et à l'avenir
qui nous
fait peur ?
La
mémoire vivante n'est pas née pour servir
d'ancre. Elle a
plutôt vocation à être une catapulte.
Elle ne veut
pas être havre d'arrivée, mais port de
départ. Elle
ne renie pas la nostalgie, mais elle lui préfère
l'espoir, ses dangers, ses intempéries. Les Grecs pensaient
que
la mémoire était fille du temps et de la mer; ils
n'avaient pas tort.
Source
: Le Monde
Diplomatique, juillet 1997
|
|
Tous les mondes
d’Eduardo Galeano
Propos
recueillis
par Niels Boel
|

|
L’écrivain
uruguayen Eduardo Galeano met à nu la
réalité. Dans cette longue conversation avec le
journaliste danois Niels Boel, il passe tout au crible: la
mondialisation, la mémoire, l’identité
culturelle, les luttes indigènes et... le football.
Ce
n’est pas un phénomène nouveau mais une
tendance qui vient de très loin. La mondialisation
s’est considérablement
accélérée au cours des
dernières années suite au
développement vertigineux des systèmes de
communication et des moyens de transport. Elle est aussi la
conséquence de la non moins vertigineuse concentration des
capitaux à l’échelle mondiale. Mais ne
confondons pas la mondialisation avec
«l’internationalisme». On peut croire
à l’universalité de la condition
humaine, de nos passions, de nos peurs, de nos besoins, de nos
rêves… Mais le «gommage» des
frontières qui permet à l’argent de
circuler librement est d’un tout autre registre. Une chose
est la liberté des personnes; une autre, la
liberté de l’argent.
Cette
différence radicale apparaît clairement dans des
lieux comme la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis,
qui n’existe pratiquement plus pour l’argent et les
marchandises, mais qui se dresse comme une sorte de mur de Berlin ou de
Muraille de Chine pour faire obstacle à la libre circulation
des personnes.
L’autodétermination
alimentaire
Le parfait symbole de la
mondialisation, c’est le succès
d’entreprises comme McDonald’s, qui ouvre cinq
nouveaux restaurants par jour aux quatre coins de la
planète. Il y a pour moi plus significatif que la chute du
mur de Berlin. C’est la queue que faisaient les Russes devant
McDonald’s, sur la Place Rouge à Moscou, au moment
même où s’effondrait ce qu’on
appelait le «rideau de fer» qui, vu la
manière dont il s’est
écroulé, était plutôt un
rideau de papier. La «mcdonaldisation» universelle
impose partout de manger dans du plastique. Mais, en même
temps, le succès de McDonald’s met à
mal l’un des droits fondamentaux de l’homme, le
droit à l’autodétermination
alimentaire. Le ventre est une zone de l’âme. La
bouche en est la porte. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu
es. Se nourrir, c’est choisir une certaine façon
de manger. La manière de cuisiner est un aspect important de
l’identité culturelle. Elle ne dépend
pas de la quantité de nourriture. Elle compte
énormément pour les peuples pauvres ou
très pauvres. Ils mangent peu ou presque rien, mais gardent
des traditions qui font que ce simple acte de manger peu ou presque
rien se transforme en une sorte de cérémonie.
Contre l’uniformisation
Le meilleur du
monde, c’est qu’il contient plusieurs mondes. Cette
diversité culturelle, qui est un patrimoine de
l’humanité, s’exprime dans la
façon de manger mais aussi dans la façon de
penser, sentir, parler, danser, rêver.
Il
existe aujourd’hui une tendance à
l’uniformisation accélérée
des modes de vie. Mais dans le même temps, les
réactions de défense s’amplifient: les
partisans des différences s’affirment et
méritent d’être soutenus. Il faut faire
ressortir les différences culturelles et non pas sociales,
pour que l’humanité reste polychrome et ne se
fonde pas en une seule couleur. Mais face à la
déferlante de
l’homogénéisation obligatoire, si
certaines réactions sont très salutaires,
d’autres relèvent parfois de la folie, comme le
fanatisme religieux et diverses formes d’affirmation
désespérée de
l’identité. Ce que je crois, c’est que
nous ne sommes absolument pas condamnés à un
monde qui ne nous laisserait qu’une seule alternative: mourir
de faim ou mourir d’ennui.
De
l’identité en mouvement
L’identité
culturelle n’est pas un vase précieux sagement
enfermé dans la vitrine d’un musée.
Elle est en mouvement, elle change sans cesse. Elle est en permanence
défiée par la réalité,
elle-même en mouvement perpétuel. Je suis ce que
je suis, mais je suis, aussi, ce que je fais pour changer ce que je
suis.
La pureté culturelle
n’existe pas plus que la pureté raciale. Par
chance, toute culture est le produit d’un mélange
incluant des éléments étrangers. Ce
qui définit le caractère d’un produit
culturel — que ce soit un livre, une danse, une expression
populaire, une façon de jouer au football — ce
n’est jamais son origine mais son contenu.
Une
boisson typique de Cuba comme le daïquiri ne contient rien de
cubain: la glace vient d’ailleurs, de même que le
citron, le sucre et le rhum. C’est Christophe Colomb qui a
importé le sucre des îles Canaries. Pourtant, il
n’y a rien de plus cubain que le daïquiri. Les
churros andalous viennent d’Arabie, les pâtes
italiennes de Chine. Aucun produit ne peut être
qualifié ou disqualifié sur la base de sa seule
origine. Ce qui compte, c’est ce qu’on en fait, et
dans quelle mesure une communauté peut se
reconnaître dans un symbole qui a à voir avec sa
façon préférée de
rêver, vivre, danser, jouer, aimer. Le bonheur du monde vient
de là: de ces brassages incessants qui font naître
de nouvelles réponses à de nouvelles questions.
Il
existe cependant, actuellement, une tendance certaine à
l’uniformisation — qui est le produit de la
mondialisation à marche forcée. Cette tendance
est liée en grande partie à la concentration des
pouvoirs entre les mains des grands groupes de communication.
Un espoir : Internet et les
radios communautaires
Le droit de
s’exprimer — reconnu par toutes les constitutions
— se réduit-il au simple droit
d’écouter? N’est-il pas, aussi, le droit
de dire? Mais qui a le droit de dire? Ces questions sont
très profondément liées aux
dégâts que subit aujourd’hui la
diversité culturelle.
Les espaces de
liberté dans le monde de la communication se sont trop
rétrécis. Les groupes dominants de communication
imposent non seulement une information manipulée et
déformée mais aussi une vision du monde qui tend
à devenir la seule possible. C’est comme si
l’on réduisait les millions de facettes des yeux
d’un insecte aux seules deux facettes centrales.
Ce
qui apparaît aujourd’hui comme
l’innovation la plus prometteuse, c’est Internet.
C’est l’un des paradoxes qui alimente
l’espoir. Internet est né de la
nécessité d’articuler les plans
militaires au niveau mondial. C’est dire que le
réseau a été conçu pour
servir la guerre et la mort. Or, il est aujourd’hui le champ
d’expression de multiples voix, hier à peine
audibles. De nouveaux réseaux de communication peuvent
s’articuler grâce à cet outil.
Certes,
Internet est également exploité à des
fins commerciales et de manipulation. Mais le réseau a
ouvert des espaces de liberté très importants
pour la communication indépendante, qui a du mal
à se frayer un chemin dans d’autres
médias comme la télévision ou la
presse écrite. Dans le domaine de la radio, la situation
évolue également favorablement. Le
développement des radios communautaires en
Amérique latine encourage l’expression populaire.
Parler aux gens n’est pas la même chose que les
écouter parler, écouter les voix qui peuvent
rendre compte de la réalité, quand elle peut
être dite et quand le peuple exerce son droit à la
libre expression.
De la fin et des moyens
Dans la Grèce
antique, on ne condamnait pas seulement le meurtrier mais aussi le
couteau. Quand un crime avait été commis, il
était jeté dans le fleuve. Aujourd’hui,
nous savons qu’il ne faut pas confondre les moyens avec les
fins. Le drame en Amérique latine ce n’est pas que
la télévision soit omniprésente,
c’est que le modèle de la
télévision commerciale nord-américaine
se soit imposé. Nous n’avons rien appris du
modèle européen d’une
télévision orientée vers
d’autres fins.
Dans de nombreux pays
européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou les
Pays-Bas, la télévision remplit —
certes moins qu’auparavant — une fonction
culturelle très enrichissante et importante en
s’appuyant sur son statut de service public. Ici, au
contraire, en vertu du modèle nord-américain, est
bon tout ce qui peut faire vendre et mauvais tout ce qui ne fait pas
vendre.
Les luttes autochtones
L’une des nombreuses
forces secrètes, des nombreuses sources
d’énergie que recèlent les terres
d’Amérique latine c’est leurs peuples,
la renaissance des mouvements autochtones et l’extraordinaire
vitalité des valeurs que ces mouvements incarnent. Ce sont
des valeurs de communion avec la nature, des valeurs communautaires de
partage et non pas d’envie. Des valeurs qui viennent du
passé mais qui parlent au futur. Ces valeurs ont beaucoup
à nous dire. Elles rencontrent un large écho car
ce sont des valeurs que l’humanité tout
entière se doit de retrouver car dans notre monde, au cours
des dernières années, les liens de
solidarité ont été gravement
affectés et souvent rompus. Notre monde est
centré sur l’égoïsme, le
«sauve-qui-peut» et le
«chacun-pour-soi».
L’Homme et la Terre
Cela fait cinq
siècles que l’Amérique latine a
été domestiquée, que la nature y a
été séparée de
l’Homme, enfin de ce qu’on appelle
l’Homme mais qui inclut en réalité les
femmes et les hommes. La nature d’un
côté, les humains de l’autre. Le monde
entier a connu ce divorce.
Beaucoup d’autochtones
condamnés à être
brûlés vifs pour idolâtrie
étaient en fait ce qu’on appelle maintenant des
écologistes. Ils pratiquaient en leur temps la seule
écologie qui me semble valable: une écologie de
communion avec la nature.
Communion avec la nature
et esprit communautaire sont les deux clefs qui expliquent la survie
des valeurs indigènes traditionnelles, malgré
cinq siècles de persécutions et de
mépris.
A l’origine et pendant des
siècles, la nature était une bête
féroce qu’il fallait dompter. Une
étrange ennemie, une traîtresse.
Maintenant
que nous sommes tous «verts» comme une
publicité mensongère, qui est faite de mots et
non de réalité, la nature est devenue quelque
chose que l’on se doit de protéger. Mais dans un
cas comme dans l’autre, qu’elle soit un objet de
domination dont on peut tirer quelque gain ou un objet de protection,
nous en sommes séparés. Il nous faut retrouver le
sens indigène de la communion avec la nature. La nature ne
se réduit pas au paysage, elle est en nous, elle vit avec
nous. Je ne pense pas seulement aux forêts mais à
tout ce qui touche à la conception sacrée que les
indigènes américains avaient de la nature et
qu’ils ont toujours. Sacrée au sens où
tout ce que nous pouvons faire contre elle se retourne un jour contre
nous.
Tous les crimes se transforment en suicides,
comme le montre les grandes villes latino-américaines, ces
mauvaises copies des villes du monde développé
où il est pratiquement impossible de marcher et de respirer.
Nous
vivons aujourd’hui dans un monde où
l’air est empoisonné, l’eau
empoisonnée, la terre empoisonnée. Mais surtout
où l’âme est empoisonnée.
Plaise au ciel que nous puissions nous ressourcer pour nous
guérir.
De la mémoire comme
catapulte
Dans Jours et Nuits
d’amour et de guerre, je me demandais si la
mémoire pouvait nous rendre heureux. Je n’ai
toujours pas la réponse. Dans le roman d’une
écrivaine nord-américaine, il est question
d’un arrière grand-père qui rencontre
son arrière-petit-fils. L’arrière
grand-père n’a plus aucun souvenir. Il est devenu
«gaga». L’arrière-petit-fils,
lui, n’a pas encore de souvenirs car il vient de
naître. En lisant ce roman, je pensais
«voilà le bonheur parfait». Mais je ne
veux pas de ce bonheur-là. Je veux un bonheur qui naisse de
la mémoire et qui se construise en se battant contre elle.
Je veux un bonheur qui en sorte endolori, meurtri, blessé
mais qui y prenne sa source.
Autoportrait
Tous mes livres sont
difficiles à classer. Il est difficile de distinguer ce qui
est une fiction de ce qui n’en est pas une. Ce que je
préfère, c’est raconter. Je me vis
comme un conteur. Je reçois et je donne. C’est un
aller et retour. J’écoute des voix et je les
restitue sous forme de récit, d’essai, de livres
inclassables où tous les styles et tous les genres se
rejoignent. J’essaie de faire une synthèse qui
aille au-delà des distinctions traditionnelles entre le
conte, l’essai, le roman, le poème, le
récit, la chronique. J’essaie de proposer un
message global car je crois que le langage humain rend cette
synthèse possible.
Il n’existe
pas de frontière entre le journalisme et la
littérature. La littérature est
l’ensemble des messages écrits qu’une
société émet, quelle qu’en
soit la forme. On peut toujours dire ce que l’on a envie de
dire, que ce soit en tant que journaliste ou en tant
qu’écrivain. Le journalisme, s’il est de
qualité, peut produire de la très bonne
littérature, comme l’ont prouvé
José Marti, Carlos Quijano, Rodolfo Walsh et beaucoup
d’autres.
J’ai toujours
été journaliste et je n’ai jamais voulu
cesser de l’être, car une fois entrés
dans ce monde magique de la rédaction, qui peut nous en
sortir? Le journalisme a ses vertus: il apprend à
être concis, à synthétiser, ce qui est
très intéressant pour quelqu’un qui
veut écrire sur une foultitude de choses. Il oblige
à sortir de son micro-monde pour se plonger dans la
réalité, danser au même rythme que les
autres. Il oblige à sortir de soi-même,
à écouter. Il a aussi ses défauts. Le
premier, c’est l’urgence. Parfois, je peux buter
sur un mot et passer plus de trois heures à en chercher un
autre. C’est un luxe que le journalisme ne peut pas
m’offrir.
Le rêve
et la vigilance
Ma seule fonction
est d’essayer de mettre au jour une
réalité masquée, de parler de ce que
nous voyons et de ce qui reste caché. C’est la
réalité de la veille, c’est une
réalité contrefaite, parfois menteuse, mais aussi
pleine de vérités méconnues ou
rarement écoutées.
Aucune
formule magique ne nous permettra de changer la
réalité si nous ne commençons pas par
la voir telle qu’elle est. Pour pouvoir la transformer, il
faut commencer par l’assumer. C’est le
problème en Amérique latine. Nous ne pouvons pas
encore la voir. Nous sommes aveugles de nous-mêmes parce que
nous sommes entraînés à nous voir avec
des yeux qui ne sont pas les nôtres. C’est pour
cela que le miroir nous renvoie une tache opaque et rien
d’autre.
... Et du football
Nous
tous, les Uruguayens, naissons en criant «but!».
C’est pour cela qu’il y a tant de bruit dans les
maternités, tant de vacarme. Comme tous les enfants de mon
pays, j’ai voulu être footballeur. Je jouais milieu
de terrain mais je n’ai jamais été
très bon car j’étais terriblement
maladroit. Le ballon et moi n’avons jamais pu nous
comprendre. J’ai vécu une histoire
d’amour non partagé. En plus, j’avais
une attitude désastreuse: quand les adversaires avaient fait
une belle partie, j’allais les féliciter, ce qui
est un péché impardonnable dans le contexte du
football moderne.
Eduardo Galeano : la joie de
raconter
La
joie de raconter d’Eduardo Galeano ne se dément
jamais. Même pas quand
il parle d’une réalité sociale peu
enthousiasmante. Les Veines ouvertes
de l’Amérique latine (1971) est une
œuvre de référence pour tous ceux
qui veulent comprendre l’histoire et la
réalité de ce continent. Son
point de départ est une énigme: pourquoi cette
terre si richement dotée
par la nature a-t-elle été si peu
favorisée sur le plan social et
politique? Cet ouvrage, aussi palpitant qu’un roman policier,
raconte
avec passion, lucidité et indignation l’histoire
de ce que Galeano
appelle «le pillage» du continent
latino-américain, d’abord par les
Espagnols et les Portugais, puis par l’Occident en
général et les
élites locales.
Sans complexe, Galeano
fait fi des frontières
qui séparent les différents genres
littéraires. Ses livres, au
carrefour de la narration et de l’essai, de la
poésie et de la
chronique, rapportent les voix de l’âme et de la
rue et offrent une
synthèse de la réalité actuelle et de
la mémoire. Eduardo Galeano est
né à Montevideo, en Uruguay, il y a 60 ans. Dans
sa ville natale, il a
été le rédacteur en chef de
l’hebdomadaire Marcha et le directeur du
quotidien Epoca. A Buenos Aires, il a fondé et
dirigé la revue Crisis .
En 1973, il s’est exilé en Argentine avant de
rejoindre l’Espagne. Il
est retourné vivre en Uruguay en 1985.
Il
est l’auteur de livres
traduits en plusieurs langues et d’une œuvre
journalistique
considérable. Outre Les Veines ouvertes de
l’Amérique latine (Plon,
1999), plusieurs de ses ouvrages ont été
publiés en français:
Vagamundo
(Actes sud, 1985)
La Chanson que nous chantons (Albin Michel,
1977)
La trilogie Mémoire du feu — Les
Naissances, Les Visages et les masques, Le Siècle du vent
(Plon 1985 et 1988)
Jours et Nuits d’amour et de
guerre (Albin Michel 1987)
Une certaine grâce
(Nathan, 1990)
Amérique, la découverte
qui n’a pas encore eu lieu (Messidor, 1992)
Le Livre
des étreintes (La Différence 1995)
Le
Football, ombre et lumière (Climats, 1998)
Eduardo
Galeano a obtenu le prix de la Casa de las Americas en 1975. Sa
trilogie Mémoire du feu a reçu le American Book
Award de l’Université
de Washington et a été
récompensée en 1989 par le ministère
uruguayen
de la Culture.
Source : Courrier de l'UNESCO,
janvier 2001
http://www.unesco.org/courier/2001_01/fr/dires.htm
|
|
|
|
|
|
Cet espace
d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
Les
articles et textes de Lionel Mesnard sont sous la mention tous droits réservés
Ils ne peuvent faire l'objet d'une reproduction sans
autorisation
Les autres articles et vidéos personnelles sont sous licence
Creative Commons 3.0 FR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
|
|
|
|
| |