|
 |
| Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
| |
- Figures
- et lieux méconnus
- du faubourg et du quartier
- de la porteSaint-Denis
- L'actuel faubourg Saint-Denis n'était
qu'un sentier au Ve siècle et devint une voie royale
qui allait en direction de la ville et de l'abbaye de Saint-Denis, qu'à partir du XIIe
siècle.
|
|
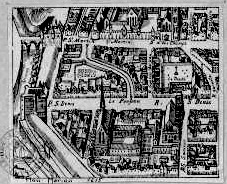 |
|
|
|
|
Ce fut
un
passage obligé pour la Cour se rendant à l'abbaye de Saint-Denis, elle
emprunta maintes fois cette route pour y accueillir ou y
enterrer nombre de ses têtes couronnées, et, le denier monarque a
procédé de la sorte a été Louis XVIII à son retour dans la capitale le
3 mai 1814, celui-ci passa en calèche sous la Porte St-Denis. L'apparition
d'une population au sein du faubourg Saint-Denis débuta avec la
construction d'une léproserie ou maladrerie dite de St-Ladre ou de
St-Lazare au XIIe siècle, en raison du retour des croisades et des
maladies liées à la peau : la lèpre.
Suivirent l'installation de plusieurs congrégations ou confrèries religieuses, dont les frères de la Mission de
Saint-Vincent de Paul à partir de 1632, ou les Lazaristes et la Compagnie des Filles de la Charité de Louise de Marillac (veuve Legras) par la suite. Et
pour les plus anciennes, tout
particulièrement les Filles-dieu, ce furent elles qui participèrent
activement à mettre en valeur les anciens terrains marécageux en
cultures maraîchères. Le nombre des
congrégations ou confréries sur la paroisse Saint-Laurent a été de
dix-neuf selon le
vicaire Louis Brochard, et les prêtres étaient désignés au sein de la
paroisse Saint-Martin -des-Champs (qui se trouve dans le IIe
arrondissement actuel, à la hauteur du métro Arts-et-Métiers).
|
|
|
La
monumentale Porte St-Denis fut édifiée en 1672 par M. Blondel
(rénovation effectuée en 1998), qui a été aussi le maître d'œuvre de la
Porte Saint-Martin. Ce fut le jeune Louis XIV qui fit tomber l'enceinte
fortifiée en 1670 construite sous Charles V vers 1360. Au cours du
XVIIe siècle, l'actuel quartier était le début de la campagne
parisienne avec la présence :
- d'une
agriculture importante, résultat de l'assèchement progressive des
marais, on peut ainsi présumer l'existence de cultures vivrières,
d'arbres fruitiers et de chaumières, puis des immeubles d'habitations.
- des petites
écuries royales ; d'où la rue et la cours des Petites-écuries, qui
jouxtent le faubourg St-Denis favorisa la venue d'artisans et de
commerçants.
|
|

|
|
|
Puis
l'on découvre l'apparition progressive d'hôtels
particuliers par le rachat des emplacements appartenant en grande
part à l'Eglise. Grande
misère et détresse s'y focalisaient, en raison de
la présence d'ordres en charge des aumônes aux mendiants. Un quartier
populaire où l'exclu vivait non loin des "restos
du cœur" de l'époque.
Le quartier St-Denis tout comme la paroisse St-Laurent virent l'installation de la bourgeoisie dans ces nouvelles
artères qu'étaient les faubourgs du nord-est de la capitale, grâce à la
création du Boulevart, appelé à ses débuts ainsi et jusqu'au XIXe siècle, il partait de la Bastille et allait jusqu'au boulevard actuel des Italiens. Cela repoussait les limites de Paris
vers un élargissement géographique de ses frontières, en raison d'une
forte accentuation de la population. Le roi Louis
XIV à partir de la fin du XVIIe siècle, à l'exception des quelques
années du temps de la régence du prince Philippe d'Orléans, comme ses
héritiers, il dirigea le pays depuis le château de Versailles. |
| |
| Avec le
petit peuple des faubourgs qui allait émerger avec la révolution
de 1789, le clergé allait y perdre un temps de sa suprématie, entre autres, en
tant que propriétaire des terrains et des bâtisses. Il est à noter que
la présence des religieux et de leurs pauvres pesaient, ou eurent de
fortes incidences sur la vie de la paroisse Saint-Laurent et le
territoire plus limité du quartier St-Denis. Il nous reste
des traces de plaintes et de procédures juridiques qui visaient
à la récupération des biens ou à
l'expulsion des religieux, bien antérieurement à
la Révolution. La vie religieuse dans toute la périphérie
nord du Boulevart allait participer à la naissance
de nouveaux quartiers mi-ruraux, mi-urbanisés.
Le quartier Saint-Denis et Saint-Martin virent naître
une forte activité marchande en dehors des anciennes enceintes
détruites sous Louis XIV. |

|
|
Avec
la révolution de 1789 s'engageait encore une mutation de Paris et une nette
progression ou accentuation des faubourgs, la banlieue de ces temps
passés se déplaçait vers les villages les plus connus : Montmartre, la
Chapelle, la Villette, etc., pour exemples. Malgré la révolution de 1789 restèrent les deux portes (la porte St-Denis
ci-contre), un peu miraculeusement survivantes, elles ont été les
témoins de nombreux affrontements et de l'apparition régulières des
barricades. Elles devinrent des lieux importants, et sanctuaires des
révolutions de 1830, 1848, et de 1871 (la Commune de Paris). |
|
| Tout
au long du XIXe siècle les quartiers St-Denis et St-Martin ont été très
en lien avec l'idée de "débauche", ou avec ce qui était des salles de
spectacles d'un genre nouveau, les faubourgs du nord-est allaient
s'ancrer comme des quartiers de la "fête" et des métiers des arts de la
scène et du spectacle vivant. Déjà au dix-huitième siècle, la Porte St-Denis
s'était pré-illustrée avec les bals du bois de Boulogne (en lieu et
place du passage voisin du Prado plus tardif). Et pour l'aspect
"louche", un passage du Désir qui semble avoir été retenu dans son
origine populaire comme le ragot local sur les activités d'hôtels
qualifiés de "garni(s)". Le passage Brady, initié par Monsieur Brady
vers 1830, en fit un grand lieu de la confection et des métiers du
textile. S'agrégèrent comme métiers spécifiques à la mémoire du
quartier St-Denis : l'édition de musique, la porcelaine, le cuir et la
fourrure, la faïence, la coiffure, l'hôtellerie et la restauration. |
| |
De
nombreux lieux festifs ou récréatifs y virent jours entre autres : les Concerts
Parisiens puis le Concert Mayol, le café-concert de La Scala, ou le
théâtre Madame qui devint le Gymnase-Dramatique, etc. (à lire sur la page suivante). Le quartier et sa périphérie ont connu aussi
la percée du boulevard de Strasbourg, de Magenta, la naissance des
deux gares, etc.. L'activité du quartier
de la Porte St-Denis fut très forte jusqu'à la
seconde guerre mondiale,
et entre autres s'installèrent les Magasins de la Ville de Saint-Denis dans le
faubourg.
Le dixième arrondissement de Paris allait voir sa
population se réduire avec le temps.
Soit 159.000 âmes en 1881, ce qui fut son pic de population à l'échelle
de la localité et non des quartiers St.-Denis et St.-Martin. Pour le
10ème, la population tout quartier confondu passa à 124.000 résidents en 1962, puis chuta à son plus bas niveau à 89.000 habitants en 1998 (un peu plus de 95.000 en 2016). |
| |
| |
| Les Hospitaliers et Chevaliers de Saint-Ladre |
|
| |
Au sein de l'actuel quartier Saint-Denis vit l'apparition
d'une première population, elle apparue avec la
construction d'une léproserie ou maladrerie. C'est
en raison des croisades menées contre les "Sarrasins" et la conquête de
Jérusalem que la lèpre se propagea par les ports de la
Méditerranée. Ce furent les Hospitaliers ou Chevaliers de Saint-Ladre
qui participèrent à la conquête de la dite "Terre Sainte",
qui ont été à l'origine de la léproserie et du peuplement du
quartier, officiellement en 1110 : première trace écrite sous forme
d'une
Charte selon Louis Brochard, vicaire de l'église de Saint-Laurent et
auteur d'une histoire de la paroisse fort instructive sur son
fonctionnement à travers les siècles.
Louis VI dit le Gros s'engagea
en leur faveur la Foire Saint-Laurent et jusqu'en 1253, le grand
maître de cet ordre devait être un chevalier lépreux.
C'était au sein de l'enclos (voisin de St-Ladre) de Saint-Laurent (bien avant de n'être
une foire à bétail) que se trouva la première
implantation marchande dans le dixième arrondissement actuel.
La foire se tenait une fois l'an et selon des règles précises, comme celle du "Landit". |
|
|
L’ordre des Chevaliers de Saint-Lazare et Maladreries

Deux lépreux demandant l'aumône (Leprosorium)
Eugène Diluscouet (1906)
« Aussi les léproseries se
multiplient-elles. Au XIIe siècle, il y en a deux cent dix-huit en
Normandie ; en Picardie on en rencontre de deux en deux lieues ; il y
en a deux mille dans tout le royaume. Si généreuse que
fût la pitié du Moyen Âge, elle fut débordée et, tandis que certains
ladres (lépreux) menaient large vie dans leurs hôpitaux, d'autres
couraient les routes à la recherche d'un abri et de leur nourriture.
D'autres causes d'ailleurs que le trop grand nombre de malades
intervinrent pour jeter les ladres par monts et par vaux.
Le Moyen-Âge est une époque où les
préjugés de caste sont très marqués et, bien souvent, l'hygiène
publique en fut la victime.Celle-ci d'ailleurs fut plus compliquée
qu'efficace. Il eut fallu pouvoir interner tous les ladres, agir d'une
façon générale et méthodique. Pour cela, un pouvoir central fort, des
ressources énormes eussent été nécessaires. Or, le roi, tout en
réglementant par ses ordonnances l'internement des ladres, jusque dans
les provinces les plus reculées, se contenta d'ouvrir le plus grand
nombre possible de léproseries.
Louis VII fit transformer en
maladreries toutes les Maisons-Dieu pour lesquelles le zèle religieux
ne s'était pas maintenu et qui, ne pratiquant plus l'hospitalité, se
trouvaient mentir aux intentions de leurs fondateurs. Il fît plus en
installant les chevaliers de Saint-Lazare dans son domaine de Boigny,
prés d'Orléans, et en leur confiant le gouvernement de toutes les
léproseries qu'il créait.
Cet Ordre avait été fondé en 1107, à
Jérusalem, et approuvé par une bulle de Pascal II, sous le nom d'Ordre
des Hospitaliers de Saint-Lazare. Cet Ordre dont le Grand-Ministre
devait être un lépreux, comprenait trois catégories de membres: pour
les fonctions du culte, des prêtres; pour la bataille, des chevaliers;
pour l'hospitalité, des frères.
C'est en 1154 que Louis VII, au retour
de la deuxième Croisade, ramena en France douze religieux lazaristes et
les installa à Boigny. A la suite des progrès des Infidèles sur les
Croisés, Gérard, le Grand-Maître de l'ordre, abandonna la Terre-Sainte
et vint les y rejoindre. Il remania les statuts et l'Ordre fut à cette
époque plus prospère que jamais. Mais à mesure que les
années passent, l'esprit public subit un revirement. Devant le flot
toujours plus menaçant des lépreux, la société s'exaspéra de son
impuissance à enrayer le mal et ceux qui, deux siècles auparavant,
étaient vénérés et choyés, n'inspirèrent bientôt plus que répulsion et
dégoût. On a dit, il est vrai, que la lèpre s'encanailla peu à peu. Ce
n'est plus l'époque, Baudoin IV, roi de Jérusalem, couvrait du manteau
royal ses pieds qui, rongés par le mal, tombaient en pourriture.
Les ladres d'alors sont de condition
médiocre. Une hygiène meilleure, des soins plus constants, ont chassé
la lèpre des hautes classes de la société. Les grands seigneurs encore
atteints s'enferment volontairement dans les maladreries, à moins
qu'ils ne restent chez eux, d'où il leur est défendu de sortir. Les
bourgeois pouvant acquitter le droit d'entrée exigé au seuil des
léproseries sont également à l'abri de la haine publique. Les pauvres
seuls en sont victimes. On lance contre eux les pires accusations » (…).
« Les biens des
léproseries furent employés à l'assistance des malades. Ce ne fut pas
sans de nombreux procès que cet édit fut exécuté. Les revenus de
l'Ordre de Saint-Lazare servirent en partie à fonder des Hôtels-Dieu.
Depuis longtemps ces revenus servaient à tout autre chose qu'à soigner
les lépreux.
En 1666, l'Ordre avait armé deux
frégates qui tinrent la mer contre les Anglais sous le commandement du
Grand-Maître. Ceci nous montre combien il avait changé au cours des
siècles. L'ardeur religieuse, qui avait animé les premiers Lazaristes,
était vite tombée.
Au XIIIe siècle, l'Ordre eut à
défendre ses privilèges contre les évêques. Un peu plus tard, pour
rehausser son éclat, la condition de noblesse fut exigée pour la
réception des nouveaux membres. En outre, les chevaliers devaient payer
un droit de mille livres, les chapelains et les frères cinq cents. Les
guerres religieuses qui survinrent rendirent difficile l'administration
des léproseries.
Le pape Innocent VIII, circonvenu
par les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, annula l'Ordre de
Saint-Lazare et donna ses biens aux premiers, sans prévenir le
Grand-Maître de Boigny.
Le Parlement de Paris, par arrêt du
16 février 1547, annula la bulle du pape. Pourtant le relâchement des
chevaliers de Saint-Lazare était avéré ; ils ne pratiquaient plus
l'hospitalité; aussi quand Paul V approuva la fondation de l'Ordre de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Henri IV les réunit-il à cet Ordre. Ainsi
transformé, l'Ordre prend un caractère séculier et très mondain bien
que les chevaliers soient astreints à certaines pratiques religieuses.
Ils reçoivent outre les biens des lépreux des pensions de toutes sortes.
Sous Louis XIV, les commanderies de
l'Ordre devinrent pour les courtisans des récompenses très enviées ».
(…) L’ordre des Chevaliers de Saint-Lazare fut dissout par l'Assemblée nationale sous la Révolution française.
Source : Eugène Disclouët, Les lépreux au Moyen Âge
Pages 13, 14 et 21 - Imprimerie Delbrel & Cie - Bordeaux - 1906 ( Gallica-Bnf)
|
|
|
|
Un
cérémonial fut lancé en 1147 par Louis VII dit le Jeune en compagnie
d'Aliénor d'Aquitaine et de ses vassaux les plus tumultueux. Tous
partaient pour les croisades et ils firent une halte dans le faubourg
Saint-Denis à hauteur de la léproserie avant que le roi et ses troupes
s'en aillent quérir en l'abbaye de Saint-Denis, des mains du pape
Eugène III : "l'oriflamme, la panetière et le bourdon" (les trois
insignes du pèlerin). En son absence la régence du royaume fut confiée
à l'abbé Suger.
Les rois faisaient un arrêt devant la léproserie de Saint-Ladre.
|
|

|
|
|
Cet arrêt se fit en l'observance d'un
culte en faveur de la guérison des lépreux, c'est-à-dire, faire d'un mal dont personne ne connaissait le
traitement, une dévotion au culte de St-Lazare ou de St-Ladre
(saint des lépreux). C'est aussi devant la Maison de St-Ladre,
répondant au nom de Logis du Roi,
que les rois de France mettaient pieds à terre lors des entrées
solennelles dans Paris. Ils recevaient de la sorte les serments de
fidélité et d'obéissance de tous les ordres de la Ville. Ci-desous le
sceau de la léproserie de St-Lazare de 1262 (il existe un autre sceau
de 1399) et suivi d'un petit descriptif des activités de la maladrerie
et ses alentours.
 |
|
« L'hôpital,
en principe, ne soignait que les malades de Paris ou de ses faubourgs,
qui devaient apporter une pitance suffisante et tout ce qui leur était
nécessaire en fait de meubles et d'ustensiles. Certains malades
fortunés faisaient entièrement abandon de leurs biens à l'institution
qui les recueillait. Une tradition solidement établie veut que les
boulangers se soient toujours montrés très généreux à l'égard de
Saint-Lazare, car on les croyait, de par leur métier, plus exposés que
d'autres à la lèpre.
A côté de l'hôpital s'étendait une vaste ferme pouvant subvenir à ses
besoins. (…) On y cultivait la vigne, le
blé, diverses plantes fourragères et des arbres fruitiers. Elle avait
une mare, un colombier, des moulins, des celliers et des granges où
l'on pouvait emmagasiner, outre le produit des récoltes locales, celui
que l'hôpital tirait de ses nombreuses terres des environs de Paris :
la Villette, Pantin, Bagnolet, Lagny, Montfermeil, Argenteuil,
Cormeilles ou Garches. »
Laure Beaumont-Maillet, (1947-2016), Vie et histoire du Xe,
page 10. Éditeur, Hervas (Paris -1988)
|
|
Comme
l'on dit, "toute misère a du bon" et l'implantation
de la léproserie impliqua de défricher les alentours,
de construire des édifices pour résider et des
lieux de cultes. La maison de Saint-Ladre vers 1122 voyait
ainsi le jour. Elle devint plus tard l'enclos Saint-Lazare aux mains de
la congrégation de Saint Victor sise à Paris. Les premiers bâtiments disparurent au XVe siècle dans les flammes,
dans
une énième bataille avec les Anglais et donna le jour au lieu dit
de Saint-Lazare. Saint-Ladre fut donc ainsi partiellement détruit par
les "Anglois"
qui assiégèrent Paris sous Charles VI. En 1490, la lèpre avait presque
disparu en France, le pape Innocent VIII supprima cet ordre - bien
qu'ils survécurent
sous l'appellation de Lazaristes et fusionnèrent vers 1630 avec la
Congrégation de la Mission, fondée elle-même en 1625. En 1672, Louis
XIV attribua aux invalides de guerre
les biens destinés aux lépreux.
|
| |
| |
| Petite histoire des Filles-Dieu |
|
Au
XIIIe siècle, ce furent les religieuses du couvent des Filles-dieu, hors des fortifications, non loin de la léproserie qui assainirent les terres de l'actuel quartier St.-Denis qu'elles mirent en culture pour certaines (*). Les Filles-Dieu s'établirent ainsi dans un premier temps hors de la ville, qui était du à la marginalisation d'une communauté de
jeunes femmes repenties qui s'activaient au profit des filles de "petite
vertu", c'est-à-dire, au secours des femmes prostituées.
|
|

|
|
(*) « Tout cela était renfermé dans un grand enclos fermé
de haies et de murailles, que nous appelons maintenant la Couture des
Filles-Dieu. Des différents plans que la Cour de Parlement a fait
lever de cet hôpital, nous apprenons qu'il portait sept cents quarante
quatre toises de circonférence (1 toise est égale à presque 2 mètres),
et trente-huit arpents d'étendue (130.000 mètres carrés ou 13 hectares), et qu'il
occupait tout ce vaste territoire que couvrent présentement quantité de
maisons, de fossés, de jardins et de marais, et rempli de légumes, de
fleurs et de fruits rares nouveaux et agréables, qui réjouissent la
vue, et excitent le gout endormi et languissant et qu'environnent de
toutes parts les anciens égouts de Paris, le bout de la rue
Montorgueil, la rue des Poissonniers, celle de Bourbon, et une partie
de la grande rue du faux-bourg St-Denys. Les Filles-Dieu achetèrent peu
à peu ce grand espace de terres contigües dans la censive de
Notre-Dame, de Ste-Opportune et de St-Lazare. Elles furent toutes
amorties avec le temps, les unes par le Chapitre de Paris, moyennant
vingt-quatre sols parisis de cens, les autres par les religieux de
St-Lazare, pour douze livres parisis de rente, et le reste de la même
façon par le Chapitre de Ste-Opportune. »
Source : Gallica-Bnf, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Henri Sauval, page 473 (Paris 1924)
|
Guillaume d'Auvergne qui fut le fondateur de cet ordre religieux
et ses filles reppenties furent à la recherche d'une terre pour ouvrir un hôpital, elles trouvèrent hors des
murailles un espace marécageux et asséchèrent les terrains, et s'établirent à proximité de la léproserie. Elles
impulsèrent un domaine qui s'étendit sur la partie sud-est du faubourg
Saint-Denis et commençait au début du boulevard Bonne-Nouvelle, jusqu'à
la rue du faubourg Poissonnière. Là où se trouve de nos jours le
théâtre du Gymnase, se tenait leur cimetière qui a disparu au début du XIXème
siècle et qui servit aussi à d'autres enterrements, il a été selon
Edouard Fournier destiné aux Prostestants, et a dépendu par la suite de la paroisse voisine de Bonne-Nouvelle.
Le
début des constructions de leur premier couvent datait de 1225 et il
avait été envisagé dans un premier temps qu'elles s'établiraient dans les parages de la
Montagne Sainte-Geneviève. En
1232, l'évêque Guillaume d'Auvergne convainc le roi Louis IX d'appuyer
financièrement les Filles-Dieu : 200 religieuses
étaient dotées d'une rente de 400 livres par an et cet acte perdura ou
fut confirmé par la royauté, mais avec des restrictions. Il
n'a existé aucun titre de fondation : « Nous n'avons aucun de nos historiens qui ne
fassent honneur à Saint-Louis de la fondations de ces
religieuses. » Louis IX a été à l'origine de la création des autres Maison(s)-dieu,
et après sa mort, il existait douze maisons de cette nature
à Paris. Les
Filles-dieu du quartier Saint-Denis répondaient aux problèmes propres
aux "filles ou femmes publiques ou ribaudes" et ont connu pas mal de
difficultés à apporter secours ou leur charité aux femmes dites "de
mauvaises vies". Et la raison pour laquelle elles furent un temps
reléguées derrière les remparts de Philippe II dit Auguste, il a fallu
trouver un accord avec les autorités religieuses locales (Lire le texte de Jaillot).
| Ce
furent avec deux arpents de terre acquis pour les fondations de la
maison que s'installèrent en bas et sur sa partie ouest du faubourg
St-Lazare, voire St-Laurent (ou St-Denis au final) les Filles-dieu. Rapidement
elles achètaient 4 autres acquisitions au sein de la
cursive des chevaliers de Saint-Ladre, et suivait l'achat en 1253, de 8 nouveaux
arpents supplémentaires.
En 1265, Louis IX (en image soignant les écrouelles, ci-contre) leur accorda
le fait de tirer de l'eau de la fontaine St-Ladre ou St-Lazare et de la faire
conduire au couvent des Filles-Dieu. |
|
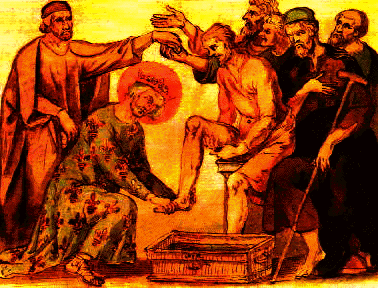 |
|
Les
Filles-Dieu en 1226, avec 200 femmes converties acquérirent
plusieurs arpents de terre hors des remparts avant d'être obligées de
changer de couvent en raison des travaux des fortifications vers 1360 et des menaces d'attaques Anglaises (*). Hors des murailles elles travaillèrent sur des terrains achetés avec
les biens de la communauté vers 1250. Elles participèrent activement
à la collectivisation des anciennes terres marécageuses
en des terres fertiles dans tout le sud-ouest du quartier - « il
fut convenu que la Maison des Filles-Dieu soit érigée
en Hôpital » - au sens d'hospitalité plus que
de soin - ce pour des femmes qui pouvaient y passer une nuit
et y « recevoir un denier ».
(*) « En 1358, le prévôt des marchands et échevins de Paris fit élever la bastille Saint-Denis (n'existe plus et qui servit de protection à la porte St-Denis). Craignant
que l'hôtel des Filles-Dieu, placé si près des nouveaux ouvrages, ne
servit d'abri et de poste avancé aux ennemis, il le fit détruire.
L'évêque Jean de Meulan les installa dans l'hôpital fondé en 1316 par
Imbert de Lyons, à l'intérieur des remparts : à l'emplacement actuel de
l'impasse du Caire. »
Source : Histoire de la Paroisse et de l'église de St-Laurent, Louis Brochard, pages 96 et 97 (Paris, 1923)
|
| |
| En
1356, le prévôt Etienne Marcel lançait le début des travaux d'un
nouveau pan de muraille, ce fut à cette occasion que le premier monastère des
Filles-dieu a été détruit et qu'elles durent s'installer à proximité de
la rue du Caire (2e arr.),
c'est-à-dire à l'intérieur de la ville, en raison des menaces
d'attaques anglaises potentielles lors de la guerre de Cent ans. En
1364, Charles V décidait du renforcement de la construction avec de
nouveaux
remparts tout autour de Paris, créant une nouvelle ceinture de protection en
plus de celle de Philippe Auguste, qui en grande partie fut conservée. A partir du
XIVème siècle, on assista à la
venue des petits artisans qui fuyaient la ville pour échapper aux
charges devenues trop lourdes. Ils s'installèrent en dehors des
remparts et allaient participer de l'apparition des fauxbourgs. Ce qui
repoussait les
frontières de Paris en dehors de l'enceinte de Charles V, qui a été
elle-même été
détruite à partir de juin 1670. |
|
Il
est à noter que les financements de l'implantation des
ordres était le fait du Prince, c'est-à-dire
subventionnée par l'Eglise puis le Trésor royal. De
plus, en raison de terres vivrières, il fut possible d'en retirer des
ressources financières non négligeables. Et aussi son lot de jalousie,
l'on retrouve à ce titre, que Guillaume d'Auvergne devenu évêque de Paris en 1228 a du convaincre
Louis IX, dit saint-Louis : « de faire des progrès sous son épiscopat.
» Pour sa part Louis IX tenta une expérience prohibitionniste accompagnée de la
réinsertion spirituelle des prostituées dans le couvent des Filles-dieu. Cela se
solda par un échec qui le conduisit à rouvrir les maisons closes ou de luxures. La
position de l'Église a été de considérer la prostitution comme un mal,
mais nécessaire, et d'en tirer quelques bénéfices, tout comme le pouvoir municipal.
|
|

|
|
|
| En
1495, les religieuses furent réunies avec celles de Frontevaud, qui
reprirent le nom des Filles-Dieu. Il
ne restait plus qu'une douzaine de
religieuses vers 1480 et elles mirent beaucoup de difficultés à
accepter les nouvelles (plus de douze années de tractation). Et le nom
des Filles-Dieu n'en disparu pas pour autant, et leur présence fut
effective jusqu'à la Révolution en 1790 avec 28 religieuses, au sein de la paroisse
St-Laurent, dont les limites étaient plus grandes que le quartier
St-Denis actuel. |
| |
| Ce
ne fut pas sans difficultés que les ordres charitables se
créerent et durent résister aux épreuves des temps politiques. Un
débat se tint au sein du clergé et aussi au sein de la noblesse sur
la question du secours aux plus démunis. S'affrontèrent surtout des
morales et des enjeux financiers, et ses réalités dépendaient pour
bonne part des paiements des caisses royales. Lesquelles ne furent pas
toujours au beau fixe. Puis s'ajoutait la question morale sur l'aide
aux indigents, aux vagabonds ou errants, aux prostitués, tout cela ne
fut pas toujours au goût des puissants, ces tristes réalités allaient
donner lieu à de nombreuses polémiques et controverses. |
|
|
La Coulture des Filles-Dieu
Henri Sauval ou Sauvalle (*) - historien de Paris
« Plus
bas que la Villette en venant à Paris, les Filles-Dieu étaient Dames
d'une coulture (terrain) dans le faubourg St-Denys, à ce qu'elles
prétendent. Elle régnait entre le chemin des poissonniers et la grande
rue du faubourg, le long de la rue de Bourbon (n’existe plus), depuis
les anciens égouts qui subsistent encore, jusqu'aux anciens fossés,
comblés sous Louis XIlI.
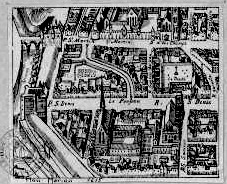 Plan du fauxbourg St-Denys de Mérian en 1615 Plan du fauxbourg St-Denys de Mérian en 1615
Leur
monastère à ce qu'elles disent, l'occupait entièrement non
seulement en 1358 et 1359 qu'il fut ruiné à l'occasion de la prise du
roi Jean, de crainte que les ennemis ne s'y fortifiassent ; mais même
dès l'an 1226. Après être sorties de là, comme ce lieu ruiné n'est
guère loin de la porte St-Denys, ceux du quartier, aussi bien que les
boueurs (nettoyeurs des déchets et boues) y portèrent leurs immondices
et leurs ordures, de sorte qu'en peu de temps, il s'en fit une masse,
et un terrain si considérable, qu'on commença à y bâtir et, même qu'en
1551 les Trésoriers de France, sans avoir égard au droit des
religieuses qui en étaient propriétaire, en passèrent bail à perpétuité
à raison de sept livres Parisis de cens à un certain Thibaud Bourgeois,
qui deux ans après s'en défit en faveur d'un autre bourgeois nommé le
Masson, si bien qu'alors le terrain se trouvant habité et ayant
besoin d'une chapelle on en fit une sous l'invocation de St-Louis, et
de Ste-Barbe.
Des
commencements si heureux y attirèrent tant de monde, qu'en peu de temps
ce terrain devint un des plus gros faubourgs de Paris : mais parce que
devant la ligue, vers l'an 1593. tout fut jeté par terre et rasé, sans
même épargner la chapelle, le lieu demeura désert, jusqu'en 1624 qu'une
nouvelle colonie y emmena des maçons pour le rebâtir, et même la
chapelle, à qui elle donna le nom de Notre-dame de Bonnes-Nouvelles.
Dix ans après
comme on vint à faire une nouvelle clôture de la ville, et que ce
terrain s'y trouva compris, tant de monde y est accouru, qu'à présent
est tout couvert de maisons et de rues, et sans un long procès intenté
par les Filles-dieu pour les fossés des environs, à ceux qui en ont
obtenu le don du feu Roi, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de
place vide à la Villeneuve sur gravois, qui est le nom qu'on a donné à
ce quartier-là. Ce qui reste maintenant de cette coulture consiste en
un grand marais plein de légumes et bordé de maisons le long du
faubourg St-Denys. »
(*) Avocat au Parlement, né et décédé à Paris, vers 1620-1676
Source : Gallica-Bnf – Henri SAUVAL - Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris - Tome premier où vous trouverez un texte plus complet sur les Filles-Dieu de la page 470 à 473 :
A Paris, chez Charles Moette, libraire, rue de la Bouclerie à St
Alexis, près le pont St Michel. Jacques Chardon, imprimeur-libraire,
rue du Petit-Pont, au bas de la rue St Jacques à la Croix d'or.
(Imprimé et édité en 1724).
|
|
LES FILLES-DIEU
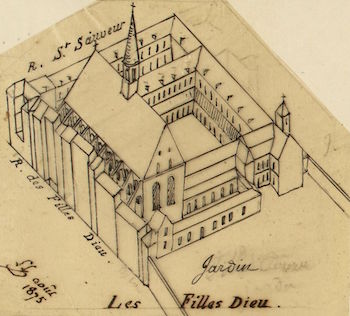 Plan du dernier hôpital des Filles-Dieu (Léon Lémonerie - crédit Paris musées)
Renou de Chauvigné dit Jaillot - géographe et historien
Plan du dernier hôpital des Filles-Dieu (Léon Lémonerie - crédit Paris musées)
Renou de Chauvigné dit Jaillot - géographe et historien
« Nous n'avons aucun de nos historiens qui ne fasse honneur à St-Louis
de la fondation de ces Religieuses. SauvaI (k) dit qu'une charte de
Baudouin, 20ème prieur de St-Martin-des-Champs, porte que ce prince, de
concert avec ce prélat, établit, en 1226, deux-cents femmes converties.
Je conviens qu'on lit cette époque dans l'inscription qui est sur la
porte d'entrée de ce monastère : mais, 1° la Charte de Baudouin ne
parle ni de St-Louis, ni de 200 Converties. La date même de 1226 aurait
dû éclairer nos historiens ; ils n'ignoraient pas que ce prince, âgé
pour lors d'onze ans, ne monta sur le trône qu'à la fin de cette année.
Mais les bâtiments qu'il fit faire dans cette maison, les revenus qu'il
fixa pour l'entretien des filles qui l'occupaient, et les privilèges
qu'il leur accorda, l'en ont fait regarder à juste titre comme le
fondateur ; ce qui n'est pas sans exemple. Dagobert 1er jouit du même
titre à l'égard de l'église de St-Denis, qu'il ne fit qu'augmenter et
enrichir.
L'opinion la plus commune, et que je crois la plus vraie, attribue
l'établissement des Filles-Dieu à Guillaume d'Auvergne, depuis évêque
de Paris. La source et l'onction de ses sermons avaient engagé
plusieurs personnes du sexe, dont la conduite avait été très-dérangée,
à mener une vie plus régulière : pour leur faire éviter les occasions
de la rechute, il forma le dessein de les réunir, et de leur procurer
un asile dans un lieu convenable. Il fit bâtir â cet effet, en 1225 ou
1226, une maison hospitalière hors de la ville et près de St-Lazare, où
il plaça ces « femmes nouvellement converties. » Cet établissement
éprouva d'abord quelques obstacles de la part des prieur et religieux
de St-Martin-des-Champs, et du curé de St-Laurent, sur le territoire et
paroisse desquels cette maison avait été bâtie ; mais ils furent
entièrement levés au mois d'avril de la même année 1226, par un accord
(m) qui fut passé entre ces pauvres femmes nouvellement converties, les
religieux de St-Martin et le curé de St-Laurent : par cet acte, il fut
convenu que la maison serait érigée en hôpital, et qu'elle ne pourrait
servir à un autre usage sans le consentement des parties contractantes
; que le curé de St-Laurent serait indemnisé des droits curiaux, qui
furent arbitrés à 20 sols de rente annuelle ; que le chapelain ou les
chapelains seraient à la nomination du prieur de St-Martin ; que ces
femmes auraient un cimetière, des fonds et deux cloches, et qu'elles
pourraient acquérir jusqu'à 13 arpents de terrain. Cet exposé, que je
viens de faire d'après les titres, suffit, à ce que je crois, pour
détruire ce que Jacques Du Breul (n), Lemaire (?) et autres ont avancé,
que St-Louis fonda les Filles-Dieu, et que son dessein était de les
placer au lieu occupé aujourd'hui par la Sorbonne : il peut aussi
servir à réfuter l'auteur du « Calendrier historique », qui ne place
(o) que vers 1230 la permission d'avoir un cimetière, des fonts
(baptismaux) et des cloches ; et celui des « Tablettes Parisiennes »,
qui marque leur fondation en 1358.
Cet établissement, formé par Guillaume d'Auvergne, dut nécessairement
faire des progrès sous son épiscopat, auquel il fut élevé en 1228 ; et
ce fut lui sans doute qui intéressa St-Louis en faveur de ces pauvres
femmes. C'est seulement par conjecture qu'on a pu avancer qu'en 1232,
ce prince y mit 200 religieuses, auxquelles il donna 400 livres par an.
Le titre de cette fondation ne se trouve point, mais le nombre de
religieuses et le revenu qui leur fut affecté, sont connus par les
lettres du roi Jean (II dit le bon), du mois de novembre 1350 (p) :
elles nous apprennent que cette fondation était un effet de la piété et
de la libéralité de St-Louis ; que la peste et la misère du temps
avaient engagé l'évêque à réduire le nombre des religieuses à soixante
; que, sur ce prétexte, les trésoriers du roi ne leur payaient plus que
200 livres ; et que, sur les représentations des Filles-Dieu, le roi
ordonna que leur nombre serait de cent, et qu'on leur payerait 400
livres comme auparavant : mais la date de la fondation n'y est point
marquée, non-plus que dans les historiens de St-Louis. Si l'on a
présumé que ce fut en 1232, c'est apparemment parce qu'en cette année
les pauvres femmes nouvellement converties obtinrent, sous le nom de
Filles-Dieu, l'amortissement des deux arpents de terre, acquis de
Guillaume Barbette, sur lesquels leur maison avait été bâtie, et de
quatre autres arpents par elles acquis dans la censive de Saint-Lazare,
sur lesquels les prieurs et religieux cédèrent la censive et la justice
qu'ils y avaient, ainsi que le droit de dîme, moyennant 12 livres de
rente (q). On voit qu'en 1253 elles acquirent encore huit autres
arpents de terre, et qu'en 1265, St-Louis leur accorda la permission de
tirer de l'eau de la fontaine de St-Lazare, et de la faire conduire
dans leur couvent.
Les guerres suscitées dans la suite par les Anglais, et la nécessité de
se défendre, firent prendre le parti de se précautionner contre toute
attaque. Les faubourgs s'étaient infiniment augmentés depuis
Philippe-Auguste, mais ils étaient ouverts de toutes parts ; ce ne fut
que sous le règne de Philippe de Valois qu'on projeta de les mettre en
état de défense. Le malheureux succès de la bataille de Poitiers
réveilla l'attention des Parisiens, et les détermina à faire creuser, à
la hâte, des fossés et des arrière-fossés au nord de la ville, et de
simples fossés autour des murs de l'enceinte méridionale. Les
arrière-fossés, suivant le plan arrêté, devaient traverser la couture,
et l'enclos des Filles-Dieu : elles furent donc obligées d'abandonner
leur maison, de la faire démolir, et de se retirer dans la ville. Jean
de Meulan, alors évêque de Paris, les transféra en 1360 dans un hôpital
près de la porte St-Denis, qui avait été fondé en 1316 par Imbert de
Lyons ou de Lyon (de Lugduno) dont je parlerai plus bas. Sauvai (r),
dans les deux longs discours qu'il nous a donnés sur les Filles-Dieu et
sur l'Hôpital d'Imbert de Lyons, s'est souvent écarté de la vérité ;
ses éditeurs ne se sont pas appliqués à la chercher, mais du moins ils
n'auraient pas du laisser subsister cette multitude infinie
d'absurdités, d'anachronismes et de contradictions qu'on y trouve
presque à chaque page, et que ses copistes ont adoptés sans examen. Le
commissaire Lamare (Nicolas, Traité de Police) n'a pas été plus exact :
si l'on examine son cinquième Plan, on verra qu'il n'indique point sous
Charles V l'hôpital d'Imbert de Lyons, où les Filles-Dieu furent
transférées, et qu'il place leur maison, sous le nom de « Filles
Pénitentes Détruites », à l'endroit où la rue Notre-Dame de Recouvrance
aboutit aujourd'hui, du côté du boulevard, quoi qu'elle fût située rue
du faubourg St-Denis, au lieu où est encore l'enseigne de l'Echiquier.
Il en est de même de leur couture, qu'il nous représente bornée au nord
par le boulevard, et au midi par la rue Thévenot, quoique de ce côté
elle ne descendît pas si bas, et que de l'autre elle remontât jusqu'à
l'égout, et il lui donne la figure d'un carré presque régulier, qui en
pousse les bornes, du côté de l'occident, jusqu'à la rue du Gros-Chenet.
J'ai
parlé ci-dessus de l'hôpital d'Imbert de Lyons. On voit par les
lettres de Guillaume de Beaufet, évêque de Paris, du mois de juillet
1316 (s), qu'il consentit, à la prière d'Imbert de Lyons, à
l'établissement d'un Hôpital pour y recevoir les pauvres femmes qui ne
faisaient que passer, et à l'érection d'une chapelle. Imbert, en
qualité d'exécuteur du testament de ses deux fils, destina pour cet
objet une maison et un jardin sis hors de la porte St-Denis, sur la
chaussée (dans la grande rue), qu'il avait acquise de Nicolas Tabourel
(t). L'hospitalité qui s'y exerçait, consistait à recevoir de pauvres
femmes pendant une nuit, et à leur donner le lendemain un pain et un
denier. Il me paraît, par différents actes, que la chapelle était sous
le titre de St-Quentin. Ce fut dans cette maison que Jean de Meulan
plaça les Filles-Dieu ; il fonda une chapelle sous le nom de la
Madeleine, et les obligea de pratiquer l'hospitalité ainsi qu'elle s'y
exerçait auparavant. Elles firent construire les lieux réguliers
nécessaires pour leur communauté ; l'évêque leur donna des Statuts, et
régla qu'il y aurait douze lits pour les pauvres femmes. Les
Religieuses, pour n'être point troublées dans les exercices du cloître
et dans la récitation des divins offices, commirent le soin de
l'hospitalité à des sœurs converses. Les malheurs des temps, et une
certaine fatalité qu'ont éprouvé presque toutes les sociétés
religieuses, introduisirent peu à peu le relâchement dans cette
communauté : telle est la suite funeste des engagements forcés, et de
presque tous les sacrifices volontaires dont on n'a pas médité toute
l'étendue ; on prend souvent pour une vocation décidée, ce qui n'est
qu'un goût passager pour une vie tranquille ; on se flatte d'étouffer
des passions dont on ne connaît que les noms et dont on ignore
l'empire, et l'on oublie bientôt ses devoirs quand on ne les remplit
qu'à regret. Les Filles-Dieu en firent la triste expérience : l'esprit
de l'ordre religieux se perdit, la ferveur et la piété s'éclipsèrent,
et les divins offices cessèrent ; à un petit nombre de religieuses
succédèrent ces victimes infortunées du libertinage, qui portèrent
peut-être moins dans cet asile le repentir du coupable abus qu'elles
avaient fait de leurs charmes, que le regret plus coupable encore de
les avoir perdus, et qui cherchèrent moins à y cacher la honte de leurs
désordres, que celle de l'indigence, qui en est la suite ordinaire.
Il ne restait plus dans cette maison que deux ou trois religieuses et
quatre à cinq converses, qui négligeaient même de s'acquitter des
devoirs que leur prescrivait l'hospitalité qui leur était confiée.
Charles VIII, pour remédier à ces désordres, et remplir les intentions
de St-Louis, ordonna, par ses Lettres-Patentes du 27 décembre 1483, que
cette maison serait occupée à l'avenir par les religieuses réformées de
Fontevraud : ce prince n'en pouvait choisir de plus propres à rétablir
l'ordre et la discipline ; mais leurs constitutions empêchèrent,
pendant onze ans, que ces lettres n'eussent leur effet. Robert
d'Arbrissel, fondateur de l'ordre de Fontevraud, dont la sainteté n'a
pas été contestée par ceux-même qui ont attaqué sa réputation (u),
avait voulu que les religieux de son ordre dépendirent de l'Abbesse ;
il se proposait dans cette pratique peu commune de l'humilité,
l'imitation de la soumission et de l'obéissance que St-Jean
l'évangéliste avait rendue à la sainte Vierge et que Jésus-Christ
semblait lui avoir prescrite en lui disant, « voilà votre Mère, ecce
Mater tua ». Tel est le motif et l'origine de l'autorité temporelle que
l'Abbesse de Fontevraud exerce sur les religieux de son ordre, autorité
douce et bienfaisante, qui ne laisse pas même aux inférieurs le mérite
de l'obéissance à des ordres qu'ils ont suggérés, et souvent dictés
eux-mêmes.
Ce genre d'administration était bien différent de celui des Filles-Dieu
: l'évêque de Paris leur donnait un chapelain à son choix, avait
inspection sur leur temporel, dont il se faisait rendre compte par le
Maître, Proviseur ou Gouverneur qu'il nommait, et était en droit d'y
faire des visites quand bon lui semblait : les Lettres Patentes de
Charles VIII, qui choisissaient des religieuses de Fontevraud pour
gouverner cette maison, lui enlevaient tous ces privilèges. Jean-Simon
de Champigny, alors évêque de Paris, plus jaloux de maintenir l'ordre
ou de le rétablir, que de conserver des avantages attachés à son siège,
consentit à les sacrifier pour procurer ceux qui devaient résulter de
ce changement : ses lettres sont du 13 avril 1494. Il se contenta
d'exiger que les religieuses feraient tous les ans l'office de
St-Louis, et qu'après le décès de Charles VIII et le sien, elles
feraient célébrer un service pour le repos de leurs âmes. Cet obstacle
étant levé, les religieuses de Fontevraud furent introduites dans la
maison des Filles-Dieu. Sauval (y), Dom Félibien, M. Piganiol et
autres, disent qu'elles en prirent possession le 15 juin 1495, au
nombre de huit religieuses et de sept religieux et qu'ils n'y
trouvèrent que quatre converses, lesquelles finirent leurs jours dans
l'observance.
S'il n'y avait pas erreur dans cette dernière date, il y aurait eu un
intervalle de presque quatorze mois entre les lettres de l'évêque et
leur exécution. Sauval, pour répondre à cette objet on, remarque
qu'alors l'année commençait à Pâques ; il fixe cette fête, en 1494,
après le 13 avril, et l'acte de soumission à l'évêque huit jours après,
c'est-à-dire, le 21 avril 1495. Il y a une, erreur manifeste dans cette
supputation : car d'un côté Pâques tombait en 1494 le 30 mars, et de
l'autre .il ne serait pas possible de concilier cette introduction des
religieuses de Fontevraud et l'incorporation des quatre Filles-Dieu le
15 juin 1495 avec l'acte même qui la constate, en date du 17 juillet
1494. On voit par cet acte, rapporté dans les preuves de Sauval (et),
que ledit jour l'évêque s'est transporté dans la maison des
Filles-Dieu, (dans laquelle il avait introduit depuis peu quelques
religieuses de Fontevraud), pour écouter les plaintes de deux anciennes
sœurs qui y demeuraient avant la réforme, lesquelles ne voulaient pas
s'y assujettir ; et qu'après avoir entendu leurs raisons, il a ordonné
qu'elles seraient mises hors de la clôture, mais qu'elles resteraient
dans la maison, où elles seraient logées suivant qu'il conviendrait, et
qu'on pourvoirait à leurs besoins.
Les religieuses de Fontevraud, qu'on avait tirées du monastère de la
Madeleine, près d'Orléans, et de celui de Fontaine, près de Meaux,
prirent le nom de Filles-Dieu, qu'elles conservent encore ; elles y
exercèrent l'hospitalité qui leur était prescrite, laquelle n'a cessé
qu'au commencement du siècle passé. La chapelle de l'hôpital et les
bâtiments étaient en très-mauvais état : on voit dans les archives du
Chapitre de St-Germain-de l'Auxerrois, que sur une requête qui lui fut
présentée par ces religieuses, il leur permit de faire bâtir une
nouvelle chapelle dans leur jardin, parce que celle qu'elles avaient
étant situé sur la rue, le service divin était troublé par le bruit. On
commença, la même année 1495 l'église que nous voyons aujourd'hui, dont
Charles VIII posa la première pierre : elle fut achevée et dédiée en
1508. Vers 1582, Pierre de Gondi, évêque de Paris, usait à cette Maison
la Chapelle de Ste-Madeleine, que Jean de Meulan avait fondée lorsqu'il
transféra les Filles-Dieu dans la ville. On voit encore au chevet
extérieur de cette église, un crucifix devant lequel on conduisait,
dans les siècles précédents, les Criminels qu'on allait exécuter à
Montfaucon (a) ; ils le baisaient, recevaient de l'Eau bénite, et
les Filles-Dieu leur apportaient trois morceaux de pain et du vin : ce
trisse repas s'appelait le dernier morceau du Patient. »
Notes de l'auteur :
(l) Sauval, tome 1 et page 470.
(m) Histoire de Paris, t. 5 et p. 602.
(n) Du Breul, p. 616 et 885. — Lemaire, t.1, p. 504,
(o) Page 200.
(p) Hist. De Paris, t.III et p. 116 et suivantes.
(q) Du Breul, p.885.
(r) Tom., 1, p. 470 et 562.
(o) Gr. Cartul. fol. 57, Cart. 73.
(t) Archives de l'Archevêché.
(u) Baillet, au 25 Février.
(x) S. Jean, chap. 19, V. 27.
(y). Sauvai, t. 1, p. 572. — Hist. de Paris, t. 1, p. 289. Piganiol, t. 3, p. 397.
(z) Registre du Secrétaire de l'Archevêché.
(et) Tome 3, p. 218.
(a) Sauval,.t. 1, p. 482 et 574.
Source : Gallica-Bnf, Recherches critiques, historiques
et topographiques sur la ville de Paris, etc. Tome 9, pages 22 à 32.
Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné dit Jaillot (1710-1780).
Edité chez A.-M. Lottin (Paris, 1772-1775)
|
|
|
|
|
| La Maison de Saint Lazare et Vincent de Paul |
|
|
 |
|
« En
1632, la célèbre Léproserie de Saint-Ladre ne renfermant plus aucun
lépreux, et le dernier Prieur Adrien Lebon ayant cêdé sa Maison à
Vincent-de-Paul, Saint-Ladre, maintenant Saint-Lazare, chef-lieu de la
"Mission", allait connaitre une ère nouvelle de gloire et de splendeur
en devenant le centre d'où rayonneront toutes les oeuvres les plus
belles de charité et de relèvement.
Sous le ministère et la direction
de celui qu'on appelait le bon Monsieur Vincent, Saint-Lazare, si
souvent au cours de son histoire centre de misère et de douleur,
symbolisa « la Maison accueillante et consolatrice », vers qui
s'élançaient la gratitude et l'admiration de l'humanité entière. »
Docteur Léon Bizard et Jane Chapon - 1925
Ci-contre : représentation du domaine de Saint-Lazare au XVIe s.
|
|
Les derniers frères Lazaristes sous tutelle de la congrégation de St-Victor se rassemblaient avec la congrégation de la Mission
de Vincent de Paul, d'autres
communautés religieuses allaient s'y agrèger. La congrégation
séculaire de la Mission prit cession de la Maison et
du Clos de Saint-Lazare et de ses 52 hectares arborés, en fusionnant
avec les derniers Lazaristes (rattachés à la congrégation de St-Victor), tout en en conservant l'appellation d'origine.
|
|
|
« L'un des événements les plus importants de cette période fut
l'installation au prieuré de Saint-Lazare de la congrégation des
prêtres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, en 1632. Au témoignage
d'Abelly, ami et biographe de saint Vincent de Paul et qui fut aussi
curé de Saint-Josse, fille aînée de Saint-Laurent, notre curé fut non
seulement l'habile négociateur de cet établissement, mais probablement
l'instigateur.
Le prieur de Saint-Lazare lui ayant fait confidence des difficultés
sérieuses rencontrées dans la direction de ses religieux, reçut de lui
le conseil de s'adresser à Monsieur Vincent. Il insista lui-même
vivement auprès de celui-ci dans le sens d'une réunion de la
congrégation au Prieuré, au point de s'en égosiller, comme il l'écrit
plaisamment, et en latin « raucae factae sunt fauces meoe » (la gorge
rauque), dans une relation qu'il a faîte des négociations.
Lorsque la bulle pontificale « aequum reputamus » (considéré comme
équitable) eut été obtenue, les curés de la ville et des faubourgs
firent à son entérinement au Parlement une opposition très ferme. Seul,
N. de Lestocq, le plus directement intéressé ou menacé, donna son
consentement par acte notarié du 9 février 1632 qui fut reçu au
Parlement. Un arrêt contradictoire et solennel, le 21 août suivant, mit
fin à la contestation. »
Louis Brochard, Histoire de la Paroisse et de l'église de St-Laurent à Paris - page 42 (1923)
|
|
Au
sein de la maison de Saint-Lazare, dans le faubourg du même nom,
les activités se développèrent en l'accueil de
religieux. S'y firent
des séminaires et s'y tenait aussi une maison de retraite
et un collège. Et l'on accordait une hospitalité
aux laïques, près de 20.000 personnes y passèrent
de 1635 à 1660, pour des séjours de huit jours,
à titre gratuit.
Vincent de Paul y conserva une chambre
jusqu'à sa disparition. Monsieur
Paul fut inhumé dans la vieille église de Saint-Lazare en 1660 à 85
ans, et béatifié en 1729.
Ses restes furent conservés jusqu'à la Révolution dans l'église disparue de Saint-Lazare et ils n'ont pas été
conservés. De triste mémoire, Saint-Lazare fut aussi une prison
(une Renfermerie) pour enfants indisciplinés de familles riches (un par
cellule et sans vis-à-vis). | |

|
Si la Maison de Saint-Lazare, doit
à Vincent de Paul (ou Depaul) d'avoir été un lieu d'hospitalité et de formation de
l'esprit avec ses séminaires, elle a été aussi une renfermerie, une prison pour les garçons
ou jeunes hommes indisciplinés ou rebelles à la commune morale. C'est là que peut-être le poète Chapelle fit un
séjour et ceci "mandé" par ses tantes (ou son oncle), qui le trouvaient un peu trop libertin à
leur goût, ou ce que lui-même a laissé comme trace comme auteur (ou ce qu'ont pu écrire les historiens).
Il existe par ailleurs une histoire élogieuse d'un ami de
Monsieur Paul, l'évèque de Rodez Abelly, ancien curé de l'église disparue de
St-Josse, puis de l'église Saint-Laurent, celui-ci a relaté dans une Vie de saint Vincent de Paul toutes ses réalisations et activités nombreuses. Vincent de Paul a été à l'origine entre autres de l'institution des Enfants-Trouvés,
qui allaient dépendre des Hôpitaux-Généraux. Il recevit la proposition
d'en prendre la direction (notamment des Maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière), qu'il refusa pour lui-même, mais accepta ou
proposa dit-on Abelly à ce poste, clef de l'histoire du
"grand renfermement". Qui s'opéra en toute négation des préceptes de
Vincent de Paul? C'est un peu tout le problème ou le fond de ce qui
allait devenir un ordre puissant et expansif en France, ne serait-ce que dans les
colonies, ou simplement ce qui allait devenir un rouage des pouvoirs établis.
Après avoir été une geôle sous la Révolution, plus tardivement St-Lazare devenait une prison réservée
aux femmes (ci-dessous en photo). Qui depuis n'existe plus, mais a laissé quelques stigmates
de bâtiments disparus. C'est en ce lieu que Louise Michel fut incarcérée
en 1883, le 1er avril, après avoir été arrêtée et conduite au dépôt. En
juin, la "Vierge Rouge" avec Emile Pouget étaient appellés à comparaître
devant les Assises. |
|
 | | Louise Michel fut condamnée à 6 ans pour sa participation à la manifestation des chômeurs du 9 mars. Lors du procès au palais de Justice sur l'île de la Cité, à sa toute fin, elle déclara au juge et à sa possibilité de pourvois : « Jamais ! Vous imitez trop bien les magistrats de l’Empire. »
« De violentes protestations, parties du fond de la salle, ont accueilli la condamnation des accusés. Quelques cris : Vive Louise Michel !
se font entendre et c’est au milieu du bruit et des cris les plus
variés que l’audience est levée. Le tumulte se continue en dehors et le citoyen Lisbonne, qui se fait remarquer par la véhémence de ses protestations, est expulsé du Palais. » Le 15 juillet, elle était transférée à la prison de Clermont dans l'Oise (un ancien cloître devenu prison).
Mémoires de Louise Michel (troisième procès, 21 juin 1883)
|
|
|
La plus célèbre des femmes
incarcérées au XXème siècle fut Mata Hari, dont la France voulue
faire un exemple en l'exécutant pour espionnage
durant la guerre de 1914-1918. Sa
culpabilité laisse de nos jours plus que des doutes. Il fallait faire
un exemple et de plus elle incarnait une morale non conformiste, elle
fut fusillée le 15 octobre 1917 au polygone de tir de Vincennes.
Mata Hari à Saint-Lazare (de son vrai nom, Margaretha Zelle McLeod)
« — Je veux écrire... Ce
sont là les premières paroles que prononça Mata Hari aussitôt après
avoir été transférée dans la cellule aménagée pour les condamnées à
mort de Saint-Lazare. Aussitôt en possession de « ce qu'il faut pour écrire », nous dit le Cri de Paris, la danseuse espionne commençai de sa large écriture, le premier chapitre de Ses mémoires.
Mata Hari s'est depuis consacrée à son œuvre. Elle ne cesse d'écrire
toute la journée, excepté naturellement durant les visites qu'elle
reçoit de M. le pasteur Darboux.
Elle
écrit ses, mémoires en français, Elle eût pu tout aussi bien le faire
en hollandais, en anglais, en allemand, eh japonais et en javanais, car
elle possède parfaitement ces cinq langues. C'est aux Indes Orientales,
où elle séjourna en compagnie de son mari, l'officier hollandais Mac
Leod, qu'elle apprit, par désœuvrement, les danses sacrées, et se
baptisa Mata Hari (Œil du Matin). Bien qu'elle soit condamnée à
mort, la prisonnière de Saint-Lazare a une singulière préoccupation,
elle craint de manquer d'argent. Son maigre pécule — elle ne possède
plus que 55 francs — a été sensiblement appauvri par les dépenses de
fiacre qu'elle a dû faire, durant l'instruction. Car elle se refusait à
venir au cabinet de M. le capitaine rapporteur Bouchardon dans la
voiture cellulaire. Espère-t-elle maintenant sa grâce ? »
Source : Retronews, journal Le Siècle,page 2, 4 août 1917
La prison fut détruite en 1930 pour insalubrité. Aujourd'hui, il ne demeure de
la prison et de l'hôpital St-Lazare, qu'une infirmerie et la chapelle de
Louis-Pierre Baltard, une opération de construction ménée en 1834, restaurées en 1931 par Gaston Lefol. Les restes de la
prison et de l'hôpital encore présents sont inscrits
auprès des monuments historiques depuis 2005.
Le domaine de Saint-Lazare
fut d'une superficie de plus de cinquante hectares, soit un
peu plus grand que le jardin actuel des Tuileries. Ce
fut la plus vaste propriété de Paris, connue pour ses arbres fruitiers
et ses productions maraîchères. L'industrialisation croissante au XIXe
siècle fit
disparaître cette grande étendue de verdure au profit notamment du
train. Et il reste aujourd'hui les 2 gares de la SNCF, notamment la gare de l'Est. Il passa aussi par là le
coup d'arrêt mis aux propriétés ecclésiastiques au sein des faubourgs.
La Révolution de 1789 proscrivit tous les ordres, sauf les ordres
charitables, mais ceci engagea leurs départs vers le sud parisien pour
les Lazaristes et soeurs associées. Et les derniers biens, c'est-à-dire
les actes de propriétés de l'Eglise du faubourg, celui-ci appelé Franciade furent vendus ou étatisés.
Lire le récit d'Albert Callet sur la prison, après sur cette même page...
|
|
|
|
|
|
A Saint-Lazare, une chanson d'Aristide Bruant, édition de 1888 : partition, extraits texte et dessin
|
|
Après
la seconde guerre mondiale, la prison pour les femmes détruite laissa
place à l'hôpital Saint-Lazare, et ce ne fut qu'en 1961 que fut créé le
jardinet encore existant et son entrée en brique rouge. Sur
les fondations d'entrée de l'ancienne prison, on découvre de nos jours
le visage Vincent de Paul dans le faubourg Saint-Denis, ainsi l'on peut
deviner en cet espace certaines marques de l'histoire. Jusqu'en 1999 est restée
une activité universitaire, principalement dans le domaine de la
médecine, et il existait aussi quelques bureaux de la préfecture
parisienne de Police. Depuis a eu lieu un réaménagement du site avec la
création d'une nouvelle voie (rue du docteur Léon Schwartzenberg -
1923-2003) et de nouveaux équipements collectifs (médiathèque, salles
de sport, une école maternelle, un centre social et un café).
|
|

Fresque murale face au square Alban Stratagne (2018)
|
|
Monsieur Vincent un film de Maurice Cloche
et avec Pierre Fresnay (1947)
|
|
|
|
La Compagnie des Filles de la Charité, au plus bref...
|
|
|
Dès
1630, Monsieur Vincent les confia à Louise de Marillac, qui le seconda
dans l'organisation, la visite et le suivi des confréries, créées par
lui-même et ses proches, là où se "donnaient" les Missions. Ces bonnes
volontés « déjà toutes données à Dieu pour le servir dans les Pauvres »
étaient donc dispersées dans Paris, chacune au service d'une confrérie
différente. Rapidement, Louise de Marillac décida la nécessité de les
grouper, afin de les mieux former et les accompagner dans leur service,
tant corporel que spirituel.
|
|
 |
|
La compagnie fut fondée en 1633, par Vincent de Paul et Louise de Marillac (ci-contre). Les
premières Charités (ou Confrérie de Charité)
ont été organisées par M. Vincent dès
1617, à Châtillon-les-Dombes. Elles étaient
alors composées de femmes de milieux relativement modestes,
celles qui désiraient se dévouer au service des pauvres et des malades de leurs villages ou paroisses.
Quand ces confréries
ont vu le jour à Paris, des Dames de la noblesse ou de
la haute bourgeoisie s'y sont engagées, entraînées
par le zèle et l'enthousiasme apostolique de Monsieur
Vincent. Mais
leurs obligations familiales, leur rang social, rendaient difficiles
les services dans les maisons des pauvres. Certaines se virent dans l'obligation de se décharger de ces tâches sur leurs
servantes, celles-ci les accomplissaient le plus souvent par contrainte, plus
que par la volonté divine ou bonté d'âme.
|
|
|
| Après
mûres réflexions, Louise de Marillac obtint l'autorisation
de Vincent Depaul, le 29 novembre 1633. Louise
de Marillac recevait régulièrement chez elle les six premières
"Filles". Ces "Filles" étaient servantes des "Dames" de la Charité et
elles engageaient ainsi l'acte de naissance de la Compagnie des Filles de la Charité.
C'était
une nouveauté dans l'Eglise catholique, qui n'admettait pas que des
religieuses
puissent vivre hors des cloîtres. La Compagnie fut approuvée par
l'Archevêque de Paris, en 1655, et par Rome, en 1668. Elles disposèrent
d'un hôpital au sein du faubourg et se trouvèrent non loin de la
maison ou enclos de Saint-Lazare, soit juste en face dans le faubourg
et à côté
de l'ancienne fontaine au nom du même saint patron, depuis disparue. |
|
|
|
UNE VIEILLE GEÔLE PARISIENNE SAINT-LAZARE
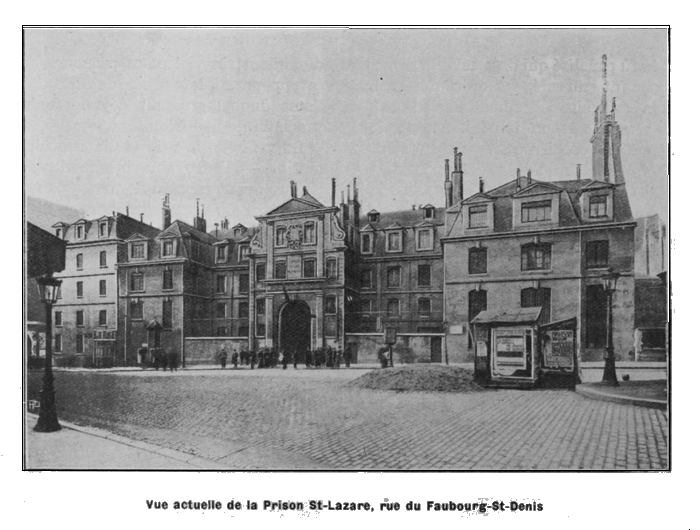
« Dans son immense enceinte,
Paris concentre toutes les joies et toutes les douleurs de l'humanité,
tous les héroïsmes et toutes les infamies. A côté des palais somptueux
consacrés aux joies, aux plaisirs, à l'art, au culte du Beau, les
musées, les théâtres, les bals, les asiles où l'on pleure, les hôpitaux
où l'on souffre, les prisons où l'on peine. A côté du Paris pimpant,
chatoyant, brillant, paré, éclatant de lumières, amoureux de luxe et de
fêtes joyeuses, le Paris dolent et misérable qu'angoisse la douleur,
qu'étreignent la misère et la faim. « Dans cet océan sans fonds, dit
Balzac, il s'y rencontre à côté des perles, des monstres. » Mais de
plus en plus ce creuset merveilleux où tout s'affine, tend à rejeter au
loin ses impuretés et ses scories.
Tandis que, par un mouvement lent, mais ininterrompu, depuis sa
formation, le Paris riche et aristocratique s'avance toujours vers
l'Ouest, la Cité, de plus en plus, repousse hors de ses murailles, dans
sa banlieue du Midi et du Nord, dans ces plaines arides, lépreuses de
misère, sans verdure, bossuées de gravats, hérissées dé cheminées
d'usines aux panaches sulfureux ou noirs, dans ces champs livides, tout
ce qu'on pourrait appeler ses communs, ses organes vils, ses voieries,
ses hôpitaux, ses abattoirs, ses prisons, comme les glaciers qui, selon
le mot de V. Hugo, « dont je ne sais quelle chasteté grandiose et, d'un
mouvement insensible, mais irrésistible et continu, rejettent sur leurs
moraines les blocs erratiques ».
Aujourd'hui, c'est au tour des prisons à émigrer hors murs; le Conseil
général de la Seine ayant entrepris l'œuvre de leur réorganisation sur
de nouvelles bases et de leur transport en dehors de l'enceinte. On a
démoli Mazas et Sainte Pélagie que remplace, sur le plateau de
Villejuif qui domine la Bièvre, la prison colossale et modèle de
Fresnes-les-Rungis qui comprend 2.000 cellules. Le plan de cette prison
nouvelle a été conçu, d'après l'inspiration du Conseil, et partant de
cette donnée que la peine, tout en châtiant le coupable, ne doit ni
l'abrutir, ni le déprimer moralement et physiquement en le rejetant
dans la vie, anémié, aigri, farouche, impropre à tout travail et bon
pour l'hôpital ou une nouvelle prison, mais lui laisser, au jour de la
libération, la force de gagner sa vie et de se réhabiliter.
Paris se trouve placé, au point de vue pénitentiaire comme au point de
vue hospitalier, dans des conditions spéciales. Il est le centre -
Eldorada ou Maëlstrom - vers lequel convergent ou sont attirés tous les
déclassés, les miséreux, les irréguliers, les tarés, les ruffians qui
espèrent y faire fortune par tous les moyens ou y cacher, dans
l'immense tourbillon, les fautes et les ruines d'antan.
Le Conseil général de la Seine a décidé que Saint-Lazare sera démoli et
ira rejoindre, sous la poussière des choses mortes, Mazas et
Sainte-Pélagie. Mais il faudra attendre que la commission
extraparlementaire du Régime des Mœurs ait statué pour décider du sort
de Saint Lazare, et il est probable que, dans un temps prochain, la
vieille prison « couleur de boue », comme l'appelle Alfred de Vigny
dans Stello, tombera sous la pioche qui en fera jaillir une envolée de
souvenirs comme un heurt d'airain fait envoler des essaims d'abeilles.
Il y avait là, dès l'an de miséricorde et grâce
1110, dominant Paris, au bord du ru de Belleville, un hôpital de
lépreux, construit sur l'emplacement d'une vieille basilique dédiée à
saint Laurent et d'un antique moustier (monastère) dont parle Grégoire
de Tours et qui fut dévasté par les hordes normandes. A leur retour de
la deuxième croisade, les soldats de la Croix avaient rapporté la peste
et la lèpre ; ces maladies horribles épouvantèrent tellement le
populaire de Paris, de tout temps si impressionnable, qu'on fit par
toute la ville une criée à son de corne et à son de trompe pour donner
ordre aux ladres de se « bouter hors des murs ».
|
|

|
La femme de Louis le Gros (le sixième du nom) fit bâtir la léproserie
qui n'était qu'un assemblage de huttes en pisé et en torchis, à demi
creusées en terre et entourées d'une muraille basse. Au lieu
d'installer, comme aujourd'hui, les hôpitaux en lieu élevé et salubre,
fouetté du plein air, on les enterrait profondément ; c'étaient des
cabanons où le jour et l'air n'arrivaient que par le haut.
La reine affecta à cette fondation la concession de certaines foires
qui se tenaient aux abords de la basilique de Saint-Laurent. En face,
sur le côté droit de la voie montueuse qui escaladait le premier
soulèvement de la colline de Montmartre, s'élevait un petit pavillon,
le Logis du Roi, où de tradition le roi de France s'arrêtait quand il
allait solennellement prendre l'oriflamme à Saint-Denis pour
entreprendre une grande chevauchée contre ses vassaux rebelles; il s'y
arrêtait une seconde fois quand il allait dormir son dernier sommeil
sous les cryptes de la vieille basilique dyonisienne.
Les ladres de Saint-Lazare, qui devaient tous être « issus d'un
légitime mariage et nés entre les quatre portes de la ville »,
venaient, en vertu d'une coutume pleine d'enseignements, jeter un à un
l'eau bénite sur la dépouille royale « déposée entre les deux portes ».
Au seizième siècle, le relâchement s'était introduit dans cet hôpital
qui ne recevait plus guère de lépreux mais des gens qui, pour échapper
à l'impôt et à la capitation si durs alors, se disaient ladres; de là
la synonymie de ladre et d'avare. Les prêtres chargés de le desservir,
selon l'habitude d'alors, envahirent les revenus et gaspillèrent les
fondations.
Pillée, dévastée, saccagée par les Anglais, la léproserie fut remise
aux chanoines de Saint-Victor, mais des irrégularités dans l'emploi des
aumônes destinées à « l'entretènement (l‘entretien) et à la nourriture
des pauvres ladres » amenèrent l'intervention du Parlement qui ordonna
aux religieux d'employer au moins le tiers de leurs revenus à
l'entretien de l'hôpital.
En 1632, la maison était en pleine décadence, lorsqu'elle fut donnée
aux prêtres de la Mission qui venaient d'être institués par saint
Vincent de Paul. Elle devint le chef-lieu de cette congrégation célèbre
qui alla par tout le monde évangélisant et prêchant les infidèles,
toutefois on imposa au fondateur de l'Institut l'obligation de recevoir
les lépreux qui étaient encore, à cette époque, très nombreux à Paris.
De sa rude et forte main, cet homme, qui fut sublime dans le bien,
régénéra la maison et y imprima sa puissante empreinte. Lorsque les
Espagnols, après la prise de Corbie (près d'Amiens), menacèrent la capitale,
l'énergique patriote, à l'appel de Richelieu, fit de Saint-Lazare la
place d'armes, le boulevard de Paris ; en huit jours, soixante-douze
compagnies levées parmi les domestiques et apprentis furent fermées,
exercées et prêtes à partir au-devant de l'ennemi.
C'est de cette petite cellule froide et triste qu'il conçut et organisa
cette œuvré admirable des Enfants assistés, de ces misérables épaves de
l'amour qui mouraient par milliers aux marches des églises. C'est de là
qu'il écrivit ces sermons et ces lettres d'un style si poignant et si
sobre où, en présence des misères de la Fronde et de l'insouciance de
la Cour, il flagelle si énergiquement les vanités, les prodigalités et
les avidités des grands. C'est sur cette marche de pierre, usée à
moitié, qu'il s'agenouillait pour demander au ciel de l'inspirer et de
le soutenir dans cette œuvre immortelle de Grand aumônier de France.
Saint Vincent de Paul mort, les Lazaristes bénéficièrent de la gloire
du bienheureux, ils agrandirent considérablement la maison et la
transformèrent en une « retraicte honneste et chrétienne » où ils
formaient, par des lectures édifiantes, des pratiques pieuses, à la
continence et à la vertu, les fils de famille dont les parents
voulaient réprimer les écarts d'une exubérante jeunesse.
Ils construisirent ces édifices conventuels que nous voyons encore
aujourd'hui, d'un aspect si dur et si sombre, si régulier et si sévère,
et qui sont de la même époque que la Sorbonne dont on a démoli, il y a
quelques années, la vieille cour de si haut caractère, avec ses
bâtiments aux toits aigus d'une élégance austère et sobre. Les
architectes laissèrent intactes les fondations de l'ancienne
léproserie. Il y a quelques années, en creusant pour l'établissement
d'un calorifère, on mit à jour, dans le vieux tuf gallo-romain, des
anciennes cryptes aux arceaux élégants, aux nervures délicates. Au bout
de la crypte profonde, à ras du sol, une trappe de fer ferme un trou
béant où l'on descend par des marches gluantes et rompues. Une odeur
fade de marécage vous prend à la gorge, on entend clapoter l'eau noire.
C'est le ru canalisé qui descend à la Seine. Chapelle (poète) fut
enfermé, par ordre paternel, dans la « retraite » des bons Pères ; mais
son exemple et son impénitence finale montrent de combien petite vertu
étaient la discipline et la correction lazaristes.C'est à la maison
Saint-Lazare, sous la férule de fer gantée de velours de ces directeurs
de consciences perverties, que l'abbé Prévost fait enfermer l'aimable
Des Grieux qui, rêvant aux folles caresses de l'adorable Manon,
écoutait d'une oreille distraite les sermons et les homélies du
séminariste Tiberge qui tant assommaient Musset !
A la veille de la Révolution, Beaumarchais y fut conduit sur un mot du
roi, écrit au dos d'une carte à jouer, pour le punir des hardiesses
immortelles qu'il s'était permises à l'égard des grands dans le Mariage
de Figaro. Il n'y resta d'ailleurs que trois jours ; un mouvement
d'opinion très violent se prononça en sa faveur parmi le peuple de
Paris, dans l'âme duquel grondait déjà le tonnerre prochain de la
Révolution. La veille de la prise de la Bastille, au matin, -
l'effroyable misère des campagnes ayant rabattu de toutes parts des
troupeaux d'affamés sur Paris - d'après un bruit qu'il y avait du blé à
Saint Lazare, la foule y court et trouve d'abondants harnois de gueule
que les bons Pères avaient entassés. On transporta le tout aux Halles,
après avoir quelque peu défenestré les meubles et donné la volée aux
prisonniers.
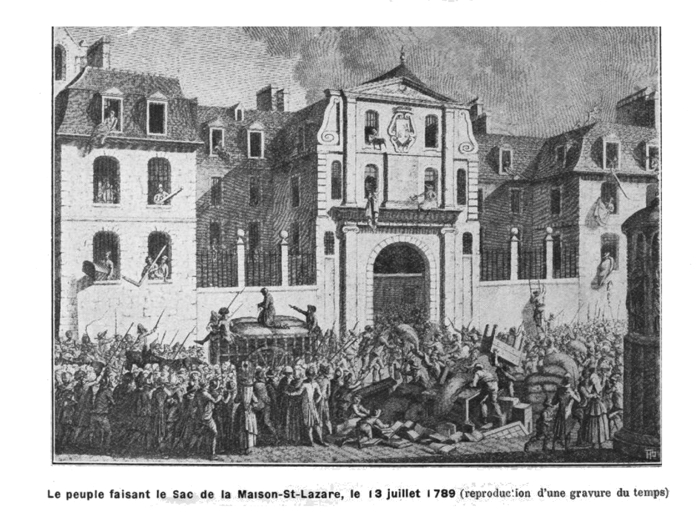
La Révolution fit de Saint-Lazare une prison. C'est dans la « Maison
Lazare » qu'André Chénier écrivit l'élégie de la Jeune Captive, hymne à
la toute charmante Mlle de Coigny, avec laquelle il ébaucha un amour
tendre et qui, « échappée aux réseaux de l'oiseleur cruel », divorça à
la suite d'un procès célèbre. Quatre cents suspects que le Comité de
salut public semblait oublier étaient entassés dans ces bâtiments gris
et sales, aux barreaux épais entourant des cours sinistres, d'où
rarement, du haut des toits, le soleil jette un rayon triste.
L'invocation de Chénier au poignard, seul espoir de la terre, ses
brûlantes apostrophes aux bourreaux, barbouilleurs de lois, vinrent
rappeler au Comité et aux triumvirs l'imprudent poète.
C'est de ce sombre corridor de gauche qu'a immortalisé Muller dans son
romantique tableau de l'Appel des condamnés, que, dans la lugubre
charrette, aux chaînes retentissantes, éclairée de falots aux lueurs
sanglantes et fumeuses, par une orageuse soirée de thermidor, partit
avec Boucher, le fade poète des Mois, André Chénier, pour aller, à
l'avant-veille du jour de la délivrance, à la guillotine, où ce qu'il
avait là s'enfuit avec son sang.
Les lieux n'ont pas changé ; c'est bien toujours le sombre porche, les
hautes mansardes, la porte cochère énorme et trapue, aux vantaux
martelés de clous, donnant accès dans une cour, aux pavés encadrés
d'herbe, et barrée en deux par un haut mur. Ce sont encore les mêmes
corridors longs et froids, aux dalles - cassées, aux portes épaisses
percées de guichets grossiers, les lourds piliers supportant les
plafonds aux poutrelles serrées, enfumés et noircis, les larges
escaliers cirés aux balustres massifs, aux marches de calcaire bleuâtre
usées par le battement des galoches des prisonniers.
A côté du Dépôt, cette antichambre, autrefois, de la mort, que le
tableau de Muller a agrandi et dramatisé, se trouve un endroit
sinistre, aux vitres épaisses, aux murs rongés de nitre et lépreux
d'humidité ; dans un coin, une auge énorme, pleine d'eau croupie. C'est
là où l'on fustigeait jadis les faiseurs de libelles. Ce cachot lugubre
de basse geôle a gardé le nom de casse-gueule. A quelques pas, au bas
de quelques marches, un trou noir éclairé par son soupirail grillagé,
c'est le cachot des Aînesses, où les fils de famille qui n'avaient pas
voulu se soumettre à la règle austère « de redressement et de pénitence
», allaient expier leurs tapageuses fredaines et leur mépris des
hypocrisies et des conversions feintes.
Les préaux, sur lesquels s'ouvrent les portes basses des anciennes
cellules des Lazaristes dont les pluies n'ont pu encore laver les
numéros, enchâssés dans les hautes murailles, sont glacials; au milieu,
une énorme fontaine de pierre qu'entourent quelques acacias malingres
et où pleure l'eau d'un robinet. Au-dessus de la porte, encore peint
des couleurs nationales, se voit le vieux cadran portant sa devise de
mort : Hœc mea, forte tua (« Voici mon heure, peut-être aussi la tienne
»), et au fronton d'un autre portail, la vieille horloge qui sonne
l'heure aux damnés de cet enfer où l'aiguille .pose sur l'émail
brillant, Dans les soixante pas où sa course est bornée Son pied sonore
et vigilant.
L'apothicairerie avec ses vases aux formes antiques, la lingerie, ont
bien gardé le caractère d'autrefois. L'atelier des détenues de droit
commun était jadis la vieille chapelle des Lazaristes; elle a été bien
dégradée, on reconnaît encore la forme de l'abside et les voûtes d'une
solidité superbe. La chapelle moderne est contiguë, c'est un bâtiment
d'une laideur officielle ; l'autel, dominé par une statue médiocre de
saint Vincent L'appel des dernières victimes de la "Terreur" d'après le
tableau de Charles Louis MULLER (musée de Versailles) de Paul, est élevé de
six marches. En bas, des bancs barbouillés de couleur jaune, réservés
aux condamnées de droit commun ; en haut, aux tribunes, les prévenues
et les condamnées administratives. Derrière l'autel, une copie de la
Madeleine de Prud'hon. Dans un campanile, une cloche blanche, d'argent
pur, dit-on, tinte les Angelus et les heures des offices.
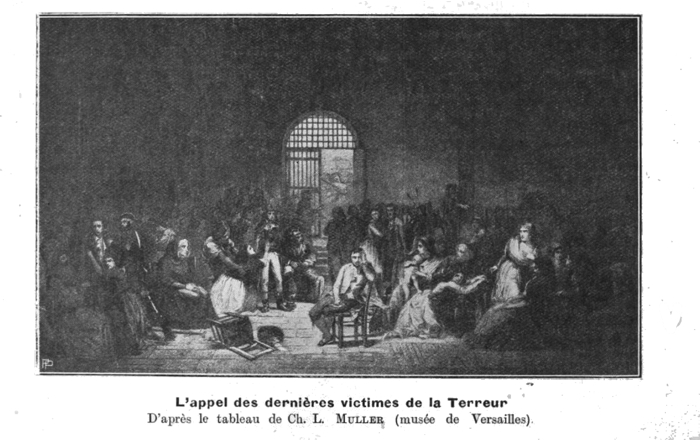
Tous ces bâtiments sont
entourés d'un large chemin de ronde ou bordés de bâtisses qui servent
de magasins de vêtements et de lingerie pour toutes les prisons de la
Seine. A la lingerie, on confectionne les camisoles de force en toile à
voile pourvues de sept courroies et destinées à mater les furieux, et
les suaires en toile grossière dont on enveloppe les morts. Là aussi se
trouvent les fours où l'on boulange pour toutes les prisons du
département, et cela en vertu d'une bien curieuse tradition qui remonte
à sept ou huit siècles, à l'époque où Saint Lazare était un hôpital de
pestiférés. Les boulangers ayant remarqué qu'ils étaient plus exposés
que les autres artisans à contracter la lèpre, probablement à cause de
l'action du feu sur la peau, faisaient à la léproserie d'abondantes
aumônes de pain, et celle-ci, par réciprocité, recevait tous les
boulangers atteints de cette cruelle maladie.
Au fond, un jardin triste et vide, planté de vignes grimpantes, de
lilas étiques, d'acacias et de sycomores d'un vert gris et terne :
c'est le lieu de récréation des nourrices, car, à Saint-Lazare, il naît
chaque année une cinquantaine de pauvres bébés. Cette nursery en plein
air jette dans ce triste refuge une note attendrie. Non loin, la
Morgue, petit bâtiment bas entouré d'un mur à hauteur d'appui, meublé
seulement de trois dalles de pierre, où on expose les corps, et d'une
table de fer pour la dissection; dans un angle, le brancard et la bière
communs.
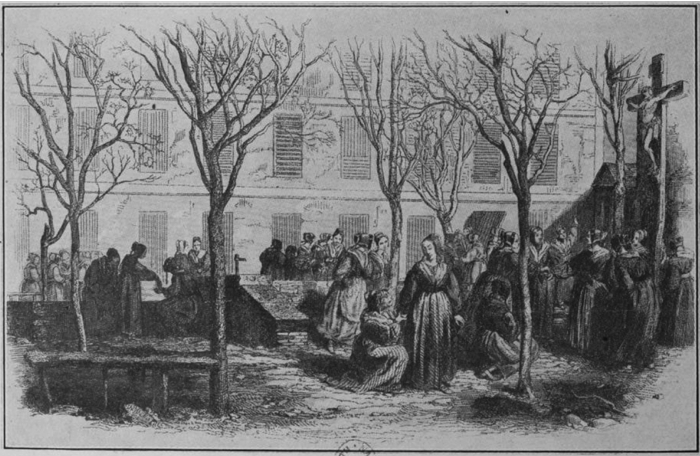
On enferme à Saint-Lazare toutes les femmes, sans exception, quel que
soit le délit ou le crime qu'elles aient commis. Malgré les règlements
et les séparations, il y a, dans une promiscuité fâcheuse et
dangereuse, la voleuse de profession, la bonne infidèle, la femme
délaissée qui a tenté de se venger, la marchande des quatre-saisons qui
a contrevenu aux règlements, les filles soumises.
Chaque jour, dans la cour d'entrée, les « paniers à salades » qui
viennent du Dépôt vident leur contenu. Les gardiens font la haie et,
une à une, descendent toutes ces femmes sur qui dame police a mis sa
rude main, quelques-unes en toilettes tapageuses, d'autres en haillons
sordides. Dans le parloir, une religieuse de Marie-Joseph fait le tri.
Les détenues administratives gardent leurs hardes, mais
s'encapuchonnent du bonnet noir de la prison. La plupart ont sur leur
figure, insignifiante et niaise, un sourire d'inconscience ;
quelques-unes ont l'air dur et révolté ; d'autres, hypocrite et
sournois. Presque toutes portent dans leur regard le souvenir farouche
des errances lugubres et des désespérances maudites.
L'aspect est étrange, dans les longs couloirs sombres, de ces longues
théories de femmes marchant silencieusement en file indienne, escortées
des religieuses de Marie-Joseph, calmes et graves, dans leurs longs
vêtements de laine, sous leur triple voile blanc, bleu et noir — œs
triplex (triple airain). Parmi ces filles au front bas, à l'air
insolent ou épais, quelques fillettes, poussées sur le fumier parisien,
pauvres brebiettes (petite brebis) égarées dans cet horrible bercail,
au teint de chlorotique (jaune pâle) ravivé par des yeux chercheurs,
charmantes sous la coiffe brune de leur petit béguin ; elles font
penser à la pauvre et adorable Manon. Va-t-elle tomber toute entière,
cette vieille geôle dont le nom sonne comme un glas sinistre dans
laquelle la lèpre du Nouveau Monde a succédé à celle de l'Orient, qui a
renfermé tant de misères, de douleurs et de révoltes ?
Ne va t'on pas garder une partie de ce vieil logis qui tient une place
à part dans les vieilles annales parisiennes, à chaque pierre duquel
s'accroche un lambeau de notre histoire Qu'on en fasse un musée
d'hygiène, un musée pénitentiaire, mais qu'on ne vienne pas encore,
nous jeter bas ces corridors, ces geôles hantés des souvenirs de jadis.
Que la Commission du Vieux Paris, que les Amis des Monuments parisiens jettent un cri d'alarme ! »
Source : Gallica-BnF Albert Callet (1843-1925), Une veille géôle parisienne St.-Lazare (Paris,1909)
|
|
|
|
|
Les énigmes de Paris et les terrains récupérés des Filles-Dieu?
|
|
|
Vous trouverez ci-après, un texte de
M. Edouard Fournier, au sujet des Filles-Dieu et de leurs terrains dans
le quartier de la Porte Saint-Denis, les suites de leurs batailles
juridiques sur leurs terres marécageuses, entre autres. Plus les
raisons de l’appellation de certaines rues des actuels Xème et
IXème arrondissements : qui en a été l’ordonnateur ou les
propriétaires, et les raisons de l’attribution des noms de la rue
d’Enghein, de l’Echiquier et d’Hauteville, et les noms d’anciennes
voies ayant depuis disparues. Ceci
bien avant les travaux d’Haussmann,
ce document permet de saisir une des mutations administratives et
urbanistiques que connue la paroisse de Saint-Laurent de Louis XIII aux
années 1770, qui absorbait les quartiers St-Martin et St-Denis. Et à
proximité se tenait la paroisse de Notre-dame de Bonne-Nouvelle
(sur l’actuel
IIème arrond.), l’église du même nom se situant rue de la Lune…
Louis XIII avait fait opérer un renforcement des fortifications par
l'élargissement des fossés sur toute la rive droite ou nord parachevant
le
travail de ses aïeux, et son fils, le quatorzième du nom engagea sa
destruction et sa mise en
perspectives dans le cadre l’élargissement de la capitale. Puis sous
Louis XVI avec ce qui allait devenir les barrières de l’octroi
dessinées par l’architecte Nicolas Ledoux à la hauteur de la barrière
des Vertus (aujourd’hui la place de la bataille de Stalingrad), qui
donnait sur le village de la Villette via le faubourg Saint-Martin,
elle se situait à la hauteur de la rue d’Aubervilliers (XIXème
arrond.). Pour la barrière de La Chapelle dans la continuation du
faubourg Saint-Denis, laissons le soin à Alfred Delvau (*) d’y répondre
:
« Je lui redonne pour un instant le nom consacré par l'usage, mais non
par l'édilité, - qui l'appelait Barrière Saint-Denis, parce qu'elle
était située à l'extrémité de la rue du faubourg Saint-Denis, &
qu'elle conduisait à la vieille Abbaye d'où l'ouragan révolutionnaire a
dispersé les poussières royales. Quant au bâtiment élevé sur les plans
de Ledoux, - bâtiment à quatre façades, avec attique &
couronnement, - c'était, « vu du côté du jardin, dit Edmond Texier à
qui je laisse la responsabilité de son enthousiasme, c'était une très
jolie habitation bourgeoise, presque un château ». On voit bien que
Texier a été jadis un peu poète : il bâtit facilement des châteaux. A
quelques pas de cette barrière se tenaient autrefois les foires du
Landit, dont la première avait été établie par Dagobert, - roi d'une
célébrité si originale, grâce à la légende populaire, qui ne ressemble
guère à l'histoire. »

Pour ce qui est des châteaux, non pas "en Espagne", mais bien à Paris, on
peut effectivement parler de petits châteaux ou de manoirs disparus en
assez grand nombre, Edouard Fournier a mis la main sur des données qui peuvent
échapper, ce qui fait à la fois l’originalité de son travail et un
apport complémentaire à Henri Sauval et d’autres auteurs de l’histoire
de la ville sur les anciennes terres marécageuses dénommée, la Tutela. Il
subsistait encore un ou deux petits marais dans le quartier de la porte St-Denis au
XIXe siècle.
Les quartiers Saint-Martin et Saint-Denis allaient faire partie du Vème
arrondissement (sur 12). Les arrondissements à leur origine ont été créés avec la loi
du 19 vendémiaire an IV ou le 11 octobre 1795. Et les quartiers prirent
formes sous Napoléon Ier, à qui nous devons une mise au pas du négoce
de l’eau dans la capitale, et pour une fois pour le bien des Parisiens du petit
peuple un accès à de l’eau en plus grande quantité. Par ailleurs et
dans la suite des choses, il y eut à Paris aussi d’importants travaux
sous Louis-Philippe, etc., etc.
(*) Source : Alfred Delvau, Histoire anecdotique des barrières de Paris
Pages 111 et 112 - éditeur E. Dentu - 1865 (Gallica-Bnf)
|
|
|
Le Prévôt, François Delamichodière,

(anobli comte d'Hauteville) |
Edouard Fournier (1892) |
« Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne saurais trop le répéter,
les rues de Paris sont un immense livre d'énigmes ; à chaque pas on y
trouve une charade, dont personne ne vous, dit le nom ; enfin, il n'est
pas un coin de rue avec son écriteau problématique, qui ne semble se
poser devant vous comme un point d’interrogation en quête d'une
réponse. Une lettre adressée à l'un de nos confrères en chronique, à
laquelle il nous pria de répondre pendant son absence, est une preuve
nouvelle des singulières préoccupations de curiosité qui sont à chaque
instant éveillées par ce vaste questionnaire toujours ouvert.
Voici d'abord la lettre :
« Monsieur,
Quoique étranger, j'ai une sainte horreur pour les fautes d'orthographe
que l’on peut faire en français, et, autant qu'il m'est possible, je
les fuis. Seriez-vous assez bon pour venir à mon aide dans une
circonstance où le dictionnaire lui-même ne saurait me tirer
d'embarras? Au centre de Paris, se trouve une rue, qui donne sur le
boulevard des Italiens, presque en face de la rue du Helder (1). Cette
rue, Monsieur, fait mon tourment : un de mes amis demeure au ne15 de la
malheureuse ; toutes les fois que j'ai besoin de lui écrire, je ne sais
comment orthographier l'adresse. Cet état de choses m'étant
insupportable, je me décide à me faire, pour une fois, dénonciateur ;
j'assigne donc, Monsieur, devant le tribunal de votre esprit et de
votre savoir, cette malheureuse rue, afin que vous vouliez bien aviser,
autant qu'il peut être en vous, à la rectification de son état civil,
de telle sorte qu'elle puisse rentrer dans les conditions normales que
toute honnête rue doit offrir.
Cette rue, Monsieur, c'est la rue de la. Bon, voici l'embarras, enfin,
c'est la rue de la Michodière. ou de la Michaudière !!! - That is the
question! Que faut-il mettre? ou bien a? chodière ou chaudière? Cette
coquine de rue porte, en débouchant sur le boulevard, et ainsi que
toutes ses pareilles, deux écriteaux : l'un me fait lire rue de la
Michodière, écrit en lettres blanches sur un fond gros bleu, tandis que
l'autre, en lettres tout à fait semblables et sur un fond non moins
gros bleu, me présente : rue de la Michaudière (1). Que faire? comment
lire, et surtout comment écrire?!!! Je pencherais pour la chaudière ;
mais si je me trompais! Il est vrai que pour fixer mon incertitude, il
me suffirait d'aborder le premier sergent de ville venu, et de lui
demander à consulter son petit livre, pour savoir comment s'écrit le
nom de la rue en question ; mais bien que logeant dans la poche d'une
autorité, ce livre ne saurait pas en être une pour moi : c'est pourquoi
j'ose vous importuner, Monsieur, et attendre de votre obligeance que
vous vouliez bien mettre fin à mon supplice. Agréez, etc. »
Ce n'est pas la première fois que la maudite rue, grâce à son nom
baroque et à l'orthographe plus baroque encore de ce nom, me fait poser
des questions semblables à celle qui fait l'objet de cette lettre, si
spirituellement humoristique. - Qu'est-ce que c'est donc qu'une
Michodière ? me disait un jour un homme fort instruit en bien des
choses, mais assez peu savant toutefois pour ce qui regarde l'histoire
de Paris. Voici la réponse que je lui fis, et dont il se montra
satisfait ; j'espère que notre correspondant le sera de même.
Il y avait une fois, c'est-à-dire en 1772, un secrétaire d'Etat, prévôt
des marchands de la bonne ville de Paris, qui s'appelait M.
Delamichodière. Remarquez bien l'orthographe de ce nom, écrit d'un seul
mot, ce sera déjà un point éclairci.
M. Jean Baptiste François Delamichaudière, né le 2 septembre 1720, n'en
était pas à sa première charge quand il était arrivé à la prévôté de
Paris. Il avait commencé par l'intendance de Riom, d'où il était passé
à celle de Lyon, en 1757. C'était un économiste distingué, s'occupant
peut-être assez mal du bien-être des populations à lui confiées, mais
fort soucieux au moins de les étudier au point de vue de la
statistique. Il avait été à ce sujet en correspondance avec Voltaire
(3) ; et il paraît que l'ouvrage in-4e, publié en 1764, avec ce titre,
Recherches sur la population des généralités d’Auvergne, de Lyon, de
Rouen y était moins de Massance, sous le nom duquel il parut, que de M.
Delamichodiere (4), et de l'abbé Audra, son collaborateur pour ce genre
de travaux.
Comme la théorie fait croire à la pratique ; comme on se persuade
aisément qu'un homme est bon administrateur, parce qu'il écrit sur
l'administration, la place de prévôt des marchands, pu plutôt de
ministre de Paris, ainsi qu'on disait alors, étant devenue vacante, en
1772, on crut devoir y nommer M. Delamichodière. Pendant la première
année qu'il était en charge, on projeta d'ouvrir vers le boulevard
Bonne-Nouvelle, tout près d’un cimetière des protestants (5), dont le
théâtre du Gymnase occupe le terrain, trois rues qui étaient destinées,
les deux premières à relier ensemble le faubourg Saint-Denis et le
faubourg Poissonnière, et là troisième à faite communiquer les deux
autres avec cette pauvre rue Basse Porte-Saint-Denis, que le boulevard
absorba, il y a cinquante ans à peu près, en élargissant sa marge. De
même qu'on cherche un parrain à un enfant avant qu'il soit au monde, on
se demande souvent, avant qu’une rue soit percée, comment
l'appellerons-nous ?
Pour la première des trois dont il s'agît, l’embarras ne fut pas grand.
Un duc d'Enghien, le dernier et le plus infortuné de ceux qui ont porté
ce nom illustre, venait de naître à Chantilly. On ne fit qu'un seul
baptême, le prince et la rue prirent le même nom, avec cette seule
différence que le petit duc était bel et bien au monde, tandis que la
rue n'exista réellement que treize ans plus tard (6).
Pour la seconde, l'inscription n'était pas difficile à trouver ; c'est
sur l'ancien fief de l’Echiquier qu'on en prenait le terrain, il est
donc naturel qu'il fournît aussi le nom (7). Pour la troisième, quel
parrain choisir? M. Delamichodière se proposa, et il fut accepté de
grand cœur, d'autant mieux qu'en sa qualité de prévôt, il aurait fort
bien pu s'imposer. Malheureusement les choses traînèrent en longueur.
Soit que les religieuses du couvent des Filles-Dieu, à qui le terrain
appartenait et qui étaient fort tenaces en fait de propriété (8) ; ne
voulussent pas se dessaisir; soit que là Ville manquât d'argent, ou
bien encore, que l'entrepreneur des bâtiments du roi, Claude-Martin
Groupy qui s'était chargé des travaux, ne fût pas en mesure de tenir
ses conventions, on mit plus de douze ans à passer du projet à son
exécution. C'est plus qu'il n'en faut pour qu'un administrateur ait le
temps d'user son crédit et de perdre sa place.
En 1778, M. Delamichodière en était arrivé là. Dès le mois d'avril, on
parlait de lui donner pour successeur M. de Blaire de Boismont, qui
toutefois ne le fut pas (9). Notre prévôt n'avait donc pas une minute à
perdre, s'il voulait enfin signaler son édilité, et surtout en laisser
un souvenir durable sur l'écriteau d'une rue de Paris (10). Il prit un
parti décisif.
Puisqu'on s'obstinait à ne tracer que sur le papier la rue projetée au
travers du terrain des Filles-Dieu, il provoqua sur un point tout
opposé du boulevard l'ouverture d'une rue, où son impatience d'être
parrain trouverait enfin à se satisfaire.
La ville, sur ses instances, acheta, tout près du pavillon de Hanovre,
le vaste hôtel qui, après avoir appartenu au maréchal duc de Lorges,
était devenu la propriété du prince des Deux-Ponts; on le jeta par
terre, et la rue tant rêvée par le prévôt fut tracée sur l'espace
laissé vide (11).
Le 8 avril 1778 parut une ordonnance royale, dont voici le premier
article : « Il sera ouvert et formé une nouvelle rue sous le nom
Delamichodière, remarquez de nouveau comment ce nom est écrit ; ici,
c'est l'orthographe officielle. - Cette rue sera bâtie sur
l’emplacement des bâtiments, cours et jardins de l'hôtel des
Deux-Ponts. Il était temps : quatre mois après, M. Delamichodière
n'était plus prévôt des marchands ; le 17 août de la même année, on lui
donnait un successeur (12).
Mais que devient, me direz-vous maintenant, le projet de rue dont
l'ajournement avait si longtemps fait son désespoir? Vous allez le
savoir et connaître en même temps à quel point ce bon M. Delamichodière
était un homme heureux. Il lui fut donné, ce qui n'arriva presque
jamais, d'être parrain de deux rues de Paris ; et pour la seconde,
chose plus singulière, il eut ce privilège lorsqu'il n'était plus en
charge depuis cinq ans.
En 1783, la rue tant ajournée fut enfin ouverte sur le terrain des
Filles-Dieu ; un nom lui devenait alors réellement nécessaire ; le plan
lui donnait celui de l'ancien prévôt ; mais puisque l'autre, plus
pressée de naître, s'en était emparée, force était de se pourvoir
ailleurs. On se souvint que M. Delamichodière avait acquis, à quelque
quarante ans de là, en Champagne, du côté de Vitry-le-François, le
magnifique domaine d'Hauteville, ancienne propriété des Guises, et
qu'en 1751, Louis XV, par faveur spéciale pour notre prévôt, l'avait
érigé en comté. Ne pouvant plus donner à la rue le nom de l'homme, on
lui donna celui de son domaine, et voilà comment elle s'appelle encore
rue d'Hauteville. Remarquez bien encore l'orthographe de ce nom,
respectez surtout la particule ; si vous l'omettiez, l'ombre de M.
Delamichodière, comte d'Hauteville, ne vous le pardonnerait pas. (sic)
Je ne sais que M. Louis Vivien à qui, sous Louis XIV, échut, comme au
prévôt de 1772, la double fortune d'être le parrain de deux rues de
Paris. L'une est la rue Vivienne pour laquelle il avait tout droit de
parrainage, puisqu'elle était percée sur des terrains dépendant, de son
fief de la Grange Batelière (13) ; l'autre est la rue Saint-Marc, qui
porte le nom d'une terre dont il était seigneur (14). »
Notes de l’auteur :
(1) Ce qui m'étonne, c'est que le correspondant anonyme ne se soit pas
arrêté à ce mot, pour poser un nouveau point d'interrogation. Peut-être
est-il Anglais, et sait-il qu'on lui aurait répondu : « Le Helder est
un fort de Hollande, qui défend l'entrée du Texel. Le 26 août 1799, le
général Abercromby débarqua dans cet endroit 15,000 Anglo-Russes, que
le général Brune força de se rembarquer. En mémoire de ce succès, il
fut décidé, à l'Hôtel-de-Ville, dans la séance du 12 brumaire an VIII,
que la rue commencée en 1793 pour être, jusqu'au boulevard, le
prolongement de l’impasse Taitbout, et qui n'était pas encore achevée,
recevrait le nom de rue du Helder. L'impasse Taitbout avait eu,
ainsi que la rue du même nom, pour parrain M. Taitbout, greffier du
bureau de la Ville en 1775. il était de la famille de M. Taitbout,
consul de France à Nappes, en 1750, qui, par ses lettres à M. de
Caylvis, avait beaucoup contribué à faire connaître chez nous les
antiquités d'Herculanum. (V. Serieys, Lettres inédites d’Henri IV et de
plusieurs personnages célèbres, 1802, in-8, p. 197-211). Les
terrains sur lesquels la rue Taitbout et sa voisine avaient été percées
dépendaient de l'espace cédé à titre d’emphytéose au financier Bouret,
par les Mathurines, dont la ferme était non loin de là, et qui ont
laissé leur nom à deux rues du même quartier. Le cimetière de la
paroisse Saint-Roch se trouvait où nous voyons le ne7 de la rue
Taitbout. En juillet 1842, on y découvrit un certain nombre de tombes
fort anciennes. (Bulletin de l’All. des Arts, 1842, p. 26.)
(2) Je dois avouer qu'aujourd'hui les deux écriteaux sont d'accords et d'une orthographe à peu près irréprochable.
(3) Oeuvres de Voltaire, éditeur Beuchot, t. XXXIV, p.15 ; t. XLIX,
(4) Correspondance de Grimm, 1ère édition, 1ère partie, t. V. p. 36,; —
Béguillet, Traité de la connaissance générale des grains,1775, in-8,
t. II, p.704.
(5) Le Provincial à Paris 1788 in-32, du quartier du Louvre, à l'article Boulevard Bonne-Nouvelle.
(6) On n'y bâtit qu'en 1785. (La Tynna, Dictionnaire des rues de Paris,
1816, in-12, p. 199.) Aussi ne se trouve-t-elle pas, non plus que sa
parallèle, dans la nomenclature donnée par Hurtault et Magny, au t. IV,
de leur Dictionnaire historique de la ville de Paris.
(7) Une remarque à faire, c'est que la rue d'Enghien actuelle devait
d'abord porter le nom de l’Echiquier, qui ne passa qu'en 1779, sur la
demande des religieuses, à la rue qui l'a gardé. Le fief, car ce
n'était pas moins, qui portait ce nom, appartenait au couvent des
Filles-Dieu, en vertu d'une donation qui leur avait été faite, vers
1225, par Guillaume Barbette, de la famille de celui dont.la célèbre
Courtille a laissé son nom à l'une des rues du quartier du Temple.
(Voir Paris dans sa splendeur, chap. M, p. 51.) Le domaine de l’Echiquier devait de s'appeler ainsi à l'enseigner d'une
maison qui en était voisine ; on la voyait encore rue Saint-Denis, près
de la porte, en 1779. (Hurtault et Magny, Dict. hist. de la ville de
Paris, t. III, p. 39.) Lors de la fondation du couvent, cette partie de
Paris était hors des murs ; mais, à l'époque de la guerre, quand il
avait fallu fortifier, on avait fait là comme sur le terrain de la
Grange Batelière,on avait coupé le fief en deux par la ligne du
rempart.
Le couvent se trouvait dans la ville et son domaine au dehors. C'était,
en cela toutefois, le contraire de la Grange Batelière, dont le fief
était hors Paris, tandis que les terrains en dépendant, et qui
s'étendaient d'une part jusque auprès de la place Vendôme, de l'autre,
jusqu'à celle des Victoires, se trouvaient englobées dans la ville. -
Le nom de l’Echiquier ne resta pas à la partie des dépendances du
couvent des Filles-Dieu qui était intra muros, mais à celles du dehors,
sur le terrain desquelles on perça les rues dont nous parlons en ce
moment.Un grand pavillon, sorte de petit château, avec grands jardins,
s'appelait notamment ainsi. Il fut plus tard la propriété du fameux
fabricant de fleurs Wenzell, qui donna de grandes fêtes dans les
galeries qu'il y avait fait construire, et qui subsistent encore au ne
36 de la rue de l’Echiquier.
Pendant la Révolution et le Directoire, ces fêtes, que Wenzell appelait
des balladères, devinrent publiques. (Ed. et J. de Goncourt, Histoire
de la société française pendant le Directoire, E. Dentu, 1855, in-8e,
p. 145.) on devine quelles femmes y venaient. Elles rappelaient les
premiers des Filles-Dieu, dont Jonville a dit à propos des quatre cents
livres de rente, que leur avait données Saint Louis : « c'était une
grande multitude de femmes, lesquelles s'estoient mises en péché de
Iuxure par pauvreté » (Mémoires, édit. Michaud, p. 326.) - Sauval ( t,
I p. 75) a parlé des restes de la Coulture des Filles-Dieu; dont
dépendait l’Echiquier. Ils consistaient, de son temps, en un grand
marais plein de légumes bordé de maisons le long du faubourg
Saint-Denis. »
(8) Elles l'avaient bien montré par le procès que, sous Louis XIII,
elles avaient fait à Frogé, au sujet du terrain des fossés voisins de
leur clôture. Le roi en avait fait don à cet entrepreneur, subrogé dé
Barbier, mais elles ne s’étaient pas moins prétendues les
propriétaires. Ce procès, qui dura beaucoup trop, avait empêché
longtemps que quelques places de la Ville-Neuve se couvrissent de
maisons. (Sauval, t. l, p. 75, 85).
(9) Mémoires secrets, t. XI, p. 249-250 (30 avril 1778).
(10) M. Delamichodière, en effet, ne déploya jamais plus d'activité que lorsqu'il fut sur le point d'être remplacé. (Id., ibid.)
(11) Sa principale entrée donnait rue Neuve Saint Augustin en face de
la rue Gailion. C'est Frémont, garde du trésor royal, enrichi sous
Colbert, qui l'avait bâti ; le maréchal de Lorges, qui avait épousé sa
fille, eut l'hôtel avec toute la fortune. Saint-Simon s'y maria avec la
fille du maréchal, mais n'en hérita pas. (Voir, ses Mémoires) édit,
Hachette, in-12, t. I, p, 154; et dans la Gazette des Tribunaux du 16
octobre 1858, le teste du contrat de mariage.) C'est au fils du
maréchal de Lorges que l'hôtel était passé. Il le vendit à la princesse
de Conti, fille de Louis XIV et de mademoiselle de La Vallière, qui, en
mai 1739, y mourut âgée de 73 ans. (Journal de Barbier, édit. in-12, t.
III, p. 173.) Elle avait légué son hôtel au duc de La Vallière, qui le
mit à loyer. Au mois d'avril 1745, il était occupé par l'ambassadeur
d'Espagne, et l'on y donnait de grandes fêtes pour le mariage du
Dauphin. Elles durèrent trois jours. Voici, d'après Barbier (idem, t. IV p. 18),
le détail de la seconde soirée : « Mardi, 20, grand concert, feu
d'artifice sur la terrasse du jardin qui rend sur le rempart, et grand
souper pour les princesses et dames de la cour, et ministres du roy
». Cet hôtel, qui, à l'époque de sa démolition appartenait, nous
l'avons dit, au prince des Deux-Ponts, était l'un des plus beaux de
Paris (Piganiol, t. lII, p. 130) - il n'égalait pas toutefois son
voisin l'hôtel de Richelieu, bâti pour le financier La Cour des Chiens,
et qui passa au maréchal après avoir appartenu à M. d'Antin. Voir plus
haut, le chap. I, p. 21, note.
(12) Le successeur fut M. de Caumartin, qui donna son nom à une rue
bien connue de la Chaussée d’Antin. MM. Jacques Chauchat et Charles
Richer, parrains de deux rues bien connues aussi, furent, l'un échevin,
l'autre quartenier pendant son exercice. - Du temps de M.
Delamichodière, on avait vu dans l'échevinage Pierre-Richard Boucher et
Henri-Isaac Etienne, qui eurent l'honneur de laisser leur nom à deux
rues percées de leur temps sur l'emplacement de l'ancien hôtel des
Monnaies ; et Jacques-François Trudon, qui fut parrain de la rue où se
trouve le joli hôtel de mademoiselle Rachel. (Voir sur Trudon,
Réimpression du Moniteur, t. II, p. 502.) - Nous trouvons encore dans
les emplois de la ville avant la Révolution, M. Lepelletier de
Mortfontaine qui, en sa qualité de prévôt, donna, en 1786, son nom à la
rue où se trouve aujourd'hui l'Opéra, et M. Buffaut, dont une rue du
faubourg Montmartre, percée en 1782, a gardé aussi le nom. La faveur de
madame du Barry avait fait arriver Buffault, non seulement à
l'échevinage, mais à la direction de l'Académie royale de musique. Sa
femme avait été marchande de modes aux Traits galants, rue
Saint-Honoré, et la favorite avait brillé parmi ses demoiselles ; de là
l'élévation du mari. (V. notre article sur madame du Barry, Revue
française, 10 janv. 1859.) On se souvint d'où il sortait, et pendant
qu'il dirigeait l'Opéra, il courut une caricature où on le voyait
mesurant, avec son aune de marchand, la bouche de ses chanteuses.
(13) Voir Paris démoli, 2ème édition, p. 283-284.
(14) La rue Vivienne s'appela d'abord rue Vivien ; mais, comme une rue
doit avoir un nom féminin, celui-ci prit la terminaison féminine, qu'il
a gardée. De même pour la rue Coquillière, qui eut pour parrain un
certain Pierre Coquillier, qui vivait sous Philippe le Bel (Sauval, t.
I, p. 32) ; de même encore pour la rue Payenne, qui doit son nom à l'un
des ancêtres du Deslandes-Payen, l'ami de Scarron. Beaucoup. de gens
pensent aussi que le nom de la rue Bleue est le féminin du nom d'un
certain M. Bleu, qui y possédait plusieurs maisons. Il a pour origine
la fabrique de boules d'indigo qu'y avait établie M. Story en 1802, et
dont les eaux, en teignant les ruisseaux, faisaient de cette rue une
véritable rue bleue.
Source : Edouard Fournier (1819-1880), Enigmes des
rues de Paris.
Nouvelle édition de 1892,
la première édition de 1860 fut épuisée -
Chapitre XV - Delamichodière
– Comte d’Hauteville – Editeur E. Dentu. (Gallica-Bnf)
|
|
|
|
|
| Fin du ruisseau de Ménilmontant et
de la Tutela ? |
|
|
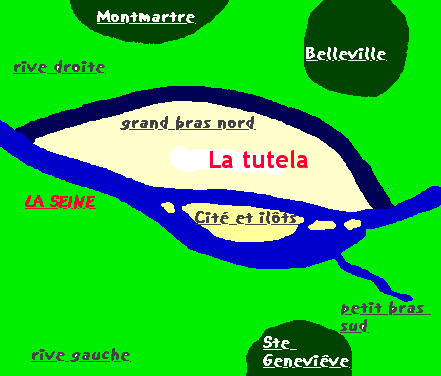 | | Le ruisseau dit de Ménilmontant servit pendant un long temps d'exutoire aux nauséabondes eaux usées du
quartier Saint-Denis, jusqu'à ce qu'en 1740, le prévôt des marchands,
Michel-Étienne Turgot, père du célèbre ministre (et auteur des plans
Turgot de Paris), le fasse voûter.
Il devenait ainsi le premier grand égout
collecteur parisien au sein du faubourg Saint Denis. L'on avait fini
par confondre le ruisseau de Ménilmontant et l'ancien bras mort de la
Seine. Les besoins en eau ne pouvant qu'augmenter au fil du temps le dit ruisseau devenu ru
se transforma en dépotoir, puis se transforma en écoulement des eaux
putrides et créant les premières bases du vaste réseau des égouts
parisiens.
|
|
|
Des
vestiges de ce "Grand égout" ont été occasionnellement retrouvés en de
nombreux endroits du dixème arrondissement, au pied de la rue
d'Hauteville, l'ex. rue de Bondy (Réné Boulanger), dans les rues du
faubourg Saint-Denis et Saint-Martin et place de la République (ex.
place du Château d'eau). Il
exista aussi une légende pour ce ruisseau, ancien bras mort de la
Seine, il
serait devenu, plutôt qu'un égout putride, la poétique rivière de "la Grange-Batelière" qui
coulerait encore souterrainement sous les maisons... il s'agit surtout
d'un aménagement spécifique se trouvant sous l'opéra Garnier.
|
|
|
Epilogue : « L'an
1400 et 9, le jour de la mi-août, fit tel tonnerre, environ
entre cinq ou six heures du matin, qu'une image de Notre-Dame,
qui était sur le moustier de Saint-Ladre, de forte pierre
et toute neuve, fut du tonnerre tempêtée et rompue
par le milieu, et portée bien loin de là ; et à
l'entrée de la Villette Saint-Ladre, au bout devers Paris,
furent deux hommes tempêtés, dont l'un fut tué
tout mort, et ses souliers et ses chausses, son gippon furent
tout dechirés, et s'il n'avait point le corps entamé;
et l'autre homme fut tout affolé. »
Source : Gallica-Bnf - Un extrait du Journal d'un bourgeois de Paris (1405-1443)
- publié d'après les manuscrits de Rome et de Paris par A. Tetuey en 1881.
Et nous de même ! C'est un témoignage
de l'époque sur une forte tempête, débordement
de notre Tutela,
(retour au tout début) ou le bras nord ou courbe de la Vieille Seine, aujourd'hui disparu? Normalement, les crues
de la Seine se raniment tous les cent ans, préparons nos bottes et nos
embarcations !
|
|
|
|
|
|
Cet espace d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le
contenu est sous la responsabilité de son
créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|
|