|

|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
|
 Amérique
Latine, sommaire année 2010, page 2
Amérique
Latine, sommaire année 2010, page 2
1- Colombie: «les faux
positifs», une barbarie travestie, Eric
Sottas
2 - Persécution
contre la Commission Justicia y Paz en Colombie, PASC
3 - L'ONU et
l'Equateur et les réfugiés colombiens, Robert James Parson
4 - Vidéo en
ligne, Alvaro Uribe, narcotrafic et
paramilitarisme, Pantuana TV
& - Alvaro
Uribe, La fin d'un
mandat n'est pas la fin d'un système
5 - Entretien
avec Hollman
Morris sur le
narco-paramilitarisme, Marcos
Salgado
6 - Vidéo en ligne,
Estella
Barnes de Carlotto, Pantuana
TV
&
- Histoire d'une grand-mère en
Argentine, Hugo Presman
7 -
Haiti : vers une occupation humanitaire? Rolphe Papillon
8 - Haïti,
Perle des Antilles ou l'île du désespoir?
|
|
|
|
|
Colombie:
«les faux
positifs»,
une barbarie travestie |

Eric Sottas
(*), le 30
juin 2009
Ces
dernières semaines un débat pénible a
opposé en Colombie celles et ceux qui, du
côté des
ONG et de la justice, dénoncent les massacres connus sous le
vocable peu explicite de Falsos Positivos (littéralement
«Faux Positifs») et les représentants de
l’armée et des autorités
gouvernementales. Ce terme
peu clair désigne, dans le langage militaire, des
résultats apparemment positifs qui, dans ce cas
précis
toutefois, relèvent d’une sinistre
mystification. De
quoi s’agit-il en l’occurrence?
Le
17 novembre 2005,
le ministre de la Défense, Camilo Ospina Bernal, promulguait
la
directive permanente secrète N°29/2005 qui
définissait une politique de paiements et de
récompenses
pour tout renseignement ou résultat concret permettant de
porter
des coups décisifs tant à la guérilla
qu’aux
organisateurs du trafic de drogue.
Sur les quelque
15 pages que
comporte la directive, plus de la moitié consiste en des
listes
fixant le prix de «diverses prestations». Par
exemple, des
renseignements permettant de saisir du matériel de guerre
seront
payés 700 pesos (30 centimes d’euro) pour des
munitions de
faibles calibres et jusqu’à 3.000.000,00 de pesos
(environ
1.000 €) pour des mitrailleuses lourdes «Punto
50».
Mais la directive ne récompense pas que les informations
conduisant à la saisie de matériel de guerre ou
leur
remise par des collaborateurs actifs, elle porte prioritairement sur la
mise hors combat, par arrestation ou élimination physique,
des
membres de la guérilla et des cartels de la drogue.
La
plus forte récompense offerte pour les principaux
responsables
s’élève à 5.000
millions de pesos,
soit plus de 1.660.000,00 €, alors que le
«prix» du
simple combattant ne représente que 3.815.000,00 pesos, soit
environ 1.250,00 €. En principe, ces récompenses ne
peuvent
être versées aux militaires et n’ont
pour but que
d’inciter la population à collaborer à
l’effort d’ensemble pour en finir avec le conflit
armé et le crime organisé. Les soldats eux se
voient
gratifiés de jours de congé additionnels pour
toute
élimination lors d’affrontements armés,
alors que
leurs supérieurs sont évalués, et donc
promus ou
placés sur une voie de garage, en fonction des
résultats
obtenus lors de combats dans les zones qui leur sont imparties. Tous
sont donc intéressés, peu ou prou, à
«faire
du chiffre» et, si nécessaire, à
créer
l’évènement.
Dans
ce contexte de
compétition et de recherche
d’efficacité à
tout prix, des soldats n’ont pas hésité
à
enlever des personnes pour les exécuter, non sans les avoir
préalablement revêtus de tenus de combat pour les
présenter comme des guérilleros
éliminés
lors d’affrontements armés. Dans certains cas, le
seul
bénéfice recherché semble avoir
été
les quelques jours de permission.
Mais, et
malgré les
précautions prises en s’attaquant à des
personnes
sans défense, y compris à des adolescents ou
à des
retardés mentaux, et en éliminant les corps dans
des
fosses communes, l’invraisemblance de certaines situations et
les
témoignages des familles et des proches finirent par mettre
au
jour une pratique que les autorités tentent de
présenter
comme exceptionnelle et imputable à quelques
«pommes
pourries» dûment identifiées et qui font
l’objet de toutes les rigueurs de la loi.
Le
rapporteur
spécial des Nations unies sur les exécutions
sommaires,
à l’issue d’une visite in situ
effectuée du 8
au 18 juin 2009, a rendu publique une déclaration dans
laquelle
il affirme que le phénomène n’est
nullement
limité à une région
géographique, ni
imputable uniquement à quelques brebis galeuses.
Il
dit
avoir rencontré des témoins et des survivants qui
lui ont
décrit des massacres de falsos positivos,
c’est-à-dire de personnes tuées de sang
froid alors
qu’elles n’avaient rien à voir, ni avec
la
guérilla, ni avec le trafic de drogue, dans les
départements d’Antioquia, Arauca, Valle del Cauca,
Casanare, Cesar, Cordoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo,
Santander, Sucre y Vichada. La dispersion géographique du
phénomène et le nombre
élevé
d’unités militaires impliquées
interdissent
d’y voir une succession d’actes isolés.
Même
si, comme le note le rapporteur spécial, il n’a
pas
été établi qu’un ordre ait
été
donné par les plus hautes sphères
gouvernementales, le
débat sur la responsabilité des uns et des autres
dans
cette sinistre affaire est loin d’être clos.
Selon
les informations que m’ont fournies tant des magistrats que
des
avocats, la justice a déjà identifié
plus de 1.300
victimes de cette pratique au cours de ces dernières
années et une centaine de militaires font l’objet
d’investigations. Et ce ne serait que la pointe de
l’iceberg! Les éléments que
révèlent
les enquêtes en cours montrent de fantastiques et atroces
réseaux de complicité. La corruption venant
s’ajouter à l’assassinat, des montages
apparaissent
au fil des confessions.
C’est ainsi que
plusieurs des
personnes qui ont signé et apposé leurs
empreintes
digitales sur les documents attestant de leur collaboration dans
l’élimination d’un pseudo
guérillero,
affirment ne pas avoir perçu plus de 20.000.00 pesos
(environ
7€) de récompense, alors
qu’officiellement
3.815.000,00 pesos (environ 1.200 €) leur ont
été
versés. Si la bureaucratie colombienne exige pour le moindre
document l’apposition des empreintes digitales, elle est loin
de
faire preuve de la même rigueur quant aux contrôles
financiers des dépenses de l’armée.
Nombre de
militaires ont ainsi détourné les
«récompenses» des assassinats
qu’ils avaient
eux-mêmes organisés, mis en scène et
exécutés.
Dans certains cas,
faisant si l’on
ose dire d’une pierre deux coups, ces opérations
ont non
seulement permis d’obtenir des récompenses indues
pour de
prétendues opérations dirigées contre
les
guérillas ou le crime organisé, mais
d’éliminer des gêneurs ou des personnes
dont les
biens suscitaient la convoitise.
Les
autorités
tant militaires que civiles continuent de prétendre que la
politique de récompenses et de primes, pour appeler les
choses
par leur nom, reste valable. A leurs yeux, elle a permis
d’éliminer Raoul Reyes, le numéro 3 des
FARC et a
porté des coups décisifs tant aux
guérillas
qu’aux différents cartels du trafic de drogue.
Elles
reconnaissent toutefois que l’absence de contrôle
sur les
fonds distribués et le manque d’investigations sur
les
prétendues morts au combat obligent à un
sérieux
réaménagement de la directive.
Ce
faisant, et
comme je l’ai déjà
déclaré à
la presse colombienne (voir El Espectador du 26 juin 2009), elles se
refusent à assumer leurs responsabilités. Au
cours de ces
dernières années, ce sont plus de 1.300 personnes
qui ont
été assassinées par des hommes de
troupe. Leurs
meurtriers non seulement les savaient innocentes, mais se livraient
à la macabre mise en scène de leur mort dans le
cadre
d’une soi-disant «opération
militaire». Outre
que de nombreux indices permettaient aux commandants de douter de la
véracité des faits (cadavres portant des
chaussures trois
fois trop grandes pour eux, mort tenant encore son arme dans la main
droite alors que tous les témoins le déclaraient
gaucher,
attardé mental qui aurait pris le maquis, voire
même un
soldat permissionnaire enlevé dans sa famille pendant ses
jours
de congé, etc.), les officiers supérieurs ne
pouvaient
ignorer que, dans de nombreuses «zones de combat»,
aucun
affrontement n’avait eu lieu. Leur manque de diligence ne
porte
donc pas seulement sur la distribution des primes, domaine dans lequel
on pourrait admettre leur incompétence, mais dans la
conduite de
la guerre.
Si par nature les confrontations
militaires laissent
des morts dans chaque camp, il appartient aux gradés de
s’assurer que le recours à la force est
légitime et
proportionnel. Les conventions internationales interdisant que tant les
civils que les combattants hors combat fassent l’objet de
tortures ou d’exécutions sommaires, il est de la
responsabilité de toute personne investie de commandement de
s’assurer du respect de ces règles fondamentales.
Si le
moindre de ces cas avait fait l’objet d’un minimum
d’investigations le phénomène
n’aurait jamais
pu prendre une telle ampleur.
Qu’elle le
veuille ou non
toute la chaîne de commandement est impliquée,
soit en
raison d’une complicité directe (non seulement les
hauts
gradés ne pouvaient voir que d’un bon
œil les
«résultats» de
l’activité de leurs
troupes, mais les liens étroits entre certains secteurs de
l’armée, les paramilitaires et les cartels font
redouter
une connivence pour éliminer les gêneurs sous
couvert de
lutte contre le crime), soit par négligence, ce
qu’en
droit on définit comme l’absence de diligence due.
La
controverse sur cette terrible affaire met en cause non seulement
l’armée, le gouvernement et le pouvoir judiciaire,
mais
elle interpelle une opinion publique désorientée.
De sa
réaction et de sa réponse dépend le
futur de la
société colombienne. Si même les falsos
positivos
sont tolérés comme des dommages
collatéraux
inévitables dans un pays en conflit,
l’idéal de
l’État de droit pour lequel se battent tant
d’hommes
et de femmes dans ce pays et que beaucoup ont payé de leur
vie
risque de s’éloigner pour longtemps.
(*)
Eric Sottas est secrétaire général de
l'OMCT (Organisation mondiale contre la torture):
Source :
http://torture.blogs.liberation.fr/sottas/
|
|
|
|
|
|
La diffamation et
la persécution se poursuit
contre la Commission Justicia y Paz en Colombie
|

Résumé
et traduction libre du PASC, 25 avril 2010
Voici
notre Censure
Éthique contre la
continuation de l’opération de
persécution médiatique et de
déligitimation qui vise notre organisation de Justicia y
Paz, plus
particulièrement le défenseur de droits humains
DANILO RUEDA, le prêtre
ALBERTO FRANCO, ainsi que le directeur de la banque de
données du
CINEP, le prêtre JAVIER GIRALDO.
Depuis
2003, au
milieu de
l’instauration de la politique de
sécurité démocratique, notre
organisation a fait l’objet d’une
persécution systématique qui inclut
des menaces de mort, des poursuites, des plans d’attentats,
la
judiciarisation, des interceptions illégales de
communications
téléphoniques et électroniques.
Quelques-unes
de
ces opérations ont été
menées dans le cadre d’actions
d’espionnage et d’investigations
offensives illégales du DAS en collaboration avec certains
acteurs
économiques, comme par exemple l’entreprise
Maderas del Darien Pizano
qui opère dans la région du Bajo Atrato.
Dans
le contexte
actuel se superposent
plusieurs opérations menées par le G3 depuis 2003
et les récentes
opérations menées à travers le DAS
comme l’Opération Transmilenium,
l’Opération Europe,
l’Opération Internet,
l’Opération Échange,
l’Opération Étrangers.
L’objectif est de semer le doute et la division
à l’intérieur des
communautés que nous accompagnons,
d’empêcher la
restitution des terres et de développer une
opération de délégitimation
et de judiciarisation.
Par
exemple, dans
le cadre de l’Opération Échange, un des
objectifs était de “neutraliser
l’influence de la Cour Interaméricaine de Droits
Humains”
comme ils essaient de le faire avec le Système
Interaméricain de Droits
Humains depuis l’année 2003. Également,
l’Opération Étrangers coïncide
avec les accusations sans fondements contre l’organisation
internationale PBI et le Projet Accompagnement Solidarité
Colombie du
Canada.
Il
y a donc
intensification de la
campagne contre le défenseur de droits humains DANILO RUEDA
et les
prêtres ALBERTO FRANCO et JAVIER GIRALDO, qui sont faussement
accusés.
DANILO RUEDA est accusé de fraude procédurale,
processus pourtant
inexistant dans les tribunaux nationaux et internationaux mais que
l’on
présente comme étant effectif malgré
l’absence totale de fondements
juridiques. Sous cette fausse accusation se cache la tentative de
produire une distorsion médiatique visant à
discréditer et faire taire
les paroles légitimes de ce défenseur de droits
humains face aux
responsabilités internationales de
l’État colombien dans plusieurs
crimes contre l’humanité et dans
l’appropriation violente des
territoires sous le prétexte d’une
persécution contre la guérilla des
FARC-EP. Cette distorsion a été
accompagnée d’opérations
d’écoutes
illégales et d’interrogatoires publics de la part
du Vice-président
FRANCISCO SANTOS, concernant son séjour aux
États-Unis.
Également,
les prêtres et défenseurs de
droits humains ALBERTO FRANCO et JAVIER GIRALDO sont accusés
d’être
terroristes et responsables d’assassinats et de
discrimination. Comme
si l’exercice intégrale de défense des
droits humains, l’affirmation de
la Vérité concernant le conflit armé
interne, et la dénonciation des
infractions au droit humanitaire international par les acteurs prenant
par au conflit, étaient une conduite délinquante.
Il
est
évident qu’il s’agit d’une
tentative de miner les initiatives mises de l’avant par les
communautés
noires et métisses dans la région du Bajo Atrato,
celles-ci ayant rendu
propice le retour sur leurs terres en évitant que se
complète
l’établissement d’un modèle
de développement soutenu par le crime et
l’appropriation violente. Il s’agit d’une
tentative de briser toute
forme de Mémoire qui permettrait de mettre en
lumière l’impunité qui
règne et de reconstruire un État de droit
contrairement à l’État de
fait qui prétend être consolidé
présentement. Il s’agit d’une tentative
d’imposer une version officielle de l’histoire et
de brouiller le
caractère légitime des expériences
civiles de Zones Humanitaires et de
Zones de biodiversité, pour les présenter comme
faisant partie de la
stratégie des guérillas.
Voici quelques faits
récents :
Mercredi le 21 avril,
pendant l’avant-midi, notre Commission de Justicia y Paz a
reçu un
message dans sa boîte courriel avec comme sujet :
LES AFRODESCENDANTS
REJETTENT ET DÉPLORENT L’INTERVENTION DE
L’ONG ’’JUSTICIA Y
PAZ’’. Le
message était signé par “La
Diáspora del Atrato”
et avait été divulgué plus
tôt pendant la dernière semaine du mois de
mars avec la prétention de boycotter la
présentation du défenseur de
droits humains DANILO RUEDA à Washington.
Dans
ce texte de
diffamation, ils affirment que
“l’intervention de monsieur DANILO RUEDA, de
l’ONG appelée Commission
de Justicia y Paz, comme conférencier dans
l’évènement du 26 mars 2010
portant sur l’impunité au Chocó et le
déplacement au Curbaradó et
Jiguamiandó organisé par l’Agence WOLA,
fait partie d’une stratégie
déployée par l’ONG qu’il
représente, laquelle organisation a
été
accusée d’actions délinquantes contre
les communautés afrodescendantes,
avec la complicité des Brigades internationales de paix
(PBI) et de
l’organisation terroriste FARC”.
Ils
affirment aussi
que DANILO RUEDA “est
aujourd’hui soupçonné de fraude
internationale par laquelle il aurait
trompé le système interaméricain de
droits humains et la commission
d’experts de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), en
affirmant qu’il représente 515 familles
afrodescendantes du Curbaradó
et du Jiguamiandó, lesquelles ont été
victimes d’actions délinquantes
des FARC et de ses propagandistes des ONG’s. Par la suite, il
a dû se
rétracter lors d’une audience de la Cour
Interaméricaine de droits
humains le 5 février 2005 à San José
de Costa Rica”.
De
plus le texte
présente
l’initiative des Zones Humanitaires comme faisant partie
d’une stratégie des FARC-EP.
Jeudi le 22 avril,
notre Commission de Justicia y Paz a reçu un courrier
électronique contenant des articles que l’on peut
voir sur
la page Avanti Ragazzi, dont
entre autres celui intitulé ’’Chroniques
d’une mort’’.
Ces articles vise la diffamation non seulement de notre travail mais
également celui d’organisations nationales de
défense des droits
humains comme le Collectif
d’avocats José Alvear Restrepo, la Commission
colombiennes de Juristes,
le CINEP et aussi des
organisations internationales comme les
Brigades de Paix Internationales (PBI) et le Projet
Accompagnement Solidarité
Colombie
(PASC) du Canada. Ces articles continuent également
d’associer notre
travail à la guérilla FARC-EP et personnalisent
une série d’accusations
sans fondements contre DANILO RUEDA et les prêtres ALBERTO
FRANCO et
JAVIER GIRALDO.
Pendant
cette
même journée du 22 avril,
vers 17h, notre Commission a été
informée d’une série de graffitis dans
l’entourage du Ministère de
l’environnement, de l’Université
Javeriana
et de l’édifice d’ÉCOPETROL.
Voici ce qu’on pouvait lire sur certains
de ces graffitis : ’’Justici
y Paz = mort, contre le curé marxiste action nationaliste
AR-NR’’, ’’Javier
Giraldo= à mort AR-NR’’, ’’ONG Justicia y Paz
terroriste’’.
Avec
ces
techniques, ils prétendent
camoufler les bénéficiaires des
opérations d’occupation de terres dans
la région du Bajo Atrato, qui sont liés aux
hautes sphères
gouvernementales. Ils prétendent faire oublier ces
mêmes acteurs qui
ont bénéficié de crédits de
la Banque Agraire pour l’implantation du
projet agroindustriel de palme africaine.
Tiré
du
rapport ’’Constancias
2230410’’ de la Commission Justicia y
Paz, datant du 23 avril 2010
Source : CIJYP et
Projet Accompagnement Solidarité Colombie
|
|
|
|
|
|
L'ONU
et l'Equateur
améliorent
le sort de milliers de
réfugiés colombiens
|
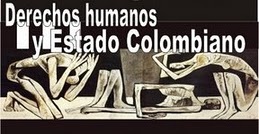 Robert James
Parson, le 9 Avril 2010
Robert James
Parson, le 9 Avril 2010
Comment
prendre en charge des dizaines de milliers de
réfugiés
dans une des régions les plus reculées et les
plus
pauvres du monde? En mettant en place des équipes mobiles
pour
recenser les déplacés, le Haut commissariat pour
les
réfugiés de l'ONU (HCR) a pu offrir le statut de
réfugiés à des milliers de personnes
dans le nord
de l'Equateur, répétant avec succès
une
expérience qui avait déjà fait ses
preuves en
Afrique et au Proche-Orient.
De concert avec le gouvernement
équatorien, le HCR a lancé fin mars 2009 un
programme
pour enregistrer rapidement et efficacement des
réfugiés
– des Colombiens dans 98% des cas. Maria Andrea Escalante,
porte-parole du HCR dans ce pays, explique que le programme
d'enregistrement a été conçu pour
fournir une
assistance aux déplacés qui se trouvent dans le
pays et
ont besoin de la protection internationale. Quelque 2 millions de
dollars ont été investis dans le projet.
Regroupés
en trois équipes mobiles, une quarantaine de personnes
formées par le HCR ont effectué le travail
(récolte des données, évaluation des
cas, prise de
décision, émission d'une carte
d'identité). Le
précieux document conférant le statut de
réfugié pouvait ainsi être
délivré en
une journée – comparée à des
démarches qui, autrement, s'étendaient sur
plusieurs
mois. Des cas problématiques, exigeant de plus amples
informations, ont donné lieu à
l'émission d'un
document attestant que le porteur est légalement reconnu
comme
requérant.
Ce papier confère –
provisoirement
– les mêmes droits que le statut formel de
réfugié. Selon Andrej Mahecic, porte-parole de
HCR
à Genève, ce programme s'est
révélé
nécessaire en raison du nombre important de
déplacés très pauvres. La plupart ne
peuvent pas
se payer le trajet en bus depuis la frontière avec la
Colombie
jusqu'au centre d'enregistrement le plus proche. Pis, le nord de
l'Equateur, en plus d'être une région
difficilement
accessible, se range parmi les plus démunies de la
planète. Pourtant, les populations locales se
démènent pour venir en aide aux
déplacés.
Près
d'un an après son commencement, l'enregistrement par ces
équipes mobiles a permis de brosser un portrait des
déplacés, permettant de mesurer les besoins
spécifiques et facilitant pour le gouvernement la
planification
de programmes destinés à aider tant les nouveaux
arrivés que la population locale. Mais le but principal de
l'enregistrement est d'offrir une protection juridique,
détaille
Andrej Mahecic: «Désormais, s'ils sont
interpellés
par la police, ils ont un document qui prouve qu'ils sont dans le pays
légalement. Et le statut de réfugié
leur offre un
accès aux services sociaux tels que les soins
médicaux et
les écoles pour les enfants. Enfin, il leur permet de
travailler
légalement, leur évitant la voie du
marché noir
où ils sont susceptibles d'être
exploités à
outrance.»
Et d'insister sur le caractère
volontaire du
programme. Car plus de deux tiers des déplacés
ont
manqué à l'appel. Quittant pour la plupart un
pays dont
ils se méfient du gouvernement, ils montrent une
réticence face à un programme soutenu par les
autorités. Mais Maria Andrea Escalante se veut rassurante:
«Le programme a été
entériné par un
accord bilatéral entre le gouvernement équatorien
et le
HCR, qui a ensuite été formalisé par
un
décret présidentiel. Il est donc impossible que
le
gouvernement en profite pour débouter ou renvoyer ces
réfugiés.» Le HCR voit dans cette
initiative un
premier pas de la part d'un gouvernement qui se veut sérieux
face à ses obligations sociales et humanitaires.
Néanmoins, le HCR souligne qu'il reste en Equateur une
centaine
de milliers d'autres réfugiés qui ne
bénéficient toujours d'aucune protection.
Source : lecourrier.ch
|
|
|
|
|
|
Alvaro
Uribe,
la
fin d’un mandat n’est pas la fin d’un
système |

Lionel
Mesnard, le
14 avril 2010
La
fin de la présidence d’Alvaro Uribe ne signifie
pas pour autant la fin de l’uribisme. Comme l’ont
démontré les élections
législatives et sénatoriales du 14 mars 2010, la
Colombie est repartie de nouveau pour un régime
très ancré à droite, mais
au-delà de l’appartenance partisane
c’est un système politique qui dans son ensemble
se perpétue. Une gangrène qu’il importe
de comprendre, tant elle joue une place centrale dans les
dérives de l’État colombien Si
l’on débat sous nos cieux de
l’abstention, les électeurs colombiens depuis de
nombreux scrutins sont environ 6 électeurs sur 10
à ne pas voter, voire à ne jamais se
prononcer. Ils furent 64% le 14 mars à bouder les urnes.
Comment peut-on comprendre que dans un pays se réclamant de
la démocratie, on arrive à 36% de votants sur des
enjeux nationaux d’une telle importance ? De plus, il existe
plus que des doutes sur le bon déroulement du scrutin hors
des grands centres urbains. Pour évidence, nous sommes dans
un pays en guerre, ou le vote se monnaie et peut aussi
s’imposer par la force dans les campagnes. Et si nous
limitons notre regard aux résultats intervenus, ce vote
à de nouveau investi des élus de droite proche
des paramilitaires et de leurs réseaux maffieux. Se
perpétue ainsi des mécanismes qui ont pour
rôle d’engendrer la violence et l’effroi
au détriment des populations civiles.
On
n’imagine pas à quel point, il est
martelé en Colombie une seule perception, et ceux qui
s’y opposent sont menacés dans leur
intégrité. Il est difficile de définir
un climat de terreur vous imposant le plus souvent au silence, aussi
parce que souvent les apparences sont trompeuses ou sourdes aux
souffrances. Face à cette réalité, il
vaut mieux rester discret et ne pas trop faire part de ses opinions,
surtout si elles ne calquent pas avec les maîtres du pays. Ce
climat de suspicion n’a rien de nouveau, il n’a
fait que se renforcer depuis 2002. Ce pays qui devrait être
un paradis est un enfer, et il l’est depuis au moins sa
séparation avec le Venezuela en 1830. De nombreuses guerres,
révoltes sociales au long du XIX° et du XX°
siècle vont émailler l’histoire de la
nation colombienne. Une des récurrences de ces affrontements
va résider pour bonne part autour de la question du
bipartisme. La république de Colombie va connaître
de nombreuses querelles entre les conservateurs et les
libéraux. Ces divergences donneront suites à des
guerres meurtrières et à un flot
régulier de victimes. Rien qu’entre 1948 et 1958,
il est fait état de 300.000 à 800.000 civils et
militaires morts. Et, ne se sont jamais véritablement
éteintes les braises, sauf à noter la naissance
des guérillas «marxistes» dans les
années 1960, puis la montée en puissance des
narcotrafics dans les années 1970. Ces
phénomènes dessineront pour bonne part le visage
de la Colombie actuelle.
Il est fait peu
état des relations entre les pouvoirs politiques colombiens,
le paramiltarisme et la pègre. Mais contrairement
à ce que l’on peut lire le plus souvent, il faut
pouvoir distinguer les acteurs clefs du narcotrafic, notamment un
certain Monsieur Alvaro Uribe qui favorisera le
développement des milices privées et du
paramilitarisme avec la création des CONVIVIR en 1991. Le
but non avoué fut de s’assurer le
contrôle du marché des drogues et de
s’approprier des terres hors de tout contrôle
légal. Ces connexions n’ont jamais
été aussi puissantes, elles rongent une bonne
part de l’appareil étatique, elles participent
à une guerre qui ne semble pas connaître de nom et
de fin, et nous fait vivre une hypocrisie hors de toute proportion. Ces
dernières années ont été
marquées par d’innombrables atteintes à
la dignité humaine, il est facile de tout mettre sur le dos
des mouvements rebelles, l’objet n’est pas de nier
leurs responsabilités criminelles, mais toute proportion
gardée ils ne sont qu’un rouage dans
l’organisation des trafics de drogue et en premier lieu chez
les achemineurs. Pour évidence, les FARC ou l’ELN
ne disposent pas des relais et moyens suffisants, ils ne
contrôlent pas les circuits de distributions et le recyclage
de l’argent sale. Bien que certains de ses parrains se
trouvent incarcérés aux USA, les mafias
colombiennes sont toujours aussi actives et nocives. La
première incidence est le niveau record de la
criminalité. Son point culminant a été
d’environ 32.000 morts en 2002 dont 8 à 10.000
morts en raison du conflit armé, de 1979 à 2002,
il s’agit d’une multiplication par cinq ou six fois
du nombre de décès civils par mort violente en
vingt ans (80% des homicides étant le fait d’une
arme à feu).
Alvaro Uribe en se faisant
élire président en 2002 met un terme au
bipartisme, toutefois il consolide une pensée binaire et
perpétue une domination quasi moyenâgeuse des
rapports sociaux. Que dire d’une économie
nationale aux mains d’une infime minorité, ou
vendue à la pièce et au profit de multinationales
? Que dire de tous ces mécanismes obscures qui alimentent
les marchés parallèles et noyautent le monde
politique colombien ? Au nom de l’ouverture à des
capitaux extérieurs, le président n’a
fait que défaire le peu de mesures sociales existantes en
privatisant l’assurance sociale et
l’éducation, et en fermant des hôpitaux
publics. La Colombie n’est pas un pays pauvre si
l’on prend en compte ses richesses minérales et
vivrières, sauf que 54% de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté et qu’en parallèle 2%
des plus riches détiennent plus de 50% des terres agricoles.
Cette nation est très attractive pour les investisseurs,
c’est même une fierté du
président que d’avoir quintuplé les
investissements étrangers (2 milliards de dollars
à son arrivée au pouvoir). La force
d’Uribe aura été de faire croire
qu’avec lui la guerre n’existait pas et se limitait
à un phénomène qualifié de
terroriste. Dans la même veine, il s‘appuya sur le
discours son ami Bush junior sur le thème de cette menace,
en assimilant tout ce qui lui était opposé
à des terroristes et en désignant les Forces
Armées Révolutionnaires comme la cause de toutes
les horreurs se produisant dans le pays. Le martelage a
gagné bon nombre d’esprits en Colombie et via bon
nombre de médias internationaux, mais pour autant la guerre
a continué, et le déplacement de dizaines de
milliers de réfugiés par an s’est
poursuivi et s’est plutôt amplifié sous
le deuxième mandat du président Uribe (plus de
300.000 en 2008).
Car ces dernières
années, effet Ingrid Betancourt aidant, les FARC sont
devenues responsables de toutes les difficultés du pays, et
tous ceux qui critiquent la politique de sécurité
nationale sont désignés publiquement comme des
«amis» des FARC. Des syndicalistes, des
journalistes ou des militants d’ONG s’activant en
faveur de la paix ou pour les droits sociaux se sont trouvés
amalgamés dans cette rhétorique quelque peu
outrancière. Et la Colombie au fil des ans est et demeure la
nation la plus dangereuse pour l’exercice du syndicalisme.
Avec un tel angle de dénigrement, il devient difficile de
relater une insécurité qui dépasse
quand même l’entendement, et qui est loin
d’être la seule responsabilité des
guérillas (ELN et FARC). Elles seraient responsables
d’un quart des victimes civiles du conflit armé.
Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte les disparus
dont les estimations varient de 150 à 300.000 personnes pour
ces dix dernières années. Les
guérillas ne sont pas exemptes de condamnations, elles ont
à leur actif des crimes de guerre et contre
l’humanité qui au titre du droit international
sont passibles du Tribunal Pénal International. En premier
lieu ce qui touche à la question des populations civiles non
armée sur un territoire en guerre, et à ce sujet
chaque combat provoque son lot de victimes innocentes et souvent plus
que le nombre de soldats tombés sur un champ de bataille. Le
sort des populations civiles en temps de guerre n’est pas
simple, il est même paradoxale, car les civils sont toujours
les premières victimes. Surtout quand le but est de ne pas
aborder certaines évidences,
c’est-à-dire les 75% de crimes
perpétrés par l’armée
régulière et les milices paramilitaires ces
dernières années, mais à nouveau en ne
prenant pas en compte les personnes disparues, et le haut niveau de
criminalité, notamment maffieuse, qui n’est en
rien hors du conflit en cours, commerce de la drogue oblige. Vous
comprenez ainsi qu’il est presque impossible
d’établir des données fiables sur le
nombre des décès civils,
particulièrement dans un univers où
l’on a découvert plusieurs charniers ces
dernières années dans les campagnes, et la
dernière fosse commune trouvée en ce
début d’année 2010 rassemblait 2000
cadavres. Dans les faits les crimes du paramiltarisme et de
l’armée régulière sont
sous-évalués, et il y aura
inévitablement de nouvelles découvertes macabres
dans les mois et années à venir (l’on
estime à minima à 2.000 charniers restant
à découvrir).
Il est
à souligner que le journal La Croix est le premier quotidien
français a relaté l’existence de fours
crématoires en Colombie (1), comme il est peu fait
état des disparus donnés en pâture aux
crocodiles, des méthodes très utiles pour ne pas
avoir un état réel du nombre de morts. Qui va se
soucier de petits paysans ou ouvriers agricoles ? Ils sont non
seulement confrontés de chaque part à des
pressions des forces en présence, mais en plus, ils
subissent une guerre au quotidien sans véritable
relâche. Rajouté à tout cela
près d’un millier de
réfugiés par jour obligés de fuir les
affrontements armés, nous atteignons des sommets de cynisme
quant à l’efficacité du
président Uribe et sa politique de
«sécurité
démocratique». Ces huit années
passés au pouvoir ont simplement
légitimé un mensonge d’État
visant à manipuler les esprits. En pur produit hollywoodien
Uribe s’est fait passé pour le
«chevalier blanc» qui allait tout nettoyer sur son
passage. Et le «nettoyage» au sens militaire du
terme a certes marqué des points, mais les
mécanismes criminels n’ont pas changé,
et ils sont restés conformes à un ordre
manifestement peu soucieux des règles d’un
état de droit. Certains aspects de cette guerre peuvent nous
échapper, si l’on ne pose pas la question du
mélange des genres entre politique, le paramilitarisme et le
contrôle des cartels toujours en présence sur les
narcotafics. Cet ensemble politico-militaire et maffieux est le
résultat de la complexité et de
l’ampleur des déséquilibres existants
depuis le milieu des années 1970 et des liens
étroits qui se sont établis entre les pouvoirs
politiques, judiciaires, militaires et les pieuvres locales de la
drogue.
Si le président Uribe
n’est pas le «chevalier blanc », mais qui
est-il, et que nous connaissons-nous de ses liens avec le
paramilitarisme ou bien le dénommé Pablo Escobar
? Il contribua à la création des CONVIVIR, des
groupes paramilitaires ou milices privées, qui ont
été financer avec l’appui des grands
propriétaires terriens et le narcotrafic. Les liens entre
les paramilitaires et les réseaux de drogues ont autre
été mis à jour, entre autre par les
aveux ou confessions récentes de Salvatore Mancuso (2), il
fut un proche d’Alvaro Uribe, lui et sa famille (3). Pour ce
qui est du lien entre Pablo Escobar et Alvaro Uribe, il marque
à la fois l’entrée en politique de ce
dernier et l’élimination du premier pour accomplir
un chemin jusqu’au mandat suprême. Pareillement,
pourquoi Alvaro Uribe Velez est-il répertorié
comme le narcotrafiquant numéro 82 au sein des archives du
Département d’État
étasunien? (4). Comment se fait-il que les USA aient
accepté que cet homme puisse se faire élire avec
de telles charges pesant sur lui, tout en continuant à
financer par milliard de dollars un plan de lutte contre la culture et
le trafic des drogues, le plan « Colombia »
initié par Bill Clinton et son homologue colombien Pastrana
? Et question au demeurant sans réponse réelle
à apporter pourquoi en 12 ans de lutte, personne
n’a pu constater un infléchissement
véritable du marché ? Il est
resté stable à environ 700 à 800
tonnes de cocaïne exportées et concernant
principalement deux marchés, les USA et l’Europe.
Les derniers mois de la présidence
d’Alvaro Uribe ne signalent pas la fin d’un
système, tout semble se présenter dans une
continuation certaine, si Juan Manuel Santos devenait le prochain
président de la Colombie. Ce dernier fut au poste de
ministre de la défense et s’est
retrouvé en première ligne lors du scandale des
exécutions extrajudiciaires de jeunes hommes civils, ceci
pour le but de faire du chiffre et de toucher des primes sur de faux
combattants prétendument tués au combat. Cette
affaire des « faux positifs » (4) est un des
révélateurs, de comment a
été organisé ces dernières
années un silence de plomb au sein de la
société civile. Des outils de
délations permettent à des citoyens de
dénoncer contre une rétribution un mal-pensant ou
«un terroriste» en puissance, c’est le
cas récent par exemple de comment dans les
universités, il est possible de toucher un petit
pécule pour dénoncer ses petits camarades. Il en
est de même à l’extérieur du
pays via certaines ambassades surveillant leurs ressortissants
à l’étranger et traquant des nationaux
non conformes et toujours sous le titre d’appartenance aux
FARC. C’est ainsi que croupi en prison un professeur
d'université, Miguel Angel Beltran.
Jusqu’à
l’an dernier, il
donnait des cours au Mexique. Il s’est retrouvé
extradé et mis sous les verrous sous la fallacieuse
accusation d’appartenance aux FARC. Et ce n’est pas
un cas isolé, il est question de 7.000 prisonniers
politiques. Un jour qui sait, il sera temps de porter un regard lucide
sur la Colombie… C’est un peu tout
l’enjeu de comprendre, pourquoi cette
société supporte depuis des décennies
de tels déséquilibres ? Il en va surtout
d’une guerre qui plonge le pays tout entier dans
l’anonymat, une négation patente des crimes qui y
sont commis.
Notes
:
|
|
|
|
|
|
Le
narco-paramilitarisme
continue de régner en Colombie
|
 Entretien
avec Hollman Morris,
Entretien
avec Hollman Morris,
Marcos SALGADO, mars 2010
Marcos
Salgado :
Quel bilan tires-tu des élections de dimanche dernier en
Colombie ? Le tableau n'est en rien encourageant, il donne l'impression
que la majorité des Colombiens ne sont pas
disposés à se servir des urnes pour sanctionner
un phénomène tel que la parapolitique...
Hollman
Morris (journaliste
colombien): Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas de
raisons de me réjouir, et le bilan que je dresse est
plutôt pessimiste. Premier point : en Colombie, on a
réélu plusieurs barons qui étaient
impliqués - eux-mêmes ou leurs proches - avec le
narco-paramilitarisme. Il y a des cas scandaleux comme celui de Mme
Teresa García, soeur de Álvaro García,
politicien colombien condamné à une peine de 40
ans en raison de ses liens avec le massacre épouvantable de
“Macayepo” (1); cependant, l'électorat
de cette zone, la côte nord de la République, a
voté pour sa soeur, et personne ne nous garantit aujourd'hui
qu'elle ne va pas, au Congrès de la République,
faire la même chose que son frère : corruption,
instigation à commettre des massacres, et personne ne nous
garantit qu'une femme comme celle-là va chercher la
vérité sur le paramilitarisme au sein du
Congrès. Et je pourrais te citer encore de nombreux cas, en
particulier au sein du Parti de la U, le parti au gouvernement. Il y en
a tant que j'en oublie les noms. Deuxième point : est
gagnant le parti connu sous le nom de PIN (Parti
d'intégration nationale), un parti apparu du jour au
lendemain avec de grands moyens ; par exemple, le MOIR a
dénoncé le fait que ces moyens proviennent du
narcotrafic et que plusieurs de ces personnes sont guidées
par les barons de la politique qui se trouvent à la prison
de La Picota, et ce parti devient la 4e force politique du pays. C'est
une honte. Le troisième point, très grave pour
moi, est qu'une personne comme Andrés Felipe Arias, candidat
conservateur, ancien ministre de l'agriculture, dont il a
été prouvé publiquement qu'il a
détourné l'argent de la nation, en accordant des
moyens aux propriétaires terriens les plus riches de ce pays
(2), puisse se présenter aux élections comme
candidat du Parti conservateur.
MS
: Devant cette
situation, le peuple colombien ne voit-il pas ce que tu dis, y a-t-il
un cordon informatif, n'y a-t-il pas de volonté de punir
cela, le paramilitarisme...? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi en
Colombie ?
HM
: Je crois qu'il y a une grande capacité
à inspirer la peur et la terreur. Le narco-paramilitarisme
continue de régner dans différentes
régions du pays, les victimes ne voient pas que ces
personnes seraient punies. Mais je voudrais signaler quelque chose
d'important : le président de la République n'a
jamais émis le moindre message pour condamner l'argent du
narcotrafic versé lors de ces élections, et il ne
pouvait pas le faire parce que plusieurs de ces personnes
impliquées dans le paramilitarisme sont également
associées au gouvernement de Uribe.
MS
: Et quel
rôle revient aux forces de gauche, aux secteurs qui ne sont
pas compromis avec cette façon de faire la politique et ne
sont pas liés aux milieux du pouvoir économique ?
Parce que ça ne s'est pas bien passé non plus
pour la gauche...
HM: Non,ça
ne s'est pas bien passé non plus pour la gauche. Avant les
élections, la gauche colombienne a donné au pays
un spectacle qui n'est pas celui d'une force organisée. Il y
a eu des querelles pour de petits morceaux de pouvoir, au lieu de
construire une proposition concrète et solide pour le pays ;
la gauche n'a pas su profiter de l'illégitimité
que confèrent à la force de gouvernement ses
alliances avec le paramilitarisme. Le départ de plusieurs
sénateurs du PDA est une sanction de l'électorat,
parce que celui-ci s'est rendu compte qu'ils se sont davantage
occupés de leurs espaces de pouvoir au lieu de faire des
propositions aux électeurs, et je tiens à dire
que les électeurs colombiens attendent des propositions
nouvelles et pas seulement qu'on leur propose la guerre ou l'agenda de
la haine. Je voudrais souligner comment Ivan Cepeda,
représentant du mouvement des Victimes de crimes
d'État, a été élu dans la
ville de Bogotá, un vote d'opinion très
important, et il va être quelqu'un d'intéressant
à analyser dans l'exercice de son mandat politique.
Source : TRADUCTION ARLAC
|
|
|
|
|
|
|
|
Histoire
d’une
grand-mère en Argentine |

Hugo
Presman, 24 juin 2004
Il fait froid en cet hiver
qui commence tout juste. Une femme
au
port élégant et dont la présence
impose le respect
est submergée de douleurs. L’almanach indique le
24 juin
1996. Elle cherche une feuille de papier et un stylo. Dans 48 heures,
un petit-fils qu’elle cherche depuis 18 ans aura cet
âge.
Elle lui écrira une lettre. Son titre? Lettre à
mon
petit-fils disparu. « Tu as 18 ans aujourd’hui...
et je
veux te raconter des choses que tu ne sais pas et t’exprimer
des
sentiments que tu ne connais pas ». Les souvenirs
s’entremêlent dans sa mémoire. Elle se
voit
elle-même quand elle était directrice
d’une
école primaire, et sa fille Laura, étudiante
à la
Faculté des Humanités de
l’Université
nationale de La Plata.
A l’époque, elle
était
seulement Estela Barnes de Carlotto, préoccupée
par les
risques du militantisme de sa fille, membre d’une
génération disposée à
mettre sa vie au
service d’une société plus juste.
Durant ces
années obscures, la mort circulait librement. Comme
l’écrit Mario Benedetti, « la vie
n’était rien d’autre qu’une
cible mouvante,
chaque nuit était toujours une absence et chaque
réveil
un rendez-vous déçu ». En novembre
1977, Laura
disparaît. Estela ne savait pas encore que sa fille
était
enceinte. La famille se mobilise à sa recherche. Habeas
Corpus
et contacts politiques. Par le biais d’une camarade, soeur de
Benito Reynaldo Bignone, elle obtient une entrevue avec ce dernier, au
Commandement en chef de l’Armée.
Les
larmes embuent
ses yeux. Les images conservent la cruauté des
années de
plomb. Le général la reçoit, son arme
posée
sur son bureau. Dans une harangue incohérente, il
n’hésite pas à lui affirmer que, pour
lui, il
fallait tous les tuer et qu’ils les tuaient tous. La seule
chose
qu’il lui a promise, c’était de lui
remettre le
cadavre de Laura.
L’espoir est revenu le
31
décembre 1977. Estela et son mari ont reçu une
lettre
disant que Laura était vivante, aux mains des forces de
sécurité. L’espoir de la retrouver se
faisait jour
avec le début de 1978. Jamais elle n’oubliera
l’après-midi du 17 avril : une femme est apparue
dans la
boutique de son mari et leur a raconté qu’elle
avait
été détenue dans le même
lieu que Laura.
Laura était vivante, enceinte de six mois ;
l’enfant
devait naître en juin, et elle a laissé entendre
qu’ils pourraient laisser le bébé
à la Casa
Cuna de La Plata. En mai 1978, elle avait déjà
pris
conscience que son drame individuel participait d’une
tragédie collective. Mais elle n’avait pas encore
pris la
mesure de la perversion et de la cruauté de la dictature
criminelle. C’est pourquoi, avec les autres
Grands-mères
de la Place de Mai, Estela tissait, avec les fils de
l’angoisse
et de l’espoir, le trousseau du petit-fils attendu. Comment
exprimer dans la lettre cette recherche collective de tant
d’années ?
« Nous,
tes grands-parents,
appartenons à cette génération qui
assigne
à chaque date une valeur spéciale et
singulière.
La naissance d’un petit-fils est l’une de ces
dates. Le
baptême (ou non), les premiers pas, la communion (ou non), la
chute de la première dent, le jardin d’enfants, le
tablier
blanc et la demande : mémé, apprend-moi les
tables. Ce
sont des moments qui comptent. C’est pourquoi cette date,
à laquelle tu atteins 18 ans, deviendra «
spéciale
et singulière » comme toutes les autres que nous
n’avons pas pu vivre avec toi. Parce qu’ils
t’ont
volé des bras de ta maman Laura quelques heures
après ta
naissance, dans un hôpital militaire, de ta maman
menottée, gardée, pour ensuite furtivement et
sournoisement te dérober pour une destination incertaine
». Maintenant la mémoire
s’arrête dans une
Argentine absente et pleine de ferveur pour un Mondial de football
(1978, ndlr) qui se déroulait à deux
kilomètres du
principal camp de concentration : l’École de
Mécanique de l’Armée. Laura
commençait son
travail d’accouchement dans l’Hôpital
Militaire, au
moment où l’Argentine, grâce
à son goleador,
Mario Kempes, marquait le premier but de la finale contre la Hollande.
Elle était arrivée du camp de
détention de La
Cacha. Le 26 juin, Guido est né. Ils ont laissé
Laura
avec son bébé cinq heures à peine.
Ensuite, ils
l’ont endormie et ramenée au centre clandestin de
détention. Pendant ces brèves cinq heures,
peut-être a-t-elle pu dire à son fils des
fragments du
poème qu’une autre mère disparue,
María du
Carmen Gualdero de García, a écrit à
son fils
à venir :
«
Pour que mon fils ne dorme pas
Dans un lit
d’hélium
Je recueillerai l’air
là où il demeure
Je
récolterai l’amour là où je
pourrai...
Pour qu’elles ne troublent pas
l’eau qu’il boira
Pour qu’elles
ne souillent ni la mer ni le bûcher
Je
réunirai la sueur des lucioles
Les larmes rebelles
de son père et il boira
Aux coupes de miel des
abeilles
Aux vaches non contaminées
Aux
nappes profondes de la terre...
Nous marcherons sur les
chemins
Moi, les yeux étonnés
Toi,
les yeux propres, neufs
Nous marcherons sur les chemins un
empan après l’autre, une terre après
l’autre
Si nous restons jusqu’à
ce jour-là toi et moi
S’ils nous le
permettent s’ils nous le permettent... Mon fils...
».
Deux mois plus tard, le 25
août 1978, Laura était assassinée.
Estela
raconte : « Quand ils m’ont donné le
cadavre
à Isidro Casanova, il m’a fallu le
reconnaître, je
n’ai pas pu parce que le visage était
déchiqueté, mais mon mari et mon frère
l’ont
reconnu ; j’ai demandé au commissaire des
nouvelles du
bébé, et il m’a répondu :
«
L’armée ne m’a livré que
ceci. Si vous voulez
l’emporter, signez ». Il a sorti un revolver et
l’a
posé sur le bureau. Je crois que l’attitude
d’une
mère désespérée qui lui
criait assassins,
voleurs, corrompus lui a fait peur.
Alors, une autre
lutte a
commencé, la lutte pour Laura morte et mon petit-fils vivant
« Et pour tous les petits emportés comme butin de
guerre
». La vie ne lui a pas restitué le sien, mais par
contre
elle participe à ce remarquable exploit de restituer leur
identité et leur histoire aux petits qui ont perdu leurs
parents. La feuille de papier attend. Comme exprimer en peu de lignes
la lutte et l’espoir ? Estela de Carlotto,
présidente des
Grands-mères (de la Place de mai, ndlr), figure publique
reconnue, poursuit sa lettre avec ces larmes qui
n’apparaissent
jamais quand elle assume ses fonctions. « Tu as dû
grandir
durant tes belles 18 années de rêve avec un autre
nom,
Guido. Ce n’est pas ton papa et ta maman qui fêtent
avec
toi ton entrée dans l’âge mûr,
mais ceux qui
t’ont volé. Ce qu’ils ne
s’imaginent pas,
c’est que dans ton coeur et ton esprit tu portes, sans le
savoir,
toutes les berceuses et toutes les chansons que Laura, dans la solitude
de sa captivité, a chuchotées pour toi, quand tu
bougeais
dans son ventre. Et tu te réveilleras un jour en sachant
combien
elle t’a aimé et combien tous nous
t’aimons. Et tu
demanderas un jour où tu peux les trouver. Et tu chercheras
dans
le visage de ta mère la ressemblance et tu
découvriras
que tu aimes l’opéra, la musique classique ou le
jazz
(quelle antiquité !) comme tes grands-parents. Tu
écouteras Sui Generis ou Almendra, ou Papo, et tu les
ressentiras dans la profondeur de ton être, car
c’est ainsi
que le ressentait Laura. Tu te réveilleras un jour de ce
cauchemar, petit-fils chéri, et tu naîtras pour ta
libération. Je te cherche. Je t’attends. Avec
beaucoup
d’amour. Ta grand-mère Estela ».
Huit
années ont passé depuis qu’elle a
écrit
cette lettre. Estela cherche, lutte et espère, tandis que
les
grands-mères continuent de tisser avec patience,
ténacité et conviction, une histoire admirable
qu’elles méritent de voir couronnée par
le retour
de tous les petits-enfants, enlevés dans une
époque sans
clémence où la vie a été
dépréciée jusqu’au
mépris et la mort
faisait parade de ses succès.
Source : Argenpress.info, 24 juin
2004
|
|
|
|
|
Haïti, Perle des
Antilles ou l’île du
désespoir?
Lionel
Mesnard, le 25 mars 2010
1
– La colonisation
espagnole et française
Le
séisme intervenu à Haïti le 12 janvier
2010 n’est qu’une catastrophe de
plus dans l’histoire d’un pays
déjà plus que sinistré. Comme lors du
Tsunami qui dévasta plusieurs pays asiatiques, les
réactions de
solidarité furent fortes dans l’opinion publique
internationale. Elles
présument pourtant qu’une fois
l’émotion passée et que les
caméras et
médias du monde auront un autre désastre
à se mettre sous la dent, l’on
oubliera assez rapidement ce monde de désolation dans lequel
survit la
majorité des Haïtiens depuis plus de trois cents
ans. Cette nation est la plus pauvre de tout le
continent américain, bien qu’elle fut en son temps
«la Perle des
Antilles» et qu’elle fit en partie la richesse de
l’Europe occidentale
grâce aux négoces et à
l’exploitation des esclaves africains.
À
l’origine de la conquête espagnole de
l’Amérique vit le jour Hispaniola
lors du deuxième voyage de Christophe Colomb le 6
décembre 1492, l’île
s’appela plus tardivement Saint-Domingue.
L’île regroupe de nos jours
la République Dominicaine située à
l’Ouest, et la République Haïtienne
à l’Est. Elle fut d’abord une colonie
espagnole et puis en partie
française. En raison des vents, de la navigation et de sa
position
géographique, elle trouva rapidement une place centrale et
stratégique
dans la région. Au commencement de la conquête
coloniale, l’île était
habitée par les "Arawaks" (terme général, voire impropre
désignant des langues amérindiennes). Il
cohabita plusieurs populations originaires dont les plus connues : les
Taïnos et les Caraïbes. L’on
estime pour l’ensemble des Antilles
(Grandes et Petites) à environ 8 millions
d’habitants à l’arrivée des
colons (1). Les populations originaires furent rapidement
massacrées ou
soumises à l’esclavage. En moins de cinquante ans,
elles furent
réduites quasiment à néant, notamment
en raison de leur refus de se
soumettre à l’envahisseur. Il reste de nos jours
quelques centaines
d’amérindiens Caraïbes sur
l’île de la Dominique non loin de la
Guadeloupe (à ne pas confondre avec la République
Dominicaine) et une
population un peu plus importante au Venezuela (2).
Il
sera
institué en 1503 par Isabelle de Castille
«l’encomienda», un mécanisme
de servage qui s’étendra à
l’ensemble des possessions espagnoles et
auquel les peuples natifs seront contraints des siècles
durant. Il
reste toujours en 2010 dans certains pays latino-américains
(la
Colombie pour exemple) des mécanismes comparables, il
s’agit en fait de
payer les travailleurs avec des bons qu’ils ne peuvent
seulement
échanger dans les magasins de l’entreprise
à des prix plus importants
que le marché courant. Dès les débuts
du seizième siècle afin de
pallier le manque de main d’œuvre et un nombre
relativement limité de
colons suivront les esclaves venant du continent africain et en
particulier pour la culture de la canne à sucre ou
l’exploitation des
mines. Il faut pouvoir distinguer deux types d’exploitations
récurrentes chez les colons espagnols,
l’encomienda et la plantation, l’une pour les
amérindiens,
l’autre pour les esclavages noirs. Dans les faits
ces systèmes
permettront et feront la richesse des nations de l’Europe de
l’Ouest. À
ce sujet, Eduardo
Galeano dans son livre «Les veines ouvertes de
l’Amérique Latine» utilise les termes de
pré-accumulation du capital
donnant naissance au capitalisme, car il s’agit en fait du
début ou des
premiers pas de la mondialisation toujours encore en cours à
travers la
planète…
En 1665, Louis XIV
engage la colonisation de la
partie Est de Saint-Domingue. Au commencement de la présence
française,
l’on trouve principalement des flibustiers puis
progressivement une des
sources principales en sucre. L’île de
Saint-Domingue au dix-huitième
siècle est la première productrice de canne
à sucre au monde. Haïti
pendant un siècle restera sous domination
française jusqu’en 1804 et la
proclamation de l’indépendance. Il faut noter que
c’est avec la
Révolution de 1789 que le vent tourne, mais il faudra cinq
ans pour que
la première abolition de l’esclavage soit
proclamée, le 4 février 1794,
même si elle est effective en 1793 à
Saint-Domingue.
2 -
Napoléon
1er , l’affaire "Dumas" et les invisibles ?
L’esclavage
est rétabli
en 1802 par Napoléon Bonaparte, on peut y voir
l’influence de son
entourage proche, pour exemple son épouse
Joséphine de Beauharnais.
Elle est née en Martinique et elle est issue d’une
famille de
propriétaire terrien, ou bien le
Général Murat lui disposant de terres
à Marie-Galante (département de la Guadeloupe).
À force de mener des
guerres Napoléon est à court d’argent,
en 1803 il cède les territoires
nord-américains dit de Louisiane (en
réalité un territoire
s’étendant
sur 13 états des Etats-Unis) pour la somme de deux millions
de dollars
de l’époque, soit environ un dollar par
kilomètre carré. Et aussi cette
cessation pour reprendre en main les différentes colonies
existantes
dans la région (Haïti, Guadeloupe, Guyane et la
Martinique aux mains
des Anglais depuis 1796).
Le
1er janvier 1804, après l’échec des
troupes napoléoniennes et
l’arrestation de Toussaint Louverture (3) qu’est
proclamée
l’indépendance de la République
d’Haïti. Un élément assez peu
connu de
son Histoire, l’île va avoir un rôle non
négligeable dans la libération
des pays sous domination du Royaume d’Espagne. Elle va
appuyer en 1806
la première tentative de soulèvement des
hispano-américains en
soutenant le débarquement au Venezuela de Francisco de
Miranda
précurseur des indépendances
latino-américaines (4). Elle sera aussi un
fort soutien de Simon Bolivar, par l’intermédiaire
d’Alexandre Pétion
(ou Alexandre Sabès) président de la
République Haïtienne (de 1806 à
1818), qui en contrepartie lui demandera de mettre un terme
à
l’esclavage.
Bien que la France
(redevenue monarchiste) ait
signé en 1815 le traité de Vienne avec la
Couronne britannique devant
mettre un terme au commerce esclavagiste (et non à
l’esclavage), sous
le règne de Charles X en 1825, le roi fait
assiéger par ses troupes
navales Haïti et menace de bombarder. S’en suit un
compromis valant la
reconnaissance de l’indépendance, mais au prix de
cent cinquante
millions de francs ors de l’époque (5), soit dix
fois la richesse
annuelle du pays, ou trois fois la valeur du pays selon Laborde un
ancien colon (puis sera ramené à 60 millions en
1838). Cette «dette»
plongera le pays dans la ruine la nation haïtienne, elle devra
s’en
acquitter jusqu’en 1947… En 1852, Faustin
Soulouque (président puis
empereur) arrête de payer ce rançonnement, mais en
1877, cette fois
c’est la Troisième République
française qui forme un nouveau blocus et
exige son rançonnement.
Suite
à la polémique soulevée par le
film «L’autre Dumas», nous avons
là aussi quelque chose de très
significatif du refus de la part de la France de reconnaître
une place
aux descendants africains dans l’histoire de France. Pourtant
à y
regarder de plus près et certainement pas dans les manuels
d’histoire,
le père du romancier Dumas fut général
de la République pendant la
"grande Révolution". Notre cher Napoléon
1er lui s’employa à ce que lui
puis sa veuve ne puissent percevoir aucune pension. Et plus de 200 ans
après, le général n’est
toujours pas reconnu comme officier de la
Légion d’Honneur. «Le
général Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie,
dit Alexandre Dumas (…) est "le seul
général de l'histoire de France à
avoir été privé" de la
Légion d'Honneur "à cause de la couleur de sa
peau et parce qu'il était né esclave, fils
d'esclave". Claude Ribbe
rappelle que "l'ordre de la légion d'Honneur a
été créé le 19 mai 1802
et l'esclavage rétabli le lendemain, que les militaires
noirs et de
couleur furent bannis de l'armée française et
assignés à résidence par
deux arrêtés consulaires secrets du 29 mai 1802".
Il ajoute que le
général Dumas avait reçu de la part de
Bonaparte un "sabre d'honneur"
au moment de la bataille d'Alexandrie et que tout détenteur
du sabre
d'honneur était admis de droit dans l'ordre de la
Légion d'Honneur.
Mais les décrets sur les gens de couleur l'ont
empêché de faire valoir
son droit. » (6)
Mais l’affaire
ne s’arrête pas à la seule
question du général Dumas, son fils auteur
universel et l’un des
romanciers le plus lu au monde passe quasiment pour un plagiaire dans
le film de Safy Nebbou. Nous savons que de nombreux
écrivains au XIX°
siècle ont fait usage d’assistants pour leurs
ouvrages (Gérard de
Nerval, Théophile Gautier, Eugène
Sue,…). Mais de là à penser que ces
écrivains ne sont pas à l’origine de
leur production, il y a un pas à
ne pas franchir et à ne pas confondre de nos jours avec les
vedettes ou
politiques qui font appel à des rédacteurs
anonymes, que l’on nomme des
«nègres». De plus, Gérard
Depardieu apparaît certes frisé ou
crépu mais
blond, mais en plus son teint n’est aucun cas
hâlé comme l’était Dumas
en raison de son métissage. Ou dans ce cas quand
verrons-nous un jour
des comédiens français originaires
d’Afrique ou des Antilles joués des
rôles de personnages historiques comme Victor Hugo ou
Émile Zola?
On
pouvait penser après un premier examen que cela
n’a pas grande
importance, pourtant après réflexion, il y a
à se demander si l’on ne
cherche pas à dissimuler les origines de Dumas ? Et, il
n’est pas le seul, c’est
aussi le cas de certains héros de
l’indépendance des Amériques
Espagnoles, notamment Simon Bolivar, et possiblement Francisco de
Miranda. Si l’on tient à certains
récits, ils ne ressemblent pas
vraiment aux peintures que nous connaissons d’eux, les
représentant
comme des blancs plutôt pâlichons via des
œuvres peintes bien des
années après leurs morts respectives. Dans le cas
de Simon Bolivar,
nous sommes face à une quasi-certitude concernant des liens
divers
(espagnol, amérindien et africain). Lors de la campagne
militaire qu’il
mena dans le Haut Pérou (aujourd’hui la Bolivie)
il fut surnommé par
une épithète discriminante de la part de ses
ennemis. On l’appela «El
Zomba» (7) en raison du fait qu’ayant
vécu et traversé l’altiplano, les
rayons du soleil eurent pour effet de lui donné une couleur
très mate.
Pour ce qui est de Miranda, on peut se demander pourquoi Madame de
Custine et son entourage lui donnèrent le sobriquet amical
de
«Péruvien»? Le Venezuela est par
excellence un pays de métis (70%),
mais depuis des générations, les oligarchies
«blanches» ont tout fait
pour masquer certaines réalités et
relèguent les afro-descendants et
amérindiens à un statut d’invisible.
3
– La famille Duvalier
et la dette haïtienne
En
1957, bien connu sous le nom de Papa Doc, François Duvalier
est élu
président. Sept ans après il instaure une
dictature militaire avec
l’appui des Tontons Macoutes (forces spéciales du
président). Cet
appendice militariste éliminera ou poussera à
l’exil de nombreux
haïtiens. Ce groupe équivaudra aux escadrons de la
mort dans les années
1970 et 1980 qui dans toute l’Amérique Latine
feront en sorte
d’éliminer les oppositions progressistes. Papa Doc
passe ses pouvoirs à
son fils en 1971. La famille Duvalier est dans l’histoire
récente
d’Haïti un des révélateurs de
comment pendant près de 30 ans, le père
puis le fils ont fait régner la terreur, et comment ils ont
l’un et
l’autre pillé les finances du pays et ce avec
l’appui bienveillant de
la France. Qui ira jusqu’à accueillir le fils au
moment de son exil en
1986 via un avion de l’U.S Air Force. Jean-Claude dit
Bébé Doc laissa
au plus bas et à lui seul une facture de 500 millions de
dollars (8),
par ailleurs sa fortune personnelle fut estimée à
environ 900 millions
de dollars après son départ de
l’île (9). Et comble du cynisme ces
sommes bien qu’elles furent en principe bloquées,
elles n’ont jamais
été jusqu’à
présent restituées aux
intéressés.
Si la dette du
pays s’élève à 880 millions
de dollars (avant le cataclysme), l’obole
de certains pays dans le cadre d’un soutien n’offre
pas vraiment de
possible reconstruction. La France à ce sujet donnant 350
millions et
annulant une dette de 50 millions d’euros à de
quoi faire rire, mais
nerveusement ou de désespoir. D’après
certaines estimations, il est
question d’un coût total de 14 milliards de
dollars, dans ce cas,
combien de temps faudra-t-il aux haïtiens pour s’en
remettre? Pour
exemple, la présidente du Chili Michèle Bachelet
après le tremblement
de terre intervenu (le 27 février 2010) sur la
côte pacifique pense
qu’il faudra 2 à 3 ans pour effacer les traces, et
le coût lui est
évalué à 3 à 4 milliards de
dollars. On peut tout à fait présumer que
pour Haïti c’est en décennie
qu’il faut compter, en clair les
survivants ne connaîtront probablement aucune
amélioration et vivront
dans des conditions bien pire qu’avant le séisme
(1 million de
personnes sans abri).
4
- Jean-Bertrand Aristide et les
puissances impérialistes
Malgré
un coup d’état intervenu en 1988, l’on
pouvait croire en 1990 lors de
l’élection du père Aristide
à un tournant politique majeur. «Sa
prestation de serment eut lieu le 7 février 1991, un mois
après que ses
supporteurs eurent obligé l'armée à
déjouer une tentative de coup
d'état orchestré par Roger Lafontant, un ancien
membre fort des régimes
des Duvalier. Pendant les premiers mois de son gouvernement, le nouveau
président essaya de purger l'armée,
l'administration publique et de
réduire les actes de banditisme. En même temps, il
aliéna le Parlement
par certains de ses choix et actions. Chaque acte posé
suscita
l'admiration de ses supporteurs et l'endurcissement de ses ennemis. Le
mécontentement de ses derniers fut à l'origine du
violent coup d'état
du 30 Septembre 1991 qui le força à s'exiler
d'abord au Vénézuela et
ensuite aux Etats-Unis d'Amérique. » (11). Avec
l’appui des USA il
revint au en 1994 et en 1995 fut élu René Garcia
Préval. De son côté,
Jean-Bertrand Aristide reste dans l’ombre du pouvoir, tout en
créant en
1996 un parti politique (Pati Fanmi Lavalas). Cette organisation fut
accusée de fraude lors des élections
législatives en 2000. Un an près,
Aristide est de nouveau élu président par 93 %
des voix mais est élu
seulement avec 5% des votants. En 2004, suite à un
soulèvement, il
démissionne et part de nouveau en exil. Il
résidera en Afrique du Sud.
Toutefois, il faudrait comprendre pourquoi Jean-Bertrand Aristide a
été
destitué, sans chercher à mettre au pilori ceux
qui apportent des
réponses non conformes aux médias de masse?
Découvrir
que le séisme offre à certains états
et
responsables politiques la possibilité de se refaire une
virginité en
matière d’aide et de secours aux haïtiens
a de quoi provoquer des hauts
de cœur. En première ligne les
États-Unis et la France sont en
concurrence pour imposer leur domination dans cette région
du monde. Si
ce bout de territoire n’offre en rien un
intérêt économique, sur le
plan géostratégique, il en est autrement. En
particulier pour le
Département d’État étasunien
qui ne fait que constater son recul depuis
l’arrivée d’Hugo Chavez et des tenants
du mouvement bolivarien en
Amérique Latine. On peut tout à fait imaginer que
les USA verraient
d’un bon œil l’installation
d’une nouvelle base militaire. C’est Evo
Morales, le président Bolivien qui rappelait lors
d’une de ses
interventions, qu’un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir. Il
serait temps que nous prenions en compte une histoire qui ne se limite
pas «à nos ancêtres les
Gaulois» (ce qui plus est en en parti erroné),
mais qui puisse tenir dans ses analyses la nature de ses
échanges avec
le monde à travers les siècles
écoulés. L’objet n’est pas de
se
flageller sur des responsabilités qui ne concernent pas
directement les
jeunes générations, du moins la mienne. Mais
d’ouvrir les yeux et de
comprendre qu’outre-atlantique et en Afrique une grande part
des
populations vivent toujours dans la misère la plus crasse
pour des
intérêts de puissances à la fois
économiques et militaires.
Cet
ensemble de faits traités n’est que la part
immergée, que subit le
peuple haïtien depuis des lustres. Il ne faut pas oublier les
relations
déplorables avec son voisin la République
Dominicaine. Cet état utilise
la main d’œuvre haïtienne sous des formes
esclavagistes et n’hésite pas
à faire assassiner les récalcitrants.
«Plus de 1000 Haïtiens sans
ressources traversent par jour la frontière à
l’est de l’Île. Il
faudrait dire chaque nuit, car ce commerce exercé par des
passeurs est
clandestin. Une fois rendus, les «visiteurs en
quête de travail»,
ainsi désignés, sont parqués dans des
baraques et exploités par les
propriétaires de plantations. Parfois à vie
lorsqu’ils ne sont pas
rapatriés sans paie et séparés de leur
famille. Sous-payés (à peine 2
pesos pour une tonne de canne à sucre
récoltée) et sous-alimentés, ils
vivent dans la misère. Obligés de payer leur lit
à crédit et leur
équipement, ils sont à jamais les
débiteurs des richissimes
propriétaires de plantations» (11). Et que dire du
sort réservé aux
migrants haïtiens dans les Antilles françaises,
c’est-à-dire expulsés à
tour de bras par la police des frontières chère
au ministre de
l’intérieur Brice Hortefeux et son mentor Nicolas
Sarkozy. En soit ce
qui se passe en Haïti à proprement parler, il ne
s’agit plus de
colonialisme, mais des ressorts de l’impérialisme
toujours en œuvre
depuis les débuts du XIX° siècle.
L’ancienne Saint-Domingue française
est un révélateur de l’hypocrisie ou
des larmes de crocodiles des
puissances impérialistes et fruit de la concurrence entre la
France et
les USA.
Notes
:
(1) Pour Hispaniola,
l’estimation est de
1 million trois cent mille habitants, pour n’en totaliser
dès 1507 plus
que soixante mille amérindiens.
(2) Lieu
d’origine des amérindiens Caraïbes.
(3)
Toussaint Louverture sera incarcéré en France
jusqu’à sa mort au
Château de Joux dans le Doubs. (Il existe un film de 2004 sur
ce
personnage historique produit par France 5).
(4)
Lire «Les
Mousquetaires de l’Amérique»,
par Lionel Mesnard :
http://lionel.mesnard.free.fr/le%20site/In-Amerique-Latine-2006-2.html
(5)
En cumule, on estimait le coût en 2004 de la dette
équivalait à environ
à 15 ou 20 milliards d’euros, soit
l’équivalent des besoins actuels
pour la reconstruction.
(6) Site de Claude
Ribbe, «communiqué de l’AFP
du 16 février 2010»:
(7)
Zambo, cette terminologie raciste en espagnol renvoie à un
mélange entre un Indien et un Noir.
(8)
Article XI, «Haïti : un pays créditeur,
pas débiteur» par Naomi Klein :
http://www.article11.info/spip/spip.php?article709
(9)
Source wikipedia sur Jean-Claude Duvalier
(10)
Haïti-Référence : «Profil de
Jean-Bertrand Aristide» :
http://www.haiti-reference.com/histoire/notables/aristide.html
(11)
Esclavage contemporain par Andrée Proulx:
http://www.voir.ca/blogs/andre_proulx/archive/2009/03/14/esclavage-contemporain.aspx
Cet article est sous la mention tous
droits réservés
et
ne peut faire l'objet d'une reproduction sans autorisation
|
|
|
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
Les articles et textes de
Lionel Mesnard sont sous la mention
tous droits réservés et ne peuvent faire l'objet d'une reproduction
sans autorisation
Les
autres documents sont sous licence
Creative
Commons 3.0 ou 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
|
|
|
|
| Page d'entrée : |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages à consulter : |
Amérique Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Eduardo Galeno : Un autre regard |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Bio(s),
textes |
| Psyché, Inconscient, Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
et légendes urbaines |
Alice
Miller : Mais qui est
donc AM? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 14/06/2010 |
|
|
|
|
| |