|
|

|
Cliquez ci-dessus pour retourner à la page d'accueil
|
| |
1 - Venezuela : Action judiciaire contre Globovisión, Gonzalo Gómez
2 - Colombie : La guerre n'est pas la seule priorité, Juanita Leon
3 - Venezuela : Les mousquetaires de l'Amérique
4 - Venezuela : Passage des Andes
5 - Venezuela : Au coeur du processus bolivarien, Pierre Beaudet
6 - Colombie : a) La propagande des médias, b) L'échec du processus démocratique, Garry Leech
7 - Colombie : Nous naviguons dans un océan d'incertitude...
|
|
Amérique
Latine
Archives
des articles 2006
Sommaire : 2ème
partie

|
|
|
|
|
|
|
Avancée
de l'action judiciaire
contre Globovisión
Par
Gonzalo Gómez
(
ANMCLA - 01/02/06)
|
|
|
À la mi janvier
2006, la Cours Constitutionnelle du Tribunal Suprême de
Justice a notifié au Procureur Général de
la République et à la Défense Publique une
décision suite au recours déposé le13 juillet
2005, autorisant l'action engagée par un groupe d'avocats
et d'associations à caractère social (ou citoyen),
menée par Julio Latan du Front National des Avocats Bolivariens,
contre les propriétaires de Globovisión.
Il a été
aussi notifié aux directeurs de l'entreprise et aux sociétés
marchandes de présenter les états de leur capital.
Conformément
(aux règles attribuées par le TSJ), elles disposent
d'un délai de 96 heures pour fixer l'audition, devant
laquelle elles devront comparaître. En conséquence,
nous sommes au devant d'un jugement, où des organisations
civiles à caractère populaire feront face aux propriétaires
de cette chaîne. Télévision clairement identifiée
pour son inclination et son soutien contre-révolutionnaire
et impérialiste aux golpistes, conduisant l'opposition
de la finance à agir contre le gouvernement du président
Chávez, et contre le processus révolutionnaire
qui le soutient.
Les parties civiles et
des adhérents de base ont commencé une campagne
nationale et internationale, qui rassemble diverses organisations
sociales et politiques au Venezuela. Ils disposent aussi de l'adhésion symbolique
et de l'activisme solidaire d'organisations d'autres pays, à
l'échelle internationale. Ceci est une initiative autonome,
qui devient nécessaire face au chantage constant des télévisions
privées. Elles empêchent les organismes d'états
et gouvernementaux l'adoption de mesures et de sanctions pour
mettre un frein aux amalgames médiatiques. Ce qui conduit
à accepter l'impunité, avec pour souci d'éviter
les scandales que produiraient les médias internationaux
de l'impérialisme, comme la SIP (l'union continentale
des grands propriétaires de la presse) et quelques paravents
"des Droits Humains" contrôlés par le
principal violeur de ces droits : l'impérialisme étatsunien.
Face à des activités
à visée globale, cette demande est la récolte
d'un grand nombre de signatures et d'adhésions d'organisations
civiles et de citoyens, ainsi que les rassemblements ou mobilisations
et activités révélatrices issues de débats
pour la formation d'une conscience critique du pouvoir populaire,
face au pouvoir médiatique. Dans le cadre de cette discussion,
le sens est de définir les bases de ce que sont, ou doivent
être les moyens de communication dans la transition vers
le Socialisme du 21éme siècle.
Au sujet des parties civiles
et des organisations adhérentes, elles exigent de la CONATEL
(organisme de régulation des fréquences radios
et télévisions) - du MINFRA (Ministère des
infrastructures) et du Ministère de la Communication (MINCI),
qu'ils informent clairement sur l'état des concessions
de l'espace radioélectrique appartenant à la nation
et sur les autorisations accordées par l'État,
dont profitent encore les télévisions golpistes
et attentatoires aux droits.
Elles abusent d'une hyper tolérance, cela est mal vécu
au sein d'un peuple victime des agressions médiatiques.
La situation des concessions paraît être un secret
très bien gardé, se glissant à contre sens
de la démocratie participative et protagoniste. Il se
propage des rumeurs, elles inquiètent les acteurs sociaux
concernant la possible reconduction de ces concessions imméritées,
ce qui pourrait se faire ou et y compris avoir déjà
été consommé dans le dos de la souveraineté.
Pour Globovisión, il se dit aussi qu'elle ne disposerait
pas de concession légale en règle. Plus troublant,
un de ses propriétaires est assigné en justice
comme commanditaire présumé du meurtre du procureur
Danilo Anderson, qui effectuait des recherches sur le coup d'état
d'avril 2002.
Tout cela supposerait l'acceptation
de l'impunité (consciente ou non), avec la bénédiction
et le sacrifice de la justice, de la loi "Resorte"
(loi sur les responsabilités audiovisuelles et sociales
- décembre 2004) et de la Constitution. Ceci se faisant aux dépens
de stratégies et de tactiques politiques au rabais : des
mécanismes ou le déni administratif de quelques
fonctionnaires. Lesquels refusent de toucher aux moyens privés,
sortis indemnes du coup d'État (du 11 au 13 avril 2002),
avec l'appui de la grève générale patronale
et du sabotage pétrolier (années 2002 et 2003).
Le résultat : impunité, soumission aux pressions
de l'oligarchie et de l'impérialisme, préjudices
pour le peuple, survivance d'une des principales armes de l'Empire,
frein au processus de changements : le risque le plus majeur
pour la révolution.
Aujourd'hui, pour tout
ce qui a pu se passer antérieurement, il y a pour souhait
que le gouvernement soutienne et ouvre le pas aux organisations
sociales pour que soit rendue la justice, et faire avancer la
révolution sur le plan de la communication avec toutes
ses implications au sein du processus, organisations qui appellent
tout le mouvement populaire à assumer cette cause. Dans le cadre de la campagne autonome
en vue de traduire en justice les propriétaires de Globovisión
(connue pour son surnom de "Globoterreur" dans les
milieux populaires), sont venus se rajouter des "charlas",
des forums et programmes de radio et télévision
(moyens alternatifs et étatiques). Le programme d'extrême
droite « Grado 33 » (émis par Globovisión)
a déjà donné une première réponse,
en essayant de décrédibiliser l'action intentée,
en l'attribuant à Chávez. Ainsi a argumenté
l'opposant Asdrúbal Aguiar contre la règle sur
laquelle se fonde le recours. Les organisations engagées
préparent toutes les réponses nécessaires.
Fait curieux : une des parties civiles, l'avocat
Julio Latan a subi, il y a quelques mois plusieurs impacts de
balles, après avoir introduit la demande et la mise en
place d'une enquête.
Source : www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=72576
traduction
libre de Samuel Viscardo
(15/03/2006) |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
La
guerre n'est pas
la seule priorité des colombiens
Par
Juanita Leon, Bogotà, Colombie,
20 février 2006
Éditorialiste à
la Semana.com
|
|

|
|
|
|
|
Une enquête effectuée
par l'Université Andine Indepaz révèle que
la pauvreté, l'injustice et la corruption sont considérées
comme des problèmes plus graves que la guerre.
Pour la majorité
des colombiens, le conflit armé n'est pas le problème
le plus important du pays. Avant tout, il est question de solutions
à la pauvreté, à l'injustice et à
la corruption. Ainsi, le démontre "une analyse des
perceptions du conflit qui prend en compte le quotidien",
un travail effectué par l'Université Andine Indepaz
et l'Institut d'Études pour le Développement et
La Paix, publiée la semaine du 20 février 2006.
L'objectif de cette étude,
pour laquelle a été effectué 2000 enquêtes
à domicile, dans 21 communes, incluant les grandes capitales
régionales, les villes intermédiaires, les communes
rurales moyennes et petites, a été d'analysé
la perception des colombiens sur comment la violence, et le conflit
armé fonctionne au quotidien. Les résultats sont surprenants. Première
chose, le discours du président Alvaro Uribe sur l'existence
d'une menace terroriste à la démocratie n'a pas
percé dans la population. 80 pour cent des colombiens
considère qu'il existe un conflit armé, et 60 %
croient qu'il existe, soit la guerre ou bien une violence généralisée.
Ces réponses ne doivent pas surprendre, parce que presque
la moitié des enquêtés disent avoir été
victime d'une certaine forme de violence en rapport direct avec
le conflit.
L'impact des crimes est
dramatique dans les zones rurales, où 45% affirment qu'un
proche parent ou voisin a été assassiné.
Dans les villes intermédiaires, 40 % des personnes ont
rendu compte d'un meurtre dans leur environnement en raison de
la violence, et l'on descend à 20 % dans les grandes villes. Dans
les villes intermédiaires et les grandes agglomération,
la menace des Farc est les plus fréquente, et dans les
villes intermédiaires ce sont les paramilitaires. Indépendamment
à ce qu'ils vivent à la campagne ou à la
ville, 61 pour cent des enquêtés conviennent que
le conflit a négativement influencé leur quotidien,
basculant leur vie dans plus d'incertain, en limitant les possibilités
de déplacement, affectant les salaires ou des opportunités
d'emploi.
Cependant, les mesures
que les colombiens - aussi bien les urbains que les ruraux -
considèrent comme prioritaires pour atteindre la paix,
ne sont pas évidentes : ils ne pensent pas que les outils
principaux passent par l'action militaire, ni dans les négociations
de paix. Au contraire, ils considèrent comme priorités
d'augmenter le nombre d'emploi et de réduire la pauvreté,
combattre la corruption et donner une espérance aux jeunes.
En ce domaine, on souligne la nécessité de plus
soutenir les déplacés (ou réfugiés
du conflit). Négocier avec la guérilla se trouve
à la 10éme place parmi 15 options.
Cette réponse est
cohérente avec les suivantes : bien que plus de la moitié
des enquêtés considèrent que dialoguer avec
le Farc puisse être "utile" ou "très
utile" pour obtenir la paix. 60 % considèrent qu'entamer
maintenant une négociation est "peu possible",
voire "impossible". L'enquête n'approfondit pas
les raisons de tant scepticisme, mais il n'est pas difficile
de les deviner. Notamment, quand on décèle comment
ils perçoivent les groupes armés : plus de la moitié
estime qu'aussi bien les guérillas, que les paramilitaires
cherchent avant tout à enrichir leurs chefs et eux-mêmes
; pour 30 % et 28 % des réponses, ils s'attaquent à
la population civile, protègent et/ou prennent part aux
narcotrafics et s'accaparent les ressources locales et les biens
publics. Seulement 2,25 % pour cent croient dans le discours
de la guérilla à vouloir un meilleur pays, et ce
pourcentage se réduit à un peu moins de la moitié
de bonnes intentions pour les paramilitaires.
L'enquête révèle
une autre donnée curieuse en ce qui concerne le gouvernement
: sauf en ce qui concerne les politiques de sécurité,
une avancée vers la paix et le combat contre le narcotrafic,
où sa gestion est approuvée par 30 à 32
% des opinions. Dans
les autres domaines Uribe se fissure. Dans la lutte contre la
pauvreté et le chômage les opinons sont négatives,
seulement 25,7 % approuvent, et y compris concernant l'application
de la Constitution Politique, qui n'arrive qu'à 29,7%.
Ceci, clairement, n'empêche pas que presque 60 pour cent
des enquêtés d'affirmer qu'ils voteront pour sa
réélection. Une donnée curieuse : ceux qui
sont considérés comme victimes des Farc attribuent
à Uribe cinq des points de plus que ceux qui sont considérés
victimes des armées d'autodéfenses (AUC, paramilitaires,
extrême droite).
Que cela signifie
t'il ?
Les chercheurs qui ont
effectué l'étude arrivent à plusieurs conclusions.
Mais les réponses les plus importantes sont celles qui
ont un lien direct avec le débat électoral, dans
la perspective des présidentielles.
La première
est que l'électorat souhaite que les futurs dirigeants
donnent la priorité à la lutte contre la pauvreté
et à la lutte contre la corruption. Vu d'ici, dans la
présente campagne électorale, tous alignés
les groupes électoraux sont en accord avec l'intervention
par voie militaire, négocier la paix et le lieu est probablement
équivoque, a déclaré Carlos Nasi, directeur
du département de science politique de l'Université
de Andines Indepaz. Les candidats doivent se montrer plus ouverts
à négocier avec les guérillas que l'actuel
gouvernement, mais à la fois être très prudent.
De fait, selon lui, l'information révélée
par le site www.votebien.com, la majorité des candidats
semble en phase avec les demandes de l'opinion publique. À
l'exception d'Alvaro de Leyva, qui considère que le problème
numéro un de la Colombie reste la guerre, et Rodrigo Crique,
qui croit que c'est un raccourci de notre vision des problèmes,
comme ceux qui considèrent la pauvreté et l'inégalité
comme des priorités.
Aussi, il existe d'autres
conclusions complémentaires. Camilo Gonzalez Posso, président d'Indepaz,
conclut à une similitude des perceptions, au sujet des
alternatives comme des solution au conflit armé au sein
de la population rurale et urbaine, ils aident à réviser
les analyses et les programmes politiques dans la recherche de
la paix, ils s'adressent unilatéralement à ce domaine
et prioritairement aux aspects militaires ou pour de possibles
négociations avec la guérilla ou les paramilitaires.
Il ajoute que l'impact du conflit dans les villes requiert des
réponses simultanées, qui vont de la sécurité
individuelle à la création d'emploi, aux investissements
sociaux, à une saine gestion, par une réforme rurale
et agricole, jusqu'à la dimension de la"tranquillité
citoyenne", qui elle est placée comme la première
obstruction vécue en raison du conflit.
Angelika Rettberg, directrice
du programme d'investissements pour la construction de la paix
au sein du département de science politique de l'Université
Andines Indepaz, remarque l'importance pour 80 pour cent des
colombiens, quand ils déclarent que la participation citoyenne
est une clef pour obtenir la paix ; et 80 % affirmant être
disposés à recevoir dans son voisinage ou dans
son entreprise un déplacé, et de même qu'en
moindre proportion un démobilisé d'un groupe armé. Cependant,
il y a à prendre en compte les urgences et respecter les
difficultés que peut poser le fait que les colombiens
ne considèrent pas le conflit armé comme la priorité
numéro une du pays. Ils ont développé un
modus vivendi pour s'adapter aux conditions de la violence. Ce
modus vivendi, en même temps qu'un outil nécessaire
de survie, est en soit une des principales barrières qui
se dresse, qui questionne et se trouve en rupture pour avancer
vers une paix établie, nous a t'elle déclarée.
Débattre des résultats de cette enquête est
déjà un bon premier pas.
Sources
: http://www.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=92838
Traduction
libre : Samuel
Viscardo (le 8 mars 2006)
|
|
|
| |
| |
|
Simon Bolivar,
Francisco de Miranda,
Simon Rodriguez,
...
Les mousquetaires de l'Amérique
Lionel
Mesnard,
le 9 mars 2006
Latine..
ci-contre
: Francisco de Miranda
|
|

|
|
J'avoue que je me suis
moqué un peu de la présence répandue du
nom de Simon Bolivar au Venezuela. Cette sanctuarisation était
d'autant plus compréhensive, que la capitale (Santiago
de Leon de Caracas) fut le lieu ou grandit le jeune Simon Bolivar
et d'autres illustrissimes vénézuéliens.
Sans vraiment m'en rendre compte, je parcourus régulièrement
la route qu'empruntait chaque jour sa mère pour se rendre
à la messe, de la maison paternelle à la cathédrale,
non loin de l'ancienne prison militaire de San Carlos.
Les différentes
représentations de Simon Bolivar m'agaçait, il
apparaissait souvent en uniforme avec des airs de Bonaparte sur
le pont d'Arcole. Un
souvenir d'une peinture d'écolier le représentant
tel quel, rien de plus et de très révélateur.
Je dois aujourd'hui reconnaître que je faisais là
une impasse qui confinait à l'absurde. Surtout, je passais
à côté de l'essentiel, et ce qui unit nos
deux peuples depuis la bataille de Valmy (1792), dans la bravoure
de Francisco de Miranda. Qui est devenu en raison de son courage
sur ce champ de bataille, général de brigade au
service de la 1ère République française
et des armées du Rhin jusqu'en 1793. Il conserve son nom
gravé sur l'Arc de Triomphe de Paris, suite à une
décision de Louis Philippe en 1836 (fin de l'achèvement
des travaux du monument). On peut y voir pied de nez aux Bourbons
de la part d'un Orléans (du fils du dit Philippe Égalité
qui vota la mort de Louis XVI). Pour Napoléon Bonaparte,
Miranda ne fut pas tendre au sujet du tyran français.
Il n'est pas l'unique étranger immortalisant la participation
de non-nationaux à la révolution et à la
Convention de 1792. Miranda et Bolivar sont indissociables, du
moins complémentaires. L'un est le précurseur,
le second le libérateur de 300 ans de domination de la
couronne d'Espagne en Amérique Latine. .
L'un et l'autre en fin
de leurs études secondaires partent de Caracas en direction
de l'Europe. Débarquement à Cadix. Leurs premiers séjour commencent
à Madrid. Miranda vers 1770 s'incorporera dans un régiment
comme capitaine, le second viendra suivre des études de
mathématiques, un peu de formation militaire et rencontrera
son épouse Thérèse en 1799. Ils ont pour
point commun une carrière militaire, pour exemple Simon
Bolivar à 15 ans est déjà sous-lieutenant,
et se fera remarquer pour ses prouesses équestres et sa
très grande résistance physique. Miranda prouvera
rapidement à l'aune de sa longue carrière d'arme,
des capacités importantes sur les champs de bataille,
une première illustration en Afrique du Nord, qui lui
vaudront aussi ses premiers déboires. Il ne sera pas reconnu
à sa juste valeur et cela provoquera chez le jeune capitaine
un agacement certain, puis ce qui lui vaudra une rupture progressive
avec l'Espagne. Il deviendra au fil du temps un agent de renseignement
auprès du futur premier ministre anglais William Pitt.
Une anglophilie que partagerons nos deux caraquéens.
La distance du pays natal
fait prendre conscience à nos deux jeunes hommes, le rôle
et l'importance du savoir, de la lecture et aussi des écrits. Ils apprendront ainsi à
maîtriser l'anglais et le français. Si la prise
de conscience politique de Bolivar est relativement précoce
à l'âge de 22 ans, Miranda est plus tardif, c'est
vers 30 ans qu'il suivra sa destiné si particulière,
qui le mènera à traverser de part en part l'Europe,
et l'Amérique du Nord au service d'un esprit nouveau.
C'est à dire révolutionnaire et démocratique.
Contrairement à Simon Bolivar, il ne reviendra pas au
Venezuela avant la cinquantaine bien sonnée, il attendra
quarante ans avant de remettre les pieds sur sa terre natale.
À partir de 1799,
le jeune Simon séjourna principalement en Espagne. Il
se mariera et retournera à Caracas à la fin de
1802, il fera deux séjours courts en France (en 1801 avec
sa future épouse et en 1802 dans le sud de la France,
pour des raisons militaires, au sein d'une garnison espagnole). Le déclic libérateur
n'est pas encore né, et il semble vouloir reprendre les
traces de son père au sein de l'aristocratie créole
vénézuélienne, ancien colonel des troupes
de Caracas. Mais il perd en 1803, sa jeune femme Thérèse,
elle décède suite à une maladie. Un déchirement
intérieur qui le pousse à ne pas abdiquer devant
le malheur et la peine. Il part à nouveau pour l'Europe,
plus exactement il sera à Paris en mai 1804. Il prend
une suite au sein de l'Hôtel des Voyageurs (rue
Viviène, Paris 2ème arrondissement) et pendant
quelques mois, il va se changer les idées. Il mènera
un train de vie dispendieux et rencontrera les arcanes d'un Paris
festif et salonnard.
Puis intervient la rencontre
clef vers septembre 1804, Bolivar se promène dans les
rues et ruelles parisiennes grouillantes de vie, et qui devine
t'il au loin, un compatriote et pas n'importe lequel : Simon
Rodriguez. Ce dernier
se demande, mais quel est donc ce dandy qui m'interpelle, avant
de reconnaître son ancien élève. Simon Rodriguez,
alias Samuel Robinson fut son précepteur un très
court temps (environ 2 mois), quand Bolivar n'avait que 14 ans
et se trouvait à Caracas. Ils vécurent quelques
temps sous le même toit, en raison des réactions
très impulsives de l'adolescent face à l'autorité
de son tuteur légal. Il est probable qu'il a trouvé
une écoute bienveillante et a profité dans ce cours
laps de temps de l'esprit libre de son maître à
vivre et à penser. Une rencontre utile à Simon
Bolivar pour trouver après des années de souffrances
intérieurs et de révoltes à l'égard
des adultes, un chemin moins chaotique. Notamment un désamour
qu'il manifestait presque à tous, sauf pour sa nounou
Josefina. Qu'il considéra comme son « seul père
» (disparu à ses 3 ans et sa mère à
9 ans) et pour sa grande soeur Maria-Antonia, qui ne pourra pas
avoir la garde de son petit frère, en raison de l'intransigeance
de son tuteur. Le jeune précepteur, Simon Rodriguez au
sein des établissements scolaires souhaita modifié
certaines règles d'éducation et se heurta à
un refus de son administration, qui lui répondra un an
après sa demande. Il démissionnera et sera amené
très rapidement à prendre l'exil pour l'Europe,
en raison de son implication dans un soulèvement contre
la tutelle espagnole. Ils se retrouveront huit ans plus tard
et loin de leur patrie commune « Caracas ».
Simon Bolivar éprouva
une certaine lassitude et ne pouvait vraiment se satisfaire de cette
vie parisienne et mondaine. Face à un certain ennui, vint le besoin de trouver un absolu. Rapidement,
il tourna le dos aux fanfreluches et s'en alla co-habiter avec
Samuel Robinson rue de Lancry (Paris, 10ème arrondissement).
On devine un peu les conversations et la différence d'âge
d'une dizaine d'année, faisant des 2 hommes de quasi frères.
De longs débats agités et aussi des lectures commentés
par nos deux compères. Il y aussi une figure paternelle
qui manque au plus jeune, et un besoin de protection maternelle.
Il y a la matière à penser et une sorte de cocon
qui va permettre de constituer la chrysalide. Le papillon Bolivar
s'envolera à Rome en 1805 (serment de Bolivar pour la
libération des Amériques espagnoles). Après
des semaines d'études sans relâche, Simon Rodriguez
pensa qu'un peu de repos était plus que nécessaire. Ils
partirent d'abord sur les traces de Rousseau, puis se rendirent dans
la ville la plus chargée d'histoire en Europe, Rome. On
parle souvent de l'exaltation de Simon Bolivar, de son côté
enflammé, certes, possiblement, mais il fut probablement
plus dans une approche propre de son destin et de ses racines,
qui en France en fit un sujet au goût d'exotisme.
Impossible de résumer
en deux lignes les différences fondamentales de ces américains
latins ou se mélange l'imaginaire des amérindiens
et de la négritude.
Le terme qui soit le plus à même de définir
l'espace culturel vénézuélien est la créolité.
Les mondes créoles ont pour espace les caraïbes et
renvoient à différents modes de colonisation (français,
anglais, hollandais, suédois, portugais et espagnols). Au 18ème
siècle au Venezuela, se distingue deux types de créoles
(les mantuanos et les péninsulaires), d'ou proviendront
Bolivar et Miranda. Justement, il y a les 2 mondes qui se font
concurrence et faisait que les vieilles familles aristocratiques
de Caracas (les mantilles ou mantuanos) dominaient, notamment les
vagues successives de migrations, que l'on nomma « péninsulaire
», et concernent entre autre les originaires des Iles Canaries.
C'est le cas et l'origine natale de Sébastien Miranda,
père de Francisco, c'est un commerçant qui s'installera
dans les caraïbes et épousera une caraquéenne
vers 1740. Il deviendra rapidement à l'aise dans son négoce
du drap. Il sera mis au ban de la bonne société
de Caracas, quand il sera nommé capitaine selon la légende. Dans la même trâme, ce qui marqua
Francisco et lui donnera l'envie de partir courir le monde. Les
antagonismes forts, l'on n'aimaient pas trop ces canariens
ambitieux.
Depuis le 16ème
siècle et la fondation de Santiago de Leon de Caracas
(1567), c'est un tout petit monde qui investit sous la conduite
de la couronne espagnole la conquête de la Petite Venise
(étymologie du mot Venezuela) environ 5000 personnes d'origine
européenne, puis suivront 10.000 esclaves noirs, pour
350.000 amérindiens. Le
royaume d'Espagne est sous l'emprise de l'Inquisition, et les
bonnes familles ne doivent avoir aucune origine juive ou maure.
Sinon, ils ne peuvent prétendre à un grade d'officier
ou avoir des responsabilités dans l'administration castillane,
et mieux vaut avoir une ascendance noble ou une bourse bien fournie
pour réviser les arbres généalogiques. Simon
Bolivar est un pur produit de cette petite aristocratie hispanique.
Son aïeul, Simon 1er de Bolivar fait parti des fondateurs
de la capitale vénézuélienne. Son arbre
est très révélateur d'une mélange
d'origines assez diverses et pas seulement espagnoles. Il y aurait
eu toutefois un peu de sang se mélangeant, donnant un
teint plutôt mat, un regard noir et des cheveux bruns et
crépus à Simon, héritier d'une longue lignée
de propriétaires terriens et miniers.
La concentration du pouvoir
en Espagne est un fait, et la couronne se préoccupait
à la fois du spirituel (la sainte inquisition), du politique
et de l'économique. C'est
certainement la cours la plus rigide ou figée que l'on
trouve en Europe, il faut attendre Charles III (vers 1750) pour
s'ouvrir un peu aux Lumières du temps. Et encore trop
tardivement, comme a pu le pré-sentir le ministre Grimaldi
au moment de la signature du Traité de Paris en 1763.
Le Venezuela dénombre en cette moitié du 18ème
siècle environ 800.000 habitants, et entre 20.000 et 45.000
résident à Caracas. La petite colonie a grandi,
et déjà plus de la moitié du pays est un
mélange des trois « races » (indiennes, noires
et blanches).
Les idées et livres
de l'époque trouvent plus de place de l'autre côté
de l'atlantique que les chez les Bourbons d'Espagne. Même le père de Simon
Bolivar dispose de livres et d'une bibliothèque d'auteurs
pas obligatoirement en odeur de sainteté pour l'Inquisition.
Il faut dire qu'à huit mille kilomètres et sous
un climat tropical, la vie est au demeurant plus douce. Chez
les créoles d'alors l'idée d'autonomie gagne peu
à peu du terrain. En soit l'Histoire n'a pas d'exemple
de répétitions propres, mais on ne peut pas comprendre
pourquoi à partir de 1810 sur le tout le continent vont
apparaître toute une série de nations nouvelles
sur les ruines de l'Empire espagnol. Une insoumission qui du
Chili au Venezuela va sonner comme un clairon.
Pourquoi quelques précurseurs
et l'on ne peut se limiter à Miranda pour en comprendre
les racines, vont semer un vent de liberté ? Hasard des temps, il n'en est
pas, le système et ce que représente l'Espagne
s'écroule comme un château de cartes. Il lui était
impossible de maintenir l'unité d'un territoire si large
avec une telle rigidité et férocité. Pour
exemple, l'existence du mot Caudillo, qui était le plus
souvent un militaire exerçant sur un territoire une autorité
du même ordre et pour son propre bien et celui de la couronne.
La cassure s'engagera avec l'extradition des jésuite d'Amérique
du Sud (vers 1760). Leur prospérité et leur bonne
entente avec les populations autochtones ne plaisaient pas aux
autorités légales et aux mantuanos. Guzman-Viscardo,
jésuite exilé en Italie rédige en 1792 une
lettre qui pose les termes d'une libération de l'oppression.
Miranda reprendra à son compte cette «lettre aux
américains espagnols», en faisant édité
en 1798 un texte qui engage les fondations de ce mouvement de
libération de la tutelle castillane.
La vie de nos compères
est un roman, et même il y a de quoi en faire une épopée.
Miranda est le plus surprenant, un certain attrait pour les masques
ou les identités diverses, jusqu'à se costumer
et se fit un peu trop remarquer lors d'un passage entre la France
et l'Angleterre. Il
va s'avérer être une diplomate et un courtisan hors
pair, c'est ainsi qu'il commencera auprès de Catherine
de Russie. N'importe quel auteur qui a pu travailler sur Miranda,
ne peut que clamer son intelligence et sa capacité à
convaincre ses auditoires. Prouesse, qui lui permettra d'échapper
à l'échafaud. Le Géneral Dumouriez, qui
fut son chef et responsable des armées du Nord, lui tendit
en Belgique en 1793 quelques traquenards. Qui mirent Miranda
dans l'obligation d'abandonner certaines positions au profit
de l'ennemi. Il fut suspecté à Paris de coalition
avec l'ennemi. Avec pour avocat celui de Marie Antoinette dit
« Madame Capet », il a semble t'il senti le couperet
passé pas loin. Il avait prévu suite à son
arrestation une fiole de poison, au cas ou on le condamnerait.
Surprise en pleine période de la terreur, notre échappe
homme à la mort et il est acquitté. Il démonta
point par point la machination que lui avait tendu Dumouriez.
Miranda le doit certainement
à des talents d'orateurs, surtout pour une personne dont
la langue maternelle n'est pas le français. Il le doit
aussi à une droiture d'esprit, on a voulu un peu en montrer
le côté libertin ou scandaleux de la personne.
Si on lit la correspondance entre Brissot et Miranda, on comprend que
la France républicaine a raté de peu de chose l'éveil des nations
latino-américaines. Et le général Dumouriez a saisi que la personne de
Miranda lui faisait de l'ombre à ses manoeuvres. Il fit en sorte de
traîner face aux demandes de Brissot de constituer un corps
expéditionnaire aux Antilles, dont Miranda aurait pu être le chef
militaire et politiique. Au moment ou se lance la Convention en 1792,
l'Assemblée disposait d'un fort point d'ancrage avec la Gironde,
qu'elle perdit rapidement en 1793. Miranda appartenait à cet esprit
girondin et républicain et a connu de l'intérieur les prisons
parisiennes de la Terreur. Par ailleurs, il fut aussi franc-maçon comme
beaucoup d'autres. Il a été surtout le créateur d'une loge Américaine
où l'on retrouva tous les protagonistes des révolutions sud
américaines, Simon Bolivar inclus.
Miranda a eu maille à faire
avec beaucoup de résistances et il a cherché auprès
des anglais, des étasuniens, des français un appui
à son combat. En
fait, il le trouvera à Haïti, tout comme son compatriote
Bolivar. Ils connaîtront le soutien d'Alexandre Piéton,
et ce qui fut la première République noire
du monde, en 1804. La même année où Simon
foulait à nouveau le sol de l'Europe, Haïti devenait
indépendante, et en 1815, Pétion président
est à nouveau là pour soutenir cette idée
d'une Grande Colombie. De prime abord on imagine pas le rôle
de cette île de nos jours coupée en deux, avec d'un
côté la république dominicaine et de l'autre
la république haïtienne. D'une part, Saint Domingue
est un axe, une route maritime obligatoire depuis Christophe
Colomb entre les deux continents. D'autre part comme ancienne
colonie française, ce fut un pays fleurissant et c'est
au sein de la société métisse et noire, que
s'affirma là aussi une volonté révolutionnaire,
trop méconnue. Haïti l'indépendante est la
terre d'où est partie la bannière bleu, rouge et
or du Venezuela et de la Colombie, le 12 mars 1806. Les différentes
incidences révolutionnaires qui interviennent à
la fin du 18ème siècle, la guerre d'indépendance
qu'engageront les Etats Unis face à la puissance britannique,
puis la révolution française, sera suivie par l'indépendance
Haïtienne, qui elle ouvrira la route au Venezuela libre.
Et nos trois vénézuéliens
reflètent bien les trois sociétés, un bourgeois
aux airs très aristocrates que fut Miranda, le «errant solitaire» que fut Rodriguez, et le noble Bolivar
qui donna corps et âme à la libération du
Pérou, de la Bolivie, de l'Equateur, et à ce qui
fut jusqu'en 1830 la Colombie (ou 10 fois l'équivalent
de la France en taille). Miranda a
passé sa vie à se déjouer des pièges
que l'on a pu lui tendre, il a fini par se retrouver au cachot
pour finir de difficiles vieux jours. Le Quichotte « sin
locura » (sans folie) que fut Miranda n'a pas d'équivalent. Le
danger est de savoir avant les autres et de sentir les changements
à venir. Il reste
encore de nos jours un personnage sans réel équivalent.
Et plus modestement de même pour Simon Rodriguez, qui est
par deux fois la conscience éclairée du jeune Bolivar.
Il faut souligner que nos trois personnages vénézuéliens
sont une peu comme les trois mousquetaires, il en existe un quatrième.
Andres Bello, père de la pensée humaniste latino
américaine, lui aussi natif de Caracas, il fut aussi le
professeur de Simon Bolivar.
On peut se demander, mais
pourquoi une si petite ville va porter autant de génies
universaux en si peu de temps?
Pourquoi ce pays a été le centre d'une attention
particulière sur les deux continents pendant de longues
années, et comme par enchantement le Venezuela est redevenue
terre inconnue ou trop lointaine? La perte d'influence
de la France aux Amériques fut marquée par la perte
du Canada en 1763, puis par la cession de la Louisiane en 1803,
et l'indépendance d'Haïti en 1804, Ce qui ne permit
plus à notre pays l'exercice d'un rôle prépondérant
dans cette région du monde. De plus, il ne laissera pas
un bon souvenir ni à Miranda, qui gardera une médiocre
opinion d'un pays qui se livre au pouvoir d'un seul homme (Napoléon
Bonaparte). Pour Bolivar, il fit comme son aîné
et alla voir en 1806 si les anglais n'étaient pas mieux
disposés à l'écouter, avant de traverser
l'atlantique et se rendre aux États Unis en 1807 pendant
3 mois, puis pour revenir au pays et engager le combat au côté
de Miranda peu d'années après.
|
|
|
| |
|
|
|
|
Passage
des Andes,
vous
avez dit chef d'oeuvre cinématographique?
Lionel Mesnard,
le 16 février 2006
|
|
|
|
Passage des Andes, est
un film collectif de l'École de Cinéma Populaire
Latino-Américaine, il a été réalisé
sous la direction de Thierry Deronne, (Vice-président
de Vive Télévision, sise au Venezuela). Oui, il
faut parler d'une oeuvre, si pour le moment j'ai du me satisfaire
de découvrir ce film en DVD. Sa place est dans les salles
de cinéma, c'est-à-dire sur un grand écran,
et soit connu du plus grand nombre.
Il est important de souligner
que je m'engage rarement dans la critique d'un film. Pour évidence
est la raison d'un rapport peu évident face à une
oeuvre d'auteur accomplie, chacun peut y puiser sa part de rêve,
et en l'état éveillée et en toute lucidité.
Je n'avais pas eu ce
genre de plaisir depuis longtemps et je dois avouer que j'ai
ces dernières années un peu déserté
les cinoches. Pour autant, il ne s'agit pas de s'appesantir sur
le déclin du cinéma, parce que justement Passage
des Andes est un retour du 7ème art. Certes ce film
n'est pas simple au premier abord, il peut faire fuir ceux qui
chercheront un énième standard hollywoodien. Si
Thierry Derrone est d'origine belge, il est en soit un «
mutant » ou l'écho de la majestueuse cordillère
des Andes. Il est un auteur engagé, mais il ne tombe pas
dans le misérabilisme de la propagande. Cet homme a depuis
longtemps épousé cette terre du nouveau monde et
son imaginaire. Et, il très difficile de restituer un
flot d'émotions, d'âmes et se sentir partir dans
les nuages tout à la fois. Je pense depuis pas mal de
temps que la réalité est souvent plus belle que
la fiction, et pourtant là les deux se mélangent
et c'est tout bonnement sublime.
Passage des Andes est un
documentaire de fiction (67 minutes), qui vous porte au croisement
de deux routes, et de deux révolutions. Plus exactement, nous plongeons dans les deux grands
réveils de l'Amérique Latine. Celle du temps de
Simon Bolivar au 19ème siècle et celle d'aujourd'hui.
Voilà, ce que je puis apporter comme indices à
votre curiosité. Je n'ai pas l'intention de commenter
un travail qui mériterait une connaissance quasi encyclopédique
du cinéma, et je préfère vous renvoyer à
l'entrevue mené par Maxime Vivas auprès du réalisateur
de ce film (1). A noter, que Thierry Deronne
a aussi réalisé (en 2004) au sein de Vive télévision
une série de leçon sur le cinéma (une dizaine),
et que ce travail reste pour le moment inédit en Europe.
Néanmoins, vous pouvez sur le site de Zalea Tv visionner
une vidéo de cet auteur talentueux, et à découvrir
absolument (2).
Si révolution, il
y a, elle se mesure principalement à la place que l'on
accorde à la culture et à sa transmission. Et il
importe de viser des objectifs de très grande qualité,
promouvoir une culture populaire qui ne se confond pas avec du
folklore. Thierry Deronne
nous transmet toute cette fraîcheur, il pose très
haut cette exigence, et ouvre tout simplement la voie à
d'autres auteurs sur un regard universel des choses. On a trop
longtemps méprisé ces gens un peu hors des conventions,
ces révolutionnaires latins que l'on croyait d'un autre
âge. Pourtant ce mouvement historique et populaire né
à la fin du dix-huitième siècle n'a jamais
vraiment quitté l'esprit de tous les américains.
Et au final, je finis par m'interroger sur le vol ou le détournement
opéré par la révolution bourgeoise de 1789,
du côté de la Bastille ?
Karl Marx, lui même
n'a pas vraiment compris qui étaient ces hommes d'outre
atlantique, il décrira Simon Bolivar (1783-1830) sous
les traits d'un nouveau Napoléon Bonaparte (lettre à
F. Engels, 1858). Certes
Francisco de Miranda (1750-1816) et Bolivar ont livrés
de nombreuses batailles, mais ce fut pour la liberté des
peuples à disposer d'eux mêmes et en ces temps la
révolution ne se vivait pas en spasme nationaliste, productiviste
ou religieux, il était au service d'un seul et même
universel et sur des bases authentiquement républicaines
et sociales. Le rêve de la grande Colombie de Simon Bolivar
était un objectif d'émancipation allant de la Paz
au Panama, sur les décombres de l'héritage colonial
hispanique. Ce qui peut étonner, c'est que cette même
unité d'esprit refasse jour de nos jours, soit pour tout
internationaliste bienveillant une nouvelle étape à
franchir qui passe par l'intégration latino américaine.
Et la route que nous ont ouverte les vénézuéliens,
les brésiliens, les argentins, les boliviens et demain
d'autres nations latino-américaines, nous rappelle un
chant bien de chez de nous « (...) debout les forçats de la faim, la raison
tonne en son cratère (...)».
Notes :
(1) A lire sur le site RISAL www.risal.collectifs.net/
(2) TELETAMBORES
: Proposition pour une télé libre, de Thierry Deronne
(2002)
|
|
|
|
| |
| |
À
la rencontre du mouvement populaire du Venezuela :
Le développement
social au coeur
du processus bolivarien
Pierre BEAUDET, le 9 février 2006
photo : http://www.abn.info.ve
|
|

|
|
|
|
|
Pour la plupart des
Québécois et des Québécoises, le
Venezuela était jusqu'à récemment associé
à l'image touristique de l'île Margarita !
Mais à Québec en avril 2001, nous avions observé
qu'Hugo Chavez était le seul chef d'état à
s'opposer à la ZLÉA. Puis, des militants et des
militantes de chez nous sont allés sur place et des companeros
et des companeras nous ont également visité. Peu
à peu s'est développée parmi nous une conscience
qu'il « se passait » quelque chose là-bas.
Aussi dans le cadre du FSM « polycentrique »
de 2006 à Caracas, plusieurs d'entre nous ont pensé
que c'était une excellente occasion d'en savoir plus.
Des rencontres ont été organisées pour faciliter
les liens avec des organisations du Venezuela. Et à travers
ces dialogues, nous avons appris des militants syndicaux, des
féministes, des animateurs du mouvement urbain, des enseignants
et des enseignantes, des intellectuels et bien d'autres acteurs
qui contribuent à construire le mouvement populaire dans
le contexte de grands bouleversements. Certes en quelques jours,
nous avons à peine effleuré la dynamique complexe
qui traverse ce pays d'Amérique du Sud. Mais avec ce qu'on
nous a présenté comme perspectives intéressantes,
lucides, critiques, constructives, nous avons conclu qu'il y
avait des pistes où développer des relations de
coopération et de solidarité à long terme.
Pour continuer cette exploration, j'ai donc écrit cinq
petits reportages pour couvrir quelques aspects du processus
en cours :
- Les enjeux du
développement social
- Le Venezuela dans la tempête, introduction
sur le contexte politique
- L'évolution récente du mouvement syndical
vénézuélien
- Le Venezuela au moment où le vent de changement
pousse fort dans l'hémisphère
- Le Venezuela et le FSM dans le contexte du FSM « polycentrique »
à Caracas en janvier dernier.
Pour ce faire, j'ai
été alimenté tout au long par beaucoup de
personnes avant, pendant et depuis Caracas. J'assume quand même
le texte et toutes les erreurs et omissions qui vont avec !
Voici donc le premier
reportage.
La pauvreté dans
un pays riche
Les turbulences qui traversent
le Venezuela aujourd'hui ne datent pas d'hier. Des confrontations
ont eu lieu et dans les années 1980, tout a déboulé.
En 1989, de graves émeutes avaient lieu à Caracas
et certaines villes de provinces. En gros, les pauvres disaient
« basta » à un régime qui
les volait tant par la corruption des élites que par l'imposition
des politiques néolibérales. Fait à noter,
le Venezuela qui est un pays très riche est habité
par des pauvres. 48% de la population vit avec moins de deux
dollars par jour. Selon la Banque mondiale, les 20% plus riches
reçoivent 53% de tous les revenus pendant que les 20%
plus pauvres doivent se contenter de 3% des revenus. Or ces pauvres
sont largement « invisibles » dans la grille
de l'économie ou du pouvoir. Ils sont dans le secteur
dit « informel ». Ils n'ont pas accès
aux services sociaux, à la santé, à l'éducation,
contrairement aux classes dites moyennes qui étaient,
du moins jusqu'au début des années 1990, assez
confortables.
Changer de cap ?
Ce sont évidemment
ces couches populaires qui se sont mobilisées avec et
pour Chavez et son projet bolivarien. Aujourd'hui, le gouvernement
proclame être engagé dans une « lutte
à mort » contre la pauvreté et l'exclusion.
Une quantité énorme de nouveaux programmes ont
été mis en place, ce qui témoigne du volontarisme
de l'État et aussi des initiatives de la base. Et selon
le gouvernement, le pourcentage de la population pauvre est en
déclin. Décidément, le pays est en train
de changer, mais bien des questions se posent sur l'ampleur et
la pérennité du processus. Pour le moment grâce
aux prix élevés du pétrole, les indicateurs
macro-économiques sont positifs, mais cette situation
pourrait changer. En tout cas, le gouvernement Chavez a choisi
de redistribuer cette richesse vers les gens. Ainsi de 1999 à
2004, les dépenses du gouvernement sont passées
de 19% à 31% du PIB. En conséquence, les indicateurs
sociaux s'améliorent. Le taux de chômage officiel
(qui n'indique pas toute la réalité parce qu'il
ignore le secteur informel) est passé de 20 à 14%
en quatre ans.
Réforme agraire
Les initiatives du gouvernement
affectent tous les secteurs. Dans le monde rural, le projet de
réforme agraire en cours a commencé à redistribuer
les terres du domaine public et pourrait s'étendre aux
terres privées. À date, 2,8 millions d'hectares
ont été distribués à environ 130
000 familles. Selon le gouvernement, l'agriculture pourrait être
un secteur prioritaire, car à date seulement 25% des terres
cultivables sont effectivement exploitées et 70% des aliments
sont importés, essentiellement des Etats-Unis et du Canada !
5% des exploitants agricoles détiennent 80% des terres
cultivables. Les petits paysans se partagent 6% des terres par
ailleurs.
Une ville pour tout
le monde
Dans les zones urbaines
où vivent plus de 80% des 26 millions de Vénézuéliens,
la majorité de la population habite les bidonvilles, les
barrios où les infrastructures sont diminuées et
où le statut des habitants n'est pas légalisé
la plupart du temps. Aussi, une des priorités du gouvernement
est de formaliser l'occupation, ce qui permettra aux habitants
de sécuriser leur maison et aussi de capitaliser. De manière
générale, le gouvernement encourage la mise en
place de « Comités de tierras urbanas »
(CTU -comités de terres urbaines), qui doivent en principe
gérer ce transfert de propriété par groupe
de 100 ou de 200 familles. À date, plus de 500 000 personnes
ont ainsi régularisé leur situation légale
en devenant formellement propriétaires de leurs maisons.
Entre-temps, le gouvernement investit dans les infrastructures
urbaines et le logement, mais les besoins sont immenses. Il manque
au moins 150 000 logements à prix modiques pour abriter
la population qui ne cesse d'affluer vers les villes. Lors d'une
visite dans le barrio « La Vega » sur les
hauteurs de Caracas, les habitants du bidonville qui compte 32
000 habitants nous ont montré les nouvelles installations
médicales et éducatives, les projets d'agriculture
urbaine et d'autres réalisations concrètes. Mais
beaucoup reste à faire. Selon une des responsables du
CTU, le gouvernement tarde à remplir ses promesses d'assainir
le quartier et de construire des installations d'égout
adéquates. Entre-temps, les quelque 5000 CUT présents
dans le pays pourraient devenir un mouvement social structurant.
Le mouvement est en marche et s'est beaucoup renforcé
depuis la « grève patronale » de
l'hiver 2003 lorsque la population a été appelée
à confronter les pénuries de toutes sortes.
L'éducation,
un droit humain
L'éducation est
une des grandes priorités pour le gouvernement Chavez
et les améliorations sont visibles et reconnues par tous,
même l'opposition. En ligne avec la constitution dont l'article
10e reconnaît l'éducation comme un « droit
humain fondamental », le gouvernement depuis 2001
a augmenté le budget de l'éducation de 2,1% du
PIB à plus de 4,3%. Des milliers de nouvelles écoles
ont été construites, mais selon le ministère
de l'éducation, le programme en cours vise plus que le
béton. De la garderie à l'université, on
veut favoriser l'accès aux couches populaires, en visant
particulièrement 1,5 million d'enfants des quartiers et
des régions défavorisées. C'est là
qu'entrent en jeu les « missions » qui
sont en fait des programmes spéciaux et parallèles
et qui visent à briser le train-train bureaucratique en
concentrant des ressources vers les pauvres. Ainsi la Mission
Robinson se consacre à l'éducation primaire et
lutte contre l'analphabétisme en visant 1,3 million de
personnes de tout âge. La Mission Ribas pour sa part aide
700 000 jeunes à compléter leur cycle secondaire
à l'aide de bourses, d'enseignement à distance
et de stages en milieu de travail (70% des jeunes ne terminent
pas leur secondaire). Dans l'enseignement supérieur, la
Mission Sucre cible 350 000 jeunes par des bourses. Hugo Chavez
promet de mettre la totalité des enfants à l'école
d'ici 2010.
Avancées dans
la santé
Dans la santé, les
progrès sont également impressionnants. Dans les
barrios, des cliniques servies par des médecins et des
paramédicaux cubains (ils seraient plus de 10 000 dans
le pays !), rejoints depuis quelque temps par quelques professionnels
vénézuéliens qui au départ boycottaient
ces initiatives. Mais la santé, c'est aussi la nutrition.
Avec la Mission Mercal, 6000 « casas populares »
ont été mises en place pour desservir 1,5 millions
d'habitants des bidonvilles. Les aliments y sont vendus à
des prix de 30% inférieur à ce qu'on trouve sur
le marché « ordinaire ». La mission
Barrio Adentro par ailleurs aide à la réfection
des infrastructures, exclusivement dans les bidonvilles. Selon
le ministre de la santé, le docteur Roger Capella, « le
domaine social est considéré comme une dépense
alors qu'en réalité, c'est un investissement. Mais
cela n'est pas vue comme cela par les économistes traditionnels ».
Les femmes au coeur
de l'économie sociale
Selon Janie Vicunem qui
est une des responsables de la BANMUJER (Banque des femmes),
au Venezuela le développement de l'économie sociale
est vue comme une économie alternative où doivent
dominer les pratiques démocratiques et autogérées.
La BANMUJER bénéficie d'un important appui du gouvernement
vénézuélien qui désire développer
de nouvelles pratiques économiques incluant le micro-crédit
et la mise en place de petites et de très petites entreprises
familiales ou coopératives. Celles-ci se développent
à un rythme spectaculaire : de 800 à 30 000
en cinq ans ! Depuis sa fondation le 8 mars 2001, la BANMUJER
a appuyé 40 000 projets (des crédits en moyenne
$300 dollars canadiens sont consentis aux femmes), ce qui a généré
75 000 emplois. Selon Vickunen, la Banque offre plus que des
crédits en s'investissant aussi dans les projets et la
formation. De plus et pour rester proche du monde ordinaire,
la BANMUJER n'a pas de succursales au sens traditionnel, mais
opère à travers 149 centres communautaires.
« Le pouvoir
aux pauvres »
Les programmes de BANMUJER
incluent des activités de formation sur les droits des
femmes, sur la discrimination, sur les droits reproductifs, qui
reste un sujet tabou dans un pays où la tradition catholique
prédomine. Tout le terrain de l'économie sociale
est donc en expansion, mais faute d'expérience et dans
un environnement économique qui reste capitaliste, beaucoup
de projets échouent ou restent dépendants de l'aide
de l'État. Le « pouvoir aux pauvres »,
qui est l'un des slogans préférés de Chavez,
reste encore une utopie lointaine, ce qui n'empêche pas
les gens des bidonvilles d'avoir le sentiment que le gouvernement
est derrière eux lorsqu'ils s'auto-organisent. « C'est
une bataille de longue haleine, selon Janie : « nous
tentons de créer une économie au service des gens
et non des gens au service de l'économie. Nous ne construisons
pas une banque, nous construisons un autre mode de vie ».
source
: http://www.alternatives.ca/article2359.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colombie
:
1)
La propagande
des médias
concernant la guerre à la drogue
2) L'échec du processus
démocratique colombien
Par Garry
Leech
janvier
et février 2006
|
|
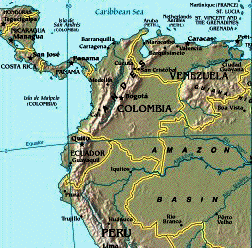
|
|
La propagande
des médias concernant la guerre à la drogue
La semaine passée
les correspondants des médias dominants basés en
Colombie ont servi la propagande de la soi-disant guerre à
la drogue menée par Washington dans ce pays sud-américain.
Après la mort le mois dernier de 29 militaires tués
par les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie
(FARC), le président Alvaro Uribe était décidé
à montrer aux Colombiens et au monde que son gouvernement
est en train de l'emporter dans le guerre civile et dans la guerre
à la drogue.
Cependant, pour que son message soit diffusé de façon
efficace, Uribe avait besoin de la collaboration des médias
internationaux. Pas de problème. Tout ce qu'il avait à
faire c'était de planifier une offensive anti-narcotiques
et de demander aux militaires un tour pour la presse [junket]
pour transporter les correspondants étrangers de Bogotá
à la zone d'opération. Inévitablement les
journalistes dorlotés allaient citer les officiers de
l'armée chargés de l'opération et allaient
présenter de façon favorable un aspect du problème.
Le 19 janvier l'armée colombienne a arrangé un
tour pour la presse pour les journalistes de Reuters et de Associated
Press pour aller couvrir l'éradication manuelle des plants
de coca dans le Parc National de La Macarena, dans le sud-est
de la Colombie. Les deux journalistes ont informé du lancement
de l'opération de façon complaisante bien qu'ils
ne fussent apparemment pas d'accord sur le nombre de troupes
impliquées (c'était 3000 soldats selon AP, et 1500
soldats et policiers selon la version de Reuters). Les deux articles
ne reportaient que le point de vue de l'armée colombienne
sur cette opération d,éradication de la plante
de coca.
Le lendemain, plus
de 50 publications dans le monde, y compris de nombreux quotidiens
états-uniens, ont rendu compte de ces deux dépêches
des agences. Le titre
impartial de Reuters était le suivant : « La
Colombie commence à nettoyer la coca le Parc National
». Le titre de la version AP cependant ressemblait
à un communiqué du gouvernement colombien ou de
l'ambassade états-unienne : « La Colombie se
réapproprie une région infestée par la coca
». A aucun moment dans ces deux articles aucun des
militaires qui a organisé le tour pour la presse [junket]
explique ce que le gouvernement fait, s,il fait quelque chose,
pour les quelque 5000 agriculteurs dont les moyens de subsistance
sont détruits. A aucun moment dans ces deux articles il
n,y a la moindre citation de propos émis par les paysans
qui sèment la coca. Cela pourrait aider le lecteur à
comprendre dans quelle mesure l,opération affecte les
paysans et leurs familles et ce que ces derniers pensent de l,opération
militaire. Et à aucun moment dans les articles il n,y
a la moindre citation des FARC, expliquant leur point de vue
sur l,opération militaire, supposée viser les sources
de financement de cette organisation insurgée.
Les tours pour la presse
[junkets] officiels, régulièrement organisés
par le gouvernement colombien et par l,ambassade états-unienne
sont un moyen pratique pour les correspondants basés à
Bogotá pour visiter les lointaines régions rurales
affectées par le conflit interne. Le problème, cependant, c'est que les journalistes
sont transportés pour passer quelques heures avec des
officiels qui leur offrent un article pré-emballé.
Inévitablement la ligne officielle s'impose dans le compte-rendu.
De leur côté, le gouvernement colombien et l'ambassade
des Etats-Unis sont parfaitement conscients de la situation de
dépendance totale des médias dominants quant aux
sources officielles. Ils tiennent donc régulièrement
des conférences de presse officielles et des officiers
sont utilisés pour les actes publics, comme par exemple
pour l'ouverture d'une nouvelle usine, ou à l'occasion
d'une nouvelle opération militaire. Les officiels du gouvernement
savent parfaitement que les médias couvriront ces actes
de façon disciplinée parce qu,ils permettent de
produire des articles convenables ; mais il y a peu de chances
pour qu'un officiel dise quelque chose qui ait la valeur d'une
nouvelle. Tous les correspondants étrangers basé
en Colombie se présentent souvent à ces actes pour
ne pas être le seul à ne pas rendre compte de la
« nouvelle », ce qui signifie que paraîtront
le lendemain des versions presque identiques du même reportage.
Les officiels du gouvernement savent que s'ils occupent quotidiennement
avec des nouvelles pré-emballées qui montrent le
gouvernement sous un jour positif, les journalistes seront trop
occupés pour pouvoir mener un véritable journalisme
d'investigation qui pourrait soulever de véritables questions
sur des thèmes importantes.
La couverture du conflit
colombien, comme pour d'autres sujets importants, ne doit pas
se réaliser de cette façon. Les correspondants devraient travailler plus indépendamment
et ne pas accepter passivement de se laisser orienter par les
officiels du gouvernement. Deux, trois, quatre ou même
cinq correspondants étrangers couvrant une conférence
de presse de l'ambassadeur états-unien, par exemple, ne
peut mener qu,à la publication de cinq articles presque
identiques. Par contre un journaliste pourrait couvrir un événement
comme une conférence de presse (et zéro si le gouvernement
ne peut pas convaincre les médias qu,il va aborder un
sujet important), cependant que les autres correspondants seraient
libres de mener des investigations sur d'autres affaires. Le
résultat pour le public serait une couverture beaucoup
plus rationnelle de la Colombie. L,excessive dépendance
des médias dominants vis-à-vis des sources officielles,
voici l,une des raisons qui font que les journalistes indépendants
et alternatifs suivent plus particulièrement les nouvelles
et les points de vue généralement ignorés
par leurs collègues des grandes entreprises médiatiques.
Dans le cas des articles
de Reuters et AP la semaine passée, les journalistes n'auraient
pas dû baser la totalité de leurs articles sur le
tour pour la presse officiel.
Ils auraient dû voyager de façon indépendante
vers la région, et mener une enquête plus profonde
et plus étudiée de l'opération au lieu de
simplement jouer le rôle de service de propagande des gouvernements
colombien et états-unien. Une telle stratégie leur
aurait permis de parler à des paysans cocaleros affectés
par l,opération, d,interroger des membres des FARC (si
ces derniers l'avaient bien voulu) et de sentir la situation
sur le terrain au-delà des confins de leur garde militaire
officielle.
Si les tours pour la
presse [junkets] offrent un accès rapide, aisé
et sûr à une nouvelle, ils affaiblissent la responsabilité
journalistique qui est d'enquêter en profondeur sur un
thème et d'éviter de dépendre d'une source
unique. Bien que travailler
de façon indépendante puisse parfois être
dangereux dans un pays frappé par un conflit comme la
Colombie, la réalité c,est que les journalistes
basés dans ce pays d,Amérique du sud sont des correspondants
de guerre et qu'ils ont la responsabilité de couvrir le
conflit de façon rationnelle. Un article basé presque
exclusivement sur quelques heures de présentation officielle
mâchée ne peut pas être considéré
comme relevant du journalisme.
En
fait, ce n'est rien de plus que de la propagande officielle.
|
|
Colombie Elections
sans démocratie
L'échec
du processus démocratique colombien
Le boycott des dernières
élections de la part de l'opposition vénézuélienne,
laquelle n'avait guère de chances de remporter plus de
20% des sièges de l'Assemblée Nationale, a permis
de susciter des interrogations quant à la légitimité
du processus électoral vénézuélien. Cependant au bout du compte il
était évident que le boycott de l'opposition n'était
rien de plus que la tentative de créer la déficience
démocratique à laquelle elle prétend s'opposer.
Cependant dans la Colombie voisine, la légitimité
démocratique est une nouvelle fois sérieusement
malmenée. La campagne électorale est marquée
par les habituels assassinats de candidats. Les candidats qui
s'opposent au président Alvaro Uribe, tout particulièrement,
sont les cibles des paramilitaires d'extrême droite supposés
respecter un cessez-le-feu.
Lors des dernières
élections au Congrès, en 2002, en raison des menaces
et des assassinats, plusieurs dizaines de candidats uribistes
s'étaient présentés sans opposition dans
les régions paramilitarisées. Les paramilitaires garantissaient ainsi la victoire
aux candidats de leur choix. Cela avait pris une telle dimension
que Salvatore Mancuso, dirigeant des Autodéfenses Unies
de Colombie (AUC), avait déclaré après les
élections que les paramilitaires contrôlaient 30%
du Congrès. Les paramilitaires appliquent exactement la
même stratégie pour les élections de mars
2006. D'après les Nations Unies, le mois dernier trois
candidats municipaux dans le sud de la Colombie ont été
assassinés par les paramilitaires.
Le commencement de la campagne
en ce début d'année rappelle également les
élections municipales de 2003 lorsque les groupes armés
illégaux avaient tué 26 candidats. Bien que 20 000 combattants
des AUC aient prétendument été démobilisés
durant ces deux dernières années, selon le Centre
des Ressources pour l'Analyse du Conflit (CERAC, http://www.cerac.org.co), le nombre de personnes tuées par les paramilitaires
en 2005 était plus de deux fois supérieur au nombre
de personnes tuées en 2004.
Selon Adam Isacson, du
Center for International Policy dont le siège est
à Washington, « les organisations paramilitaires
colombiennes en fait renforcent leur pouvoir, y compris lorsqu'elles
se ''démobilisent''.
Le processus électoral a été l'un des moyens
principaux ayant permis l'augmentation de leur pouvoir. Avec
quelques dessous de tables et avec beaucoup de menaces, les chefs
des AUC assurent que les candidats qui leur sont alliés
remportent les gouvernorats, les mairies et les sièges
au Congrès ». Il est difficile de considérer
le processus électoral colombien comme légitime,
quand nombre de candidats opposés au président
sont contraints de se retirer parce qu'ils risquent d'être
assassinés. Ainsi, les irrégularités du
processus électoral colombien menace beaucoup plus gravement
la démocratie que les problèmes rencontrés
par l'opposition vénézuélienne.
L'ambassadeur états-unien
William Wood a dénoncé l'implication des paramilitaires
démobilisés dans le processus politique colombien,
ce qui avait conduit le président Uribe à porter
des accusations d'intromission. Une sénatrice a accusé Wood de l'avoir
fait retirer de la liste des candidats de son parti en raison
de ses liens avec le paramilitarisme. Mais étant donné
que les élections au Venezuela, en Bolivie, en Iran, en
Egypte et au Liban, ont été remportées par
des régimes critiques des Etats-Unis, il est improbable
que le gouvernement Bush remette sérieusement en question
la légitimité du processus démocratique
colombien qui devrait se conclure par la ré-élection
d'un très proche allié.
Sources : Colombiajournal : http://www.colombiajournal.org/colombia225.htm
et http://www.colombiajournal.org/colombia227.htm
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|
Colombie :
Nous
naviguons dans un océan d'incertitudeavec
à l'horizon de temps à autre des îlots de
certitudes...
Lionel Mesnard, Paris
le 23-12-2005
|
|

|
|
Aborder la complexité
d'un pays à travers un article sur des bases critiques,
nous avons là toute la limite et le danger de la chose.
Un site, « Média
Ratings France » nous propose de décrypter l'actualité
de la presse nationale (1) et au final, l'on devine un travail
de propagande assez déroutant. Du moins, pour un observateur
relativement attentif de comment en France est traitée
la question colombienne ? S'il fallait faire un florilège
des inepties écrites, des contre-vérités
sur l'Amérique Latine, il faudrait créer quelques
emplois à temps plein... Entre les à peu près,
l'absence de références historiques, les insultes,
les mensonges, et l'ignorance des journalistes et de ceux qui
commentent les commentaires de la presse, je me demande ce que
peut comprendre l'opinion publique d'une telle mélasse
?
Si vous croyez encore
dans l'objectivité et que vous prenez pour bon enfant
les propos de certains, la guerre civile qui se déroule
depuis plus de 40 ans en Colombie n'est pas prêt de finir.
Ce jeu est dangereux,
pour ne pas dire pervers. Mieux vaut éviter de juger et
répéter sans relâche, que la seule voie possible
passe par une issue politique et une paix civile, qui ne soit
pas artificielle. En arriver à faire les louanges du président
Alvaro Uribe, c'est proprement incroyable. Mettre toutes les
responsabilité de ce conflit sur les FARC, c'est désigner
un bouc émissaire un peu trop facilement, mais on oublie
au passage le rôle de l'ELN, et surtout les Armées
des Unions Combattantes à qui sont imputées plus
de 70% des atteintes aux droits de l'Homme pour l'année
2004 sur l'ensemble du territoire colombien (2).
C'est aussi ignoré les problèmes frontaliers avec
les voisins (Brésil, Équateur, Pérou, et
le Venezuela), qui subissent eux aussi des exactions liées
aux débordements des forces en présence. En bref,
on pourrait en faire un poème à la Prévert,
mais la question est trop paradoxale pour la prendre à
la légère.
Concernant Ingrid Betancourt,
rien n'oblige à partager toutes ses idées. Il importe
d'être conscient que les colombiens y attachent relativement
peu d'attention tant les difficultés quotidiennes sont
prégnantes. Une
réalité que récemment Mélanie Delloye-Betancourt
rappelait, tant les médias sont concentrés, plus
exactement aux mains d'un seul homme et ami du président
ultra-conservateur en place. Mais de là, à ce que
la famille Betancourt soit l'objet de dénigrement, cela
marque à tout égard une absence d'empathie, le
peu de noblesse de la cause « critique ». Mettre
en avant l'action de la maman d'Ingrid Betancourt auprès
des enfants défavorisés d'un quartier de Bogotà,
non c'est impossible, sauf à rappeler pourquoi cette famille
lutte corps et âme, c'est-à-dire pour la paix et
le progrès social pour tous en Colombie. Quand certains
prennent tribunes bien à l'abri et sous des airs de «
démocrates », on se demande au service de quelle
idéologie rétrograde ?
Comme le Ruanda, la
Birmanie, la Colombie mériterait que les instances pénales
onusiennes ré-ouvre le dossier sur la question des nombreux
crimes perpétrés contre l'humanité, et crimes
de guerre, dont un des principaux responsables de l'enlisement
depuis les années 1990 n'est autre que le président
Alvaro Uribe. Ce dossier est resté clos et avec la bienveillance
de la France en 2002. Si
depuis quelques mois, la diplomatie française oeuvre plutôt
dans le bon sens, et cherche à libérer les 3 otages
franco-colombiens (3), elle l'a fait aussi avec l'Espagne,
l'Italie et la Suède (en janvier 2005). En clair ce n'est
pas une intervention disjonctée de Dominique de Villepin
sur la question, mais bel et bien une action commune de 4 pays
membres de l'Union Européenne à prendre avec considération
et pondération. La Norvège y participe, ainsi que
la Suisse dans les actuelles négociations concernant les
FARC ; et l'on doit souligner le rôle de deux médiateurs
(Cuba et le Venezuela) dans les pourparlers entre Alavro Uribe
et l'ELN (l'Armée de libération nationale) en décembre
2005 à la Havane, et la présence de Gabriel Garcia
Marquez (Prix Nobel de littérature, colombien).
Il serait judicieux de
parler du « syndrome de Bogotà » sous un autre
angle, celui du rôle des transnationales, du financement
étasunien du Plan Colombie, qui au lieu d'éradiquer
la corruption, soutien et favorise la terreur des paramilitaires
contre les populations civiles avec l'appui de l'armée
régulière, et protégeant principalement
les entreprises étrangères qui pillent les richesses
de ce pays. Et ce malgré
une pseudo démilitarisation des troupes d'extrêmes
droites (AUC), un véritable miroir aux alouettes, dans
les faits les pressions et les crimes continuent chaque jour.
En 2005, près de 70% des syndicalistes assassinés
ou persécutés dans le monde l'ont été
en Colombie : plus de 145 meurtres et environ 700 agressions
physiques. Cette flamboyante démocratie que l'on nous
dépeint est un mensonge. Et s'il faut ajouter à
la liste entre 20.000 et 40.000 morts par an depuis la fin des
années 1980 en raison de la guerre civile toujours active,
plus environ 200.000 réfugiés supplémentaires
par an, sans omettre les 300.000 actuels exilés, et les
2 millions de migrants économiques au Venezuela. L'addition
est un peu lourde pour faire l'éloge d'un régime
en réalité corrompu jusqu'à la tête
du pouvoir.
Écrire, que
Alvaro Uribe dispose du soutien de plus de 70% des colombiens
(et depuis 3 ans, selon le jounal Le Monde paru le 5-11-2005)
), on en rigole dans un pays ou à peine un habitant sur
deux se rend aux urnes. Ah,
le bouquet est tellement sinistre que nous avons encore droit
« au méchant populo-castriste Chavez ». Celui
que l'on s'ingénue à dépeindre en «
dictateur », a néanmoins permis des évolutions
sociales et économiques significatives au Venezuela, quand
en Colombie la lutte contre la pauvreté consiste à
fermer des hôpitaux publics (4).
La sagesse de Hugo Chavez Friàs a été récemment
d'apporter son soutien à la libération des otages,
il a proposé de se mettre aux services de la libération
d'Ingrid Betancourt aux côtés de la France (Paris,
octobre 2005), et il n'est pas comme on le prétend un
soutien affirmé aux guérillas. Il y a des contradictions
qui échappent à certains, je leur accorde le droit
d'être des propagandistes, mais certainement pas des observateurs
critiques. C'est affligeant quand on fait le décompte,
et que l'on constate que L'ELN n'est pas considérée
comme une « organisation terroriste » (elle aussi),
est-ce un oubli dans la circulaire européenne de 2003,
qui montre là aussi une faille ou une incohérence
de plus ? (5)
Pour revenir sur les « dangereux terroristes » des
Forces Armées Révolutionnaires de Colombie et patentés
« narcotrafiquants », il y aurait de quoi voir sur
place ce qu'il en est exactement ? Surtout quand on sait le rôle moteur dans
l'économie colombienne de l'argent de la cocaïne,
et la proximité, là encore troublante des cartels,
notamment de Medellin dans l'ombre du président. J'en
oublierai presque comment on asperge régulièrement
les terres et les paysans de produits toxiques, provocant chez
les enfants comme chez les adultes des pathologies lourdes et
handicapantes. Pour éliminer des plans de coca, on fait
de même avec le genre humain, au nom de la lutte contre
les stupéfiants. Celui qui tente de mettre son nez dans
la question colombienne, a plutôt intérêt
à s'informer largement. Je regrette à ce titre
que l'évocation de la Colombie se limite à la libération
d'Ingrid Betancourt et que l'on ne puisse pas prendre en compte
toutes les réalités pesantes. Il faudrait évoquer
la mémoire de Camilo Torres, de pourquoi des libéraux
(au sens local c'est la gauche modérée), des hommes
d'églises ont du conserver les armes et lutter contre
l'infamie en place à Bogotà et depuis des lustres.
Pour autant, cela n'absout pas les FARC et L'ELN d'erreurs et
de crimes, je ne connais pas de « guerres propres »,
à part celles d'un certain Bush Junior et l'administration
de l'État étasunien, qui maintiennent une tutelle
oppressante sur l'Amérique Centrale et du Sud. La dernière
trouvaille des amis parlementaires de Bush Junior est de construire
un mur de 1000 kilomètres de long entre le Mexique et
les USA (selon un sondage récent 58%des étasuniens
désapprouvent) et les mexicains se sentent insultés,
et se demandent ce qu'il va advenir aux plusieurs millions de
migrants sans papiers résidant aux Etats-Unis ?
La chasse aux «
marxistes » ou aux « rouges » marche à
plein depuis plus de 40 ans en Amérique Latine, ainsi
on objecte une réalité qui a poussé certains
à choisir une forme ultime de résistance à
l'oppression. Dans
le cas des militants d'origines des FARC, en 1964 c'était
ça ou disparaître (au sens physique du terme), et
pour tous ceux qui avaient choisis la révolution armée
comme dernier recours face à l'intolérable. Une
part du territoire colombien est morcelée, sa géographie
particulière fait qu'une partie sont des zones sous influences
« révolutionnaires » en son nord comme en
son sud. Il existe aussi des expériences originales menées
par des groupes religieux et civils pour créer des espaces
de Paix. Là aussi, on dénombre l'assassinat régulier
de militants d'associations des droits de l'Homme , qui justement
favorisent et soutiennent des expériences collectives
pacifiques et ses membres sont menacés quotidiennement
par les paramilitaires. Tout cela encore n'est que le haut de
l'iceberg de la question colombienne. L'objet est-il de savoir
qui sont les bons et les méchants ? Pas vraiment, la marche
indispensable vers une résolution plus que nécessaire
du conflit n'est pas que l'affaire des seuls colombiens. C'est
pour eux que nous devons amener un peu plus de précisions,
moins d'à peu près et l'espoir de pouvoir un jour
ne plus vivre dans la fureur des armes. Il est temps non seulement
d'abattre le mur du silence, mais aussi de mettre fin à
une désinformation permanente sur les souffrances des
populations sud américaines.
A côté,
la « dictature » cubaine est presque un paradis terrestre
et ce malgré les privations du blocus économique,
qui lui aussi a plus de 40 ans d'âge. Et il y a trente ans de cela, Bush Senior dirigeait
la CIA, et la lutte contre les « communistes » a
été surtout l'élimination de nord en sud
des Amériques des élites militantes et progressistes.
On ne naît pas révolutionnaire, on le devient quand
la somme devient inacceptable, que l'on conserve en soit une
capacité à s'indigner mais aussi à réfléchir
et que l'on ne reste pas assis à attendre que le monde
change, quand 80 à 90 % de la population n'a pas de quoi
vivre dignement. Le propos peut sembler moral, oui mais au bon
sens du terme, de l'honnêteté intellectuelle. À
ne pas prendre sous un angle, mais sous plusieurs, sinon c'est
faire un travail qui ressemble, soit à une problématique
systématique, donc folle, soit à dénigrer
des hommes et des femmes de progrès ; et finir par ressembler
à la même soupe, qui vue ou lue de Bogotà
ou de Paris ressemble à une hyper concentration des moyens
d'informations à destination des citoyens. Si les outils
de la critique sont eux mêmes tronqués, ne chercher
pas à croire, faîtes vous votre propre opinion,
et à partir d'analyses plus sérieuses. Qui cherche
trouve, et, pour reprendre une idée d'Edgar Morin sur
la complexité, nous naviguons dans un océan
d'incertitude avec à l'horizon de temps à autre
des îlots de certitudes...
Notes :
(1) 2 articles de media-ratings.com
en 2005 sur la Colombie :
- http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1092
- http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1216
(2) Un article sur le documentaire de Nicolas Joxe
« ils ont tué un homme, ils ne feront pas taire
un peuple (de juin 2005) sur la page Amérique Latine du
site.
(3) à noter que Ingrid Betancourt
n'est pas la seule franco-colombienne retenue contre son gré,
un jeune homme, Marc Beltra et Madame Duvaltier (71 ans) ont
disparu depuis de long mois, et sans véritables nouvelles
d'eux depuis.
(4) Il existe un reportage très instructif produit
au sein du « Journal International des Quartiers »,
son site jiq-nib.org. C'est un document de Jungando de Locales
(un regroupement de télévisions alternatives colombiennes)
et le sujet traite de la fermeture (2004) d'un espace hospitalier
dans un quartier populaire de Bogotà.
(5) DÉCISION DU CONSEIL du CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE du 22 décembre 2003, mettant
en uvre l'article 2, paragraphe 3,du règlement (CE)n°
2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques
à l'encontre de certaines personnes et entités
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant
la décision 2003/646/CE. Référence du texte
: 2003/902/CE.
|
|
|
|
| |
Cet espace
d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes, ... |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui est donc A.Miller ? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
F. de
Miranda
: Citoyen du monde |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 05/02/2011 |
|
|
|
|
|