|

|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
|
Géologie
et Préhistoire
de Paris et de
sa région
Ci-contre une
illustration : en noir les limites
administratives de la capitale. En bleu et jaune les carrières...
|
|

|
|
|
|
|
Les
carrières ont eu un rôle important et sans
réelle discontinuité sur au moins 1.500 ans et pour
diverses opérations de construction.
Elles sont parfois citées sous la dénomination de
catacombes, sauf qu'il s'agit de l'ossuaire de plusieurs anciens
cimetières parisiens, qui se trouve dans les sous-sols de la place
Denfert Rochereau, et sans rapport direct avec la période romaine. Les
anciennes carrières couvrent une part non négligeable de la
surface de Paris, soit plus de 700 hectares.
|
La
topographie actuelle du bassin Parisien est le résultat de
l'érosion et des dépôts de
sédiments des cours d'eaux et des
légères poussées à
l'origine de la constitution des Alpes. Au nord de la Seine, on
dénombre du gypse et témoigne de la
présence, il y a environ 38 millions d'années,
d'une mer fortement minéralisée produit par une
forte évaporation en climat chaud, voire aride.
Les calcaires
grossiers
que l'on rencontre dans les sous sols du sud de la Seine indiquent la
présence, il y a environ 45 millions d'années
d'une mer (climat tropical) d'une dizaine de mètre de profondeur,
grouillante
de vie et d'organismes. Les 20 premiers mètres
de roches calcaires exploitables sous la capitale diffèrent
entre le nord et le sud de la Seine, le seul point commun ce sont des
terrains issus de la sédimentation marine.
« La
mer, qui occupait jadis ces dépressions, ne les a pas complètement
évacuées. La Manche, la mer du Nord interrompent, par transgression, la
continuité d'anciens massifs. Mais la nappe dont elles recouvrent le
socle continental est mince. Ce sont des mers à fonds plats, dont les
flots dissimulent sous des profondeurs inférieures à 200 mètres une
partie du bassin de Paris, de celui de Londres, du Massif armoricain. (...)
Ce
n'est pas aux rivières actuelles, mais à des courants anciens
incontestablement plus violents dans leur régime et moins définis dans
leur cours qu'on peut attribuer les dénudations dont le Bassin parisien
porte les traces. Ces courants ont préexisté à l'établissement du
réseau fluvial. Ils le surpassaient, non seulement en force, mais par
l'étendue du domaine qu'ils embrassaient. Parmi les débris de roches
dont ils ont jonché le sol, il en est qui proviennent d'au delà des
limites actuelles du Bassin de la Seine. Le Massif central a fourni son
contingent aux traînées de sables de certains environs de Paris. (...)
Cela
semble presque une dissonance de comparer le réseau fluvial actuel à
ces courants diluviens. Certes, il ne rappelle que de bien loin ses
violents ancêtres par son régime et ses allures. D'abord il a subi un
démembrement notable. (...) Il est impossible de ne pas reconnaître
toutefois que les directions générales des courants diluviens ont guidé
les directions de la plupart des rivières actuelles. »
|
| |

|
| |
| L'on
observe que les exploitations de "pierre à
plâtres" se firent sur les terrains gypsifères au
nord de la Seine. Tandis
que
les carrières
à calcaire du sud fournirent les pierres pour la
construction. Le calcaire fut ainsi exploité dans les
5ème, 6ème, 12ème, 13ème,
14ème, 15ème et 16ème arrondissement
de Paris (770 hectares) et laissa place à d'importants vides
dans le sous-sol qui sont à l'origine des anciennes galeries. Où l'on
exploita notamment certains types de calcaires (tendres ou durs) et
l'exemple le plus notable est celui de la cathédrale Norte-Dame, qui
trouva là ses matériaux principaux hormis le bois. |
| |
Vidéo sur La mer à Paris, il y a 45 millions d'années : cliquez ici !
Auteur et réalisateur Olivier Lemaitre (durée 8 minutes)
|
|
|
Sans
étudier et comprendre la topographie et l'hydrographie,
certains peuvent alimenter des rumeurs, mais le risque d'inondation
n'est pas impossible. Pour la
Seine, le mauvais souvenir de 1910
n'est pas à écarter. Depuis d'importantes
rétentions d'eaux se sont édifiées en
amont et un plan de prévention des risques et d'urgence est
prévu.
Un des dangers majeur
pourrait résider dans l'érosion, et le calcaire
est une roche plus ou moins dure, mais qui se dissout et est hautement fissurable. Vous pouvez le tester avec avec une goutte
d'acide chlorhydrique, il se produira une évaporation ou une réaction
chimique sur la roche. La question se pose d'autant plus avec la
densité des constructions sur des sols fragiles,
à Paris en rive nord et sud. |
| |
|
|
Une inondation sur les
deux rives serait un désastre, comme l'ont connu les
Praguois en 2002 et 2012. Mais
ce sont aussi des
sous-sol parisiens qu'il faudrait s'alarmer en plusieurs points de la
capitale.
De
nombreuses fondations
pourraient ne pas résister à une trop grande
humidité, voire combinée à des périodes de sécheresse. La présence des roches
calcaires est plus qu'un indice, quand on l'associe à
l'existence de traverses et carrières nombreuses dans les
souterrains parisiens.
De temps
à
autre, un immeuble, une rue peuvent s'affaisser dans Paris,
l'événement est heureusement rare, mais assez régulier pour ne pas être totalement
négligé.
Plus
d'une fois à Paris se sont produits ces trois ou quatre dernières décennies des effondrements
d'immeubles, ou des chaussées s'affaissant. La situation la
plus spectaculaire s'est passée en rive droite, rue Papillon
(dans le IXe arrondissement), c'est tout un lot
d'immeubles qui s'enfonça d'un seul mouvement de terrain.
|
|
|
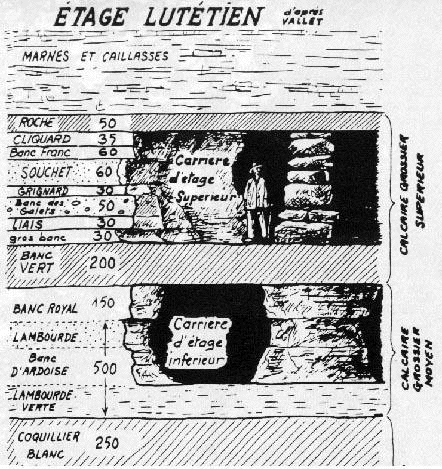
|
|
| |
Plus tardivement dans les
années 1990, ce furent les travaux autour de la connexion du
transport ferroviaire de la gare du Nord qui provoquèrent
des mouvements sensibles sur un quartier nord du Xe
arrondissement (lézardes dans les appartements).
Et ce ne sont pas les les seules zones à avoir subit des
dommages dans la capitale. Les deux derniers affaissements connus se
sont déroulés en rive gauche, dans le XIIIe et le XVe arrondissement.
D'autres accidents
à venir ne sont pas à écarter (plus ou
moins importants), mais comment se prémunir de mouvements
éventuels? Aussi étonnant que cela
puisse paraître cette ville connaît relativement
mal l'ensemble de ses souterrains, ou plus exactement en oublie un peu
l'activité de ses sols et les risques potentiels. Du moins,
nous disposons de peu d'information à ce sujet.
|
|
|
|
|
Paris aux temps antéhistoriques
(deuxième partie)
Carte
de la Seine aux âges antéhistoriques (ou planche n°3) dépôts du
Quaternaire et anciens lits
Extraits de La
Seine :
le bassin parisien aux âges
antéhistoriques (*)
Eugène Belgrand
|
|
« C'est surtout à l'origine de l'âge de la pierre (le terme se réfère à
l'usage des outils aux temps préhistoriques) que les anses ont
joué un grand rôle dans le dépôt des alluvions et des corps flottants.
Les lits des cours d'eau étaient alors mal dessinés; ils occupaient
tout le fond des vallées, qu'il fût large ou étroit, et pénétraient
dans toutes les érosions et échancrures des coteaux produites par les
actions diluviennes.
Ces premiers lits étaient beaucoup plus élevés que les lits des cours
d'eau modernes. Dans le travail d'abaissement, les graviers de ces
hauts niveaux ont été presque entièrement emportés; ce qui en reste
encore a été conservé surtout dans les anses, qui, par leurs
dispositions, sont naturellement à l'abri de la violence des courants.
On en trouve aussi quelques lambeaux sur les caps des tournants.
Comme exemples de dépôts dans les anses, nous citerons, à Paris, les
graviers des hauts niveaux de la plaine de Vincennes et de Montreuil,
déposés dans l'anse comprise entre la pointe du cap sur lequel s'élève
le fort de Nogent et le promontoire de Fontarabie, près de Charonne; en
face, sur la rive gauche et à la même altitude, les sablières de l'anse
de Vitry, ainsi que les graviers des bas niveaux du Marais, des
quartiers bas de la rive droite à Paris, déposés dans l'anse comprise
entre la pointe du cap Mazas et Chaillot.
On a figuré sur une carte de Paris (planche n°3 de La Seine aux âges
antéhistoriques) les lambeaux des graviers des hauts niveaux, le cordon
continu des terrains de transport des bas niveaux dans la traversée de
Paris, les sablières en exploitation dans les graviers de l'anse de
Montreuil, les graviers de l'anse de Paris, les caps d'alluvion du
Champ de Mars et du bois de Boulogne, ainsi que le sillon du fleuve
moderne. Ce sillon serre de près le coteau concave du tournant du Champ
de Mars, entre Chaillot et le Point-du-Jour, laissant les terrains de
transport sur la rive gauche; ensuite il traverse ces terrains de
droite à gauche entre le Point-du-Jour et le bas Meudon, pour aller se
coller contre le coteau concave du tournant du bois de Boulogne, entre
le bas Meudon et Clichy, laissant les terrains de transport à droite.
La figure dont il s'agit est donc une véritable démonstration (…).
Lorsqu'on étudie la disposition des lits successifs de la Seine dans
Paris, on trouve que le plus ancien et le plus élevé a laissé sa trace
sur les hauteurs de la plaine de Montreuil, à l'altitude de 55 mètres,
de la terrasse d'Ivry, de l'ancienne barrière d'Italie et de l'ancienne
barrière de Vaugirard, à l'altitude de 60 et même de 63 mètres : le
niveau d'étiage actuel est à l'altitude de 26m 25, ce qui donne une
différence de niveau d'environ 29 à 37 mètres entre les lits les plus
élevés et le plus bas. C'est donc à l'altitude de 60 mètres que j'ai
tracé les deux limites du lit primitif de la Seine et de la Marne, et
j'ai poussé ces lignes de niveau en amont de Paris jusqu'à la
Ferté-sous-Jouarre, dans la vallée de la Marne, et dans celle de la
Seine, jusqu'à Corbeil. (…)
Les deux coupes dont je vais parler ont été relevées sur le tracé du
chemin de fer de Ceinture, près des fortifications entre les vallées de
la Bièvre et de la Seine. Le chemin de fer a été tracé dans une
dépression du cap de la barrière d'Italie. Lorsque le lit de la Seine
s'est abaissé progressivement, l'eau du fleuve s'est longtemps déversée
dans la vallée de la Bièvre par cette dépression. (…)
A Paris, cette séparation est très remarquable. Ainsi, sur la rive
droite, les graviers des hauts niveaux s'abaissent en pente douce
d'abord, et sans solution de continuité, tout autour du plateau de
Vincennes, entre Joinville-le-Pont et l'avenue Daumesnil, jusqu'au bord
des coteaux de Charenton. Leur plus basse altitude, au bord de
l'escarpement formé par ces coteaux, est environ de 51 mètres. Les bas
niveaux commencent à la rue de Charenton, et leur plus haute altitude
est de 36 mètres. Il y a donc une solution de continuité de 14 mètres
entre les terrains de transport des hauts et des bas niveaux. Il
existe, à la vérité, quelques lambeaux de lits intermédiaires,
notamment à la rue des Trois-Chandelles, où l'on trouve une sablière à
l'altitude de 41 mètres.
On en trouve çà et là, en divers autres points de Paris (planche n°3), notamment sur les promontoires des tournants du Champ de Mars et du
bois de Boulogne. En général, les lits intermédiaires se relient aux
bas niveaux, sans solution de continuité; il y a, au contraire,
solution de continuité entre les hauts niveaux et les lits
intermédiaires, par exemple entre les graviers de l'avenue Daumesnil et
de la rue des Trois-Chandelles. (…)
Maintenant reportons-nous à de longues années en arrière. Il est bien
clair que les grands cours d'eau de l'âge de pierre, que j'ai cherché à
décrire, n'ont jamais pu produire de tourbes au fond des vallées du
bassin de la Seine, puisque leurs eaux étaient non seulement
limoneuses, mais encore assez violentes pour remanier les sables et les
cailloux de leurs lits.
C'est donc après l'achèvement du travail d'abaissement des lits,
lorsque le climat s'est adouci, lorsque les fleuves immenses qui
roulaient dans les vallées sont devenus des ruisseaux, en un mot quand
certains cours d'eau sont devenus assez tranquilles pour ne plus
entraîner même du limon, que la tourbe a commencé à tapisser le fond
des vallées de ces cours d'eau. (…)
« A l'extrémité de la plaine d'Ivry, toujours dans le même lit de la
vieille Seine, on trouve une petite anse où le terrain de transport
s'est déposé dans les mêmes conditions que dans l'anse de Montreuil. La
sablière du Kremlin route d'Italie n°50 est exploitée dans cette
anse. Elle présente les mêmes dispositions que les sablières de
Montreuil; tandis que, dans toutes les autres sablières de la plaine,
le gravier est presque entièrement imprégné de limon rouge, le sable de
la carrière du Kremlin est pur et ne tache pas les doigts; comme à
Montreuil, on y trouve aussi des ossements.
De ce qu'on n'a trouvé qu'un petit nombre d'ossements dans les graviers
pénétrés de limon rouge de la plaine d'Ivry, de la Butte-aux-Cailles et
de l'avenue Daumesnil, qui étaient au milieu du lit ou en plein
courant, il ne faut pas conclure que ces dépôts ne sont pas de même âge
que ceux des anses de Montreuil et du Kremlin; ces graviers
appartiennent au même lit du fleuve; ils sont sensiblement à la même
altitude, mais ils se sont déposés dans des conditions différentes. (…)
Les dépôts tourbeux des terrains perméables du bassin de la Seine
et de la Picardie sont, suivant moi, une des preuves les plus fortes de
la rapide diminution du débit des cours d'eau à la fin de
l'âge de pierre (sic). »
|
(*) "Anté" voulant signifier l'idée d'Avant (l'Histoire), ou ce qui est
antérieur.
|
Carte du relief de Paris Ouest/Est
|
  |
Sources : Gallica-BnF et Ville de Paris
Textes ou extraits
rajoutés le 3 février 2018
|
|
| |
| Le
Paris de la préhistoire |
|
|
Cela
fait environ 1,8 millions d'années que se fit le premier passage de nos
lointains parents depuis l'Afrique, le berceau de notre humanité par le
sud méditerranéen. Voilà 600.000 ans que les premiers hominimes
(les homidés concernant les hommes et les grands singes) mirent pied en Europe du nord, dont il nous reste que peu d'éléments :
vestiges ou traces qui sont difficilement classifiables, ou au mieux
proches de l'Homo erectus présent en Asie. Il ne s'agissait pas donc
pas encore des Homos sapiens (de l'adjectif latin "sage") qui
n'apparurent que vers 330.000 ans dans la région du Rif au Maroc, en
l'état des recherches actuelles.
Concernant les origines les plus communes des Européen(ne)s, les parents génotypiques parvinrent des Sapiens (ce que nous sommes, seule et dernière espèce humaine survivante)
après l'extinction de Néandertal (dont nous partageons quelques restes génétiques estimés à un peu moins de 4%) depuis le Proche Orient et par petits groupes successifs. Ceci
reléguant les théories scientistes et racistes du XIXe siècle, voire
toujours active chez les identitaristes incultes et/ou cyniques en
activité sur la toile. Des inepties à replacer dans leur contexte historique et politique propre, et sans lien ou fondement avec les connaissances présentes.
|
Les
conditions climatiques au paléolithique ne firent de nos ancêtres les plus directs principalement que
des habitants migrateurs ou nomades, ils ne s'établissaient que si les
conditions atmosphériques étaient favorables. La région francilienne fut plus
à l'origine une terre de transhumance, de passage. Les premières
incursions et implantations humaines se situent au Magdalénien vers
14.000 ans de manière temporaire ou selon
les saisons.
|
|
|

|
|
Brève CHRONOLOGIE ou repères
temporels :
Le
paléolithique débute il y a 650.000 années... |
|
Paléolithique supérieur (fin - 12.000 ans)
- 54.000 ans : Arrivée de l'Homo sapiens en Europe.
|
| - 35.000 ans : Début de la civilisation Moustérienne du ChatelPerronnien. |
| - 25.000 ans : Disparition de l'Homme
de Néandertal. |
Période dite du Pléniglaciaire
supérieur :
- 30.000 : débuts du Wurmien supérieur
-
11.000 ans : Fin de la glaciation de
Würm
(IV)
|
Le Magdalénien entre - 17.000 et - 12.000 ans
L'holocène débute à partir de - 10.000 ans
|
|
|
| |
| Avec
des fossiles découverts lors des percées des
carrières en font des témoignages
précieux. Ceci peut expliquer
les allées et venues
ou passages lors du paléolithique. A une condition, si le climat était
clément, les populations fabriquaient des outils, mais se déplaçaient au
moment des glaciations ou froids hivernaux. Et
s'en allèrent en grande partie du bassin Parisien vers des
terres plus clémentes, selon les aléas du temps. C'est vers le sud-ouest
ou le sud-est
de la France qu'il faut se tourner pour mieux appréhender
les hommes et femmes de ces premiers âges. |
|
Le
recul des glaciers engagea la fin de la présence de larges
étendues d'eau, le rôle des sédiments
ou des couches succésssives favorisa l'émergence d'une nature moins
hostile. La fin cette ère glacière a permis aux humains à la fin du
paléolithique de s'installer un peu plus au nord de la
"France" et de "l'Europe". (des noms très tardifs et inexistants pour les premiers Hommes)
La sédentarisation a été très
tardive avant le néolithique, elle a eu une place
déterminante dans l'accroissement des groupes humains sans limite
continentale, pour autant le nomadisme ne disparaissait pas.
|
|

|
|
|
Des
restes de chasse, en des os de mammouths, de
cervidés et de rennes furent découverts en 1886
dans une carrière de Beaugrenelle. De Grenelle, en passant
par Montreuil et jusqu'à Chelles en Seine-et-Marne, le sol
nous explique ainsi ce qu'était la faune de la capitale et de sa
banlieue lors des périodes froides. Les ossements
découverts témoignent de la présence
de grands mammifères.
Pour traces, le
square
Montholon (9ème arrondissement) délivrait un squelette entier d'un mammouth, la
place de l'Opéra des molaires. Concernant les
périodes de glaciation, on découvrit la
présence d'ours et même de bisons qui furent exhumés lors du creusement du métro Goncourt (10ème
arrondissement) et sous le boulevard Raspail (14ème
arrondissement de Paris). |
| |
|
Traces
des grands animaux
(troisième partie)

Tête et Corne d'Aurochs époque quaternaire
(découvert à Montreuil)
Extraits de La Seine :
le bassin parisien aux âges antéhistoriques
Eugène Belgrand
|
Preuve de
la paléontologie :
Traces de l’industrie humaine
et débits des grands animaux de l’âge de pierre
« Je ne suis point naturaliste, et je n'entreprendrais
pas cette
dernière partie de l'histoire de la Seine, si elle ne jetait un grand
jour sur les faits qui ont été exposés ci-dessus. Mon savant confrère
et ami, M. Lartet, a bien voulu d'ailleurs aucun reste des grands
animaux me prêter son bienveillant concours, et c'est avec son aide que
j'ai entrepris cette tâche ardue. (…)
J'ai dit que cet ancien lit traversait l'emplacement de Paris presque
en ligne droite, et ne dessinait pas les sinueux méandres que la Seine
a tracés depuis. D'après cela, c'est principalement dans les anses des
rives qu'on pouvait espérer trouver des ossements.
Le 31 mars 1866, je visitai les sablières de la plaine de Vincennes
avec M. Prestwich et plusieurs autres géologues anglais, notamment M.
Jeffreys et M. Warrington, président de la Société géologique de
Londres, et un géologue belge, M. Dupont. C'est ainsi que j'ai connu
les sablières de Montreuil. Le jour de cette visite, nous y trouvâmes
divers ossements, et notamment un grand humérus d'éléphant, aujourd'hui
déposé au Muséum. (…)
Ces graviers se sont déposés, comme on l'a déjà dit, dans une anse
comprise entre les promontoires de Nogent-sur-Marne et de Charonne; au
fond, sur la pente, est bâti le village de Montreuil. (Planches ne 3 et
4) Les eaux du fleuve pénétraient en tournoyant dans cette anse, y
perdaient leur vitesse et y déposaient les corps flottants et les
sables.
Onze sablières y sont exploitées en ce moment; dans toutes on trouve
des ossements; mais les deux plus riches, incomparablement, sont celles
qui touchent à la route départementale de Paris à Montreuil et qui sont
exploitées par MM. Savart et Trimoulet. Pour un ossement qu'on découvre
dans les neuf autres sablières, on en trouve certainement dix dans
celles-ci. Cela prouve, ce me semble, que les cadavres arrivaient en
flottant dans l'anse de Montreuil, et qu'ils atterrissaient à certains
points favorables. Si les ossements y avaient été jetés avec le sable,
on ne comprendrait pas pourquoi tous les points de l'anse ne seraient
pas également riches, et pourquoi les graviers ossifères se seraient
portés spécialement dans l'emplacement des carrières Savart et
Trimoulet.
Les ossements se trouvent toujours dans le fond des sablières, rarement
à plus de 2 ou 3 mètres au-dessus du terrain tertiaire sur lequel
reposent les graviers, c'est-à-dire dans le gravier de fond. Leur état
de conservation est très variable; quelques-uns n'ont subi altération;
on croirait, à les voir si parfaits, qu'ils viennent d'être
désarticulés : j'ai découvert notamment une jambe complète d'aurochs.
L'humérus, le cubitus et le radius, les six os du carpe, le métacarpien
et son petit os complémentaire, ont été recueillis dans leur position
naturelle; cinq des phalanges et leurs petits os étaient au-dessous,
aucune dans le sable.
A côté, et un peu au-dessus, se trouvait la tête, mais renversée,
c'est-à-dire à plat sur l'os frontal. L'atlas et une autre vertèbre
cervicale ont été recueillis dans le voisinage avec un fragment d'un
autre métacarpien ; mais, comme ils étaient mêlés avec beaucoup
d'ossements provenant d'autres animaux, on n'oserait affirmer que tous
ces débris de grand boeuf appartinssent au même aurochs. D'autres
ossements sont dans un état de conservation beaucoup moins parfait, et
j'en ai recueilli qui sont roulés jusqu'à l'usure presque complète. (…)
On a dit plus haut que les eaux de la Bièvre, refoulées par le
fleuve, de l'âge de pierre, avaient formé, en amont de la butte aux
Cailles, un épais dépôt limoneux.
M. Constant Prévost a donné la liste suivante des ossements recueillis
dans cette localité par M. Duval :
Eléphant.
Côte et portion du bassin, fragments de dents.
Cerf. Bois.
Boeufs. Plusieurs os et dents.
Rhinocéros. Os du carpe et dent molaire.
Chevrotain, très petite espèce. Portion de tibia.
Blaireau. Mâchoire et plusieurs os.
Cochon. Dents.
Tigre ou lion. Dent canine.
Cheval. Mâchoire.
Rongeurs. Dents et vertèbres de plusieurs espèces
très petites (campagnol).
Oiseaux. Os de gallinacés.
Os de batraciens, lézards, serpents, coquilles fluviatiles et
terrestres, telles que hélices, paludines, bulimes, cyclostomes,
lymnées et cyclades.
D'après M. Lartet, parmi les ossements de rongeurs se
trouvait une tête de marmotte très bien conservée. (...)
Quoique les géologues aient été peu portés à l'étude des terrains de
transport avant les découvertes de M. Boucher de Perthes, cependant les
ossements sont si nombreux dans les localités que je viens de nommer
(Chaillot), que depuis longtemps ils ont attiré l'attention des
naturalistes.
Ainsi, dans l'ouvrage de Cuvier (t. IV, p. 156), il est fait mention
de la canine du grand "felis" trouvée en creusant un puits rue
d'Hauteville et donnée par M. de Bourrienne au Muséum, où elle est
encore aujourd'hui. Cuvier a décrit divers autres ossements, notamment
une canine d'hippopotame découverte à Grenelle. M. le comte de
Rambuteau a donné au Muséum un humérus de rhinocéros trouvé dans les
fouilles de l'Hôtel de Ville. (...)

Dents de mammifères de l'époque Quaternaire
(découvert à Montreuil)
-
SABLIÈRES DU CHEVALERET. Elephas primigenius, molaire, os du tarse.
- SABLIÈRE DE LA PETITE RUE DE REUILLY, passage
Montgallet, altitude
35m, 23. Très nombreux ossements: Elephas primigenius ; Rhinocéros
tichorhinus; Rhinocéros Merckii; Equus ; Bos ; Cervus megaceros (?).
- RUE POPINCOURT, même altitude. Ossements d'éléphant.
- PLACE DE GRÈVE. Humérus de rhinocéros. (M. le comte de
Rambuteau.)
- SQUARE MONTHOLON. Squelette complet d'Elephas
primigenius. (MM. Gonse, Belgrand)
- RUE D'HAUTEVILLE. Canine de grand felis. (Cuvier)
- RUE DE DOUAI. Jambe complète de cheval, métacarpien de
renne. (M. Belgrand)
- TRANCHÉE DU GRAND ÉGOUT DE SÉBASTOPOL. Défense
d’éléphant.
- SABLIÈRES DE LA PLAINE DE GRENELLE ET DE L'AVENUE DE
LAMOTHE-PIQUET,
ne 61, aujourd'hui remblayée. Très nombreux ossements recueillis par M.
Gosse, de Genève : éléphant, rhinocéros, cheval, renne, cerfélaphe,
grand boeuf, grand tigre, etc., et, en outre, nombreux silex taillés.
Canine d'hippopotame. (Cuvier) (…)
En résumé, les faunes des hauts et des bas niveaux
des graviers de
l'ancien fleuve parisien sont presque identiques. Le renne et le
rhinocéros tichorhinus n'ont pas été trouvés dans les hauts niveaux de
Montreuil, mais la plupart des autres animaux de l'époque quaternaire
ont évidemment habité le bassin de la Seine pendant toute la durée de
l'âge de la pierre taillée. On trouve même dans toute cette étendue de
temps des animaux qu'on considérait comme appartenant à l'époque
pliocène (de 5,3 à 2,5 millions d'années), tels que les rhinocéros
Merckii et etruscus, le
trogontherium, un grand cerf (Cervus Belgrandi) qui se rapproche
beaucoup plus des espèces considérées comme pliocènes que des espèces
de l'âge de la pierre taillée. Les silex travaillés manquent
jusqu'ici
dans les hauts niveaux. »
|
|
Notes sur
l'auteur et compléments d'informations :
|
Paris doit beaucoup à Eugène Belgrand.
«
D’abord
ingénieur des Ponts et Chaussées en Bourgogne, dans le département
d’Avallon, il est repéré par le baron préfet Haussmann qui le fait
nommer Inspecteur des Eaux et des Égouts, un poste-clé dans
l’entreprise immense de réhabilitation de la capitale. Fin connaisseur
du Bassin de la Seine dont il avait fait les relevés géologiques et
hydrométriques, Belgrand s’attelle à la tâche difficile de faire venir
l’eau de source aux robinets des Parisiens.
Ci-contre : cliché d'Eugène Belgrand
|
|
 |
Sa passion pour l’ingénierie romaine l’aida à concevoir un système
d’aqueducs souterrains et dériver ainsi les sources de la Dhuis et de
la Vanne. L’eau de source se déversait ainsi dans les réservoirs de
Ménilmontant et de Montsouris, d’où elle était envoyée aux
particuliers. L’eau arrivant aux appartements devait aussi en repartir
: Eugène Belgrand réalise alors le système d’égouts souterrains, le
dessin des plaques, des regards et des bouches de récupération des eaux
usées.
La Bibliothèque nationale de France conserve les comptes rendus, les
rapports, les tableaux de relevés pluviométriques, mais aussi les
cartes du Bassin de la Seine, les héliogravures des bornes-fontaines,
les plans des égouts, le dessin des tuyaux de canalisation de
différents diamètres, les profils des aqueducs souterrains, toute une
masse de documents qui permet de suivre l’itinéraire des recherches
d’Eugène Belgrand. Un certain nombre de documents imprimés appartient
au fonds Le Senne dédié à l’histoire de Paris. On notera, à côté des
monographies, deux portefeuilles d’estampes dédiés au système d’égouts,
des atlas de cartes et de plans, et une lettre envoyée à Félix Nadar –
des documents qui sont conservés dans les départements spécialisés du
site Richelieu. »
Extrait
d'une notice de la BnF
Les égouts de Paris - Les travaux
souterrains de Paris - ATLAS, Tome 5 d'Eugène
Belgrand - Éditeur Dunod (Paris) - 1887 (de
nombreuses planches ou cartes)
et d'autres textes disponibles sur Gallica BNF notamment sur les inondations de Paris en mars 1876,
où il fait part de 1802 et 1807, les trois plus grandes crues du XIXe
siècle.
|
Sources : Gallica-BNF et Ville de Paris
Textes ou extraits rajoutés le 4 février 2018
|
|
|
Présence
humaine en Île de France et le premier Parisien, enfin retrouvé !
|
|
|
|

|
|
En Europe de l'Ouest ou Occidentale, les populations
préhistoriques allaient s'établir non loin des
côtes de l'Atlantique ou de la
Méditerranée. Au plus proche, l'on
conserve dans le
Périgord des traces réelles des premiers habitants établis dans l'hexagone il y a environ 23.000 ans.
A la fin de l’ère de glaciation, la
région île de France vit l'apparition des premiers nomades sur les rives de la Seine, une première incursion humaine
remontant
à environ 14.000 années. Le résultat des
fouilles entreprises
en 1964 sur une commune en Seine-et-Marne : La Grande Paroisse. Un travail
mené par
André Leroi-Gourhan (en audio sur ses travaux - 1911/1986), ancien professeur à la Sorbonne, et auteur entre autres du livre : Le Geste et la Parole (1965). |
|
|
Ces
recherches archéologiques attestent de la présence d'humains depuis le
Magdalénien, nous sommes encore au paléolithique dit supérieur, cette très longue
période s'achevant il y environ 12.000 ans avant l'ére dite chrétienne. Des chasseurs de rennes venus poser leur campement
sur le
site de Pincevent, près de la ville de Monterreau. A l'origine les fouilles devaient seulement mettre à
jour des traces Gallo-romaines. Il a été procédé à l'exploration des couches inférieures,
des restes préhistoriques se trouvaient sous les alluvions, ce qui a permis la
découverte d'un mammouth et plus.
Les Magdaléniens venaient sur le site
entre autres pour les silex, qu'ils trouvèrent nombreux pour la
fabrication de leurs outils.
Les rennes servaient à
l'alimentation,
les cuirs ou les peaux à l'habillement, etc. Ces animaux étaient
attaqués à l'aide
des
armes de
chasse faîtes en silex. Ces populations passaient environ cinq
mois sur place avant de changer de lieu, ils y construisaient des
cabanes pour refuge et y firent des feux pour la cuisson de leurs
aliments. Ces fouilles
ont demandé au moins 20 ans de recherche (1964-1984), elles se sont déroulées l'été
pendant deux mois. Il existait une vidéo sur le sujet du CNRS : L'Homme de Pincevent (elle n'est plus consultable).
André Leroi-Gourhan définissait l'anthropologie comme l'« étude des modalités du comportement de l'homme sans restriction d'époque ou de niveau culturel » ; un tel programme, ajoutait-il, « contraint
la recherche à se placer en face de la totalité des faits humains, dans
la nature anthropologique de leurs auteurs, dans leurs activités
corporelles et mentales, dans les produits oraux et matériels de ces
activités, sur toute la surface de l'habitat humain, dans toute la
profondeur du temps qui sépare le jour présent des origines ».
|
|
Puis ce fut l'arrivée d'autres populations
humaines dans l'actuelle région Ile de France aux alentours
de moins 11.000 ans dans la forêt de Fontainebleau : Musée de
la Préhistoire en
Ile de France à Nemours.
Peu à peu, les humains vont ainsi se
stabiliser dans
cette niche
écologique encore froide, permettant néanmoins à des femmes et
des
hommes de trouver des lieux de chasse ou de pêche pour répondre à leurs
besoins,
donc à titre temporaire. |
|
 |
|
|
| Nous concernant la deuxième vague
d'Homo-sapiens s'établit à
la fin du paléolithique et au début de l'âge du mésolithique, il y a environ 11.000 ans dans la région
Francilienne, en forêt de Fontainebleau.
Il a été découvert un nombre important de traces sous la forme de
représentations pour beaucoup non figuratives (photo ci-dessus), se
trouvant dans des espaces
cavernicoles. Ce qui pourrait ressembler à un langage ésotérique - pour
hypothèse - ce langage n'a pas été encore décrypté, mais ces
graphismes interrogent
sur une population présente entre moins 9.000 ans et moins 5.000 ans
avant notre ère en l'actuelle région parisienne. |
|
|
CHRONOLOGIE (avant l'an 0) :
Mésolithique - Néolithique - Âges des métaux
|
|
Mésolithique : d'environ - 10.000 ans à - 5.400 ans
|
Néolithique ancien : à partir de - 5.300 ans
Néolithique moyen : à partir de - 4.500 ans
Néolithique final : à partir de - 3.950 ans
|
| - 7.500 : Sédentarisation en Europe, apparition de
l'agriculture (plantation de l'orge), de l'élevage, de la poterie, du tissage, et des
premiers mégalithes. |
| - 2.500 : Début
de l'âge du cuivre. |
| - 1.800 :
Installation des
Ligures en Europe occidentale. |
| - 1.600 : Début
de l'âge du bronze. |
| -
1.500 :
Installation de la civilisation des proto-celtes. |
| -
1.200
: Début de l'âge du fer. |
|
|

|
|
|
 |
|
En 2008 dans le XVe arrondissement (rue Farman), il était dévouvert par l'Inrap le premier peuplement de
chasseur/cueilleur, il y a 10.000 ans.
Et enfin, le premier parisien retrouvé ! (*) ou en l'état le doyen de la capitale..., dont il reste une mâchoire inférieure édentée (ci-contre, crédit Inrap)
(*) Une émission de France Culture, le Salon noir de Vincent Charpentier
avec Bénédicte Souffi, archéologue à l'Inrap, et Didier Busson,
département Histoire de l'Architecture et Archéologie de la ville de
Paris (2013 - durée 23 minutes) |
|
|
Dans le centre de Paris des
traces d'habitat rural et des sépultures
néolithiques ont été exhumés lors des fouilles du Louvre dans les
années 1980. D'autres indices avaient révèlé l'aspect artisanal en des silex
taillés déjà trouvés en 1912 place du
Châtelet, ou ce qui ressemblait à l'esquisse d'un atelier
préhistorique. De même pour les objets
retrouvés lors des fouilles de Bercy en 1991-1992 : pieux de
construction, des pierres polies, des outils en os et en bois
de cerf, des céramiques. Rien qui ne certifie vraiment une
présence dense, mais l'esquisse d'un début de
peuplement sédentaire (et à lire la page suivante sur les fouilles des entrepôts de Bercy).
|
|
|
Néolithique, 40 ans de découvertes : Cliquez ici
"La France d'avant la France" ou protohistoire de la France? :
|
Avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France et membre de l'Institut
Carbone 14 - France Culture du 01/07/2018 - durée 31 minutes |
|
|
|
« A
chaque fois que l'homo sapiens arrivait quelque part, il favorisait les
espèces qui lui étaient utiles, et éliminait les espèces qu'il jugeait
inutile. » De même pour l'archéologue et spécialiste de la protohistoire, Jean-Paul Demoule, auteur de : Mais où sont passés les Indo-Européens? (en 2017 chez Points), ce dernier précise que : « l'agriculture sédentaire a provoqué la sixième grande extinction des espèces. »
Au
néolithique, il y a environ moins 7.000 ans, à l'échelle
planétaire, les modes de développements ou d'échanges pouvaient variés d'un continent à un autre dans leur mise en œuvre : céramiques, poteries, mégalithes et agriculture. Et,
il est estimé à environ 1 million d'hommes et de femmes de
ces âges lointains, nous sommes aujourd'hui un peu plus de sept
milliards et face à des changements dont nous ne soupçonnons pas encore
les forces et les menaces présentes et futures. Loin d'être une période
calme, le néolithique a été source de nombreuses et nouvelles
difficultés que nos ancêtres communs à tous, d'ici ou d'ailleurs durent
affronter.
|
|
|
Au
néolithique de nouvelles essences
végétales firent jours en raison des
transformations climatiques. La rive droite parisienne a été
forestière et demeura un espace marécageux, pour
exemple lors des fondations de la mairie locale du 10ème
arrondissement de Paris en 1892, on retrouva diverses traces
d'animaux : cerfs, aurochs et daims.
Dans
son organisation géographique, la capitale actuelle se trouve dans une
sorte de demi cuvette relativement large, nommée Vallée de la Seine,
auxquelles se joignent celles de la Marne et de la Bièvre (cf. E.
Belgrand). Son territoire se compose de sept
collines
réparties sur les deux rives. Ces monticules ou petits monts
surplombent le paysage
de la capitale entre soixante et une petite centaine de mètres de
hauteur. Sur ces
hauteurs
(à l'abri) apparurent probablement des cultures
et des fermages après diverses vies minérales, puis animales.
|

|
|
| |
| Au milieu de cet espace
coule un fleuve, la Seine pas encore dénommée ainsi par les Romains (Sequana). Il se peut
que la pêche soit en
cohérence avec l'habitat, qui aurait pu être
d'abord lacustre. La plaine, quant à elle représentait la meilleure
voie de déplacement en ces temps reculés.
Pourquoi aller franchir des murailles ou frontières naturelles, quand il est plus simple de
circuler en terrain ouvert, notamment si l'on se déplace en
groupe, plus encore des armées. |
| |
Tout
dépend des raisons, elles furent dans cette partie de
l'île de France pour des besoins vivriers, puis agricoles de toute
évidence. La
Seine et ses affluents faisaient de
cette
région reconquise en terre de prairie, un lieu idyllique.
Des roches calcaires, de nombreux et importants cours d'eaux et des
sédiments marécageux furent utiles à
rassembler d'abord une faune stable et abondante, végétale (cueillette)
animale (chasse). Il est toutefois très probable que les espaces boisés
avec la présence d'humains sédentaires à partir du néolithique, plus
leurs constuctions en bois et les cultures réduire fortement les
ressources forestières. L'empreinte humaine allait se faire sentir et
transfomer l'environnement par un épuisement des ressources naturelles. Un mouvement qui ne fera avec le temps que se démultiplier.
Nos humains parents accédaient ainsi à l'actuelle région parisienne, mais
très progressivement, la nature était encore capricieuse. Nous savons des Hommes de la
protohistoire, l'existence ou la pré-existence de coutumes
religieuses, notamment de rites qui protégeaient des
éléments naturels. |
| |
|
|
Naissance de l'histoire rurale : "Et l'Occcident s'éveilla !" Cliquez ici
|
|
Avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France et membre de l'Institut
Carbone 14 - France Culture du 31/12/2017 - durée 31 minutes
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Cet espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation politique, ou
entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|
|