|

|
Cliquez
ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
 Amérique
Latine, Sommaire année
2010, page 1 Amérique
Latine, Sommaire année
2010, page 1
1
-
Vidéo, Mémoires Argentines, les
enfants volés,
Pantuana TV
2 - Le
paramilitarisme
toujours très actif en Colombie, HRW
3 - Le TLC entre
L’Union Européenne et
la Colombie remis en cause par l’Espagne
& -
Le TLC UE/Colombie,
pire que celui avec les USA ? Jorge
Enrique Robledo
4
- Haïti-Séisme
: L’interminable
tragédie, Castro Desroches
5 - De
la
discrimination
dans les opérations de secours ? Alterpresse Haïti
6 - Haiti-Séisme
: Repenser
l’État, Maryse
Noël Roumain
7 - Colombie : Terre
et Confilt,
extraction des ressources, Inter Pares
8 - Exorcisme
de
la culture de
l’impuissance, entretien avec Eduardo Galeano
9 - Conférence
Mondiale,
Changement climatique, Evo Morales
|
|
|
|
"Mémoires
Argentines, les enfants
volés"
Dans
le cadre de la
présentation du livre
"Punto Final" de Félicie
Dubois, le Collectif Argentin pour la Mémoire
ré-ouvre la question des
30.000 disparus sous la dictature du Général
Videla.(1976 -1982). Aux confins de l'auto-analyse et de
l'écriture,
Félicie Dubois tente de
poser un point final. Sofia, l'héroïne de son roman
a 22 ans. En
faisant un test ADN, elle va découvrir sa
véritable identité. Ses
parents ne sont pas ses parents biologiques.
Sous
la
dictature militaire de 1976 à 1982, on estime que 500
enfants ont été
volés (ou appropriés). À ce jour, ils
sont une centaine en Argentine
ayant pu découvrir qui ils étaient. Nous vous
invitons avec ce document
à mieux connaître un pan de la mémoire
des familles de disparus et les
crimes commis, pour bon nombre en attente d'un jugement des bourreaux.
Maison de l'Amérique
Latine à Paris, le 19 février
2010
|
|
|
|
|
Le paramilitarisme toujours très actif en Colombie
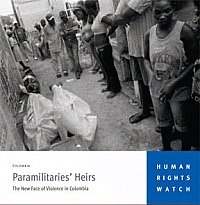
Human Rights Watch, le 3 février 2010
L'ONG
HRW lance un nouvel appel pour dire "halte aux exactions commises
par les groupes ayant succédé aux paramilitaires"
et précise que "le
gouvernement (colombien) doit protéger les civils et engager
des
poursuites contre les membres de ces groupes ainsi que leurs complices."
La Colombie doit prendre des mesures efficaces contre les
groupes
violents qui ont surgi dans tout le pays à la
suite de la
démobilisation incomplète des groupes
paramilitaires et qui sont
coupables de multiples atteintes aux droits humains, a
déclaré Human
Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui (3
février 2010, lire
tout le rapport en anglais cliquez
ici !).
Le rapport de 122 pages, intitulé «Paramilitaries
Heirs: The New Face
of Violence in Colombia » («Héritiers
des paramilitaires : Le nouveau
visage de la violence en Colombie »), documente les exactions
graves et
répandues commises par les groupes qui ont
succédé à la coalition
paramilitaire connue sous le nom de Autodefensas Unidas de Colombia
(Autodéfenses unies de Colombie, AUC). Ces groupes se
rendent
régulièrement coupables de massacres, de
meurtres, de déplacements
forcés, de viols ainsi que d'actes extorsion,
créant une atmosphère
lourde de menaces dans les communautés qu'ils
contrôlent.
Souvent, ils prennent pour cible des défenseurs des droits
humains, des
syndicalistes, des victimes des paramilitaires qui réclament
justice,
et des membres de la communauté qui n'obéissent
pas à leurs ordres. Le
rapport s'accompagne d'une présentation
multimédia comportant des
photos et des enregistrements audio de Colombiens pris pour cible par
les groupes qui ont succédé aux paramilitaires.
«Quel que soit le nom que vous donniez à
ces
groupes - paramilitaires,
gangs, ou tout autre nom - leur impact sur les droits humains en
Colombie aujourd'hui ne devrait pas être
minimisé», a indiqué José
Miguel Vivanco, directeur de la division Amériques
à Human Rights
Watch. «Tout comme les paramilitaires, ces groupes qui leur
ont succédé
commettent des atrocités épouvantables, et ils
doivent être stoppés.»
S'appuyant sur près de deux ans de recherches
menées sur le terrain, le
rapport décrit l'impact brutal de ces groupes sur les droits
humains en
Colombie, mettant en avant quatre régions où ils
ont une présence
considérable : la ville de Medellín, la
région d'Urabá dans le
département de Chocó, et les
départements du Meta et du Nariño.
Ces groupes représentent une menace croissante pour les
droits humains
dont peut bénéficier la
société colombienne. Selon les estimations les
plus prudentes avancées par la Police nationale colombienne,
ces
groupes comptent plus de 4 000 membres répartis dans 24 des
32
départements de la Colombie. Les groupes recrutent
activement de
nouveaux membres, et malgré les arrestations de certains de
leurs
chefs, ils s'empressent de remplacer ces dirigeants et
d'étendre leurs
zones d'opération.
La montée en puissance de ces groupes a
coïncidé avec une forte
augmentation des taux nationaux de déplacement interne
depuis 2004
jusqu'en 2007 voire au-delà. Une grande partie de ces
déplacements se
produit dans des régions où les groupes qui ont
succédé aux
paramilitaires sont actifs. Dans certains endroits, à
Medellín par
exemple, où le nombre d'homicides a presque
doublé durant l'année
dernière, les opérations menées par
ces groupes ont entraîné une
augmentation spectaculaire de la violence.
Le rapport documente de multiples exemples d'exactions commises par ces
groupes, notamment les suivants :
Alors qu'une défenseure des droits humains portait
assistance à une
victime des paramilitaires chez la victime à Antioquia, des
membres
d'un groupe se faisant appeler les « Aigles noirs »
ont fait irruption
dans la maison, ont violé les deux femmes et ont averti la
militante
qu'elle devait cesser ses activités en faveur des droits
humains. Elle
a dû finalement quitter la ville à cause des
menaces continuelles
émanant du groupe.
Plus de 40 personnes du quartier de Pablo Escobar à
Medellín ont dû
abandonner leurs logements entre fin 2008 et début 2009
à la suite des
meurtres et des menaces dont s'est rendu coupable un groupe
armé local,
en partie constitué de paramilitaires
démobilisés.
Dans le département de Nariño, près de
la frontière sud du pays, la
plupart des habitants de trois communautés de la
municipalité côtière
de Satinga ont été déplacés
après que l'un des groupes issus des
paramilitaires (utilisant alors le nom d'Autodefensas Campesinas de
Nariño, ou Forces d'autodéfense paysannes du
Nariño) estentré dans
l'une des villes, tuant deux jeunes hommes et causant semble-t-il la
disparition forcée d'un troisième.
L'émergence de ces groupes était
prévisible, a observé Human Rights
Watch, essentiellement en raison de l'incapacité du
gouvernement
colombien à démanteler les réseaux
criminels de la coalition
paramilitaire au cours du processus de démobilisation, entre
2003 et
2006. La mise en œuvre insuffisante des
démobilisations par le
gouvernement a également permis aux paramilitaires de
recruter des
civils se faisant passer pour des paramilitaires devant être
démobilisés, tout en conservant certains de leurs
membres en activité.
Le rapport décrit, par exemple, la démobilisation
du Bloc Nord, où il
existe des preuves substantielles de fraudes ordonnées par
le leader de
l'AUC, Rodrigo Tovar (connu sous le pseudonyme de «Jorge
40»).
Le rapport exprime aussi des préoccupations quant au fait
que les
activités des groupes issus des paramilitaires seraient
tolérées par
certains agents de l'Etat et des forces de
sécurité gouvernementales.
Des procureurs tout comme des officiers supérieurs de la
police ont
expliqué que cette tolérance constituait un
véritable obstacle à leur
travail. En outre, dans chacune des villes et des régions
où Human
Rights Watch s'est rendue, l'organisation a recueilli à
maintes
reprises des allégations d'une pareille tolérance
de la part des forces
de sécurité.
Au Nariño, par exemple, un homme s'est plaint que
« les Aigles noirs
nous interrogent, à vingt mètres des policiers...
On ne peut pas faire
confiance à l'armée ni à la police
parce qu'elles sont pratiquement
avec eux.» Dans la région d'Urabá, un
ancien fonctionnaire a indiqué
que la police d'une des villes semblait travailler avec les groupes
issus des paramilitaires : «Tout ça est
très évident... La police
contrôle les entrées et les sorties [de la ville]
et ... ils partagent
les renseignements.» Dans le département du Meta,
un fonctionnaire a
indiqué qu'il recevait « des plaintes constantes
selon lesquelles
l'armée menaçait les gens, disant que
‘les Cuchillos' [‘les
Couteaux', principal groupe paramilitaire de la région]
allaient
arriver... Dans certains cas, l'armée s'en va et les
Cuchillos
arrivent. »
Human Rights Watch a rappelé que le gouvernement colombien a
des
obligations légales de protéger les civils contre
divers dangers,
d'empêcher les exactions et, lorsqu'elles se produisent, de
garantir
que leurs auteurs soient tenus de rendre des comptes.
Toutefois le gouvernement n'a pas fait en sorte de garantir que les
unités de police chargées de combattre les
groupes, ou les procureurs
chargés de mener les enquêtes à leur
sujet, disposent de ressources
suffisantes. Il a tergiversé lorsqu'il s'est agi
de financer le
Système d'alerte précoce du Bureau de l'Ombudsman
(Médiateur), qui joue
un rôle crucial dans la protection des populations civiles.
Des
organismes gouvernementaux ont parfois refusé leur
assistance à des
civils qui signalaient avoir été
déplacés par des groupes armés. Le
gouvernement n'a par ailleurs pas pris de mesures efficaces pour
identifier les fonctionnaires qui auraient toléré
ces groupes, enquêter
sur leurs actes et les sanctionner.
«L'administration Uribe n'a pas traité l'essor des
groupes issus des
paramilitaires avec le sérieux que le problème
exige », a conclu José
Miguel Vivanco. « Le gouvernement a pris quelques mesures
pour
affronter ces groupes, mais sans fournir un effort soutenu et
significatif visant à protéger les civils, mener
des enquêtes sur les
réseaux criminels de ces groupes, saisir leurs avoirs et
traquer leurs
complices.»
|
|
|
|
Le
Traité de Libre Commerce
entre
L’Union Européenne et la Colombie remis en
cause par l’Espagne
|
Lionel Mesnard, le 1er
février
2010
C’est un grand revers
pour le Président Alvaro
Uribe Veléz et sa
politique de «sécurité
démocratique». «Nous ne pouvons pas
avoir un
Traité de Libre Commerce avec un pays qui ne respecte pas
les droits
humains». C’est en ces termes que des
élu(e)s espagnols jugent et
mettent en cause une possible signature du T.L.C (ou A.L.E : Accord de
Libre Échange) entre la Colombie et
l’Union Européenne en discussion depuis deux ans.
Il faut souligner que
la présidence espagnole de l’Union
Européenne, par le Premier ministre
Luis Zapatero a débuté le 1er janvier 2010 (1).
Une délégation de sept parlementaires
espagnols
s’est rendu en Colombie
du 23 au 30 janvier 2010. Ils ont rencontré des
fonctionnaires
gouvernementaux de la justice et diverses organisations civiles (dont
le MOVICE). Deux d’entre eux, Marian Suarez
(élue des Baléares,
centre
droit) et Jordi Pedret (du PSOE, parti socialiste) rendent compte
d’un
panorama sombre des droits humains en Colombie.
L’hebdomadaire Semana
(2) les a interrogés sur leur perception du pays suite
à cette visite.
Il en ressort un jugement sévère et
«ils ont demandé au final que le
gouvernement reconnaisse le conflit armé» (3).
Cette nouvelle est à la fois une bonne nouvelle et
une
surprise. Mais
nous ne pouvons oublier le rôle diplomatique qu’a
joué l’Espagne ces
dernières années pour l’obtention
d’un accord humanitaire concernant le
sort des otages civils et politiques aux mains des FARC. Il faut saluer
cette initiative et aussi se réjouir des conclusions car
elles
correspondent à l’attente de nombreux acteurs
sociaux et politiques de
la paix en Colombie (4). Pour autant, il reste maintenant aux instances
de l’U.E. de mettre un terme définitif aux
négociations et de mettre en
oeuvre des initiatives en faveur d’un cessez-le-feu et pour
l’ouverture
de négociations avec tous les acteurs de cette
guerre:
gouvernement
colombien, FARC, ELN.
Il est plus que temps que nous prenions conscience en Europe
d’un des
plus vieux conflits armés dans le monde. Existant depuis
1964, depuis
1991, il n’a fait que s’amplifier. Cette guerre
touche régulièrement
des personnalités civiles, tout particulièrement
ces dernières années
des syndicalistes, des journalistes, des militants des droits de
l’Homme, des enseignants, des responsables paysans
amérindiens ou de
communautés afro-colombiennes. Et sans oublier des dizaines
de milliers
d’anonymes, hommes et femmes, dont il faudra bien un jour que
l’on
reconnaisse le fait d’avoir été
victimes de crimes de guerre et aussi
de crimes de contre l’humanité.
Tel pourrait être est l’enjeu d’une paix
durable, et les bases d’une
réconciliation nationale, à la condition de faire
face à une mémoire ou
l’État a tout fait ces dernières
années pour nier les évidences et les
réalités. Un millier de personnes par jour en
2008 sont devenues des
réfugiés et sont venues croître les
plus de 3 millions de personnes
déjà sinistrées, et pour la
très grande majorité se trouvant sans
aucune aide et dans le dénuement le plus total. Selon une
enquête
récente cinq millions sept cent mile colombiens vivent en
dehors de
leur pays sur une population totale de 45 millions (soit plus de 10%).
Et l’on remarque une fuite massive des classes moyennes,
chaque année
par milliers des
gens diplômés n’ont que pour ambition
que d'aller vivre en
paix et en démocratie (rien que pour la France
près de 50.000
colombiens y résident, dont de nombreux
réfugiés sociaux et
politiques).
La Colombie ne devrait plus échapper à un moment
donné à une
condamnation des plus grandes instances internationales (ONU, UE, TPI,
CSI).
Semble-t-il, l’étau se resserre. Le Tribunal
Pénal
International est
maintenant en mesure depuis fin 2009 de statuer sur les
atrocités
commises par tous les acteurs du conflit. Il est à
noter,
que le
nombre en 2009 de «faux positifs»,
c’est-à-dire de jeunes civils
enlevés dans les centres urbains et tués par les
forces
armées du pays
a chuté en flèche, et ne concerne plus que
quelques cas
ces derniers
mois (environ 1500 jeunes hommes assassinés sur les
années 2007 et
2008). L’objet caché était de gonfler
les
statistiques sur le nombre de
guérilleros abattus par l’exercice national, et au
passage
vanter la
politique de «sécurité
démocratique»
du président Uribe et de son ancien ministre de la
défense, Juan
Manuel
Santos. (*)
Notes :
(*)
Erratum : dans le texte d'origine il était fait part du
vice-président, il s'agissait en fait de l'ancien ministre
de la
Défense et actuel président du Parti social
d'unité nationale (à ne pas confondre avec
Franscisco
Santos, vice-président depuis 2006).
1) "La délégation (…)
coïncide avec le semestre pendant lequel le
Gouvernement espagnol à en charge, la Présidence
du Conseil de l'Union
Européenne et la célébration, en mai
à Madrid, du Sommet de Chefs
d'État de l'Amérique latine et l'Union
Européenne. Par cela, elle
accorde et donne une place importance pour que les Droits de l'homme en
Colombie soient présents dans l'agenda politique espagnol et
européen",
et le précise dans la déclaration
émise par les parlementaires à la fin
de sa visite.
(Semana.com)
(2) lien en langue espagnole de l’entretien avec les 2
parlementaires
espagnols sur Semana.com :
(3) Texte final de la
délégation en castillan :
(4) Pour rappel (février 2009), un texte du
sénateur
Jorge Enrique Robledo du parti Démocratique et Alternatif de
Colombie :
|
|
|
L'ACCORD DE
LIBRE-ECHANGE ENTRE LA COLOMBIE ET L’UE
:
PIRE
ENCORE QUE CELUI QUI A ETE NEGOCIE
AVEC
LES ETATS UNIS ?
Par Jorge Enrique Robledo,
sénateur,
Bogotá, le 19 février 2009
Le gouvernement colombien et
l’Union
européenne
sont en train de
négocier un accord de libre échange. Il y a bien
des raisons de croire
que les colombiens, en tout cas presque tous, en souffrirons des
conséquences aussi graves, ou pires, que celles qui furent
accordées
dans le cadre du Traité de Libre Echange signé
avec les Etats-Unis, un
accord léonin qui n'a pas heureusement
été ratifié par le Congrès
nord-américain parce que la majorité du parti
Démocrate, et le
gouvernement de Barack Obama lui-même considèrent
que sont
insuffisantes les explications et les agissements du gouvernement du
président Alvaro Uribe en ce qui concerne les assassinats
des
syndicalistes: il y en a eu 49 en 2008, soit 25% de plus
qu’en 2007.
Ces assassinats confirment que la Colombie est le pays le plus
dangereux du monde pour les dirigeants syndicaux. A cela
s’ajoute les
scandaleuses violations de droits humains commises par des membres de
l’armée colombienne, et les relations
de nombreux hauts
dirigeants
politiques proches du gouvernement avec les organisations
d'escadrons
de la mort, aussi appelés groupes
paramilitaires.
L’Union européenne prétend
prolonger la
durée des brevets qui créent
des monopoles et des augmentations de prix au-delà de ce que
prévoient
les normes de l’OMC et au-delà des avantages
obtenus par les Etats-Unis
dans le cadre de l'ALE qu'ils ont négocié avec le
gouvernement
colombien, et qui ont pourtant signifié des hausses de prix
des
médicaments d'un milliard de dollars par an, selon les
calculs de l'
Organisation panaméricaine de la Santé. Et il est
proposé que la
Colombie accepte ce que le capital transnational n’a jamais
obtenu
précédemment, ni en Europe ni nulle part ailleurs
dans le monde:
l'imposition de peines de prison pour toute violation des
droits
de
propriété intellectuelle. Si l'ALE
Colombie-Etats-Unis est un accord
OMC plus, celui que veut passer l’Union Européenne
avec la Colombie
doit être appelé OMC plus plus. En toute
tranquillité le ministre
colombien de commerce, Luis Guillermo
Plata, a avoué: "Il y a des lignes rouges dans ces
négociations (ave
l'UE) qui sont les mêmes que celles de l'ALE
négocié avec les
Etats-Unis, et la Colombie n'ira pas au delà"
Avec de tels porte-paroles, il n’est pas surprenant, que les
parties
aient convenu de conclure cet accord en quatre mois à peine,
et que,
comme ce fut le cas avec les nord-américains, les textes
aient été
négociés dans le plus grand secret et sans tenir
compte de l'avis des
organisations de travailleurs, paysannes et indigènes.
Tout comme ce fut le cas avec les Etats-Unis pour leur ALE,
l'Union
Européenne a imposé que les
négociations soient menées
séparément avec
chacun des pays de la région andine. De sorte que la
Communauté Andine
des Nations (CAN), le projet d'intégration entre les pays de
la
sous-région, sera encore plus affaibli qu'aujourd'hui. Que
l'Union
Européenne n'appelle pas sa proposition "Traité
de Libre Commerce
(ALE)" mais "Accord Commercial" ne correspond qu'à un
changement de nom
calculé pour tromper les millions de Colombiens qui
rejettent l'ALE
avec les Etats-Unis.
Comme dans le cas des États-Unis, les différences
économiques entre la
Colombie et l'Union Européenne sont incommensurables. Par
exemple, le
PIB de l'UE est 80 fois supérieur à celui de la
Colombie et ses
subventions agricoles atteignent les 70 milliards de dollars par an.
L’égalité entre les parties que
proclamera l'ALE n’est rien d'autre que
la consécration d'une énorme
inégalité. Le Traité accordera aux
entreprises transnationales de l'Union Européenne le droit
d'aller en
Colombie pour s’emparer des grandes entreprises, des
ressources
naturelles et du marché intérieur, et cela
gratuitement, c'est à dire
sans devoir payer pour cette prérogative, rien de plus de ce
qui est
demandé aux colombiens eux-mêmes. Les dommages
causés par les capitaux
entrant et sortant de Colombie, les dégâts
causés à l’environnement et
les pires conditions de travail qui soient font aussi partie des bonnes
affaires recherchées par les investisseurs
européens.
Il est choquant que, alors même que se confirme la
responsabilité du
"libre commerce" comme cause de ce qui sera sans doute retenu dans
l'histoire comme la pire crise de l'histoire du capitalisme, les
gouvernements de l’Union Européenne et de la
Colombie insistent pour
approfondir cette politique. Ils confirment ainsi que les gouvernants
des deux parties sont disposés à
élever les souffrances de leurs
peuples à des niveaux inimaginables.
Il est clair que l’Union Européenne, sachant bien
combien le
président
de la Colombie, Alvaro Uribe, a besoin de la signature d'un ALE pour le
faire apparaître comme une absolution morale et politique,
saura faire
payer le prix d'une telle absolution en privilèges pour ses
entreprises
transnationales, en allant même au-delà de ceux
qu'ont obtenu les
Etats-Unis dans leur ALE avec la Colombie
|
|
|
|
|
Haïti-Séisme
: L’interminable tragédie
Par Castro Desroches, le 22 janvier 2010
Le terrible tremblement de terre qui vient de dévaster
Port-au-Prince et certaines villes de province a suscité
à travers le monde un vaste mouvement de
solidarité et de
compassion envers le peuple martyr d’Haïti. Le
président américain Barack Obama a
réagi
immédiatement en créant une Commission
d’urgence
dirigée par ses deux prédécesseurs
George W. Bush
et Bill Clinton. Le président du
Sénégal,
Abdoulaye Wade, a officiellement offert de mettre une région
fertile de son pays à la disposition des Haïtiens
désireux de trouver refuge en dehors des
frontières
nationales. Dans un élan humanitaire remarquable, des
secouristes venus de toutes parts ont répondu à
l’appel de ce petit pays qui ne semble pas pouvoir atteindre
une
ère de répit après plus de 500 ans de
turbulences
coloniales et postcoloniales.
Des millions de
dollars ont été déjà
débloqués par la communauté
internationale en vue
de financer le vaste mouvement de sauvetage qui se fait actuellement
sur le terrain. Pour la grande majorité des observateurs,
Haïti a besoin d’une aide matérielle
massive et
urgente en vue de limiter les dégâts humains qui
s’élèvent déjà
à un nombre
incalculable de victimes. Au-delà de
l’immédiat, un
travail titanesque de reconstruction sera nécessaire en vue
de
rendre fonctionnel le pays haïtien. A un tournant aussi
dramatique, le rafistolage ne suffira pas. Aux grands maux, les grands
remèdes.
En attendant des lendemains
moins pénibles, chaque jour apporte dans la diaspora
haïtienne sa litanie de nouvelles «
imbibées de sang.
» Nouvelles de destruction, de pertes en vies humaines et de
famine. Images technicolors de la lutte dérisoire pour la
survie
au milieu des ruines. Images apocalyptiques d’une
Haïti
ravagée par un fléau encore plus
dévastateur que
les pires dictatures de notre tumultueuse Histoire. Les
Haïtiens
de l’étranger redécouvrent avec horreur
l’étendue du dénuement qui frappe
«
l’amère patrie. » Un sentiment
d’impuissance,
de malaise et de culpabilité vient s’ajouter
à la
tristesse que provoque le spectacle de tant de malheurs. Comment
avons-nous permis à un si beau pays de descendre si bas ?
Aucun
Haïtien ne pourra désormais se dédouaner
de ses
responsabilités dans la débâcle
nationale.
Avec cette catastrophe Haïti devient davantage un pays en
faillite, un pays assisté, sinistré et
dépendant
de la bonne volonté de la communauté
internationale.
Haïti va-t-elle s’enfoncer
irrémédiablement
dans sa douloureuse agonie ? Va-t-on assister au contraire à
un
sursaut national en vue d’engager ce pays vers la voie de la
modernité ?
Aujourd’hui, les
puissances amies d’Haïti se battent pour la
distribution de
l’aide humanitaire. La France a même
accusé les
États-Unis de vouloir imposer sinon une occupation, du moins
un
monopole dans la logistique des opérations de sauvetage.
C’est la ruée vers Haïti. Aucune
puissance qui se
respecte ne veut être accusée
aujourd’hui de
non-assistance à pays en danger. Qu’en sera-t-il
demain
lorsque les caméras de la télévision
étrangère seront fatiguées
d’enregistrer les
mêmes images déprimantes de misère
extrême et
de désolation ?
Ce qui est
évident, c’est que l’avenir de ce pays
ne semble pas
très radieux si l’on tient compte du comportement
énigmatique de ce qui tient lieu de gouvernement en
Haïti.
Refugié dans son solennel silence, le président
René Préval semblait avoir tout bonnement disparu
dans
les décombres. Il a finalement refait surface
miraculeusement
à l’Aéroport international de
Port-au-Prince sous
les yeux étonnés des journalistes de la CNN. Pour
un peu,
on aurait cru qu’il s’apprêtait
à prendre le
premier avion en partance pour Miami, « son »
palais et sa
résidence privée ayant été
détruits.
Le président Préval aura beau clamer et proclamer
qu’il est encore vivant. L’impression
générale, c’est que symboliquement, il
a disparu
avec le Palais National.
Le moment
n’est certainement pas à la polémique
mais un peu
plus de leadership serait dorénavant
particulièrement
apprécié. Ne serait-ce que pour sauver les
apparences.
Autrement, au-delà de la tragédie, nous risquons
de
passer davantage pour une caricature de pays. Une grande savane
désolée dirigée par des zombis en
cavale.
La générosité des partenaires
internationaux et
des sympathisants à la cause haïtienne est plus
qu’évidente. Cependant, sans vouloir sombrer dans
un
nationalisme étroit, il s’agit en fin de compte de
notre
pays à nous. Nous ne pouvons plus continuer à
demander
aux étrangers d’être plus
haïtiens que les
Haïtiens eux-mêmes.
Haiti-Séisme
: De la discrimination
dans
les
opérations de secours ?
Dépêche
du 22
janv. 2010 [AlterPresse] - Un sauveteur colombien
affirme à la presse colombienne que les équipes
de secours déployés en
Haiti suite au puissant séisme du 12 janvier ont
reçu l’ordre de
vérifier si les cadavres rencontrés
étaient ceux de Blancs ou de Noirs.
«Il y a du racisme dans les opérations de secours
en Haiti», dénonce
Camilo Monroy dans des déclarations faites à
Radio W et rapportées par
le quotidien El Tiempo.
Monroy, étudiant en photographie qui
a intégré une délégation de
la défense civile et du personnel médical
militaire colombiens, a fait part de ses frustrations dans son travail
de secouriste à Port-au-Prince.
Le premier choc reçu a été
le 15 janvier dans l’aéroport international
Toussaint Louverture, où un
citoyen noir a été, selon lui,
abandonné sur la piste sans aucune aide.
« Il y a avait cette personne brûlée
à 80%, abandonnée sur la piste
sans aucune aide et ils ne sont pas allés la sortir, alors
qu’il y
avait deux personnes blanches à
l’intérieur de l’aéroport,
légèrement
blessées seulement, avec trois docteurs à leurs
côtés et des pansements
sur la tête », affirme-t-il.
Camilo Monroy soutient que les
secouristes ont reçu l’ordre de
vérifier si les cadavres rencontrés
étaient blancs ou noirs, sans pouvoir identifier
l’origine de cet ordre.
« S’ils étaient noirs ils les
laissaient, s’ils étaient blancs ils les
sortaient aussi vite que possible. Si nous n’arrivions pas
à les
reconnaître, on sortait une main et on prenait des empreintes
».
Le secouriste colombien a également émis des
critiques sur la gestion
des secours. Selon lui, « les opérations
à l’hôtel Montana, un des plus
importants de la capitale et dans lequel descendaient
d’importantes
personnalités, ont été interrompues
quand un général chilien, qui fait
partie de la mission de l’ONU, a ordonné de
chercher son épouse, qui
était hébergée dans
l’immeuble, sans se préoccuper de la
présence ou
non de plus de gens sous les décombres ».
D’autre part, il a
fait remarquer qu’ « il n’ y a pas
d’hôpital pour soigner les blessés,
mais au siège de l’ONU, où
étaient les cameras de télévision, il
y
avait 600 secouristes pour sauver une seule personne ».
Le
séisme survenu le 12 janvier à Port-au-Prince et
dans quelques autres
villes de l’Ouest et le Sud-est d’Haiti a fait des
dizaines de milliers
de morts, 250.000 blessés et d’innombrables
dégâts matériels.
|
|
|
|
Haiti-Séisme
: Repenser l’État
Par Maryse Noël
Roumain, le 21
janvier 2010
«
Le
rôle de l’Etat est multifunctionnel et dynamique
plutôt que singulier
et statique » (1)
Il faut bien l’admettre : le tremblement de terre du 12
janvier
2010 en Haïti a provoqué l’effondrement
de notre
capitale et d’autres régions du pays, causant
morts,
blessés, sans abris et traumatises. Mais il a aussi comme
résultat et comme constat : l’effondrement de
l’État.
C’est d’un
État fragile qu’il s’agit. Un
État ayant du
mal à se démocratiser et étant
incapable de
développer les infrastructures nécessaires et
d’organiser l’offre de services de base
à sa
population. Un État qui avec peine commençait
à
rétablir la sécurité avec ses 14.000
policiers et
l’aide des Nations Unies. C’est cet État
en faillite
qui serait appelé à faire face à
l’immense
tache de reconstruction du pays.
Il nous
faut, pour répondre aux besoins du pays et de la population,
profiter de l’opportunité pour repenser et
redéfinir l’État.
De quel
État avons-nous besoin ?
Nous avons besoin d’un État capable de faire face
à
la situation grave et complexe dans laquelle le pays et le peuple
d’Haiti se trouvent aujourd’hui suite au
désastre du
12 janvier dernier. Dans cette nouvelle conjoncture, il nous faut
dépasser toute vision réductrice car
l’État
ce ne sont plus les occupants du palais présidentiel
d’ailleurs sérieusement endommagé et
désaffecté, ce ne sont plus les
différents
ministères réduits en poussière et
leur personnel
désorganisé et désorienté,
ce ne sont plus
les sénateurs, les députés et le
personnel du
corps judiciaire incapables de fonctionner. Ce n’est
même
plus le corps de police en formation. L’État, ce
devrait
être l’ensemble des forces vives et saines de la
nation
organisées autour des taches de reconstruction et de
leaderships
compétents et dévoués à la
cause du pays.
Le consensus aujourd’hui est qu’un État
performant
est une condition nécessaire à la reconstruction
et au
relèvement des pays ou l’État a failli.
Cette
vision est encore plus valable dans les circonstances actuelles.
La société civile
La société civile organisée et
à organiser
doit être amenée à participer aux
taches de
l’État plus que jamais fragilisé et
défaillant si nous voulons éviter et contenir le
chaos et
la violence anarchisante et être capables de nous atteler
à la tache en tant que partenaires de la
solidarité
internationale qui s’offre à nous
aujourd’hui si
généreusement.
Sortir de la
mentalité « lakou »
La vision de l’État en tant
qu’instrument d’un
pouvoir personnel au service d’un clan ou d’un
petit groupe
doit s’effacer pour céder la place à un
État
démocratique au service de la collectivité. Il
nous faut
sans tarder sortir de la logique de « chasse
gardée
», de la mentalité « lakou »,
qui ont
marqué nos gouvernements trop souvent dictatoriaux et
prédateurs. Il nous faut plutôt favoriser la
collaboration
et la coopération par la mise en commun des ressources et
des
compétences. Il faut une synergie des compétences
et des
ressources.
Entrer dans la modernité
L’opportunité s’offre à nous
d’entrer
aujourd’hui dans la modernité par le
dépassement
des éléments négatifs de notre
mentalité et
de nos pratiques, causes de notre sous-développement
chronique
et de la faillite de nos institutions.
Entrer
dans la modernité, c’est aboutir à la
conception et
la constitution d’une autorité centrale
compétente
et démocratique de gestion et
d’exécution ;
c’est avoir une administration publique performante,
soucieuse
d’une culture de résultats ; non corrompue,
efficiente,
transparente et comptable ; c’est penser la
préparation et
le renouvellement des cadres par la formation dans le but
d’assurer la reconstruction et de créer un nouveau
leadership ouvert sur le monde et conscient de ses
responsabilités personnelles et sociales, avec la
capacité de solutionner les problèmes complexes
qui se
posent.
Identifier
nos forces
L’opportunité se présente
d’identifier nos
forces et nos faiblesses afin de pouvoir capitaliser sur les
premières et éradiquer les dernières.
Nos forces,
c’est notre culture qui représente un potentiel
pour le
développement d’activités
créatrices de
richesses et le renouvellement de notre identité et de notre
dignité ; ce sont nos ressources humaines, notre capital
humain
dans lequel il nous faut davantage investir en mettant sur pied des
programmes d’éducation de qualité et en
se souciant
de la santé de la population comme de son
bien-être ; nos
forces, c’est notre éthique de travail sur
laquelle nous
devons reposer pour créer des emplois, de la richesse et des
biens.
Utiliser nos ressources au sens large
Les ressources financières externes ne sont jamais
suffisantes
en elles-mêmes pour catalyser le développement
durable. Il
faut envisager les ressources dans le sens large. Notre pays quoique
pauvre possède des ressources potentielles et par le pouvoir
de
l’imagination peut en créer de nouvelles. (Ghani
et Al,
2008).
Il ne faut pas négliger par
exemple les contributions de nos expatriés qui peuvent
investir
dans le pays d’une façon plus profitable. La
richesse de
notre secteur privé qui, à l’heure
actuelle, est
exportée peut être investie dans la
création
d’emplois dans le pays même, en collaboration avec
l’investissement étranger dont
l’intérêt se manifeste. Et, par-dessus
tout, la
résilience, la créativité et la grande
capacité d’adaptation de notre peuple peuvent
être
mises à contribution de même que sa
volonté de
participation par le travail, le bénévolat, qui
doit
être récompensée à sa juste
valeur.
Notre force réside aussi dans la valorisation que nous
accordons
en tant que peuple à l’éducation
conçue
comme moyen de la mobilité sociale et de la
réussite. Il
est plus que temps d’encourager ces valeurs positives qui
tendent
à se perdre.
Encadrer et
mobiliser nos jeunes
Notre jeunesse, qui représente plus de 60% de la population,
livrée à elle-même,
représente notre avenir.
Elle devrait être encadrée,
préparée,
formée et mobilisée. Elle doit
s’impliquer,
participer à travers ses organisations dans les taches de
reconstruction et de développement. Notre jeunesse est la
source
d’où viendront les leaders et les cadres de demain
qui
prendront en charge la relève devant assurer la
réalisation et la continuité de la reconstruction.
Supporter et encourager nos compétences
Notre potentiel de leadership, nos talents et nos intelligences, ne
peuvent être abandonnés : « leadership
needs to be
nurtured at all levels of society, in government and business, from the
village to the presidency, the workshop to the boardroom”
(ibid).
Nos leaders, nos compétences doivent être
appelés
à participer et à donner le meilleur
d’eux-mêmes et d’elles-mêmes.
La valorisation
du mérite et de l’excellence doit être
priorisée ; la criminalité,
l’immoralité et
l’impunité condamnées et combattues.
Notre nation et la communauté globale sont à un
moment
critique. Un défi se présente à nous
qui nous
pousse à questionner nos façons
établies de
concevoir et d’agir. Notamment notre compréhension
de
l’État et les pratiques qui en
découlent. La
façon dont nous posons les problèmes et les
solutions que
nous proposerons détermineront notre succès ou
notre
échec.
Nous devons pouvoir saisir les
opportunités qui s’offrent à nous.
Notre nation a
sans aucun doute besoin de la solidarité internationale et
de la
constitution d’un fonds de reconstruction estimé
à
plusieurs milliards de dollars, mais elle possède aussi
d’autres capitaux tels que sa culture, ses ressources
humaines,
sa volonté de travailler …qu’il faut
aussi
considérer et utiliser pour créer un
État
performant qui servira de véhicule à la
prospérité et à la
sécurité ; sinon
nous serons toujours dans la spirale de la pauvreté et de
l’instabilité.
Note
:
(1) Ghani,
A. & Lockhart, C., Fixing Failing States, a Framework for
Rebuilding a Fractured World, New York : Oxford University Press. 2008.
|
|
|
|
|
|
Terres et conflit : extraction
des ressources
Par
Inter Pares, septembre 2009
droits
de la personne et responsabilité sociale des entreprises :
les
sociétés canadiennes en Colombie
Nécessité
de l’étude
L’investissement
étranger direct canadien en Colombie a augmenté
sensiblement depuis les années 1990, notamment dans les
télécommunications, les mines et
l’extraction de
combustibles fossiles. Les sociétés
minières et
pétrolières canadiennes jouent un rôle
majeur en
Colombie. Les zones où se concentrent leurs
activités,
riches en minerais et en pétrole, ont
été –
et sont toujours – aux prises avec la violence, les
déplacements de population et les activités
paramilitaires. De fait, c’est dans les régions
riches en
ressources que l’on constate 87 % des déplacements
forcés, 82 % des violations des droits de la personne et du
droit humanitaire international, et 83 % des meurtres de dirigeants
syndicaux. La gravité de la violence et la
présence de
groupes armés illégaux font craindre que
l’investissement canadien profite du conflit ou
qu’il en
soit complice. Maria McFarland Sánchez-Moreno,
principale
chercheuse pour les Amériques de Human Rights Watch, a
déclaré dans son témoignage devant le
Congrès des É.-U. le 12 février 2009 :
«
Malgré le tableau idyllique de la situation des droits de la
personne que brossent souvent des représentants de
l’État colombien, il y a encore
aujourd’hui en
Colombie des violations généralisées
des droits de
la personne – exécutions extrajudiciaires de
civils,
disparitions forcées, enlèvements, utilisation
d’enfants-soldats et de mines antipersonnel, extorsion et
menaces. Le controôle des terres, de la
main-d’œuvre et des ressources naturelles fait
partie
intégrante de la guerre et de la violence en Colombie et le
pays
a été le théâtre de
déplacements et
de meurtres massifs à des fins économiques et
politiques
au cours des dernières décennies. Il y a des
corrélations frappantes entre les sites
d’investissement
(national et étranger) et les violations des droits de la
personne, à partir des meurtres et massacres
jusqu’au vol
massif des terres et de la propriété, en passant
par les
violations du droit de circuler librement et du droit à un
environnement sain.
|
|
|
|
«
L’Amérique Latine exorcise
la
culture de l’impuissance »

Interview
d’Eduardo Galeano, le 8 janvier 2010
L’auteur
et le journaliste uruguayen Eduardo Galeano consacré il y a
presque 40 ans avec le livre "Les veines ouvertes de
l’Amérique latine", l’oeuvre que le
président
vénézuélien, Hugo Chavez, a choisie de
donner
à son homologue américain , Barack Obama. Mais la
fascination que Galeano éveille subsiste
jusqu’à
aujourd’hui. Un témoignage quotidien de cette
admiration :
pendant l’entrevue, qui s’est
déroulée dans
un café de Buenos Aires, un homme s’est
approché
avec discrétion avec sa fille et il s’est assis
à
une table proche pour pouvoir l’écouter. Son
dernier livre
"Miroirs", parle d’un monde contradictoire qui a de la peur
de se
voir, et de se reconnaitre.
Comment
vous définissez l’Amérique latine ?
C’est
une terre de rencontres de beaucoup de diversités : de
culture,
religions, traditions, et aussi de peurs et d’impuissance.
Nous
sommes différents dans l’espoir et dans le
désespoir.
Comment cette variété influence le
présent ?
Durant
ces dernières années il y a un processus de
renaissance
latino-américaine dans lequel ces terres du monde commencent
a
se découvrir elles-mêmes dans toute leur
diversité.
Ce que l’on a appelé découverte de
l’Amérique a été, en
réalité,
une dissimulation de la diversité de la
réalité.
L’Amérique est l’arc-en-ciel terrestre,
qui a
été mutilé durant quelques
siècles de
racisme, de machisme et de militarisme. Ils nous ont laissé
aveugles de nous-même. Il est nécessaire de
récupérer la diversité pour
célébrer
le fait que nous sommes plus [NDT : divers, riches, complexes] que ce
qu’ils nous ont dit.
Cette
diversité peut-elle être un empêchement
pour l’intégration ?
Je
crois que non. Toute unité fondée sur
l’unanimité est une fausse unité qui
n’a pas
d’avenir. La seule unité digne de foi est
l’unité qui existe dans la diversité et
dans la
contradiction de ses différentes parties. Il y a un triste
héritage du stalinisme qu’on a appelé
"socialisme
réel" tout au long du 20° siècle, cela a
trahi
l’espoir de millions de personnes justement parce
qu’on a
imposé ce critère, celui que
l’unité
c’est l’unanimité. On a confondu ainsi
la politique
avec la religion. On a appliqué des critères qui
étaient habituels dans les temps de la Sainte Inquisition,
quand
toute divergence était une hérésie
digne de
punition. Cela est une négation de la vie. C’est
un sort
de cécité qui t’empêche de te
mouvoir parce
que le moteur de l’histoire humaine est la contradiction.
La
diversité peut-elle établir des chemins
irréconciliables de vie ?
Non
jamais. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de la
vérité de la vie. Il faut la
célébrer,
parce que meilleur de la vie c’est sa diversité.
Le
système qui domine la planète nous propose une
option
très claire. Il faut choisir, de voir si tu
désire mourir
de faim ou d’ennui. Je ne veux mourir d’aucun des
deux. Le
système dominant d’aujourd’hui nous
impose une
vérité une seule, une seule voix, la dictature de
la
pensée unique qui nie la diversité de la vie et
qui par
conséquent la rétrécit, elle la
réduit
à presque rien. Le meilleur de ce que le monde a
réside
dans la quantité de mondes qu’il loge, et cela
vaut
à son tour pour l’Amérique latine. Le
meilleur
d’elle c’est la quantité des
Amériques
qu’elle contient.
Vous
parliez d’une redécouverte
latino-américaine. Un exemple ?
La
Bolivie, avec Evo Morales, elle a redécouvert sa
diversité avec beaucoup de dignité et avec la
fierté de dire : « Nous sommes divers, et sommes
indigènes. Mais non seulement indigènes. Nous
sommes
divers ». Il est évident que la Bolivie est un
pays comme
le Paraguay, et jusqu’à un certain point
l’Uruguay,
soumis dans une certaine mesure au poids asservissant des grands
voisins, et surtout du Brésil, qui s’oppose
actuellement
à ce que chaque pays ait un vote dans la Banque du Sud.
Quelle
est la force de ce projet ?
La
Banque du Sud est la base financière de
l’unité
latino-americaine, un projet de Chávez certainement. Il est
né comme une réponse à la dictature
financière du Fonds Monétaire International et de
la
Banque Mondiale, où n’existe pas le
système «
d’un pays, un vote ». Les votes
dépendent du capital
investi : tant d’argent, tant de votes, de sorte que le Fonds
est
dirigé par cinq pays, et la Banque par huit, même
si
l’un est appelé Mondial et l’autre
International.
Peut-il
récupérer un fonctionnement
démocratique ?
C’est
très difficile, pour la simple raison que la
démocratie a
été plus formel que réelle dans les
processus
historiques latino-americains. Et dans les démocraties, pour
qu’elles le soient vraiment, elles ne doivent pas
régir
des relations verticales ou hiérarchiques, où il
y a une
autorité et des exécutants. Elles doivent
être
horizontales, solidaires, égales entre elles capables de se
respecter et de se reconnaître, parce que la
vérité
c’est que nous ne nous connaissons pas. Nous devons nous
connaître pour commencer à nous
reconnaître, pour
savoir tout ce que nous pouvons apprendre de l’autre. Depuis
la
conquête espagnole nous avons été
formés par
des empires successifs à l’ignorance mutuelle, au
divorce
et à la haine mutuelle. La spécialité
latino-americaine est la guerre entre voisins.
Le
Brésil peut faire valoir que, puisqu’il est plus
grand, il doit avoir
davantage de voix ?
Cela
part de la base dont la grandeur coïncide avec grandiloquent.
Mon
expérience m’a enseignée que la
grandeur
n’habite pas le grandiloquent. Elle est dissimulée
dans
les gens anonymes, dans le jour après jour qui
paraît
insignifiant et indigne d’attention. Le grandiloquent est
généralement très mesquin et avec un
petit esprit.
Je ne veux pas dire que le Brésil ait un petit esprit, mais
il
ne faut pas confondre où est la grandeur
brésilienne, qui
réside parmi les moins bien traités de ses
citoyens.
Des
héros anonymes ?
Dans
une conversation on m’a demandé quel
était mon
héros préféré.
J’ai dit : « Le
jour où j’allais à
l’aéroport pour
entamer ce voyage j’ai pris un taxi, et j’ai
discuté
avec le conducteur. Le chauffeur travaillait dans le taxi entre 10 et
12 heures par jour, mais ensuite il avait un autre emploi. Il dormait
entre trois et quatre heures par jour pour donner à manger
à son fils. Pour lui les dimanches n’existaient
pas, il ne
se rappelait pas non plus à quoi ils ressemblaient
».
Celui-là est mon héros
préféré.
Avant
on disait que le moteur de l’histoire humaine est la
contradiction. Croyez-vous qu’il y ai des contradictions
nuisibles ?
Il ne doit pas être ainsi. Toute
contradiction est un signal de mouvement. En effet il y a des
injustices objectivement nuisibles. En Amérique latine,
l’abîme qui sépare ceux qui ont de ceux
qui sont
dans le besoin, à la minorité dominante de la
majorité dominée, est chaque fois plus grand.
L’Amérique Latine est une région
inégale
dans un monde chaque fois plus injuste, où ceux qui sont
affamés dépassent le milliard de personnes.
Observe-t-on
de nos jours un changement significatif en Amérique latine ?
Oui.
Il se produit quelque chose de très beau, qui est une sorte
d’exorcisme collectif des vieux démons. Et
d’autres
nouveaux aussi. Un de ceux qu’a laissé
l’héritage colonial a été la
culture de
l’impuissance, qui te met l’idée dans la
tête
que « il n’est pas possible » de changer
les choses.
Et cela vaut pour les pays pauvres et pour ceux qui sont riches. Parce
que le Vénézuéla est un pays
objectivement riche,
il a du pétrole, mais ce concept de l’impuissance
y a
été intériorisé
c’est un fait contre
lequel le pays essaye maintenant de combattre. C’est un
combat
difficile, parce que la culture du pétrole forme pour
acheter et
non pour créer.
Qu’est-ce
que vous voulez dire ?
On
te forme avec l’idée qu’il ne faut pas
travailler
pour créer des choses si l’on peut les consommer.
C’est la culture de consommation, non de création.
Née de la culture de l’impuissance, qui est la
pire des
héritages coloniaux. Il t’enseigne à ne
pas penser
avec ta tête, à ne pas sentir avec ton propre
coeur, et
à ne pas bouger avec tes propres jambes. On te forme pour
marcher en chaise roulante, pour répéter des
idées
étrangères et pour éprouver des
émotions
qui ne sont pas tiennes.
Les
gauches de l’Amérique latine sont-elles
différentes ?
Il
y a de tout, par chance, justement parce que nous sommes divers.
C’est pourquoi c’est très injuste de
généraliser, surtout quand la
généralisation proviend de regards
étrangers, qui
regardent te jugent, et en te jugeant te condamnent. Il y a un complexe
de supériorité qu’ont les pays
dominants dans le
monde, qui imposent les conditions pour obliger les autres à
passer les examens de la démocratie, qui sont les grands
enseignants pour décider qui est démocrate et qui
ne
l’est pas, quels processus sont bien et lesquels sont
mauvais. Et
quand ces professeurs de démocratie viendront nous juger,
nous
surveiller depuis dehors et nous condamner à
l’avance, ils
exerceront un droit de propriété qui est
l’un des
droits les plus répugnants.
Quelles
différences y-a-t-il entre les présidents du
Vénézuéla, de
l’Équateur et de la
Bolivie ?
Beaucoup, parce qu’ils sont des
expressions de trois pays différents. La liste des
différences est interminable. Mais la liste des
coïncidences entre les pays qui cherchent des chemins de
libération après des siècles
d’oppression et
de négation d’eux-même n’est
pas tellement
interminable. Ce sont les expériences différentes
de
trois pays qui décident de cesser de cracher sur le miroir,
d’arrêter de haïr leur propre image, de se
permettre
de regarder avec les yeux de ceux qui les méprisent.
Quel
rôle accomplit le Brésil dans ceci ?
Un
rôle très important, mais le problème
c’est
la tentation d’un mot abominable : le leadership. Tous les
pays
s’attribuent l’intention de l’exercer et
cela
génère des relations contaminées par
l’ordre
hiérarchique qui nie
l’égalité de droits. Je
ne veux que personne soit mon leader. Je ne veux pas commander ni
être commandé. Je ne suis pas né pour
obéir.
Je suis né pour exercer ma liberté de conscience.
Je ne
peux pas accepter l’idée que parmi les personnes
ou parmi
les pays il y ait des conducteurs ou des conduits. Il faut aller vers
une société vraiment libre.
Qu’est-ce
que vous pensez de la réélection
présidentielle ?
Je
n’aime pas beaucoup, parce que cela implique un certain
attachement au pouvoir et cela n’est recommandable en aucun
cas.
Le pouvoir en lui, bien qu’il soit un petit pouvoir,
empoisonne
assez l’esprit. Je sais qu’il faut
l’exercer, mais en
sachant qu’il est dangereux. Le pouvoir produit des
monarchies,
des pouvoirs absolus, des voix qui n’écoutent que
leurs
propres échos incapables d’écouter
d’autres
voix.
D’où
convient cette tentative de se perpétuer dans le leadership ?
En
Europe on l’attribue à
l’héritage du
caudillisme en Amérique latine, au
sous-développement,
à l’ignorance, à notre tendance au
populisme et
à la démagogie. Mais il faut regarder
l’histoire
des pays dominants pour voir jusqu’à quel point
eux ils
ont été soumis à la
volonté, par exemple,
d’un type complètement fou comme Hitler.
C’est
invraisemblable : dans le pays le plus cultivé
d’Europe,
des millions de personnes l’acclamaient. Et les leaders de
maintenant, Qu’est-ce qu’ils pensent venir nous
enseigner ?
L’Uruguay a une démocratie plus ancienne que la
majorité des pays européens. Et en
matière de
droits de l’homme, il a conquis avant les Etats-Unis et
beaucoup
de pays européens la journée de travail de huit
heures,
le droit au divorce, et l’éducation gratuite et
obligatoire.
Pourquoi
y-a-il à peine des relations entre
l’Amérique latine et l’Afrique ?
C’est
un scandale. Cela provient du système éducatif et
des
moyens de communication. Dans la majorité des pays de
l’Amérique latine il y a une influence africaine
énorme : dans la cuisine, le sport, le langage,
l’art. Et
toutefois, de l’Afrique, nous ne savons rien.
Pourquoi
?
Par
racisme. Nous savons ce que nos maîtres de siècle
en
siècle ont voulu que nous sachions, et de de nous nous
ignorons
presque tout parce que cela leur convenait. Par exemple, cela ne leur
convenait pas que nous sachions que ces esclaves qui sont
arrivés de l’Afrique chargés comme des
choses
apportaient leurs dieux, leurs cultures. De toute façon, le
problème avec l’Afrique né du racisme
et de
l’exploitation esclavagiste n’est pas
latino-americaine,
mais de toutes les Amériques. C’est pourquoi
l’élection d’Obama m’a paru
digne
d’être célébrée,
bien qu’ensuite
ce qu’il a fait ne me convainque pas trop.
Que
représente Obama ?
Un
de mes enseignants, don Carlos Quijano, avait l’habitude de
dire
: « Tous les péchés ont une
rédemption. Tous
sauf un. Il est impardonnable de pécher contre
l’espoir
». Avec le temps j’ai appris combien il avait
raison.
Regrettablement, Obama pèche contre l’espoir que
lui-même a su réveiller, dans son pays et dans le
monde.
Les frais de guerre ont augmenté, ils dévorent
maintenant
la moitié de leur budget. Une défense contre qui,
dans un
pays envahi par personne, qui l’a envahi et continue
à
envahir presque tous les autres ? Et le comble, cette blague de mauvais
goût : recevoir le prix Nobel de la Paix en
prononçant une
éloge à la guerre.
Quelles
sont, à son avis, les peurs du 21° siècle
?
L’art
de raconter est né de la peur de mourir. C’est
dans les
mille et un des nuits. Chaque nuit, Sherezade racontait une nouvelle
histoire pour un nouveau jour de vie. Mais je crois aussi que la peur
de vivre est pire que la peur de mourir. Et il me paraît que
l’affaire, dans ce monde et en ce temps, est
celle-là : la
peur de se souvenir, la peur d’être, la peur de
changer.
Soit : la peur de vivre.
Vous
voyez un exemple de cette peur dans le Sommet de Copenhague ?
Les
assassins de la planète versent de temps à autres
une
larme, pour que les déargentés sachent
qu’eux aussi
ils ont un petit coeur. Mais c’est du pur
théâtre.
Ils savent bien que les modèles de vie
d’aujourd’hui, qu’ils imposent, sont des
modèles de mort. Je me demande vers quelle
planète iront
ceux choisis par le Seigneur quand ils auront fini
d’exploiter la
Terre jusqu’à la dernière goutte.
|
|
|
CONFERENCE
MONDIALE
DES PEUPLES SUR LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
 Evo
Morales Ayma, le 5 janvier 2010,
Evo
Morales Ayma, le 5 janvier 2010,
Président de l'État Plurinational de Bolivie
-
Considérant que le changement climatique représente une menace
réelle pour l’existence de l’humanité,
des êtres vivants et de notre Terre-Mère telle que
nous la
connaissons aujourd’hui;
- Constatant le grave
péril pour les îles, les zones côtières, les
glaciers de
l’Himalaya, les Andes et les montagnes du monde, les
pôles,
les régions chaudes comme l’Afrique, les sources
d’eau,
les populations affectées par les désastres naturels croissants, les
plantes et les animaux, et tous les écosystèmes en général.
-
Etant évident que les plus affectés par le changement climatique
seront les plus pauvres de la planète qui verront leurs foyers
détruits, ainsi que leurs moyens de survie et seront obligés de
migrer et de chercher refuge ;
- Confirmant que 75% des
émissions historiques de gaz à effet de serre proviennent des pays
irrationnellement industrialisés du Nord;
-
Regrettant l’échec de la Conférence de Copenhague
dû à
la responsabilité des pays appelés « développés
»
qui ne veulent pas reconnaître la dette climatique
qu’ils
ont envers les pays en voie de développement, les futures
générations et la Terre-Mère;
- Réaffirmant la nécessité de lutter pour la justice climatique;
-
Reconnaissant la nécessité d’assumer des actions urgentes
afin
d’éviter de plus grands désastres et souffrances à
l’Humanité, à la Terre-Mère et de rétablir
l’harmonie
avec la nature;
- Et célébrant la Journée International de la Terre-Mère,
Le
gouvernement de l’Etat Plurinational de Bolivie convoque les
peuples et mouvements sociaux et les défenseurs de la Terre-Mère du
monde, invite les scientifiques, académiciens,
juristes et
gouvernements qui souhaitent travailler avec leurs peuples à la
Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement Climatique et les
Droits de la Terre-Mère qui aura
lieu du 20 au 22 avril 2010 à Cochabamba en Bolivia.
La
Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement Climatique
et
les Droits de la Terre- Mère a pour objectifs :
1 - Analyser les causes structurelles y systémiques qui
provoquent le changement climatique
et proposer des mesures de fond qui rendraient possible le
bien-être de
toute l’Humanité
en harmonie avec la nature.
2 - Discuter et se mettre d’accord sur le projet de
Déclaration
Universelle des Droits de la
Terre-Mère.
3 - Se mettre d’accord sur les propositions de nouveaux
engagements
pour le Protocole de
Kyoto et pour les futures décisions de la Convention Cadre des Nations
Unies sur le
Changement Climatique. Ces
propositions guideront l’action des gouvernements engagés sur la voie des négociations à
propos du changement
climatique et dans
toutes les sphères des
Nations Unies sur les thèmes suivants :
a) dette
climatique.
b) migrants-réfugiés du changement climatique.
c) réduction des émissions.
d) adaptation.
e) transfert des technologies.
f) financement.
g) forêts et changements climatiques.
h) vision partagée.
i) peuples indigènes
j) autres.
4 - Travailler pour organiser un Référendum Mondial des Peuples sur
le changement
climatique.
5 - Analyser et tracer un plan d’action en vue de la
constitution d’un
Tribunal pour la Défense
du Climat.
6 - Définir les stratégies d’action et de mobilisation pour
la
défense de la vie face au
changement climatique et pour les Droits à la Sauvegarde de la
Terre-Mère.
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
Les articles et textes de
Lionel Mesnard sont sous la mention
tous
droits réservés et ne peuvent faire l'objet d'une reproduction sans
autorisation
Les
autres documents sont sous licence
Creative
Commons
|
|
|
| Page d'entrée : |
|
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages à consulter : |
Amérique Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Eduardo Galeno : Un autre regard |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La
Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Bio(s),
textes |
| Psyché, Inconscient, Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
Histoires
urbaines et légendes
|
Alice
Miller : Mais qui est
donc AM? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 15/06/2010 |
|
|
|
|
| | | | |