|
 |
| Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
La Commune de Paris
Elle n'est pas morte !
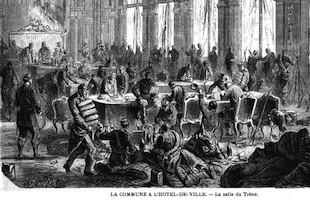
Les annexes : Proclamations, chronologie, documents, filmographie,
bibliographie, et pour
finir : deux chansons
d'Eugène Pottier
Retour à
la 1ère page et 2ème page de la Commune
|
|
|
|
|
Documents parlementaires
et
proclamations de la Commune
Le cadave est à terre et l'idée est debout. Victor Hugo

Arrestation de Louise Michel, peinture de Girardet
|
|
|
Extraits de l’Enquête parlementaire,
sur l’insurrection du 18 mars 1871
(Tome 3, les pièces justificatives, à consulter dans la bibliographie)
« Dans le conflit douloureux et terrible qui menace encore Paris
des horreurs du siège et du bombardement, (...) la Commune de Paris a
le devoir (...) de préciser le caractère du mouvement du 18 mars,
incompris, inconnu et calomnié par les hommes politiques qui siègent à
Versailles.
"Paris demande" :
- La reconnaissance et la consolidation de la
République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du
Peuple.
- L’autonomie absolue de la Commune étendue à toutes les localités
de la France et assurant à chacune l’intégralité de ses droits.
- Les droits inhérents à la Commune sont : le vote du budget
communal, recettes et dépenses ; la fixation et la répartition de
l’impôt ; (...) l’organisation de sa magistrature, de la police
intérieure et de l’enseignement ; l’administration des biens
appartenant à la Commune.
- Le choix par l’élection ou le concours, avec la responsabilité et
le droit permanent de contrôle et de révocation des magistrats ou
fonctionnaires communaux de tous ordres. La garantie absolue de la
liberté individuelle, de la liberté de conscience et de la liberté de
travail (...).
- L’intervention permanente des citoyens dans les
affaires communales par la libre manifestation de leurs idées. (...)
- L’unité, telle qu’elle nous a été imposée jusqu’à ce jour par
l’Empire, la monarchie et le parlementarisme, n’est que la
centralisation despotique, inintelligente, arbitraire et onéreuse.
L’unité politique telle que la veut Paris, c’est l’association
volontaire de toutes les initiatives locales. (...) La Révolution
communale, commencée par l’initiative populaire du 18 mars (...) c’est
la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du
fonctionnarisme, de l’exploitation, de l’agiotage, des monopoles, des
privilèges auxquels le Prolétariat doit son servage, la Patrie ses
malheurs et ses désastres.
|
|
 |
|
|
Manifeste du Comité central de la Commune (26 mars 1871)
« La Commune est la base de tout État politique comme
la famille est l’embryon de la société. Elle implique comme force
politique la République, seule compatible avec la liberté et la
souveraineté populaire. La liberté la plus complète de parler,
d’écrire, de se réunir, de s’associer, la souveraineté du suffrage
universel. Le principe de l’élection appliqué à tous les fonctionnaires
et magistrats (...). Suppression quant à Paris, de l’armée permanente.
Propagation de l’enseignement laïque intégral, professionnel.
Organisation d’un système d’assurances communales contre tous les
risques sociaux y compris le chômage. Recherche incessante et assidue
de tous les moyens les plus propres à fournir au producteur le capital,
l’instrument de travail, les débouchés et le crédit, afin d’en finir
avec le salariat et l’horrible paupérisme.
|
|
|
Extrait de la Déclaration au Peuple français (19 avril 1871)
« Il faut que Paris et le pays tout entier sachent
quelle est la
nature, la raison, le but de la Révolution qui s’accomplit. (…) La
Commune a le devoir d’affirmer et de déterminer les aspirations et les
vœux de la population de Paris ; de préciser le caractère du mouvement
du 18 mars, incompris, inconnu et calomnié par les hommes politiques
qui siègent à Versailles. (…) Que demande-t-il ? La reconnaissance de
la consolidation de la République, seule forme de gouvernement
compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et
libre de la société. (…) Nos ennemis se trompent ou trompent le pays
quand ils accusent Paris de vouloir imposer sa volonté ou sa suprématie
au reste de la nation, et de prétendre à une dictature qui serait un
véritable attentat contre l’indépendance et la souveraineté des autres
communes. Ils se trompent ou trompent le pays quand ils accusent Paris
de poursuivre la destruction de l’unité française, constituée par la
Révolution, aux acclamations de nos pères, accourus à la fête de la
Fédération de tous les points de la vieille France. L’unité, telle
qu’elle nous a été imposée jusqu’à ce jour par l’empire, la monarchie
et le parlementarisme, n’est que la centralisation despotique,
inintelligente, arbitraire ou onéreuse. (…) La lutte engagée entre
Paris et Versailles est de celles qui ne peuvent se terminer par des
compromis illusoires : l’issue n’en saurait être douteuse. La victoire,
poursuivie avec une indomptable énergie par la Garde nationale, restera
à l’idée et au droit. (…) Nous avons le devoir de lutter et de vaincre! |
|

Barricade de la rue Saint-Sébastien - Paris 11ème |
|
|
|
-
Chronologie des événements
-
et
des faits (de 1870 à 1882)
|
|
1 ) Année 1870 :
de juillet à décembre
|
|
Septembre : A
Paris,
proclamation de l'abolition de l'empire et de
l'instauration de la République
- L'armée prussienne arrive sous les murs de
Paris.
- L'armée française est délogée des hauteurs de
Châtillon, d'où l'artillerie allemande peut bombarder la capitale.
-
Jules Favre proclame que le gouvernement républicain ne veut pas céder "un
pouce de notre territoire" à l'ennemi.
- Le
journaliste Félix Pyat lance pour la première fois dans le journal
Combat, l'idée d'une commune de Paris
|
|
Octobre
: A Paris, manifestation des bataillons
de Belleville et de
Ménilmontant animée par Gustave Flourens
- Léon Gambetta s'envole en ballon (l'Armand Barbès) de la capitale pour Montdidier dans la Somme. Le lendemain, le comité central républicain des 20 arrondissements appelle à
manifester pour que soit fixer une date pour des élections municipales
démocratiques au gouvernement.
-
Suite à l'annonce de la perte du Bourget par l'armée française, Paris
connaît de nouvelles manifestations des
bataillons de Belleville et Ménilmontant.
-
A la fin du mois une manifestation est organisée par les groupes de la gauche révolutionnaire à Paris. On y
crie : Vive la Commune!, l'Hôtel de Ville est pris d'assaut par les
manifestants et le gouvernement menacé.
|
|
Novembre : Le plébiscite organisé par le
gouvernement de la
Défense
Nationale lui donne une large victoire.
-
Élections municipales, pour désigner les conseils municipaux des
20 arrondissements de Paris.
|
|
Décembre : Échec d'un tentative de sortie
en direction de
Champigny.
-
Second échec d'un tentative de sortie au Bourget.
- En France, les températures chutent fortement au début du mois, lors
de la deuxième offensive près du Bourget, le général Ducrot et ses
combattants repoussent les Prussiens par moins 14 degrés.
- Les animaux du Jardin d'acclimatation sont vendus et entrent dans la
composition des menus chez certains restaurateurs pour le réveillon de
Noël (lire ci-après le sort des éléphants)
|
|
Chasse à l'éléphant dans Paris

FULBERT DUMONTEIL (1871)
« Il n'y
a plus de réel aujourd'hui que l'étrange et le fantastique. Qui nous
eût dit que Castor et Pollux, les gentils éléphants du Jardin
d'acclimatation qui ont promené des pensionnats entiers sur leur dos,
seraient tués par M. Devisme, achetés 27.000 francs par M. Deboos, de la Boucherie anglaise, convertis en aloyau et mangés par le bourgeois de Paris?
Mais que Sa Compassion M. de Bismarck se rassure ; c'est uniquement à
cause du prix élevé des fourrages, et non au point fie vue de
l'alimentation, que ces animaux ont été vendus. Paris a autre chose
encore qu'une trompe à mettre sous sa dent. Notons également que Castor
et Pollux n'étaient que les hôtes provisoires du Jardin des Plantes (note : les deux jeunes éléphants un mâle et une femelle
étaient présents depuis 1869 pour la joie des bambins, le couple avait
été transféré le 18 septembre 1870 depuis le jardin d'Acclimation à
celui des Plantes, selon le Rappel). Le
Muséum a du foin et peut nourrir ses hôtes qui appartiennent en quelque
sorte à la science. C'est une bibliothèque vivante qui ne périra pas.
Passons maintenant à la chasse ou plutôt à l'exécution. Pollux est
tombé hier matin sous la balle de M. Devisme. La carabine qui l'a tué
est du calibre 33 millimètres (...) La charge de la carabine, pour lancer
ce projectile, est de 8 grammes de poudre. Le coup a été tiré à 10
mètres; entrée au défaut de l'épaule droite, la balle a brisé la
première côte et fait explosion dans l'abdomen. Après cette décharge
terrible, l'éléphant est resté debout et s'est agité sans chercher
toutefois à briser ses liens. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes
que l'hémorragie interne, causée par l'explosion, a étouffé l'animal.
Alors, il est tombé ; mais son agonie a été longue. Quatre grands
sceaux avaient été remplis de son sang qu'il donnait encore signe de
vie.
A cette curieuse exécution assistaient M. Geoffroy-Saint-Hilaire,
directeur du Jardin d'acclimatation, M. Milne-Edwards, M. Bouchel,
chasseur émérite, des naturalistes, etc. Ce matin est venu le tour de
Castor. M. Devisme était présent. Mais c'est M. Milne-Edwards fils qui
a très heureusement abattu l'animal. Il s'est servi d'une carabine de
chasse à deux coups et de balles coniques à pointe d'acier.
L'animal avait été solidement lié par une forte courroie en cuir.
Frappé à la tempe droite, il a jeté un cri plaintif et est tombé; puis
il s'est relevé. Alors, une nouvelle balle l'a atteint au milieu du
front. Il est tombé une seconde fois à genoux et s'est étendu immobile,
comme foudroyé, sur le flanc droit. Sa trompe a remué légèrement. Son
œil doux et fin s'est fermé. Il était mort.
Aussitôt la victime est passée entre les mains des hommes de M. Deboos
et s'est trouvée, en un clin d'œil, dépouillée de son énorme carapace,
qui a été vendue 4.000 francs. Alors nous avons pu admirer une viande
remarquablement belle, tendre et rose comme la chair du veau. Mais il
faut dire que Castor et Pollux n'ont que six ans, c'est-à-dire que,
malgré leur taille gigantesque, ils n'étaient encore que de vrais
enfants, attendus que leurs pareils vivent cent ans et plus. (…)
Côtelettes, ô mes chères côtelettes, quand reviendrez-vous?
Source : Journal du siège, le journal Le Gaulois, page 2, du 1er janvier 1871
|
|
|
|
| 2) Année 1871 : l'an 01 de la Commune |
|
Janvier : Nouvelle journée de manifestations insurrectionnelles à
Paris
-
Les Prussiens bombardent la capitale.
- Ci-dessous et
sur les murs
l’Affiche rouge est placardée avec les mentions « Place au Peuple !
Place à la Commune! », à son origine Edouard Vaillant, Jules
Vallès et
des délégués des vingt arrondissements.
- La mairie du
20ème arrondissement est prise par les émeutiers, qui réclament une
Commune de Paris.
- Signature des
préliminaires de paix, à Versailles.
- Signature de
l'armistice par Jules Favre avec le chancelier Bismarck.
|
|
|
|
|
La première Affiche Rouge ?
(...)
Les révolutionnaires de Paris, mécontents de la nomination des maires
et de l'ajournement des élections (note : notamment la désignation
d'une Constituante), avaient résumé dans une déclaration, signée de 46
noms,surnommée "l'affiche rouge" (14 septembre 1870), les mesures
proposées par les réunions publiques en vue du siège.
Mesures proposées pour le siège : Pour « pourvoir
au salut de la patrie ainsi qu'à la fondation définitive d'un régime
véritablement républicain par le concours personnel de l'initiative
individuelle et de la solidarité populaire », on réclamait « l'expropriation de toute denrée alimentaire emmagasinée dans Paris chez un marchand en gros et en détail », remboursable après la guerre au prix de revient ; chaque quartier élirait une commission « chargée
de faire l'inventaire des objets de consommation et d'en déclarer les
détenteurs actuels personnellement responsables envers l'administration », et de répartir les approvisionnements également entre tous en calculant « la durée maximum probable du siège ». Les municipalités devraient assurer aux familles « le logement indispensable ».
L'après-midi,
les délégués venaient chaque jour au siège de l'Internationale pour se
concerter, et le soir ils rapportaient les décisions dans leur quartier
au comité de vigilance local ou dans les clubs. Ils étaient en
relations avec Blanqui et avec Flourens, devenu commandant dans la
garde nationale à Belleville, qui demandait, par privilège personnel,
le grade de colonel. (...)
Ernest Lavisse, Histoire de France contemporaine, page 266
Texte
de la deuxième Affiche Rouge, du
7 janvier 1871
AU
PEUPLE DE PARIS
*
Les délégués des vingt arrondissements de Paris
Le
gouvernement qui, le 4 septembre, s’est chargé de la défense nationale
a-t-il rempli sa mission? – Non !
Nous
sommes
500.000 combattants et 200.000 Prussiens nous étreignent ! À qui la
responsabilité, sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils
n’ont
pensé qu’à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des
armes. Ils se sont refusés à la levée en masse. Ils ont laissé en place
les bonapartistes et mis en prison les républicains.
Ils
ne se sont décidés à agir enfin contre les Prussiens qu’après deux
mois, au lendemain du 31 octobre. Par
leur
lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu’au
bord de l’abîme : ils n’ont su ni administrer ni combattre, alors
qu’ils avaient sous la main toutes les ressources, les denrées et les
hommes.
Ils
n’ont
pas su comprendre que dans une ville assiégée, tout ce qui soutient la
lutte pour sauver la patrie possède un droit égal à recevoir d’elle la
subsistance ; ils n’ont rien su prévoir : là où pouvait exister
l’abondance, ils ont fait la misère ; on meurt de froid, déjà presque
de faim : les femmes souffrent, les enfants languissent et succombent.
La
direction militaire est plus déplorable encore : sorties sans but ;
luttes meurtrières sans résultats ; insuccès répétés, qui pouvaient décourager les plus
braves ; Paris bombardé. Le gouvernement a donné sa mesure : il nous tue. Le salut de Paris exige
une décision rapide. Le gouvernement ne répond que par la menace aux reproches de l’opinion. Il
déclare qu’il maintiendra l’ORDRE, comme Bonaparte avant Sedan.
Si
les hommes de l’Hôtel de Ville ont encore quelque patriotisme, leur
devoir est de se retirer, de
laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance.
La municipalité ou la Commune,
de quelque nom qu’on appelle, est l’unique salut du peuple, son seul
recours contre la mort.
Toute
adjonction, ou immixtion au pouvoir actuel ne serait qu’un replâtrage,
perpétuant les mêmes errements,
les mêmes désastres. Or la perpétuation de ce régime, c’est la
capitulation, et Metz et Rouen
nous apprennent que la capitulation n’est pas seulement encore et
toujours la famine, mais la
ruine et la honte. C’est l’armée et la Garde nationale transportées
prisonnières en Allemagne, et
défilant dans les villes sous les insultes de l’étranger ; le commerce
détruit, l’industrie morte, les
contributions de guerre écrasant Paris : voilà ce que nous prépare
l’impéritie ou la trahison.
Le
grand peuple de 89, qui détruit les Bastilles et renverse les trônes,
attendra-t-il dans un désespoir
inerte, que le froid et la famine aient glacé dans son cœur, dont
l’ennemi compte les battements, sa dernière goutte de sang? – Non ! La
population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette
honte. Elle sait qu’il en est
temps encore, que des mesures décisives permettront aux travailleurs de
vivre, à tous de combattre.
Réquisitionne ment général – Rationnement gratuit – Attaque en masse
La politique, la stratégie,
l’administration du 4 septembre,
constituées de l’Empire, sont jugées.
Place
au peuple ! Place à la commune !
Les Délégués des Vingt arrondissements de Paris : ADOUÉ, ANSEL, Antoine ARNAUD, J.F. ARNAUD, Edm.
AUBERT, BABICK, BAILLET père, A. BAILLET,
BEDOUCH, CH. BESLAY, J.M. BOITARD, BONNARD, Casimir BOUIS, Léon BOURDON, Abel BOUSQUET, V. BOYER, BRANDELY, Gabriel
BRIDEAU, L. CARIA, CAILLET, CHALVET, CHAMPY,
CHAPITEL, CHARBONNEAU, CHARDON, CHARTINI,
Eugène CHATELAIN, A. CHAUDET, J.B. CHAUTARD, CHAUVIÈRE, CLAMOUSSE, A. CLARIS, CLAVIER, CLÉMENCE, Lucien COMBATZ, Julien
CONDUCHÉ, DELAGE, DELARUE, DEMAY, P. DENIS,
DEREUX, DURINS, DUPAS, DUVAL, DUVIVIER, R.
ESTIEU, FABRE, F. FÉLIX, Jules FERRÉ, TH. FERRET, FLOTTE, FRUNEAU, C .J. GARNIER, L. GARNIER, M. GARREAU, GENTILINI, Ch.
GÉRARDIN, Eug. GÉRARDIN, L. GENSON, GILLET,
P. GRIRARD, GIROUD-TROUILLIER, J. GOBERT, Albert GODILLE, GRANDJEAN, GROT, HENRY, Fortuné HENRY, HOURIOUL, Alph.
HUMBERT, JAMET, JOHANNARD, Michel JOLY,
JOUSSET, JOUVARD, LACORD, LAFARGUE, LAFFITE, A. LALLEMENT, LAMBERT, LANGE, J. LARMIER, LEBALLEUR, F.
LEMAITRE, E. LEVERDAYS, Armand LÉVY,
LUCIPIA, Ambroise LYAZ, Pierre MALLET, MALON, Louis MARCHAND, MARLIER, J. MARTELET, Constant MARTIN,
MAULLION, Léon MEILLIET, N. MISSOL, Dr Tony
MOILIN, MOLLEVEAUX, MONTELLE, J.MONTELS, MOUTON, MYARD, NAPIAS-PIQUET, Émile OUDET, PARISEL, H.
PIEDNOIR, PIRÈVE, PILLOT
docteur, PINDY, Martial PORTALIER, PUGET, D-TH. RÉGÈRE, RETTERER aîné,
Aristide REY, J. RICHARD, ROSELLI-MOLLET, Édouard ROULLIER, Benjamin
SACHS, SAISSON, TH. SAPIA, SALLÉE, Salvador DANIEL, SCHNEIDER, SERAY,
SICARD, STORDEUF, TARDIF, TREILLARD, TESSEREAU, THALLER, THEISZ,
THIOLIER, TRIDON, URBAIN, VIARD, ED. VAILLANT, Jules VALLÈS, VIELLET
|
|
|
|
Février : Élection d'une Assemblée Nationale à dominante
conservatrice
- Le petit peuple de Paris y voit une menace pour
la République.
- Première réunion de l'Assemblée nationale à Bordeaux.
- Adolphe Thiers est nommé chef du Pouvoir Exécutif de la "République Française".
- Signature des préliminaires de paix à Versailles.
|
|
|
|
AU PEUPLE, CITOYENS,
Le Peuple
de Paris a secoué le joug qu'on essayait de lui imposer. Calme,
impassible dans sa force, il a attendu sans crainte comme sans
provocation les fous éhontés qui voulaient toucher à la République.
Cette fois, nos frères de l'armée n'ont pas voulu porter la main sur
l'arche sainte de nos libertés.
Merci à tous, et que Paris et la France
jettent ensemble les bases d'une République acclamée avec toutes ses
conséquences, le seul Gouvernement qui fermera pour toujours l'ère des
invasions et des guerres civiles. L'état de siège est levé. Le Peuple
de Paris est convoqué dans ses sections pour faire ses Élections
communales. La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours
de la Garde nationale.
Hôtel de Ville, Paris, le 19 mars 1871.
Le Comité Central de la Garde Nationale : ASSI, BILLIORAY,
FERRAT, BABICK, Edouard MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER,
GOUHIER, LAVALETTE, Fr. JOURDE, ROUSSEAU, Ch. LULLIER, BLANCHET, J.
GROLLARD, BARROUD, H. GERESME. FABRE, POUGERET.
|
|
| |
Mars : L'armée Prusienne de Guillaume 1er
pénètre dans Paris
-
L'accueil est glacial : fenêtres closes, tentures noires sur les
façades, rues désertes...
-
L'Assemblée
nationale à Bordeaux ratifie les préliminaires de paix de Versailles
par une écrasante majorité de 546 voix contre 107.
-
L'armée allemande évacue Paris.
- Les
bataillons populaires de la Garde Nationale se fédèrent et constituent
la force armée d'une éventuelle révolution.
- Décès de Charles Hugo à 44 ans à Bordeaux (lire l'article avec des extraits de presse
ci-dessous)
- Dans la
nuit du 17 au 18, l'opération de récupération des canons de Paris,
ordonnée par Thiers, provoque la colère des Parisiens et le
déclenchement d'émeutes, depuis Montmartre.
-
Journée
d'insurrection marquant le début des mouvements préliminaires de la
Commune de Paris.
- Le
Gouvernement quitte Paris pour Versailles.
-
L'Assemblée Nationale siège à Versailles.
- Mise en
place du conseil communal de Paris, baptisé Commune de Paris.
|
|
|
MORT DE CHARLES HUGO
(né en 1826 et mort le 13 mars 1871)
 dessin de Nadar dessin de Nadar
|
|
Sept heures du soir. Charles est mort. (...)
Mort ! Je n’y croyais pas. Charles !… Je me suis appuyé au mur.
Choses vues, extraits des carnets, Victor Hugo (13 mars 1871)
|
|
Le Journal des Débats :
La presse sera
unanime pour s'associer à la douleur de l'illustre poète, déjà si
souvent et si cruellement frappé dans ses affections les plus chères.
Nature aimable, expansive et bienveillante, Charles Hugo ne comptait
que des amis, et l'éloge que fait de lui le journal la Liberté sera
ratifié même par ceux dont les convictions politiques s'éloignaient le
plus des siennes.
Charles Hugo était l’une
des plus brillantes et des plus sympathiques personnalités du
journalisme militant. Attaché par ses convictions autant que par les
traditions paternelles à un parti dont les tendances rendaient parfois
fort délicate la tâche de ses apôtres, il eut le tact et le talent de
se faire lire toujours avec respect et souvent avec admiration par
ceux-là même qui étaient ses plus ardents adversaires politiques.
Le Siècle :
Nous nous
associons de tout notre cœur au deuil qui vient d'atteindre notre grand
poëte. Charles Hugo était un sincère et ardent républicain, un
publiciste distingué. Il avait supporté, lui aussi, d'une âme fière,
les rigueurs d'un exil qui n'en était pas moins cruel pour être
volontaire. Puissent les témoignages de la sympathie publique qui
éclatent autour de la tombe de ce bon citoyen apporter quelque
adoucissement à la douleur paternelle!
L'Opinion nationale :
Une nouvelle
douleur vient de frapper Victor Hugo, si inattendue qu'elle rappelle le
malheur affreux qui lui ravit sa fille autrefois. Charles Hugo avait
quarante-cinq ans. Son père ne le pleurera pas seul; car il laisse une
jeune femme et deux petits enfants. Les circonstances qui le firent
entrer dans la vie littéraire par le journalisme militant,
n'éteignirent pas en lui les aspirations vers les études plus calmes et
d'un caractère plus purement artistique. Témoin le petit acte : Je vous
aime, qui eut un grand succès à Bruxelles, en 1861.
Sorti à dix-huit ans du
lycée Charlemagne, il était, à vingt-deux ans, secrétaire de Lamartine.
C'était au plus fort de la vie politique de son père, ce qui explique
son entrée immédiate dans le mouvement. Il fut rédacteur de l’Evénement
quand Paul Meurice le fonda, et ses articles y furent remarqués. En
1831, il suivit son père en exil. Il commença alors à publier des
livres dont les tendances réalistes étaient ennoblies par la dignité de
la langue et une certaine hauteur d'observation. Tels sont le Cochon de saint Antoine, la Chaise de paille, Une famille tragique, le plus connu, et la Bohème dorée.
Dans quelques jours, Paris, où il était revenu le 5 septembre, allait acclamer son nom à la Porte-Saint-Martin, où son drame : les Misérables,
tiré du livre admirable de son père, va être représenté. Cette pièce,
qui a réussi à Bruxelles, en 1863, aura l'honneur de mettre à la scène,
la première après tant d'années ! des personnages héroïques et d'une
taille légendaire, mus par de grandes et nobles passions. Le public ne
les a pas oubliés, ni Mgr Bienvenu, à la charité sans égale, ni Fantine
au sourire douloureux, ni Marius aux chastes amours, ni Enjolras le
violent, ni Valjean le repenti. Je suis sûr qu'il les reverra avec
reconnaissance pour celui qui les lui rend, et partagera le deuil de sa
mort.
Le Rappel, qui nous
a appris le premier ce malheur, perd, en Charles Hugo, un de ses
rédacteurs les plus appréciés. Une grande modération, qui ne
compromettait en rien sa fermeté républicaine, distinguait ses articles
que j'ai entendu louer souvent par des gens d'autres partis. Rien de
plus sympathique, d'ailleurs, que le souvenir qui s'attachera à ce nom.
Il rappellera une piété filiale à toute épreuve, l'amour de la famille,
le goût des études élevées, de hautes vertus de citoyen et d'honorables
qualités d'artiste. - Armand Silvestre.
Le Charivari :
Encore un deuil
et un deuil cruel! Ainsi sont les jeux de la mort et du hasard; est
pour Rochefort qu'on tremblait hier, c'est Charles Hugo qui succombe.
C'était - tous ceux qui l'ont connu le savent - une vaillante nature et
un bon cœur. C'était aussi une plume nerveuse, un esprit élevé, un
démocrate fervent.
Il avait fait ses premières armes à l’Evénement.
Il avait connu tour à tour la prison et l'exil. A Bruxelles, sa maison
était hospitalière et charmante; tous les proscrits en connaissaient la
route. Il n'y a pas de consolation à chercher en présence d'un
semblable malheur. Que dire à sa jeune femme qui pleure en tenant dans
ses bras deux chers petits enfants? Que dire à ce père déjà si
terriblement éprouvé, comme si la destinée proportionnait la violence
de ses coups à la grandeur de ceux qui sont frappés?
Charles Hugo avait su
porter sans en être écrasé le nom le plus éclatant du siècle. Il avait
voulu être quelque chose par lui-même et il y avait réussi, Une longue
et brillante carrière semblait être ouverte devant lui. Plus rien.
L'heure présente est implacable. Aux douleurs publiques elle ajoute les
douleurs privées. Il semblait pourtant que la mort devait avoir plus
que son compte de cercueils. - Pierre Véron.
Source : Gallica-Bnf, Le Rappel, n° 643, du 18 mars 1871
|
|
|
|
|
-
-
A LA GARDE NATIONALE De PARIS
-
- Les
conspirateurs royalistes ont ATTAQUÉ. Malgré la modération de notre
attitude, ils ont ATTAQUÉ. Ne pouvant plus compter sur l'armée
française, ils ont
attaqué avec les zouaves pontificaux et la police impériale.
- Non contents de couper les correspondances avec la
province et de faire de vains efforts pour nous réduite par la famine,
ces furieux ont voulu imiter jusqu'au bout les Prussiens et bombarder
la capitale.
- Ce matin, les chouans de Charette, les Vendéens de
Cathelineau, les Bretons de Trochu, flanqués des gendarmes de Valentin,
ont couvert de mitraille et d'obus le village inoffensif de Neuilly et
engagé la guerre civile avec nos gardes nationaux. Il y a eu des morts
et des blessés.
Élus
par la population de Paris, notre devoir est de
défendre la grande cité contre ces coupables agresseurs. Avec votre
aide, nous la défendrons.
-
Paris, le 2 avril 1871.
-
La
Commission Exécutive : BERGERET, EUDES,
DUVAL, LEFRANÇAIS, Félix
PYAT, G. TRIDON, Éd.
VAILLANT
|
|
| |
Avril : Décret de séparation de l'Église
et de l'État
- Prise
de Courbevoie par les versaillais.
- Échec
d'une sortie sur Versailles.
- Mort de
Gustave Flourens.
- Les
franc-maçons de Paris placardent sur les murs de la capitale un appel à
la paix et contre la guerre civile, à l'attention du gouvernement et de
la Commune.
-
Constitution de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les
soins aux blessés.
- Les
artistes parisiens se forment en Fédération à l'initiative du peintre
Gustave Courbet.
-
Promulgation de la loi municipale.
- Décret
(s)
: de réquisition des ateliers abandonnés; établissant un moratoire des
effets de commerce; interdisant le travail de nuit dans les
boulangeries.
|
|
Mai : A Paris, création d'un Comité de
Salut public
- Décret de
la Commune ordonnant la restitution des objets d'une valeur inférieure
à 20 francs et mis en gage au Mont-de-Piété.
- Les Versaillais s'emparent du
fort d'Issy.
- Signature du Traité de
Francfort. La France, vaincue, doit
verser à l'Allemagne une indemnité de cinq milliards de francs or et l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées
par l'Allemagne.
- La Colonne Vendôme est abattue.
- Décret communard de laïcisation
de l'enseignement.
 Photo de la Rotonde (Paris 19ème ar.) Photo de la Rotonde (Paris 19ème ar.)
|
|
21-28 mai : la Semaine Sanglante
- la Commune de Paris est
réprimée dans le sang, le premier jour Issy-les-Moulineaux tombe aux mains des Versaillais.
- Les troupes
versaillaises pénètrent dans Paris par une barricade de la porte de
Saint-Cloud, qui a été provisoirement abandonnée par ses défenseurs.
- Arrestation de Louise
Michel.
- Mort sur la barricade du Château-d'Eau de Louis-Charles Delescluze.
La dernière barricade
des
journées de Mai est rue Ramponeau. Pendant un quart d'heure, un seul
Fédéré la défend. Trois fois, il casse la hampe du drapeau versaillais
arboré sur la barricade de la rue de Paris. Pour prix de son courage,
le dernier soldat de la Commune réussit à s'échapper. (P. Lissagaray)
 Eugène Varlin (1839-1871), fusillé le 28 mai
avec pour dernier mots :
Eugène Varlin (1839-1871), fusillé le 28 mai
avec pour dernier mots :
«Vive
la république, vive la commune! Varlin
était commissaire
aux subsistances et aux finances (ci-dessus), il déclara le 27 mai : « Oui,
nous serons dépecés vivants. Morts, nous serons traînés dans la boue.
On a tué les combattants. On tuera les prisonniers, on achèvera les
blessés. Ceux qu'on épargnera, s'il en reste, iront mourir au bagne.
Mais l'histoire finira par voir clair et dire que nous avons sauvé la
République.
*
Autres
figures
de la Commune :
Louise
Michel (1830-1905)
institutrice puis combattante, déportée à Nouméa en 1873, libérée en 1880 ;
Jules Vallès (1833-85) condamné à mort par contumace ; Félix Pyat
(1810-89) membre de la commission des Finances, en fuite ; Raoul Rigault
(1846-71, "préfet de police") fusillé ; Prosper-Olivier Lissagaray
(1838-1901), journaliste.
|
|
Novembre
: Exécution du communard Théophile Ferré
(ami de Louise Michel).

En
1872 :
- Promulgation de la loi Dufaure contre
l'Internationale.
- Dissolution des
Gardes nationaux.
- Départ du premier convoi
de déportés communards vers la Nouvelle Calédonie.
En
1880 :
- Première
commémoration organisée au mur des Fédérés du cimetière du Père
Lachaise à Paris.
- Promulgation de la loi d'amnistie des Communards.
|
|
Courrier de Marx et
Engels
Convoqué
le 21 mars 1881 pour commémorer la Commune de Paris, par le président du
meeting slave,
Citoyens,
A notre grand
regret, nous devons vous informer que nous ne sommes pas en mesure
d’assister à votre meeting.
Lorsque la Commune
de Paris finit par succomber et fut massacrée par les
défenseurs de l’«ordre», les vainqueurs ne
se doutaient pas, certes, qu’il ne passerait pas dix ans avant
que, dans la lointaine Pétersbourg il se déroule un
événement qui, sans doute, après un long et
violent combat, ne manquera pas d’aboutir lui aussi à
l’instauration d’une Commune russe. Ils ne se doutaient
pas non plus que le roi de Prusse avait préparé la
Commune en assiégeant Paris et en forçant le pouvoir
bourgeois à armer le peuple, que ce même roi de Prusse,
dix ans après, serait assiégé dans sa propre
capitale par les socialistes, et qu’il ne pourrait sauver son
trône qu’en proclamant l’état de siège
dans la capitale berlinoise.
De même, en
persécutant systématiquement, après la chute de la
Commune, l’Association internationale des travailleurs pour
l’obliger à abandonner son organisation formelle et
extérieure, les gouvernements du continent croyaient pouvoir
détruire, par décrets et lois d’exception, le grand
mouvement international des travailleurs et ne se doutaient pas que ce
même mouvement ouvrier international serait, dix ans plus tard,
plus puissant que jamais et s’étendrait non seulement aux
classes ouvrières d’Europe, mais encore à celles
d’Amérique, et que la lutte commune pour des
intérêts communs contre un ennemi commun les
réunirait spontanément en une nouvelle et plus grande
Internationale, qui dépasse de loin ses formes
extérieures d’organisation.
Ainsi, la Commune
que les puissances du vieux monde croyaient avoir exterminée vit
plus forte que jamais, et nous pouvons nous écrier avec vous :
Vive la Commune !
|
|
|
|
|
En 1882 :
L'Insurgé
de Jules Vallès parait en feuilleton
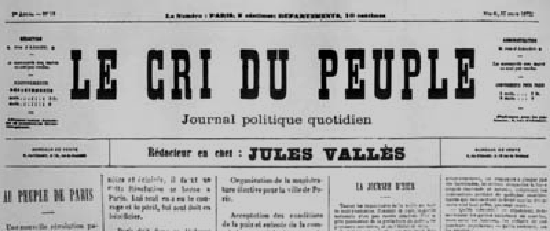
Le
Cri du Peuple (22 février 1871 - 23 mai 1871)
Ce périodique était vendu 5
centimes et composé d'une feuille grand format, cinq colonnes à la
page. Le Rédacteur en chef fut Jules
Vallès, ses principaux rédacteurs ont
été : Casimir Bouis, Jean-Baptiste Clément, Pierre Denis, Charles
Rochat, et des articles occasionnels de Bauer, Courbet, André Léo.
Le n°1 parut le 22 février, mais le journal fut
supprimé par le général Vinoy le 11 mars, au n°18. Le 19 mars, Vallès
lança un nouveau journal, Le Drapeau, préparé pour tourner
l’interdiction ; mais l’insurrection de la veille rendait cette
précaution inutile, aussi fit-il reparaître Le Cri du Peuple, dont le
n° 19 sortit le 21 mars. Il
devait paraître régulièrement durant toute la
Commune, jusqu’au n°
83 daté du mardi 23 mai 1871. Le Cri du Peuple est le journal le plus
célèbre de la Commune. Il le doit à la personnalité de Vallès qui, en
fait, n’y collabora qu’assez peu et cessa même d’y écrire après le 19
avril, car il donnait tout son temps à la Commune.
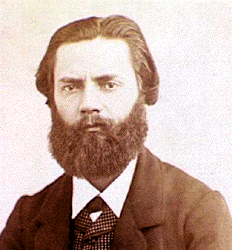 Jules Vallès fut
édité en 1886 pour l'Insurgé, il publia aussi
l'Argent, Les
Réfractaires, La Rue, l'Enfant, le
Bachelier, etc., et certains de ses ouvrages sous le pseudonyme de Jacques Vingtras. Il fonda Le Cri du Peuple et collabora au sein du journal avec toutes les écoles de pensées socialistes de l'époque. Jules Vallès fut
édité en 1886 pour l'Insurgé, il publia aussi
l'Argent, Les
Réfractaires, La Rue, l'Enfant, le
Bachelier, etc., et certains de ses ouvrages sous le pseudonyme de Jacques Vingtras. Il fonda Le Cri du Peuple et collabora au sein du journal avec toutes les écoles de pensées socialistes de l'époque.
Le Cri du Peuple, 29 années disponibles,
dont 83 numéros pour 1871 sur Gallica-BNF : Cliquez ici
|
|
|
Guerre populaire
- jusqu'au communisme !

Discours
pour le XVe
anniversaire de la Commune de Paris
- Friedrich ENGELS, le 18
mars 1886
Citoyens,
Ce
soir, avec vous, les ouvriers des deux mondes célèbrent l'anniversaire
de l'événement le plus glorieux et le plus terrible dans les annales du
prolétariat. Pour la première fois depuis qu'il y a une histoire, la
classe ouvrière d'une grande capitale s'était emparée du pouvoir
politique. Le rêve fut court. Écrasée entre les mercenaires
ex-impériaux de la bourgeoisie française d'un côté et les Prussiens de
l'autre, la Commune ouvrière fut écrasée dans un carnage sans exemple
que nous n'oublierons jamais. Après la victoire, les orgies de la
réaction ne connurent plus de bornes; le socialisme parut noyé dans le
sang, le prolétariat rebelle réduit pour toujours à l'esclavage.
Quinze
ans se sont écoulés depuis. Pendant ce temps, dans tous les pays, le
pouvoir au service des détenteurs de la terre et du capital n'a épargné
aucun effort pour en finir avec les dernières velléités de rébellion
ouvrière. Et qu'a-t-on obtenu ? Regardez autour de vous. Le socialisme
ouvrier révolutionnaire aujourd'hui est une puissance devant laquelle
tremblent tous les pouvoirs établis, tous les grands de la terre, les
radicaux français aussi bien que Bismarck, les rois boursiers de
l'Amérique aussi bien que le tsar de toutes les Russies.
Ce n'est pas
tout. Nous sommes arrivés à ce point que nos adversaires, quoi qu'ils
fassent, et bien malgré eux, travaillent pour nous. Ils ont cru tuer
l'Internationale, eh bien ! aujourd'hui l'union internationale du
prolétariat, la fraternité des ouvriers révolutionnaires de tous les
pays sont mille fois plus fortes, plus vivantes qu'elles le furent
avant la Commune de Paris ; l'Internationale n'a plus besoin d'une
organisation formelle, elle vit et grandit grâce à la coopération
spontanée, cordiale des ouvriers d'Europe et d'Amérique.
En
Allemagne, Bismarck a épuisé tous les moyens jusqu'aux plus infâmes
pour tuer le mouvement ouvrier; avant la Commune, il avait, en face de
lui quatre députés socialistes ; il a si bien réussi qu'il en fait
élire maintenant vingt-cinq; et les ouvriers allemands se moquent de
lui en déclarant qu'il ne ferait pas mieux la propagande
révolutionnaire, même s'il était payé pour cela.
En France, on vous a
imposé le scrutin de liste, scrutin bourgeois par excellence, scrutin
inventé exprès pour assurer l'élection exclusive des avocats,
journalistes et autres aventuriers politiques, les porte-parole du
capital. Et qu'a-t-il fait pour la bourgeoisie, le scrutin de liste?
Il a créé au sein du Parlement français un parti ouvrier socialiste
révolutionnaire qui, par sa seule apparition sur la scène, a porté le
désarroi dans les rangs de tous les partis bourgeois. Voilà où nous en
sommes.
Tous les événements tournent en notre faveur. Les mesures les
mieux calculées pour arrêter le progrès victorieux du prolétariat ne
font qu'en accélérer la marche. Nos ennemis eux-mêmes, quoi qu'ils
fassent, sont condamnés à travailler pour nous. Et ils ont si bien
travaillé, qu'aujourd'hui, le 18 mars, depuis les mineurs prolétaires
de la Californie, jusqu'aux mineurs forçats de la Sibérie, des millions
d'ouvriers feront retentir ce cri :
Vive
la Commune ! Vive
l'union internationale du prolétariat universel !
|
|
|
- La
Commune en chiffre
La
France est composée à
65% par une population rurale, pour un peu plus de 38 millions
d’habitants, dont 27 millions vivent dans les campagnes et 11 millions dans
les villes ; dont 3 millions résident dans des grandes villes (Lyon,
Marseille, Rouen, etc.). Paris rassemble 2 millions d’habitants, soit 5% de la
population, dont 900.000
employés et 480.000 ouvriers, 114.000 domestiques, 45.000 concierges.
L’industrie et le commerce emploient près de 70% de la population
parisienne. A l'exemple du commerce les grands magasins représentent
10.000 employés et en majorité des hommes, mais les petites échoppes ou
boutiques sont les plus importantes en nombre, et pouvant avoir un(e)
employé(e) ou plus. Beaucoup de femmes sont cantonnées aux tâches à la
pièce à domicile, notamment dans la confection, et elle sont les moins payées
après les enfants (à partir de 8 ans : 1 franc par jour ouvrable). Sinon
36% des parisiens sont des natifs avec une ou plusieurs générations, et 58%
viennent des provinces françaises, et 6% sont des étrangers (plus de
100.000 personnes).
*
Effectifs
militaires en 1870 : garde active 80.000
hommes, garde sédentaire 113.000 hommes, soit 234 bataillons pour la capitale.
Au mois de mars 1871, le Comité central des gardes nationales : ses effectifs étaient de 215
bataillons, soit environ 1.000 soldats par bataillon, aux derniers
jours ou avant l'attaque finale ont peut estimer qu'il y avait une
résistance de l'ordre de 50.000
hommes et femmes (environ 200) derrière les barricades ou sur les
fortifications, dont une bonne
partie sera passée par les armes sans le moindre jugement, et incluant
des innocents ou des personnes n'ayant eu aucun rôle actif.
De mars à avril, les troupes Versaillaises : se composèrent d'abord d'environ
40.000 hommes (sergents de ville, gardiens de paix, gendarmes et
bataillons des gardes bourgeoises), plus vinrent 80.000 soldats des
troupes régulières relâchés par les autorités allemandes.
Fusillés par les fédérés ou insurgés : 484 personnes dont
66 otages.
Pertes militaires de Versailles : 877 morts, 266 disparus,
6.454 blessés.
Répression et délation des communards :
la dernière semaine de mai de 20 à 32.000 morts, combattants inclus ;
80 condamnations à mort après la Commune, et 400.000 dénonciations
écrites.
Fédérés prisonniers et en fuite : plus de 40.000 arrestations, dont
967 décès lors de l'incarcération : 10.137 déportations ; dans une enceinte fortifiée : 1.169 ; réclusions
à perpétuité : 1.247. Et en estimation basse environ 5.000 exilés.
Emprisonnements à des courtes peines : 3.354 hommes et femmes ; sur 40.00 jugements acquittés : 2445 ;
non lieux : 22.727.
*
- Censures et
Conséquences
-
Paris sera doté d'un régime Municipal spécial (pas de maire élu avant
1977)
- L'état de siège sera maintenu jusqu'en 1876, avec autorisation
préalable pour les journaux, censure des théâtres, couvre-feu pour
les cafés et restaurants.
- L'artisanat parisien est décimé (50% des peintres, plombiers, couvreurs, cordonniers, etc.)
- Toute apologie de la Commune fut jusqu'à la 1ère Guerre mondiale
interdite.
*
|
|
| Filmographie : conférences et documentaires Tv et cinéma |
|
|
Sur les routes de l'exil des communards
*
Conférence de Mme Laure GODINEAU, maître de conf. à Paris XIII et Sorbonne Cité
|
|
|
Production Comité d'Histoire de la Ville de Paris - durée 85 minutes
|
|
|
*
Louise Michel : une conférence de Xavière Gauthier,
Emmanuelle Wion, pour la lecture des textes - Sujet : Féminisme 1870-1914
Production : BNF, date d'édition : 2012 (durée 82 minutes)
|
|
Maxime Lisbonne le d’Artagnan de la Commune
Sur les traces de Maxime Lisbonne le d’Artagnan de la Commune
Réalisation de C.Cerf et de J. Margueritte. Production du CNDP 1983 (durée 28 minutes)
|
|
Ce film (...) fut interdit par la censure
lors de la première demande de visa au prétexte de "Considérations
fallacieuses et insultantes à l'égard de Monsieur Thiers. Le visa
non-commercial ne lui fut accordé que le 27 juin 1956, après quatre ans
de distribution quasi clandestine.
Réalisation de Robert Ménégoz, 1951 - Ciné archives (durée 35 minutes)
|
|
 |
|
La Commune (extrait 4 minutes)
Auteur et Réalisateur : Peter WATKINS
MONTAGE: Agathe BLUYSEN, Peter WATKINS (film remasterisé)
Synopsis : "Nous
sommes en Mars 1871. Alors que la «télévision versaillaise» désinforme,
se crée la «télévision communale», émanation du peuple des insurgés. Le
film est un événement. Il s’attaque à un moment mythique de l’histoire
de France : la Commune de Paris."
Plus de 200 acteurs interprètent les personnages de la commune.
|
|
|
Source : France 5 -
Mémoires Vives Productions
(durée 52 minutes x 3)
|
|
|
|
|
|
|
- BIBLIOGRAPHIE
Sélection de 25 publications antérieures à 1920 sur la Commune de Paris
 Caricature d'Adolphe Thiers
Caricature d'Adolphe Thiers
- La patrie en danger, parution en 1871 préfacier Maurice Bouis, Auguste Blanqui
- Mes cahiers rouges au temps de la Commune, parution en 1900, Maxime
Vuillaume
- Les séances officielles de l'Internationale à Paris, pendant le Siège et pendant la Commune, parution en 1872 (3e édition)
- Journal Officiel de la
Commune, publié du 20 mars au 24 mai 1871, rédacteurs en chef Charles Longuet et ensuite Pierre Vésinier
- Édition du Journal officiel, allant du N° 79 (20 mars) au N° 144 (24 mai 1871), parution en 2011, un travail bénévole et protégé de M. Claude Ovtcharenko.
- Souvenirs d'un membre de
la Commune, parution en 1873, François Jourde
- La Guerre civile en
France, ouvrage terminé en mai 1871, Karl Marx
-
Souvenirs de la Commune, parution en
1883 (2e édition), Edgar Monteil
- Histoire critique de la
Commune, parution en 1871, George Morin
- Histoire de la Commune, parution en 1871 à Londres, Pierre Vésinier
- Les huits journées de
mai derrière les barricades, parution en 1871 à
Bruxelles, Prosper Lissagaray
- La vision de Versailles, parution en 1873, Prosper Lissagaray
- Histoire de la commune de
1871, parution en 1896 de la nouvelle édition, la première date de 1876, Prosper Lissagaray
- La Commune, histoire et
souvenirs, parution en 1898, Louise Michel
- La Commune vécue : 18 mars-28 mai 1871, parution de 1903 à 1905 en 3 volumes, Gaston da Costa
- La Commune de Paris, Au jour le jour , parution en 1904, Elie Reclus
- La guerre sociale : discours prononcé au Congrès de la paix à Lausanne, parution en 1871, André Léo
- Histoire de la révolution de 1870-1871, parution en 1872, Jules Claretie
- L'Année Terrible, parution en 1872, Victor Hugo
- Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars, parution en 1872 en 3 volumes : Tome 1, Rapports, Tome 2, Dépositions des témoins, Tome 3, Les pièces justificatives, Assemblée Nationale
- Le livre rouge de la justice, édité à Genève en 1871, Jules Guesde
- Histoire Socialiste, chapitre XI, parution 1908, sous la direction de Jean Jaurès
- Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris en 3 volumes, parution en 1878, Arthur Arnould
- Paris, journal du siège, préface d'Edgar Quinet, parution en 1873, Hermione Quinet
- La Commune de Paris et
Russie des Soviets, extrait du chapitre VI de Terrorisme et Communisme publié en 1920, Léon Trotsky
|
|
|
|
|
Et
tout fini avec des chansons !
Après
le vote de la loi
d'amnistie,
Eugène Pottier revient de son exil aux Etats-Unis. C'est en 1884 qu'il compose l'Insurgé en
hommage à Blanqui et aux Communards, en 1886 à la Commune.
-
Elle n'est pas morte
-
- On
l'a tuée à coups de chassepot,
À coups de mitrailleuse
Et roulée avec son drapeau
Dans la terre argileuse.
Et la tourbe des bourreaux gras
Se croyait la plus forte.
Tout ça n'empêche pas Nicolas
Qu' la Commune n'est pas morte !
- Comme
faucheurs rasant un pré,
Comme on abat des pommes,
Les Versaillais ont massacré
Pour le moins cent mille hommes.
Et les cent mille assassinats,
Voyez ce que ça rapporte.
- On a
bien fusillé Varlin,
Flourens, Duval, Millière,
Ferré, Rigault, Tony Moilin,
Gavé le cimetière.
On croyait lui couper les bras
Et lui vider l'aorte.
- Ils
ont fait acte de bandits,
Comptant sur le silence.
Achevez les blessés dans leur lit,
Dans leur lit d'ambulance
Et le sang inondant les draps
Ruisselait sous la porte.
- Les
journalistes policiers,
Marchands de calomnies,
Ont répandu sur nos charniers
Leurs flots d'ignominie.
Les Maxim' Ducamp, les Dumas
Ont vomi leur eau-forte.
- C'est
la hache de Damoclès
Qui plane sur leurs têtes.
À l'enterrement de Vallès,
Ils en étaient tout bêtes
Fait est qu'on était un fier tas
À lui servir d'escorte
- C'
qui prouve en tous cas Nicolas,
Qu'la Commune n'est pas morte !
- Bref
tout ça prouve au combattant
Qu' Marianne a la peau brune,
Du chien dans l' ventre
- et qu'il est temps
D'crier vive la Commune !
Et ça prouve à tous les Judas
Qu'si ça marche de la sorte
-
Ils sentiront dans peu
nom de Dieu,
Qu'la Commune n'est pas morte !
|
|
- L'insurgé, son vrai nom,
- c'est l'Homme,
- Qui n'est plus la bête de somme
Qui n'obéit qu'à la raison
Et qui marche avec confiance
Car le soleil de la science
Se lève rouge à l'horizon.
-
- Devant
toi, misère sauvage,
Devant toi, pesant esclavage,
L'insurgé se dresse
Le fusil chargé.
-
- On
peut le voir en barricades
Descendr' avec les camarades,
Riant, blaguant, risquant sa peau.
Et sa prunelle décidée
S'allum' aux splendeurs de l'idée,
Aux reflets pourprés du drapeau.
-
- Il
comprend notre mèr' aimante,
La planète qui se lamente
Sous le joug individuel.
Il veut organiser le monde
Pour que de sa mamell' ronde
Coul' un bien-être universel.
-
- En
combattant pour la Commune,
- Il
savait que la terre est une,
Qu'on ne doit pas la diviser.
Que la nature est une source
Et le capital une bourse
Où tous ont le droit de puiser.
-
- Il
revendique la machine,
Et ne veut plus courber l'échine
Sous la vapeur en action.
Puisque l'exploiteur à main rude
Fait l'instrument de servitude
Un outil de rédemption.
-
- Contre
la classe patronale,
Il fait la guerre sociale
Dont on ne verra pas la fin
- Tant qu'un seul pourra, sur la sphère
Devenir sans rien faire
Tant qu'un travailleur aura faim!
-
- A la
bourgeoisie écoeurante
Il ne veut plus payer de rente
Combien de milliards tous les ans?
- C'est sur vous, c'est sur votre viande
Qu'on dépèce un tel dividende
Ouvriers, mineurs, paysans.
|
|
|
|
Cet espace
d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
Les
articles et textes de Lionel Mesnard sont sous la mention tous droits réservés
Ils ne peuvent faire l'objet d'une
reproduction sans autorisation
Les autres documents sont sous des licences
Creative Commons 3.0 ou 4.0 (audio)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
|
|
|
|