|
|
|

|
|
Cliquez ci-dessus pour retourner à la page d'accueil
|
|
| |
|
Amérique
Latine - Archives 2005
Sommaire de la page 
1 - "En Amérique Latine, il ne se passe rien..." José Steinsleger
2 - La question vénézuélienne Roberto Hernandez Montoya
3 - Venezuela : Les
ombres du passé !
4 - La révolution bolivarienne : mythe ou réalité
?
5 - Hugo Chavez vers un 9ème scrutin gagnant ?
6 - Nouvelle
victoire du camp Bolivarien, Paul-Emile
Dupret
7 - Colombie : Ils ont
fait taire un homme...
8 - Venezuela : Un nouveau
modèle de communication est en marche ?
|
|
|
|
| |
|
|
|
"En Amérique
latine
il ne se passe rien..."
José
Steinsleger,
)))))
La Jornada,
Mexico 15 juin 2005
|
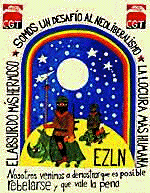
|
En début de semaine dernière, alors
que les peuples de Bolivie encerclaient La Paz et que le président
du pays andin présentait pour la seconde fois sa démission,
Alain Touraine, théoricien des mouvements sociaux
et de la "sociologie de l'action", déclarait
à Mexico : "En Amérique latine il ne se passe
rien...".
La sociologie tourainienne peut se résumer
en quelques mots : lire pour croire,
ne pas voir pour nier. Ses dévôts réfuteraient
une généralisation aussi tranchante. Cependant,
Andrés existe aussi. Andrés est un garçon
de la sierra nord de Puebla qui lave des voitures dès
6 heures le matin, me garde La Jornada et parfois parcourt
ses pages.
Me montrant la une (l'auteur mentionne la "Rayuela"
de la Jornada, littéralement la "Marelle", ndt)
du jeudi 9 juin, Andrés m'a demandé : "Regarde, licencié... Qu'est-ce que
ça veut dire ?" (Andrés
m'appelle toujours "licencié" et je lui
réponds "tu seras plus licencié").
Sans ma dose de café matinal, je lis : "Quelle
démocratie ?". Puis je vois en première
page : "Alain Touraine : la démocratie menacée
de mort". Je lui explique. Andrés répond
: "Ah, c'est ça... je comprends maintenant".
Je monte les escaliers en me disant : "Que d'efforts...". Que d'efforts
doivent faire nos peuples pour pénétrer la profondeur
des propos de personnages comme Touraine, "... une des
figures centrales de la pensée contemporaine".
Les peuples d'Amérique latine sont en train de le démasquer.
Et je crois qu'Andrés fait son chemin. Au moins a t-il
été, avec toute sa famille, à la marche
de soutien à Lopéz Obrador (candidat de la gauche
à l'élection présidentielle mexicaine, ndt).
"Dans la plus grande partie
du monde ce qui domine c'est l'incapacité de penser, d'agir,
de prévoir et de faire des projets pour l'avenir...", déclare
Touraine. "C'est un monde
qui ne se pense pas et y compris sur ce continent je ne vois
pas de grands courants de pensée (sic)... ", ajoute t-il.
Il me faut un café.
Et même un double. Je persiste dans le masochisme matinal
: "... ce qui commande c'est les finances, les personnes
qui s'intéressent à l'argent, pas à la production".
Ouah, l'apport à la "pensée contemporaine"
! Je regarde par la fenêtre et entame le dialogue avec
un petit oiseau :
-Tu te rappelles quand Touraine a rencontré
Carlos Menem, et a ensuite écrit : "Il
est surprenant de comparer le parallélisme qui existe
entre l'évolution politique de l'Argentine et le processus
que connaissent les autres grands pays occidentaux, dans lesquels
il se produit ce qu'on peut définir comme une révolution
libérale (sic)" (Revue
Noticias, Buenos Aires, 16-05-1995) ?
Petit oiseau : C'est ta
faute.
- Quelle
faute ? Touraine a été le grand gourou de ces "scientifiques
sociaux" des partis pragmatiques à usage multiple
qui nous ont mis dans cette misère de pensée que
maintenant il déplore.
Petit oiseau : Et bien...
C'est un Français ! Que sais-tu toi de son originale et
syncrétique conception "actionnaliste" qui définit
de manière précise les mouvements sociaux, y incluant
la notion de "classe sociale" ? Touraine est très
savant et toi tu n'es même pas licencié.
- Oiseau contaminé !
Maintenant je te chasse. C'est sûrement Toni Negri qui
t'envoie.
Petit oiseau : Personne
ne m'envoie. Je suis un partisan de la liberté. Touraine
m'a appris que je dois penser en fonction de ma nourriture. L'idée
tourainienne de "mouvement social" a le mérite
d'avoir entrevu avec clairvoyance que l'idée traditionnelle
du sujet révolutionnaire, ou transformateur de la société,
est entrée en crise.
- Serait-ce que tu crois que la conception "actionnaliste"
de Touraine, que l' "autonomie" des mouvements sociaux
inclus l'analyse de classe ? C'est
ce que dit aussi l'Italien Sylos Labini qui comme l' "original"
Touraine mélange Marx, Weber, Durkheim et le fonctionnalisme
étatsunien et préfère chercher en Amérique
latine une ressemblance avec son propre univers pour expliquer
le pourquoi des différences.
Petit oiseau : Je crois
dans la conscience intestinale, le seul modèle viable.
Toi par contre tu crois dans les idées et restes au XIXe
siècle, alors que tout indique que les classes sociales
doivent être réalistes et chercher des palliatifs
à la crise à l'intérieur du système.
- Quel système
?
Petit oiseau : La démocratie,
quoi ! Pour Touraine, les quatre conditions requises de la démocratie
sont : 1) l'existence d'un espace politique reconnu (la "citoyenneté")
; 2) la séparation de la société civile
et de l'Etat ; 3) la présence consciente d'un principe
d'égalité entre les individus, et 4) l'existence
de groupes d'intérêt "reconnus et organisés
de telle manière que les institutions représentatives
correspondent à des intérêts représentables,
préalablement organisés".
- Tout
cela semble parfait, petit oiseau. Trente années à
répéter la même chose ! La démocratie.
Quelle démocratie ? La démocratie est un "système"
ou un principe ?
Petit oiseau : Les deux
à la fois. La classe ouvrière et les syndicats
n'ont été qu'un phénomène passager
lié au développement du capitalisme industriel.
Aujourd'hui il convient d'être démocratique.
- Et comment
fais-tu pour éviter qu'un chat en finisse avec toi ?
Petit oiseau : Je suis
"réaliste". Je vole.
Sources :
La Jornada www.jornada.unam.mx
- Traduit du castillan par Max Keler (Révolution Bolivarienne n°12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
question
vénézuélienne,
Roberto Hernández
Montoya
|
|
|
Roberto Hernández
Montoya est Président
du Centre d'Etudes de l'Amérique Latine Rómulo
Gallegos (Celarg). Il
a fait ses études d'analyse du discours à l'École
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à Paris. Il a été
le président fondateur de l'Association vénézuélienne
d'éditeurs et directeur des éditions de l'Ateneo
de Caracas.
Le 11 avril 2002 se sont
produits les événements suivants : l'OPEP a été
abolie, le Groupe 77 + la Chine a été décapité,
l'approvisionnement de pétrole à Cuba a été
suspendu, on a compromis l'accès de Luiz Inácio
Lula da Silva au pouvoir au Brésil et le pétrole
du Venezuela a été mis à la merci des géants
de l'industrie.
Le Venezuela continue à
être aujourd'hui un laboratoire international. Tout se joue au Venezuela : l'économique,
le juridique, le social, le culturel, le politique, le militaire.
Chaque bouffonnerie ou chaque gloire vénézuéliennes
deviennent des références pour tous les peuples,
pour tous les chercheurs, ainsi que pour les curieux de tous
ces phénomènes. Mais on risque de se laisser piéger
dans un labyrinthe de miroirs qui complique le regard sur les
problèmes et ses solutions.
Le problème n'est pas Hugo Chávez. Il n'est pas
non plus la solution. Pour moi les chavistes ne sont pas seulement
pas ceux qui pensent que Chávez est la solution de tous
les problèmes. Ceux qui pensent que Chávez est
l'origine de tous les problèmes ont été
créés par lui sont aussi des chavistes. Les deux
se trompent.
La plupart des opposants
de Chávez semblent penser que s'il disparaît du
contexte politique tous les ennuis vont disparaître aussi
: la corruption, les démagogues, les médias manipulateurs...
Il n'y aura plus des
parents irresponsables, ni des femmes infidèles, ni des
guérilleros colombiens dans le territoire du Venezuela.
Et bien, j'ai le devoir alarmant de vous informer que tout cela
va continuer si Chávez n'est plus au pouvoir parce que
les solutions illusoires ne sont pas, hélas, des solutions.
Mais j'ai aussi le devoir, cette fois agréable, d'informer
que la solution à tout problème n'est pas Chávez.
Il a le pouvoir de résoudre plusieurs maux, mais pas tous.
C'est à dire, la solution est dans les mains et les esprits
de tous les vénézuéliens. Chávez
n'est que le résultat d'un processus d'années et
d'années où ont été créées
les conditions sociales et politiques dont il avait besoin pour
arriver au sommet du pouvoir. Mais ce sommet-là n'est
pas une Montagne Magique. Il est plutôt un défi,
le défi de Damoclès, pour quiconque occupe sa position.
Chacun doit travailler à son niveau, dans son espace,
et y faire son mieux.
Quelles réactions
a provoquées l'actuelle condition vénézuélienne
? Il y en a une dont
on fait très peu mention dans les médias internationaux
: un enthousiasme populaire qu'on n'avait pas vu depuis plus
d'un siècle. Puis il y a la réaction contraire
que je perçois en deux groupes difficiles à distinguer
puisqu'ils se confondent eux-mêmes dans des idées
et des actions communes. Le premier groupe c'est la droite pure
et dure, la droite de toujours. On connaît très
bien cette droite partout, donc je ne vais pas en parler beaucoup.
Je fais mention seulement des actions dirigées depuis
Washington et qui ont provoqué plusieurs événements
dont je ne vais faire mention que de deux : le coup d'état
d'avril 2002 et le sabotage de l'industrie du pétrole
de la fin de 2002 et du début de 2003. On y a tout essayé
: la formule chilienne, la formule appliquée au Nicaragua
pour renverser les sandinistes, etc. On n'a presque rien inventé
de nouveau pour les nouvelles conditions qu'on trouve au Venezuela.
J'y reviendrai.
L'autre groupe est celui
que je propose de nommer la « nouvelle droite »,
c'est à dire, celle puisée de l'ancienne gauche,
qui a fait le saut ornemental des palissades. Sous la dictature médiatique sous laquelle
survit l'humanité depuis des années, il est très
facile de glisser dans des erreurs assez dangereuses. C'est ce
qui s'est passé avec une bonne partie de la droite. Mais
cela devient encore plus dangereux lorsqu'on est en train de
chercher d'urgence un prétexte pour évader ses
responsabilités historiques. C'est le cas de plusieurs
militants de la dite « gauche caviar », celle qui
trouve les excuses les plus farfelues à l'heure de faire
face à ses engagements. Quelques uns avaient déjà
fait le parcours qui va de la guérilla au fascisme pur
et dur. Quelques autres ont découvert que la gauche tout
entière avait tort à peine le gouvernement de Chávez
a commencé à prendre les mesures que la gauche
avait elle-même toujours demandées. Ils ont soudain
montré ce qu'on a découvert à la Nouvelle
Orléans : le visage caché des États Unis,
le visage de la misère économique et sociale. L'analogie
est utile : c'est ce que les toréadors appellent «
l'heure de la vérité », le moment d'affronter
le taureau. Lorsque l'ouragan a frappé la ville de Louis
Armstrong on a découvert qu'il y a 37 millions des pauvres
au pays qu'on considère le plus riche du monde. Aussi,
lorsque la révolution a éclaté au réel,
cette gauche commode a choisi le vieux chemin de la droite. Ella
a dévoilé son vrai visage. Elle l'a fait avec un
tel acharnement qu'on a du mal à faire la différence
avec la vieille droite. Ils ont défilé ensemble
et ils ont participé ensemble aussi dans toutes et chacune
des aventures de la contre-révolution.
Le problème avec
cette gauche est le problème posé par la trahison.
Elle fait perdre un temps précieux pendant qu'on discerne
s'il s'agit d'une hésitation passagère, d'une erreur
ou d'une trahison. Mais
une fois qu'on découvre qu'il s'agit bien d'une trahison,
on perd aussi un temps précieux à essayer de comprendre
comment quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour certains
principes passe d'un jour à l'autre au champ radicalement
antagonique. Mais le dommage le plus grave est celui de confondre
la gauche d'autres pays, qui perd à son tour un temps
précieux à essayer de savoir si ce qui se passe
au Venezuela est une vraie révolution ou s'il s'agit d'un
processus bonapartiste, d'une des dictatures militaires traditionnelles
de l'Amérique Latine, d'un processus stalinien, d'un phénomène
fasciste, etc. Et bien, l'ancienne gauche devenue la nouvelle
droite a radoté tout cela : Chávez est en même
temps un dictateur et de droite et de gauche. Puisqu'il est militaire,
il n'est que trop facile de soutenir qu'il est un dictateur militaire
comme n'importe quel autre. Brillant ! Il est suffisant d'être
militaire pour être un gorille. Bien évidemment
on n'a pas eu trop de militaires présentables en Amérique
Latine. Mais il y en a eu plusieurs qui sont plus que présentables
: Miranda, Bolívar, Sucre, Sandino au Nicaragua, Torrijos
au Panama, Líber Seregni à l'Uruguay, tout récemment
décédé ; Juan Velazco Alvarado au Pérou.
Et ainsi de suite. Là l'opposition vénézuélienne
a choisi la voie la plus risquée : démontrer qu'il
y a une dictature au Venezuela. Bien sûr, de loin on peut
croire quoique ce soit que disent les journaux ou CNN, qui disent
toujours la vérité, n'est-ce pas ? Et bien, non.
Il suffit de lire la presse ou de regarder la télévision
du Venezuela pour tout comprendre. Notre ambassadeur Roy Chaderton
a dit qu'il suffit de mettre dans une chambre d'hôtel à
n'importe quel visiteur au Venezuela avec un appareil de télévision
pendant environ 15 heures d'affilée. S'il survit, il saura
de quoi s'agit-il après témoigner la campagne maniaque
et tapageuse que les médias ont déclenché
contre le gouvernement depuis 2001 environ. Avant cela les médias
ont hésité, quelques uns pensaient qu'ils pouvaient
composer avec le nouveau gouvernement. Lorsqu'ils ont découvert
qu'ils ne pouvaient pas pactiser avec Chávez, ils ont
en même temps découvert qu'il était un dictateur.
Or c'est la dictature la
plus étrange de l'histoire, où il y a des maires
d'opposition avec des corps de police armés qui participent
dans un coup d'état, tout en restant en place lorsque
le coup fait faillitte. C'est une dictature où il
y a des manifestations d'opposition presque chaque semaine, où
les médias font des blagues obscènes sur la fille
de Chávez qui n'a que sept ans. Or, aucun journaliste
ou commentateur n'a été importuné par la
dite dictature. Y avait-il des maires d'opposition pendant le
régime de Vichy ? Il est donc bien difficile de prouver
qu'il y a une dictature sous un gouvernement où la liberté
d'expression et de manifestation n'a aucune limitation. Un groupe
des militaires putschistes de 2002 a même implanté
dans une place des quartiers riches de la capitale un soi-disant
« territoire libéré ». Ils y ont restés
campés pendant des mois, jusqu'à ce que le théâtre
a décliné par lui-même, sans aucune intervention
de la dite dictature, à cause de l'abandon total de ses
adhérents. Il doit être bien dur devoir mener à
bien cette tâche de démontrer contre toute évidence
qu'il y a une dictature au Venezuela, une dictature qui a gagné
confortablement dix élections d'affilée depuis
1998. Mais ils ont aussi du mal a décider quelle est la
nature de cette dictature, voire si c'est une dictature de droite
ou de gauche. La droite n'hésite pas à pérorer
qu'il s'agit bien d'une dictature de gauche, du fait de l'amitié
entre Fidel Castro et Hugo Chávez. On dit que Chávez
veut transformer le Venezuela dans un nouveau Cuba. La nouvelle
droite, c'est à dire, l'ancienne gauche, a du mal a prôner
cette thèse. Ils préfèrent babiller qu'il
s'agit plutôt d'une dictature militaire de droite style
Augusto Pinochet. Quand on leur montre qu'il y a toutes les libertés
des démocraties bourgeoises, et encore d'autres, ils disent
que Chávez a « l'intention » de devenir un
dictateur. Bel et bien un procès d'intention. Cette dictature
a été un complet échec, puisqu'elle ne réussit
pas à s'installer comme telle depuis six ans !
On a pu voir un graffiti
sur un mur de Caracas : « À peine ils ont perdu
leurs privilèges ils ont découvert la liberté
». Au Venezuela il y avait avant Chávez une sorte
de démocratie électorale où les citoyens
ne pouvaient s'exprimer que dans des élections pour la
plupart frauduleuses.
C'était un régime corporatif, où les forces
qui dominaient étaient les syndicats patronaux, les businessmen
associés avec le grand capital mondialisé (c'est
à dire contrôlé par les États Unis),
l'Église et l'Armée. Or, l'Armée du Venezuela
a passé par une évolution bien intéressante.
Il n'est pas été par hasard que c'est les militaires
qui se sont révoltés en 1992 contre ce régime
corporatif, avec Chávez en tête. L'armée
du Venezuela est composée par des hommes et maintenant
des femmes surgissant des classes populaires ou de la classe
moyenne appauvrie. Ce n'est pas le cas d'autres pays de l'Amérique
Latine, où les officiers des armées sont largement
composés par la haute bourgeoisie, voire les oligarchies.
En 1989 les classes appauvries du Venezuela se sont violemment
révoltées contre les politiques néolibérales
du gouvernement. L'armée a été utilisée
par les classes dominantes pour une répression sanglante.
Cela a provoqué une crise de conscience dans tous les
rangs de l'armée, ce qui a précipité ses
deux révoltes de 1992, dont je viens de faire mention.
On assiste aujourd'hui
au Venezuela à une fusion des civils et des militaires
dans les tâches les plus diverses, dès la rescousse
des populations sinistrées, jusqu'aux missions sociales
: alphabétisation d'un million trois cent mille personnes
dans environ une année, l'éducation, la santé,
la distribution d'aliments, la production, la défense
de la nation, etc. Le contrecoup qui a suivi le coup d'état
de 2002 a été mené et par les civils et
par les militaires dans une action commune et concertée.
En ce qui concerne
l'entente avec Cuba, il s'agit d'une collaboration dans des tâches
essentielles comme l'éducation et la santé, ainsi
que le fournissement des carburants. Il y a actuellement des
milliers des médecins cubains qui procurent des soins
gratuits à des millions de pauvres, 24 heures sur 24,
les 365 jours de l'année. On envoie à Cuba des
centaines de malades graves pour y être guéris.
On y a rétabli la vision à environ 70.000 personnes,
jusqu'à aujourd'hui. On a adapté une méthode
cubaine pour l'alphabétisation, mais dirigée et
administrée par des enseignants et des volontaires vénézuéliens.
On lutte actuellement au Venezuela contre les latifundistes,
contre les installations industrielles abandonnées, contre
l'usure, contre les abus des patrons, contre les émissions
de télévision inappropriées pour les enfants
et les adolescents. Et ainsi de suite.
Tout cela est inacceptable
pour la bourgeoisie et surtout par l'impérialisme assoiffé
de pétrole. Le même impérialisme qui a envahi
l'Iraq, le même impérialisme qui a déclaré
la guerre au monde et qui a envahi plusieurs pays de l'Amérique
Latine. C'est une menace
mondiale permanente qui s'est considérablement aggravée
par la bande fondamentaliste en place à la Maison Blanche.
Si l'on a une pensée progressiste, Bush devrait être
un bon guide pour s'orienter dans la carte mondiale. Chaque fois
que le gouvernement impérialiste exprime sa « préoccupation
» pour un pays quelconque, on doit examiner les faits de
plus près. Cette bande a même changé le nom
des frites en anglais, qu'on avait toujours appelé French
fries pour les appeler à la cafétéria
du Congrès « les frites de la liberté »...
Tout cela fait rire mais cela fait pleurer des milliers de familles
iraquiennes et de la Nouvelle Orléans.
Merci.
sources
: http://www.analitica.com/bitblioteca/roberto/
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Les
ombres du passé :
-----
l'idéologie
néo-libérale,
ou
trente ans de déstabilisation
en Amérique Latine
Lionel Mesnard,
octobre 2005
|
|

|
|
En
relisant certains articles sur Reporter Sans Frontière sur
internet, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la Fondation Nationale
pour la Démocratie (National Endowment for Democracy ou NED).
Étonnamment, on trouve sur son site des programmes et des
financeurs en faveur du Venezuela, et c'est aussi une
«ONG» étasunienne. Le rôle de certains
groupes de pression comme le NED a été plusieurs fois mis
en cause dans sa volonté de nuire au gouvernement de Hugo
Chavez, et soit disant au nom des droits de l'Homme. Et, qui
a participé au blocage de l'activité économique en
2003 et à rassembler les signatures du référendum
révocatoire d'août 2004, avec le succès que l'on
connaît ? Le NED et sa filiale vénézuélienne
SUMATE en particulier. Qui au nom de la démocratie «mise
en danger» voulait encore après le coup d'état
avorté de 2002, faire partir le «diable» en personne
et ses amis du MVR (Mouvement pour la 5ème République).
Si Robert Ménard, le président de RSF semble assumer se faire en parti financer
par le NED : que distille ce machin, c'est quoi au juste ? Si
l'on s'en tient à d'autres sites,
nous avons là une tête de pont favorisant une
déstabilisation des institutions, et peu importe l'approbation
de 70% des vénézuéliens en 1999 et les
différentes victoires éléctorales depuis. Sur les
financements, en cela pas de mystère, on retrouve pour gentils
donateurs les néo-conservateurs du parti républicain. Au
moins sur ce point les anglo-saxons sont plus transparents que ne le
sont les français (1). Néanmoins,
si le rôle économique est connu,
il existe aussi une fonction idéologique. Défendre la
démocratie est en soit appréciable, mais on a souvent
sous estimé la nuisance d'objectifs politiques précis.
Depuis l'école de Chicago de Milton Friedmann (1973),
voilà de nouveau une officine de la pensée
néo-libérale, sous la façade d'une organisation
non gouvernementale. Et nous sommes loin d'un dessein gratuit au profit
d'une humanité allégée de ses souffrances.
Depuis un 11 septembre
1973 à Santiago du Chili, l'on peut saisir ce que cache
ce genre de structure très «honorable»,
comment business et idéologie font bon ménage ?
Tout cela bien enveloppé dans le respect de l'individu,
mais en faveur des multinationales et comme appui aux oligarchies
sud américaines, vraiment méconnues pour leur souci
du partage des richesses. Les dizaines millions de miséreux
qui n'ont pas accès au plus usuel, le marché s'en
charge à sa façon : qu'ils crèvent la gueule
ouverte ! Victoire des marchandises sur la dignité humaine,
le commerce domine, et les libertés les plus fondamentales
reculent en tout point de la planète. Sauf au Venezuela
ou l'on ne cesse de dénoncer un présumé
dictateur. Cherchez l'erreur ?
J'ai un peu
mieux saisi en voyant la bouille de monsieur Francis Fukuyama sur le
site du NED. Souvenez vous, ce n'est pas si vieux. Une publication du
sieur avait annoncé "la fin de l'Histoire", suite à
l'écroulement du mur de Berlin en 1989. Démocratie et
marché allait tout régler, sauf que le premier terme ne
doit pas avoir le même sens pour tout le monde. Et le
marché n'assure aucune garantie aux populations de ne pas
sombrer dans l'invisibilité de l'économique. La course
à la plus value prévaut bien plus sur les besoins d'au
moins 800 millions de personnes en danger de mort. Au rythme où
nous allons, jamais ne sera assuré aux plus démunis
(3/5ème de l'Humanité) la possibilité de vivre
autrement, sauf à élargir le fossé des
inégalités entre le nord et le sud. Qu'un politique
veuille mettre les richesses de son pays (le pétrole) au service
des populations de l'espace caraïbe-andin et au delà,
ça agace. Cela vient mettre à bas les règles
cyniques sur la libre concurrence et en plus protége une nation
de l'évaporation de ses capitaux. Tout cela n'est pas conforme
au dogme de ce piètre idéologue qu'est monsieur Fukuyama,
et son bras armé : le NED.
Apparemment, quand on vient
prouver le contraire, notamment au sud de la Floride, ça
fait désordre cette idée de participation concrète
à la démocratie. L'on préfère depuis
fort longtemps éliminer les acteurs du changement social
en Amérique latine. Les puissances impérialistes
ne s'embarrassent guère des progressistes qui vont au
bout de leurs idéaux ou principes. Les réseaux
nauséabonds qui ont tenté le 11 avril 2002 de faire
tomber un régime démocratique sont aujourd'hui
peu à peu démasqués. Si l'on resitue
le problème depuis 1973, on peut remarquer la même
mécanique implacable, instruite à la Maison Blanche
ou au sein du Pentagone. En 1973, c'est un certain Georges Bush
qui était directeur de la CIA... La compromission des services secrets
US avec la multinationale ITT mettra un terme au front populaire
au Chili par un coup d'état militaire sanglant. Et Pinochet
appliquera en plus de la terreur pour politique économique,
celle de l'Ecole néo-libérale de Chicago. En résumé
la politique du département d'Etat en Amérique
du Sud est la même ou presque depuis plus de 30 ans.
|
|
Note :
(1) http://www.ned.org/
Extrait financiers
du NED : Venezuela
en 2004 : le NED soutien 13 projets au Venezuela, pour un total
de : $874,384. Exemple : Instituto de Prensa y Sociedad
Venezuela : $72,000.. NED
Venezuela en 2003: le NED soutien 15 projets pour un total de
: $1,046,323. Exemple : Sumáte : $53,400
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
La
révolution bolivarienne :
mythe ou réalité ?
Lionel Mesnard,
septembre 2005
photo : apporea.org / Chavez à l'ONU
|
|

|
|
Il est très facile
à plusieurs milliers de kilomètres d'esquisser
un portrait de Hugo Chavez, il suffit de choisir son camp et
au final dépeindre une situation à travers des
batailles politiques ou journalistiques très franco-françaises. Dans ce cas, quelle perception
peut en avoir un citoyen vénézuélien des
quartiers défavorisés sur certains travers cocardiers
? La base électorale chaviste n'en connaît pas les
subtilités et à vrai dire n'y pense pas, ou se
fait une autre idée de la Nation française. Tout
comme en France, comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe
là-bas ? Doit-on se fier à un enjeu où la
question se résume trop souvent à être pour
ou contre un chef d'Etat, qui de plus échappe à
certains critères du "vieux continent" ? Face
à des prises de position réductrices, on finit
par ne pas expliquer ce qui se passe au Venezuela, et un article
à lui seul peut difficilement restituer les enjeux d'une
société complexe. Tout cet embrasement autour d'une
personnalité ne sert pas vraiment la cause d'une population,
dont les choix politiques sont difficilement contestables, évoquons
plutôt un renouveau social et les leçons d'humilité
d'un peuple qui ne demande qu'à vivre dans la dignité.
Il paraît dans notre pays un livre tous les deux ou trois
ans sur la question du Venezuela, et les deux dernières
publications évoquent le nom du président vénézuélien
(1). Il faut semble t'il accrocher le lecteur, il y
a un contexte de l'édition où il est difficile
d'alimenter un point de vue échappant au conformisme ambiant.
Néanmoins, cette rareté littéraire propose
des ouvrages de qualité, des auteurs avec une opinion
ne concordant pas vraiment, mais il vaut mieux ne pas trop s'arrêter
à des questions de positionnement. Mais qui peut vraiment
mettre en lumière la réalité vénézuélienne
? Personne, ce serait un mensonge, mais entre ces deux plumes
à la fois affectives et politiques, il peut exister heureusement
d'autres approches, notamment critiques, sans pour autant invalider
l'expérience vénézuélienne. Pourquoi
se borner à un camp, quand l'intérêt est
de comprendre comment peut agir une "conscience collective".
L'idée de Nation fédère encore des élans
et permet d'engager des transformations, donnant ainsi au politique
un dessein et de quoi agir sur le quotidien. Se déroule
au Venezuela une étape indispensable vers un Etat de droit,
incluant toutes les composantes sociales du pays. Elle n'est
pas le fait d'un individu, mais le produit d'une société
en mouvement, qui se cherche encore et avance à son rythme.
En 2005 ou plus particulièrement depuis 2003, l'on constate
une nette amélioration, voire une situation exceptionnelle
de développement. Il n'y a pas vraiment de comparaison
possible, sauf à revenir aux années 1960 en matière
de progrès social, ou sur le plan économique depuis
1973 (première crise énergétique). Un contexte
qui de plus échappe à la gouverne étasunienne,
et confirme son affaiblissement constant depuis 2001 au plan
international. Cette résistance vénézuélienne
au système néo-libéral n'est pas un épiphénomène.
Ce peuple méprisé par son oligarchie est à
bien des titres exemplaire. Et cela n'a vraiment rien d'exotique,
tout ceci est très actuel et vient bousculer certains
repères, et ne se limite pas qu'au seul Venezuela. Si
le contexte mondial lui est favorable, il y a surtout la dynamisation
du marché intérieur et des avancées sociales
ouvrant des perspectives pour une meilleure redistribution des
richesses.
I - Et , si
la question était de savoir pourquoi les vénézuéliens
soutiennent aussi massivement la politique de changement ?
On peut facilement
le comprendre à travers son histoire récente et
jusqu'à l'accession de Hugo Chavez à la présidence
de la République.
Le malaise était telle, qu'il y avait la nécessité
de mettre un terme au détournement de l'argent du pétrole
au profit d'une infime minorité, de le redistribuer en
faveur de la grande majorité. Sans oublier des pages de
répressions très sanglantes, avec une utilisation
systématique de la torture ou l'assassinat des opposants
de gauche. Ce n'était pas chose gagnée quand Chavez
arriva en 1999 à la tête du pays, l'économie
allait au plus mal. Les vénézuéliens ont
fait un drôle de pari en croyant sur la volonté
d'un seul homme de mettre fin à des années de corruption
et de terreurs. Sans l'appui et la mobilisation de la population,
la révolution bolivarienne aurait été impossible,
et la stratégie qui consista à changer la constitution
a provoqué une dynamique citoyenne. Les citoyens sont
ainsi les acteurs de cette transformation plus progressive que
radicale. Rien n'était acquit et il a fallu même
un tournant politique pour que Chavez aille plus loin dans le
mouvement des réformes. Il est arrivé à
relancer le processus après le coup d'état du 11
avril 2002, contre toute attente. À cette même période,
le petit peuple des faubourgs populaires s'est levé et
a dit non à une nouvelle dictature. Quarante-huit heures
après les putschistes prenaient la fuite et le gouvernement
chaviste reprenait sa place légitime. Et neuf scrutins
électoraux victorieux d'affilés n'ont fait que
renforcer les positions de Chavez et ses partisans au niveau
local, régional et national. Une population qui se réfugiait
dans l'abstention a fini par prendre en main son devenir. Il
y a un élan démocratique et populaire indéniable
et à suivre !
Le terme de révolution
peut porter à confusion, il ne se passe pas une révolution
au sens des schémas traditionnels que nous avons pu connaître
en Europe. Au plus
court, il ne s'agit pas d'un abominable et nouveau régime
"marxiste" mais d'un mouvement populaire. Il faut insister
sur la question sociale et penser cette révolution en
une architecture démocratique et évolutive. La
pensée de Socrate est souvent évoquée au
Venezuela et à juste titre. L'analyse critique et un contexte
favorable à l'éclosion d'une parole citoyenne libre,
et une pleine participation à la vie de la cité
sont les fondements mêmes de la pensée socratique.
Et à la différence d'Athènes, point besoin
d'avaler la ciguë pour défendre ses idées.
Si le Venezuela n'était pas un pays avec des fondements
démocratiques, au sens ou c'est le peuple qui décide
des voies de son émancipation, il n'y aurait pas ce soutien
indéfectible aux institutions de la cinquième République.
Elles ne sont peut être pas une panacée,
mais permettent à des collectifs de s'organiser et de
pouvoir appuyer des réquisitions, ou simplement par un
travail de terrain militant aller au devant des besoins des plus
déshérités. Chiche, qu'en France, nous puissions
décider de construire des logements pour ceux qui n'y
ont pas accès, de rendre les terres en friche aux petits
exploitants agricoles, et d'autres mesures qui permettent aux
vénézuéliens de mettre un arrêt à
une discrimination certaine. Il n'y a pas de fracture brutale
ou violente hormis dans le camp de l'opposition revancharde,
qui attise une volonté de pousser cette nation à
la guerre civile. La révolution bolivarienne, souhaitons-le
doit rester paisible et par progression, on ne renverse pas un
système, on le réforme pour agir sur les causes.
Rendre le pouvoir au peuple, c'est un projet original quand on
connaît en France une crise sans précédent
des institutions républicaines. La participation des citoyens
à la chose publique pourrait nous inspirer quelques idées
fécondes, nous qui sommes en principe à l'origine
de deux déclarations universelles des droits de l'Homme
(1789 et 1793) ? Deux déclarations très contradictoires,
l'une défendant la propriété individuelle,
l'autre des droits équitables.
Il existe évidemment
de nombreuses contradictions dans le jeu institutionnel bolivarien,
mais s'est ouvert une
petite brèche pour une démocratie "directe",
et tout cela dépendra de la volonté (ou pas) de
favoriser une transversalité des pouvoirs. Rien n'est
acquit, en l'état c'est un système certes républicain,
mais pyramidal, tout comme chez nous avec ses défauts
autocratiques. Sortir d'une misère endémique soixante-dix
pour cent des vénézuéliens nécessite
un effort important pour l'éducation, la mise en place
d'un maillage social fort qui réponde à des besoins
universels. Il n'est pas simple de régler des questions
aussi essentielles sans procéder par étapes. Il
faudra probablement une génération pour mettre
fin à des déséquilibres qui durent depuis
la conquête espagnole. Il en est de même pour les
mentalités, et à ce sujet la reconnaissance des
peuples indigènes est un pas vers un apaisement des consciences.
Plus encore, si nous tendons enfin l'oreille à la question
de notre mémoire, plus prosaïquement à l'Histoire
de l'Humanité. Le registre de la Nation est devenu une
base commune à l'échelle planétaire, mais
des états sans échanges sont des pays amenés
à décliner. C'est un peu tout l'enjeu de ce qui
fera le moteur de l'Histoire de demain ou pas, et la nature de
nos échanges qui ne sont pas seulement économiques.
Le monde est dans l'obligation de changer de base, et il faut
le rappeler que le nationalisme dans une vision étroite
conduit toujours à la guerre. Et c'est dans une perspective
internationaliste que le prolétariat mondial s'émancipera
peu à peu des rouages du système capitaliste. Et
cette perspective ne peut aboutir que si l'on s'en tient à
pacifier les débats et défendre des idées
que l'on croit justes. La raison est plus de convaincre et de
s'organiser en font de classe, que de combattre ou éliminer
les adversaires. Un nouvelle ère démocratique doit
naître, tirer des leçons du passé et esquisser
un autre avenir dans un espace politique pacifié, mais
pas pour autant sans contrôle des masses ou contre-pouvoirs.
II - Il existe
des points communs entre nos deux peuples, il y a en particulier
cette incapacité à se soumettre à un ordre
rigide.
C'est même
le plus beau paradoxe des vénézuéliens,
ils rêvent tous d'ordre, mais ils sont aussi des individus
et leurs comportements sont tout aussi contemporains que les
nôtres, allant de l'altruisme à l'égoïsme. La société de consommation
agit là-bas pareillement, les modes de vie sont sans grande
originalité d'une part ou d'autre. La problématique
est sociale et urbaine avant tout, le reste est vraiment secondaire
quand on connaît de telles disparités sociales ou
l'extrême pauvreté concerne un quart de la population.
La question n'est pas de s'apitoyer sur le sort des plus humbles,
mais de pouvoir esquisser un ordre construit sur l'équité
et la redistribution des richesses. La question n'est pas vraiment
vue de France de prendre parti, quelle légitimité
avons-nous à l'égard de ce peuple courageux, si
nous tombons dans nos traverses hexagonales. Et inversement,
rien ne nous empêche de prendre part à des débats,
à exprimer un point de vue extérieur.
Il semblerait utile de
faire tomber certains masques, mais faut-il à tout prix
désigner certaines chapelles politico-médiatiques,
et ainsi leur faire de la publicité inutile. Si nos amis vénézuéliens
connaissaient mieux les débats de la "rive gauche
parisienne", je ne suis pas sur qu'ils se reconnaîtraient
dans certaines invectives fumeuses. Le débat politique
au Venezuela est déjà suffisamment explosif, pour
venir surajouter nos examens de conscience. Pas plus, qu'il y
a à sortir la boîte de cirage, il n'y a pas plus
d'homme suprême, que de hasard. Et rien ne sert de trouver
en Hugo Chavez une personnalité de la même teneur,
il fait figure d'exception. C'est un personnage dont l'inspiration
est romanesque. Il est acteur de son destin et sait qu'à
tout moment ce qui est arrivé à Salvador Allende
en 1973 au Palais de la Moneda peut survenir à Mira Flores
à Caracas. Tant que Castro canalisera la hargne de Washington,
et que Chavez pourra se dissimuler dans l'ombre du vieux caudillo
cubain, il ne sera qu'un des nombreux "marxistes" en
planque de Mexico à Buenos Aires. Il sera toutefois amené
à reprendre la suite d'un combat que Castro n'a pas su
amener à son terme. Quand ici beaucoup sont à douter
de la démocratie, et tendent peu à peu vers des
systèmes ou des pensées populistes et totalitaires.
Hugo Chavez lui imprègne un nouvel élan démocratique,
il n'a rien inventé en soit, simplement il n'a pas mis
court au changement. Pour le moment il a su l'accompagner, il
dispose d'indicateurs et d'une situation unique pour améliorer
le quotidien de la majorité. Contrairement à son
voisin brésilien, le président Lula, sa réélection
en décembre
2006, sauf catastrophe
majeure, est évidente, et l'opposition n'a aucun challengeur
de taille à lui opposer et encore moins de solutions,
sauf à retourner en arrière.
L'énigmatique
Chavez est un habile politique, un fin stratège, mais
sans l'appui des vénézuéliens, il n'existerait
pas. Mais il est bien
là sur la scène internationale, et pour de longues
années. Le jeune "putschiste" d'hier est devenu
un républicain prudent et sage. Est-ce un mythe ou la
réalité, voilà la question qui se pose à
son sujet ? Se sert-il de l'Histoire ou embrasse t'il la cause
des vénézuéliens ? Pour le moment la balance
bascule du côté de son peuple. Avec des progrès
sociaux et économiques et une plus forte participation
de la population, sa légitimité et son intégrité
incarne un espoir pour de nombreux latinos américains
et au delà. La raison et le coeur semblent faire bon ménage,
malgré certains dérapages verbaux propres au contexte
vénézuélien. Chavez est un personnage baroque,
il marque peut être des temps nouveaux ? Bien sur cela
échappe un peu à nos schémas traditionnels
emprunt d'un grand rationalisme.Pourtant au titre des républicains,
son combat est aussi le notre. Il manque cependant à son
nouveau socialisme une dynamique. La société vénézuélienne,
et plus largement sud américaine en oublie la question
des femmes. Et étrange paradoxe, c'est vers Cuba qu'il
faut se tourner pour voir la forme la plus avancée d'égalité
entre les hommes et les femmes (notamment le droit d'avorter
et d'accéder à une contraception libre). Si en
1999 avec la nouvelle constitution, l'Etat vénézuélien
est devenu laïque, il lui reste à y inclure la moitié
de ses membres à l'édifice. Cette faiblesse apparaît
au grand jour quand il est question de dépénaliser
l'avortement. Oui, mais selon des critères eux en rien
tolérants et ne permettant pas aux femmes de sortir des
griffes du machisme (l'avortement resterait limité aux
viols et aux incestes). On peut évoquer le pragmatisme,
dire cette question doit évoluer, être comprise
au sein de la société pour enfin parvenir à
des relations plus équitables. Mais il y a de quoi affirmer
le contraire, et dire que les femmes sont aussi amener à
s'émanciper, à vivre librement et faire reculer
les préjugés. La loi, c'est le moteur des révolutions
et le gouvernement de Hugo Chavez n'échappera pas aux
critiques s'il omet sa base le plus porteuse de transformation.
Ce n'est pas qu'une question de parité, il s'agit des
bases de l'égalité, les femmes ont des droits spécifiques
et le Venezuela sur cette question traîne, un peu trop
des pieds.
Évidemment ce
genre de critique vue d'Europe peut s'avérer facile, la
mise en oeuvre plus problématique. Les résistances de la morale religieuse
sont prégnantes et le pouvoir des hommes est relativement
omnipotent. Certes, il existe de nombreuses femmes exerçant
des responsabilités, mais la société vénézuélienne
est un monde à bien des égard phallocrate et paternaliste.
Il y a là un grand travail de réforme à
ouvrir sur la place des femmes. Des propositions doivent trouver
plus d'écho. Il va de soit que c'est l'affaire des vénézuéliennes
de bousculer certains tabous, d'exiger des lois nouvelles. Il
ne faudrait pas que chaque année le jour du 8 mars soit
un alibi. Au moment où se discute à la chambre
des députés du code pénal, il importerait
de retirer toute forme de pénalisation de l'avortement.
Ce qui aiderait à engager un débat sur le droit
des femmes de fond ; mais c'est un peu absent des débats.
Beaucoup de jeunes femmes des milieux populaires sont amenées
à avoir des couches relativement précoces, et l'on
sait à quoi conduisent les pratiques illégales
en ce domaine, c'est-àdire à favoriser des rentes
de situation et des problèmes sanitaires lourds. Il y
a, à la fois un travail d'éducation à la
sexualité et au respect du corps des femmes à faire
avancer par une meilleure information sur les modes contraceptifs.
Les premières victimes des violences sont les femmes,
il ne faudrait pas non plus leur voler leur part de révolution,
leur droit à un socialisme nouveau. Certains principes
universalistes valent pour toutes et tous, et la lutte des femmes
est loin d'être achevée ou gagnée d'avance.
C'est avant tout une question de solidarité internationale
et un problème d'honnêteté intellectuel ;
la lutte des femmes est indissociable du progrès social,
quelque soit le lieu sur terre, ne l'oublions pas.
(1) en 2002 Hugo Chavez et le Venezuela de Frédérique
Langue, et en 2005
Chavez Presidente
! de Maurice Lemoine
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Venezuela
:
Hugo
Chavez
vers un neuvième
scrutin gagnant ?
Lionel Mesnard, août 2005
|
|
|
|
Nous voilà
presque au neuvième scrutin électoral au Venezuela
depuis l'élection de Hugo Chavez Frias à la présidence
de la République en 1998. Dimanche 7 août 2005, se tiendra la désignation
des conseils municipaux (municipios). Le Conseil National Electoral
(CNE) annonce que toutes les conditions de sécurités
sont remplies, les urnes s'installeront entre jeudi et vendredi.
Les électeurs vénézuéliens sont à
nouveau appelés à voter, de nombreux observateurs
étrangers sont présents pour vérifier à
nouveau la conformité du processus électoral. On
ne peut pas dire que la démocratie soit en panne, ni le
train des réformes sociales et économiques, non
plus. De quoi penser avec un trait d'humour que «notre
dictateur patenté» Hugo Chavez s'y prend vraiment
mal. Les vénézuéliens n'ont pas la chance
que nous avons d'avoir un vrai populiste de droite en France
au ministère de l'Intérieur.
Depuis la fin octobre 2004,
si les tensions restent prégnantes avec la puissance étasunienne
et le voisin colombien (incidents frontaliers de février
2005), tous les indicateurs internes sont au beau fixe. Malgré
tout le ramdam sur la loi de responsabilité en matière
de communication, la liberté d'expression ne s'en porte
pas plus mal et avait besoin d'un cadre légal notamment
pour ses dérives télévisuelles (1). On a
peu ébruité par ailleurs en France les autres réformes,
et l'on a pu remarquer au Forum Social Mondial (janvier 2005)
que le président vénézuélien a tout
simplement volé la vedette à son invitant le président
brésilien Lula. Hasard des choses, ou décidément
le verbe de Chavez fait mouche?
À y regarder de
plus près, que dire d'un Etat où la dette extérieure
se réduit malgré la pression des remboursements,
où la croissance flirte depuis presque 3 ans avec les
10 pour cent. Certes les cours du pétrole sont au plus
haut, mais il y a de la part du gouvernement chaviste une impulsion
concrète. Il favorise des échanges au sein du MERCOSUR (2) : ils
vont de l'échange d'énergie, aux besoins scolaires
et sanitaires. L'économie sociale prend peu à peu
une certaine place dans le pays, à ce titre le nombre
des coopératives est en augmentation constante et à
un rythme soutenu. Le travail de re-dynamisation passe aussi
par la réquisition des terres et la limitation du système
latifundiste. Le développement de petites et moyennes
exploitations pouvant se tourner vers le marché intérieur
est évident, et les besoins ne sont pas encore tous couverts.
À ce sujet, le Venezuela fait ce que son voisin brésilien
a oublié dans de vagues promesses électorales.
Il en va de même pour certaines entreprises, si l'outil
est abandonné, l'État et les salariés ne
plient pas devant la spéculation. Ils peuvent ainsi intervenir
dans un espace de co-gestion, dont l'exemple est venu de l'entreprise
VENEPAL. Qui fut le fruit d'une expérience de reprise
suite à un lock-out patronal, un transfert du privé
vers l'État avec ses travailleurs mobilisés pour
assurer le maintien de l'outil de travail.
La politique du «poco
a poco» continue sa révolution tranquille, et les
sondages donnent toujours à Chavez une popularité
à faire perdre sa rationalité à plus d'un
gouvernant européen. En
soit le scrutin à venir ne présentera pas vraiment
de surprise, sauf que certains pourront dire ou écrire
que la mobilisation a été moins forte, normal comme
ici l'enjeu à un caractère local, et pas national.
Ce qui est encore plus étonnant c'est à quel point
la révolution bolivarienne fédère les espoirs
sur quasiment l'ensemble des peuples en lutte du sous continent
latino américain, notamment les peuples indigènes.
À ce titre, le texte récent du front Zapatiste
au Mexique a de quoi nous inquiéter
(3). Le Nicaragua, Le Guatemala, les
nations andines sont au plus mal. Institutions et économies
maintiennent l'oppression sociale et le cynisme des oligarchies
n'a pas de limite. La misère continue de s'accroître
au nom du néo-libéralisme, ces pays ou plus exactement
les populations ont pour exemple une option républicaine,
solidaire et démocratique. Le changement c'est l'affaire
de tous, et le gouvernement Chavez n'est pas exempte de critique.
Mais c'est avant tout le choix des vénézuéliens
qui priment et ils n'infléchissent pas depuis 1999, même
les réformes de fond se poursuivent sans attendre l'accord
de Washington. Récemment Bush et Madame Rice ont quasiment
jeté l'éponge en prônant l'abstention électorale
au Venezuela.
Plus exactement, on souhaiterait
que le Venezuela ne soit plus dans les médias français
un combat d'arrière garde, ou l'enjeu d'un fan club à
Chavez. Cela vaut aussi bien pour la presse dominante ou
qualifiée d'alternative. Je veux bien comprendre que la
presse puisse avoir besoin de publicité, de sous, mais
de là à faire de la réclame pour PDVSA (l'entreprise
nationale des pétroles vénézuéliens)
c'est assez grotesque et déplacé. Mais bon certains
n'en sont pas à une contradiction près, ou ne font
que reproduire ce système tant dénoncé de
«chiens de garde». On pourrait imaginer que le journalisme
d'un Albert Londres ou d'un Jack London soit encore possible.
Je tiens à saluer tout particulièrement le travail
du Réseau d'Information sur l'Amérique Latine (risal.org)
et tous ceux qui s'échinent à ne pas faire de la
critique un vain mot. Quelque soit nos opinions, si nous avons
conscience que pendre position pour un pouvoir est souvent un
leurre, alors peut être là nous servons des intérêts
communs pour une transformation en profondeur de nos sociétés
de l'information ?
PS : j'en oublierais les discussions au sein de l'OMC
et la petite guerre des marchés à la banane. L'Europe
veut imposer, plus exactement maintenir des taxes imposantes
aux bananes vénézuéliennes et autres des
régions caraïbes et latines. C'est à cela
que l'on mesure que ce ne sont plus les femmes et les hommes
qui font l'histoire mais les marchés de l'absurde.
Notes :
(1) lire l'article de Renaud Lambert
sur le « prisme médiatique vénézuélien
» de juin 2005, sur le site risal.org : http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1408
(vous pouvez aussi
en ligne vous inscrire à sa lettre régulière).
(2)
le Mercosur (marché
du sud) est l'équivalent de ce que fut le système
d'échanges économiques entre les états européens
dans les années 1970.
(3) Ezln (Front zapatiste de libération nationale)
s'interroge fortement sur son avenir, dans un texte disponible
sur le oueb : «Lettre de l'EZLN à
la société civile» du 21 juin 2005 (en français ou en espagnol).
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Elections
municipales
au Vénézuéla :
nouvelle
victoire
du camp Bolivarien !
Paul-Emile
Dupret,
9 août 2005
|
|
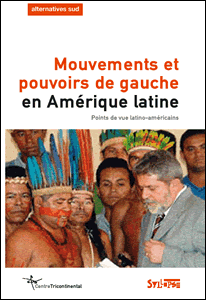
|
|
Le « Bloc pour le changement », alliance
de partis progressistes appuyant le gouvernement du président
Chavez, a remporté haut la main les élections municipales
au Venezuela ce dimanche 7 Août, ce qui permet d'augurer
qu' il remportera également les élections parlementaires
qui auront lieu de 4 décembre prochain, qui sont essentielles
pour le renforcement du projet bolivarien. Les
forces bolivariennes ont remporté plus de 70 % des sièges
en dispute,au cours d' une journée électorale qualifiée
de « transparente et démocratiques » par les
observateurs internationaux. Avant les élections, l' opposition,
affaiblie et divisée sur le fait de participer ou non
au scrutin, avait tenté de discréditer le processus
électoral en accusant de partialité l'arbitre électoral
(CNE-Conseil National Electoral).
Cette campagne avait été orchestrée
par l'ONG « SUMATE » financée par les fonds
nord-américains "pour la démocratie"
et avait été relayée par divers médias
internationaux comme par exemple le journal espagnol El País,
propriété du groupe de presse PRISA. Ces médias se trouvent une nouvelle fois
contredit par l'évidence du caractère exemplaire
du processus électoral vénézuélien
et de l' appui populaire au projet bolivarien.
Dans son édition du 9 Août, le journal
El País tente cependant à nouveau de tromper ses
lecteurs en évoquant une abstention de 75 % au cours de
ces élections, alors que l' autorité électorale
officielle a annoncé une abstention de 69 %, soit inférieure
de 7 points à celle d' élections locales similaires
organisées au cours de l'année 2000. En outre le nombre de votant en
termes absolus est bien supérieur que lors du scrutin
de l'année 2000 car des millions de citoyens et citoyennes
auparavant exclus de toute participation électorale, -souvent
pour cause d' analphabétisme-, ont été depuis
lors inscrits au registre électoral national.
sources
: Collectif Venezuela
13 Avril
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
Cinéma
documentaire :
«Ils ont fait taire un homme»,
ils
ne feront pas
se taire un peuple !
Lionel Mesnard, juin 2005
|
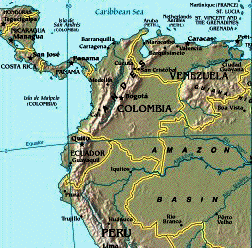
|
|
« Ils ont fait taire
un homme » est un film documentaire de Nicolas Joxe et
Yves Junqua sur les paramilitaires des Autodéfenses Unies
de Colombie (AUC). Le
parcours de Nicolas Joxe débute en 2001 à son arrivée
à Bogotá. Il conservait de la Colombie des souvenirs
de vacances et les origines de sa mère. Il découvrira
une autre réalité, il cherchera à comprendre
pourquoi ce pays vit en plein chaos. Il l'arpentera du nord au
sud et face à certains témoignages, il s'interroge
sur l'intolérance et la violence qui en découle.
«Dans un bidonville de Carthagène un homme me prend
par la main et me parle. Il a été ouvrier agricole
dans une bananeraie de l'Uruba. Il me raconte comment dix de
ses camarades ont été décapités pour
avoir osé organiser une grève, un crime commis
par des paramilitaires à la solde du patron». Ce
travail s'achèvera en 2003, nos deux co-auteurs seront
amenés à quitter le territoire colombien en moins
de quarante huit heures.
En Colombie, depuis les
années 50 se déroule un conflit armé. Notamment entre l'État et
des groupes guérilleros, dont les Forces Armées
Révolutionnaires Colombiennes crées en 1965 (d'inspiration
«marxiste»). En réaction, il y a 20 ans,
se sont constitués des groupements autonomes armés
d'extrême droite : les AUC. Elles rassemblent environ 15.000
soldats, semant dans tout le pays tristesse et désolation.
En 15 ans, elles ont exécuté plus de 15.000 civils.
Ces forces paramilitaires ont à leur actif au moins deux
tiers des actes de violation des droits de l'Homme, pour près
d'un quart aux troupes de la guérilla. Les AUC s'appuient
manifestement sur le haut commandement militaire pour agir. Elles
trouvent un soutien faussement dissimulé auprès
de l'actuel président de la République. Au nom
de la lutte «contre le terrorisme» et la «menace
communiste», Alvaro Uribe Veldez (élu en 2002) avait
déjà favorisé la constitution dans les années
90 ce type de formation dans la région de Medellin.
Pour la seule année
2004, 200 syndicalistes colombiens ont été assassinés. Soit la moitié des représentants
syndicaux éliminés à travers le monde parmi
plus de 4000 crimes recensés. L'information passe au compte
goutte. L'Amérique Latine semble un objet lointain, frappé
d'un interdit commercial, ou de ce fameux «bon sens»
du marketing télévisuel, «ce n'est pas grand
public». La Colombie est en tout point l'invendable destination.
Les thèses les plus réactionnaires triomphent,
le monde se voile la face. Derrière la chasse aux trafics
de la cocaïne et à ses filières mafieuses,
on assiste surtout à une mascarade. En attendant l'oligarchie
et les multinationales prospèrent. Les populations, elles
se terrent. Ces dernières années plus de trois
millions de personnes ont fui certaines zones de guerre et sont
venues rejoindre le flot de misère des quartiers pauvres
des grande villes.
La plus vieille démocratie
sud américaine est enlisée dans la corruption,
les richesses sont détournées au profit d'une minorité
ou pour les intérêts de firmes étrangères.
Les AUC font la sale besogne au profit d'un Etat disqualifié. Le
néolibéralisme d'Alvaro Uribe étouffe tout
développement. Il profite de la manne financière des
Etats-Unis dans le cadre du plan Colombie contre les narcotrafiquants,
mais se souci pas trop des questions sociales et humaines. Une vaste
supercherie, ou peu à peu, on élimine toute forme
d'opposition, sauf à alimenter les fronts
«révolutionnaires» de nouvelles recrues. Comment
peut-on expliquer la disparition d'une organisation légale de
gauche en quelques années ? L'Union Patriotique a connu pour ses
membres un sort très particulier. On peut penser qu'un parti
puisse disparaître ou s'éteindre, faute de soutien
électoral, mais ce n'était pas le cas. Ce fut par une
élimination systématique que s'organisa l'extinction de
l'UP, dans le meilleur des cas pour quelques uns de ses membres la
survie passa par l'exil.
Ce système de «nettoyage»
a atteint des sommets en 2004, ce sont aussi les associations
de droits de l'Homme ou humanitaires qui sont l'objet de cette
menace. C'est une pratique
qui ressemble aux exactions commises pendant la guerre d'Algérie
par les troupes françaises. La démocratie colombienne
est en proie à un fascisme sans nom. Il est temps de sortir
ce pays du silence, de parler des vrais enjeux. Les politiques
en cours sont contraire à toute forme d'éthique
et c'est une nation entière qui sombre en l'attente d'une
solution politique. Au plan international, la France ne donne
pas vraiment le bon exemple, et refuse au sein de l'ONU, que
la Cours Pénale Internationale se saisisse des crimes
commis en Colombie.
Le documentaire de Nicolas
Joxe et Yves Junqua illustre dans le quotidien et les différentes
rencontres le visage du pays réel. Les peurs, les douleurs sont manifestes, mais l'atmosphère
du film va au delà du chagrin. L'on doit saluer la qualité
des témoignages d'un peuple qui n'a nullement l'intention
de se taire. Certains pans de la société civile
résistent à cette mécanique implacable.
Ce film a valeur d'exemple, de ce que l'actualité des
médias, dans le cas de la Colombie ne souhaite pas toujours
aborder.
NB : Productions Iskra
(co-production ARTE), avec le soutien avec la F.I.D.H, et en collaboration avec des associations colombiennes.
|
|
|
|
|
|
| |
|
Un
nouveau modèle
de communication
en marche au Venezuela
?
Lionel Mesnard, 21 avril 2005
|
|
|
Selon l'agence d'information
ALIA-2 (1) du 15 avril 2005, lors des 3ème
rencontres internationale de soutien à la révolution
bolivarienne, Andres Izarra a expliqué l'importance de
"contrecarrer la campagne médiatique" menée
"contre son pays" dans le monde, lors de sa participation
à la table ronde consacrée "à la démocratie
et aux savoirs communicationnels". Le
ministre de l'information et de la communication a présenté
les axes et les dispositifs de son programme, notamment suite
à la loi de responsabilisation en matière de communication
de décembre 2004. Depuis avril 2002, le président
Hugo Chavez Frias a tenu à transformer le paysage audiovisuel
vénézuélien, pour mettre un frein au monopole
des télévisions du privé. Il s'est employé
dans un premier temps à relancer la télévision
d'état (canal ocho). Il a favorisé la création
de Vive Télé en 2003, en nommant à sa tête
l'ancienne directrice de Catia TV. La télé communautaire
(2) de l'Ouest de Caracas fort active
dans l'information des quartiers populaires, lors du coup d'état
du 11 avril 2002.
C'est un programme complet
en matière de presse, d'édition, radio et télévision
décrit par le ministre dans ses aspects techniques (relais,
émetteurs, télés et radios). L'objectif est la couverture de
80 pour cent du territoire en proposant une offre élargie,
à l'évidence aux modestes médias communautaires.
À remarquer l'édition de 20 millions de livres
par an dans une nation ou les principales maisons se trouvent
à Barcelone ou Buenos Aires. Hormis la ville universitaire
de Mérida disposant de circuits d'éditions propres
à cette région Andine, il y a un problème
d'accès à la lecture pour tous. Le but de ses actions
est de rendre en sorte la population à la fois active
(protagoniste) et participative. Dessein de cette réforme,
sortir le peuple de sa sous information ou désinformation
chronique. Un projet audacieux dont on peut souligner le presque
sans faute des étapes, malgré les tumultes autour
des menaces pesant sur la liberté d'expression au Venezuela.
Le ministre a parlé
de la récente naissance de Télé Sur en compagnie
d'autres pays partenaires (Argentine, Brésil, Cuba, Uruguay). Une nouvelle télévision
d'information à l'échelle du continent latin prend
pied face aux monopoles privés de l'information, en particulier
la chaîne CNN sud américaine. Une équipe
est composée des journalistes Jorge Botero, de Colombie,
Ovidio Cabrera, de Cuba. Également figurent Beto Almeida,
du Brésil, Ana Lescano d'Argentine, et Aram Aharonian
est le Directeur Général (le siège social
à Caracas). Il faut souligner la création pour
le Venezuela d'un canal spécifique pour les enfants avec
des programmes adaptés aux mineurs. Le tout s'organisant
dans le développement de productions nationales sous quota
(40% minimum) selon la nouvelle loi).
Encore récemment
en mars 2005, L'association Reporters Sans Frontières
dénonçait les menaces d'autocensure sur la presse.
Le renforcement de
l'arsenal juridique en cas de dérapage des journalistes
dans la cadre des nouvelles modifications du code pénal.
RSF avait déjà en 2004 émit des réserves
sur la nouvelle loi en matière de communication. Au sujet
de Télé Sur, il s'écrit que c'est un embryon
de télé sans réel capacité de faire
face à ses concurrentes latino-américaines. Il
semblerait que le gouvernement de Hugo Chavez ne soit épargné
d'aucune critique à chaque avancée. Ce rééquilibrage
entre médias privés et médias d'état
ou communautaires ne plait pas à ce qui ressemble de loin
à des écrans poubelles. De quoi faire rêver
le président de TF1, Monsieur Le Lay, sur les temps de
cerveaux disponibles pour les sodas (au Venezuela c'est Pepsi
qui domine !).
Dans cette tourmente de
l'info autour de la révolution bolivarienne, il y a toutefois
une distance à tenir avec la propagande officielle. Oui, le contenu est facteur de
développement. On peut néanmoins s'interroger sur
comment ces outils seront un jour au service d'un contrôle
citoyen plus ample ? La transparence en l'état est un
leurre, tout est question de stratégie. Difficile de ne
pas voir en un ministre de l'information et de la communication,
un contrôle étatique un peu pesant. Certes républicain,
mais qui reflète l'incapacité des pouvoirs politiques
à couper le cordon avec les médias. Me que faire,
si la médiocrité l'emporte et qu'au final les vénézuéliens
continuent à regarder les mêmes programmes insipides
? Quand au demeurant c'est une « guerre » des médias
qui s'y déroule, pour se demander mais que vient faire
RSF sur un terrain si aventureux ? On peut en saisir l'inquiétude
face à des menaces objectives, mais sur la non-objectivité
des propos, la notion d'autocensure laisse rêveur «
au pays du journalisme ». Dans un monde dominé par
la désinformation et la propagande, voire la haine ou
l'insulte raciste, il est difficile de trouver un juste équilibre.
Sauf à mettre en lumière les différentes
thèses et tous les débordements, en particulier
dans le domaine de la vie privée de chacun à être
protéger des abus du sensationnalisme ou de la désinformation.
On rêverait d'un
train des réforme, au même rythme que celui des
médias au pays de Hugo Chavez. Cet intérêt
trouvera t'il de nouvelles pistes en des programmes de qualité
et critiques, et pas du béni oui-oui pro-gouvernemental
? Un nouveau modèle
ou l'expression des sans voix est il possible outre atlantique
? Dans ce travail programmatique, les médias communautaires
restent néanmoins marginaux. Ou, faudra t'il simplement
se contenter d'un rééquilibrage de son et d'image,
au seul profit de l'état républicain ? Saluons
pour le moment la création des deux nouveaux canaux, un
pour l'info et l'autre pour la jeunesse. Pour le reste, il faudra
attendre la fin de cette réforme (sur 3 ans et s'achevant
avec le mandat du président en 2006), pour être
comptable des atteintes à la liberté d'expression.
Pour le moment en 2005, ou du moins en 2004 hors les cris et
manifestations de l'opposition à la chambre des députés
contre la nouvelle loi. Aucun journaliste n'a été
poursuivi en justice. Ou finalement, qui sait, si tout ce travail
n'aura pas permis d'assainir un peu le PAV ? Globotélévision
avec un nouvel habillage graphique apparu à la fin décembre
2004, peut encore aujourd'hui défendre la liberté
d'expression, surtout entre deux pages pub de 10 minutes.
Même l'Episcopat
catholique romain de Caracas a reconnu dans la loi sur les médias
de communication un accord non dissimulé. Séquences de violences,
pornographie ou images avilissantes des femmes seront soumises,
à un contrôle plus stricte, protégeant entre
autre les jeunes publics des scènes les plus crues à
certaines heures de la journée. En octobre 2004, Hugo
Chavez appuyait toute ses félicitations à son ancien
ministre de la communication Jesse Chacon (promu au ministère
de l'intérieur) pour une réussite pleine et entière.
Tout en remarquant que ce n'étais pas le cas de tous ses
ministres. Son remplaçant Andres Izarra, lui est un ancien
journaliste issue du privé récemment acquit au
pouvoir en place. Il a mené à la chambre et devant
les organismes compétents la loi nouvelle jusqu'à
sa promulgation et continue l'uvre de son prédécesseur
tambour battant.
Sans entrer dans le manichéisme
qui prévaut à parler qu'en bien ou en mal du régime
vénézuélien, on peut se douter que le public
ne va pas instinctivement suivre les nouveaux médias. Les habitudes télévisuelles
sont universellement abrutissantes ou restreintes. La manipulation
des masses n'est jamais loin des enjeux stratégiques des
pouvoirs politiques et économiques de toute nature. Les
intentions d'Andres Izarra sont louables, mais, on en distingue
pas toujours la surface conquise sur les médias dominants.
Vive Télévision, suite à une enquête
d'opinion est loin d'être suivie par les foules, une timide
pénétration dans les milieux populaires faute de
disposer d'échantillons fiables. Son nouvel habillage,
après ses 1 an d'existence fait penser à Arte ou
à la Sept française. Elle ne recueille pas encore
une grande adhésion, n'est-elle pas un brin trop austère
? Si quelque part, un média nouveau peut échapper
à la « sondomania média métrique »,
il y a plutôt de quoi s'en réjouir. Il existe une
école Latine de l'image et du son à soutenir et
à accompagner. Elle a devant elle souhaitons un nouvel
avenir. Au Venezuela, se produit un film d'auteur tous les 3
ou 4 ans, face à la machine hollywoodienne, ça
ne pèse pas lourd. Il reste en perspective un long travail
éducatif à entreprendre pour sortir du consumérisme
télévisuel là-bas, comme ici. Ou comment
soutenir une création « révolutionnaire »
et populaire ou à l'image des vénézuéliens
?
En forme de boutade et
en réponse au lancement de cette chaîne latino américaine
d'info, Télé Sur.
Hugo Chavez disait rêvé devenir animateur de Télé
à la place de son poste de président (mars 2005).
Le gag pourtant est aussi réalité, il est un peu
le Drucker national du dimanche et surtout sans Michel Drucker.
En ce domaine, il a un avenir et il aime beaucoup les médias
pour peaufiner son image à l'internationale. La révolution
bolivarienne fait avec les moyens du bord et avec progressivité.
Les mondes virtuels sont puissants et parfois ubuesques. Les
problèmes du quotidien sont bien plus considérables,
que la question d'une lucarne permettant à un peuple d'oublier
un peu les lourdeurs de l'existence. Par un rêve uniquement
matérialiste et d'ascension sociale, il nous éloigne
de tout processus révolutionnaire. Il n'y a pas de quoi
jeter la pierre au gouvernement chaviste de vouloir impulser
une nouvel élan. Attention de ne pas s'engouffrer dans
les slogans ou les discours paranoïaques ! On peut juger
les progrès accomplis, les soutenir, et aussi les critiquer
pour alimenter le débat et sortir ce pays d'un certain
oubli et de toutes ses dérives médiatiques.
Notes et compléments :
(1) Agence Latino-américaine
d'Information et d'Analyse, « En marcha, une nuevo modelo
comunicacional » sur : http://www.alia2.net
(2) Le terme « communautaire
» est a associé, vue de France, à l'idée
de collectifs. Il ne s'agit pas de communautarisme, mais de médias
(radio et télé) alternatifs. Un réseau relativement large, comprenant
plus de 200 structures nouvelles à l'échelle du
pays. Il existe environ une trentaine de télés
communautaires très inégalement dotées et
ne diffusant pas toutes pour le moment.
Sources et photo : site en castillan "Agencia
de Noticias Bolivariana"
|
|
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
|
|
|
|
|
|
| Adresse et page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy" ? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes, ... |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui est donc A.Miller? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 05/05/2012 |
|
|
|
|
|
|