|

|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
 Infos
sur l'Amérique Latine, Infos
sur l'Amérique Latine,
Sommaire de la page 3,
1 - Guatemala, de
la guerre au dévellopement durable, Ethic.es
2 - Colombie
en
guerre, Violences sexuelles contre les femmes, par
Amnesty International
3
- Mexique,
les
populations indigènes entre mafia et armée, Wolf-Dieter Vogel
4 - Rapport
sur la multinationale PERENCO au Guatemala, Collectif Guatemala
5 - Mapuche
du
Chili : Appel urgent à la société
civile internationale, pétition
|
|
|
|
|
Guatemala
: de la guerre
au développement durable |
Ethic.es (site espagnol), le 7 octobre 2011
L’histoire d’une centaine d’anciens
combattants recyclés dans un projet environnemental
Entre 1960 et 1966, le Guatemala a vécu une guerre civile
laissant de profondes cicatrices dans le paysage cartographique de ce
pays. Pendant 36 années de sang a eu lieu ce que
l’on
appela la « tuerie guatémaltèque
», qui selon
les Nations Unies (ONU) fit plus de 200.000 morts et plus de 45.000
disparus tout au long du conflit. Ethic analyse sur le terrain la
situation d’une centaine d’anciens combattants de
la
guérilla guatémaltèque qui ont
décidé de travailler en faveur d’un
avenir durable,
dans les terres arides du département du Petén.
Personne ne peut deviner à première vue ce que le
village
rural de Nuevo Horizonte cache dans ses entrailles, il se situe
à environ 30 kilomètres de Poptún dans
le
Petén à 375 kilomètres au nord-est de
la capitale
Guatemala Ciudad. Derrière la vaste
végétation qui
entoure chacune des 200 maisons qui se trouvent là, plus
d'une
centaine de soldats ont décidé d'abandonner les
armes
pour administrer un projet durable éloigné des
fusils.
L'existence d'écoles, d’une clinique, de salles
à
manger, de logements, de magasins et d’un centre culturel ne
feraient pas soupçonner au voyageur une
communauté
s’organisant de manière pratique dans des
assemblées démocratiques, et, comme si nous
étions
dans un État indépendant à
l'intérieur du
"pays du maïs".
La guerre a maintenu unis ce groupe de
Guatémaltèques
pendant 18 ans, durant lesquels ils ont appris à vivre de,
par
et pour la montagne. Le milieu naturel de la forêt
était,
comme l’expliqua à Ethic, Eusebio Figueroa (plus
connu
sous le nom de Ronie) : « l’espace de vie que nous
avions
durant la guerre » et comment la terre, nous fournissait des
« médecines, de la nourriture, de la chaleur et un
lieu
». Les principes d’actions dans cette
communauté se
sont inspirés de l'effet inverse : « Rendre
à la
terre tout ce qu'elle nous a donné ».
Mais le passage de la guerre à un projet de
durabilité
rurale n'a pas été facile dans
l’absolu.
Quatre-vingt-dix pour cent des personnes
intégrées dans
ce groupe du Petén étaient d'origine
amérindienne
et très peu en contact avec les livres, de même
pour
s'informer des meilleures techniques du moment pour mettre en valeur la
terre.
Le premier grand défi a été, donc,
d'étudier comment obtenir un développement
durable et
efficace. Un terrain qui donnait des produits pour subsister et, en
définitive, pouvoir lui rendre à ce sol aride les
nutriments nécessaires, pour être de nouveau
productif. La
clé, affirma Ronie fièrement, a
été l'amour
de la connaissance que certains avaient
développée tout
au long des années dans la montagne. « Dans la
guerre,
nous portions la plus grande bibliothèque errante qui fut
connue
», ajouta l'ex-combattant en se donnant de grands airs.
«
Chacun de nous se chargeait d'un livre et d’un cahier, en
plus de
ses vêtements, de sa nourriture, de son fusil et de son sac.
De
plus, tout était basé sur une
transmission de la
connaissance : celui qui ne savait pas lire, enseignait les secrets des
plantes aux uns et apprenait à lire à
l’aide des
autres. ».
En
négociant avec la terre
Quand ils se sont installés à Nuevo Horizonte,
les
conditions n'étaient pas des meilleures pour les semailles.
« La terre ne donne pas si tu ne la soignes pas : il faut lui
parler, il faut négocier avec elle.
»
« Mais quand nous sommes arrivés à
cette
étape, nous n'avions pas d'idée de comment
traiter la
milpa (le champ de maïs) pour qu'elle nous donnât le
fruit.
C’est ainsi que nous nous sommes dit : « compagnon,
nous
allons faire des recherches. Et avec notre goût pour la
lecture
que nous apportions de la montagne, nous avons fait des recherches sur
comment cultiver le grain, créer une coopérative,
construire une école ».
Ainsi a commencé une aventure qui dure
déjà depuis
15 ans et, au-delà de la vision de ses acteurs,
s’est
constitué un foyer pour plus d’une centaine (en
moyenne)
d'enfants vivant là. Après avoir
revitalisé le
terrain, l'objectif a été de continuer de
croître
à travers des projets de développement au sein de
la
communauté. « Quand nous avons pu obtenir que
l'électricité parvint à Horizonte -
continua Ronie
- nous avons pu construire la première école, la
clinique, la salle à manger, les magasins et d'autres
affaires".
« Ce qui dérange le plus les touristes qui se
logent ici
ce sont les coqs, le moteur de la machine des omelettes et les
moustiques », explique Wilson Pérez, responsable
du
programme tourisme solidaire, qui en 2010 a
hébergé plus
de 500 touristes provenant entre autres pays : de France, du Canada,
d'Israël, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie
et de
l'Allemagne. « Ce projet a cinq ans », explique
Wilson
Pérez, « et ce que nous voulons, c'est de montrer
aux
personnes qui viennent, comment nous vivions quand nous
étions
dans la montagne ». En plus des logements ruraux avec une
capacité allant jusqu'à 70 personnes, Horizonte
propose
au touriste d’aller dans un bois proche pour revivre comment
nous
survivions durant la guerre grâce à la
connaissance des
plantes. »
Les
femmes comme moteur
Considérées à Nuevo Horizonte comme le
grand
soutien à la communauté, les femmes de ce village
se sont
regroupées à leur propre initiative en
Association de
Femmes, elles ont beaucoup à dire et fait. Elles appuient
leurs
propres projets, comme la production de savons, d'oeufs et les
omelettes de maïs qui se consomment dans ce village
particulier,
en plus de l'organisation de cours, de rencontres et
d'évènements pour des femmes
extérieures au
village. « Par exemple, il y a quelques mois nous avons eu
une
rencontre entre femmes productrices sur les droits de l'Homme et
quatre-vingts femmes sont venues. Il y a eu aussi une formation de
femmes amérindiennes, pour qu'elles puissent exiger leurs
droits
et apprendre un métier », détailla
l'ex-combattant.
Source
: Traduction
libre de Lionel Mesnard, tous droits réservés http://ethic.es/2011/10/guatemala-de-la-guerra-al-desarrollo-sostenible/
|
|
|
Guatemala,
la multinationale PERENCO
ou
l'exploitation du pétrole coûte que coûte
Un
document vidéo de 22 minutes sur Pantuana Tv
Par
ordre d'apparition :
-
Nathalie Péré-Marzano, déléguée
générale du CRID, coordinatrice du
réseau Une
seule planète.
-
Aníbal García, député
indépendant
guatémaltèque au Congrès de la
République
du Guatemala depuis 2008. Il a déclaré
sa
candidature à la vice-présidence
auprès de
Rigoberta Menchú, Prix Nobel de la paix 1992, avec la
coalition
« Frente Amplio » pour les élections de
septembre
2011.
-
Cynthia Benoist, auteure
du rapport « Perenco, exploiter
coûte que coûte ». Coordinatrice du
Collectif
Guatemala au Guatemala.
-
Antonio Manganella, chargé
de plaidoyer sur la
responsabilité sociétale des entreprises au
CCFD-Terre
Solidaire et représentant de la Coalition
européenne pour
la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises.
-
Grégory Lassalle, réalisateur
et journaliste, membre du Collectif Guatemala
Une
initiative des Réseaux CRID et Une Seule Planète,
du CCFD Terre Solidaire, d'Amnesty International et du Collectif
Guatemala
Source
: Pantuana
TV - juillet 2011
Deux
dossiers à télécharger :
Le
dossier de Presse du Collectif Guatemala :
et
le rapport sur Perenco au Guatemala :
|
|
|
|
|
|
|
COLOMBIE.
LES VIOLENCES SEXUELLES
COMMISES CONTRE LES FEMMES
|
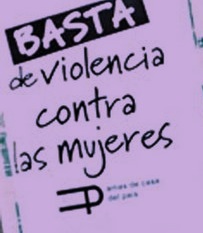
par Amnesty International, le 21 septembre 2011
Colombie
: Les violences sexuelles commises contre les femmes dans le contexte
du conflit restent impunies
Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont
été
victimes d'un déplacement forcé, d'une
exécution
extrajudiciaire, de torture, de viol, d'une privation de
liberté
ou d'une disparition forcée au cours du conflit que
connaît la Colombie depuis 45 ans.
Selon le Cabinet-conseil pour les droits humains et les personnes
déplacées, une organisation colombienne de
défense
des droits humains, plus de 280 000 personnes ont
été
déplacées de force en 2010.
Amnesty International estime qu'au cours des 25 dernières
années, entre 3 et 5 millions de personnes ont
été
déplacées à l'intérieur de
la Colombie.
Le parquet général enquête actuellement
sur plus de
27 000 cas de disparitions forcées survenues dans le cadre
des
affrontements ; le nombre réel de disparitions
forcées
serait toutefois beaucoup plus élevé.
Les défenseurs des droits humains, les dirigeants
communautaires, les syndicalistes, les petits paysans, les populations
indigènes et d'origine africaine, ainsi que les personnes
vivant
dans des zones ayant une importance stratégique pour les
parties
au conflit ou présentant un intérêt
dans le cadre
de projets miniers, agroindustriels ou
énergétiques
nationaux et multinationaux sont particulièrement
exposés
aux violations.
Les
parties au conflit
Le conflit armé interne qui déchire la Colombie
depuis
plus de quarante-cinq ans oppose les forces de
sécurité
et les paramilitaires à divers mouvements de
guérilla
classés à gauche. Toutes les parties au conflit
continuent à commettre de nombreux crimes de droit
international
et violations des droits humains d'une grande gravité, dont
beaucoup constituent des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité. Le fait de prendre civils et combattants pour
cible
de manière délibérée et
systématique
sans opérer de distinction est l'une des
caractéristiques
de ce conflit.
Les groupes de guérilla continuent à se rendre
coupables
de graves atteintes aux droits humains et au droit international
humanitaire, dont des homicides illégaux, des prises d'otage
et
le recrutement de mineurs par des unités de combat.
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC)
disposeraient de quelque 9 000 combattants dans de nombreuses zones du
pays, en particulier dans les départements du Meta, du
Guaviare,
du Vichada, du Casanare et d'Arauca, dans l'est du pays, ainsi que dans
ceux du Caquetá, du Putumayo, du Valle del Cauca, du Cauca
et de
Nariño, dans le sud.
L'Armée de libération nationale (ELN) compterait
entre 2
500 et 3 000 combattants, et disposerait d'un nombre
équivalent
de miliciens. Ce groupe est le plus puissant des
départements
d'Arauca, du Casanare et de Boyacá, dans l'est de la
Colombie,
mais il est également présent dans d'autres
parties du
pays, telles que les départements du Norte de Santander, de
César, de Santander, du Chocó, de
Nariño, du Cauca
et la région de Magdalena Medio.
Les groupes paramilitaires, qui restent opérationnels - bien
que
le gouvernement affirme le contraire -, parfois avec la
complicité des forces de sécurité,
sont
responsables de graves violations des droits humains, en particulier
contre les défenseurs de ces droits, les dirigeants
communautaires et les syndicalistes. Ils sont également les
auteurs d'opérations d'« épuration
sociale »
dans des quartiers urbains pauvres ; les victimes sont souvent des
jeunes gens accusés d'être des petits
délinquants,
des toxicomanes ou des travailleurs du sexe. Les lesbiennes, les gays
et les personnes bisexuelles et transgenres sont eux aussi dans la
ligne de mire.
Beaucoup d'éléments tendent à prouver
que le
nombre de combattants faisant partie de ces groupes est en
augmentation, que ces groupes deviennent plus violents et qu'ils
traversent actuellement une phase de consolidation, dans le cadre de
laquelle des groupes de taille modeste sont absorbés par
d'autres plus larges.
Les groupes paramilitaires ont renforcé leur
présence
à travers le pays au cours des trois dernières
années et sont désormais actifs dans la plupart
des
départements colombiens. Les résultats de
certaines
recherches indiquent que ces groupes ont désormais 7 000
combattants à leur disposition ainsi qu'un réseau
de
soutien composé de 8 200 à 14 500 membres, et
qu'ils ont
ces dernières années eux aussi connu un processus
de
consolidation (Instituto de Estudios para el Desarollo y la Paz).
Violences
sexuelles contre les femmes et les jeunes filles
En 2010, l'Institut national de médecine légale
et de
sciences criminalistiques a effectué 20 142 examens dans des
cas
présumés de violence sexuelle, contre 12 732 en
2000.
84 % des victimes étaient des femmes et des jeunes filles.
Sur
les plus de 20 000 personnes examinées, 17 318 (soit plus de
85
%) avaient moins de 18 ans. Toutefois, seuls 109 des cas
examinés en 2010 semblaient relever du conflit. Compte tenu
de
la probabilité que de très nombreux cas ne soient
pas
signalés, ce chiffre est sans doute bien
en-deçà
de la réalité.
73 % des femmes ayant connu des mauvais traitements physiques n'ont pas
signalé les abus qu'elles ont subis (étude
nationale sur
la démographie et la santé sur l'ensemble des cas
de
violence sexuelle contre les femmes, mai 2011).
70 % des femmes victimes de violences physiques et 81,7 % des victimes
d'agressions sexuelles ont choisi de ne pas porter plainte
auprès des autorités (bureau du
médiateur
colombien, rapport sur l'ensemble des cas de violence sexuelle, 2010).
82,1% des victimes de violences sexuelles relevant du conflit ne
signalent pas les faits (Oxfam et Casa de la Mujer).
Sur 183 affaires de violences sexuelles que le parquet
général a été
chargé d'examiner par
la Cour constitutionnelle en 2008, les groupes de guérilla
seraient responsables dans 8,5 % des cas, les forces de
sécurité dans 19,4 %, les paramilitaires dans
45,8 %, des
groupes armés non identifiés dans 4,5 %, des
criminels de
droit commun dans 4% et un membre de la famille dans 1,5 %, tandis que
dans 16,4 % des cas le groupe auquel appartenait l'auteur
présumé n'a pas pu être
établi.
Rares sont les cas qui font l'objet d'une enquête.
D'après
les statistiques du parquet général, outre les
183
affaires de violences sexuelles sur lesquels la Cour constitutionnelle
a ordonné au parquet général
d'enquêter,
seuls 68 autres cas de violences sexuelles commises dans le cadre du
conflit font actuellement l'objet d'investigations.
Le processus Justice et paix
Aux termes de la Loi pour la justice et la paix, environ 10 % des plus
de 30 000 paramilitaires censés avoir
été
démobilisés dans le cadre d'un processus
lancé par
le gouvernement en 2003 remplissent les conditions requises afin de
bénéficier d'une importante réduction
de peine
pour avoir déposé les armes, avoué des
violations
des droits humains et restitué des terres et des biens
volés.
Cela aurait eu pour effet que des dizaines de milliers de combattants
s'étant trouvés en première ligne
déposent
les armes, mais a en revanche laissé intactes les structures
politiques et économiques très
étendues et
puissantes que les paramilitaires et leurs alliés du monde
des
affaires, de la politique et de l'armée ont construites au
fil
des années.
Quelque 90 % des dizaines de milliers de paramilitaires qui auraient
déposé les armes n'ont jamais fait l'objet
d'enquêtes pour violations des droits humains et ont donc
été libres de rentrer chez eux.
Au mois de mars 2011, les paramilitaires ayant participé au
processus Justice et paix avaient avoué plus de 57 000
crimes ;
seuls 86 de ceux-ci étaient de nature sexuelle.
|
|
|
|
|
Au Mexique, les
populations indigènes
prises en
étau entre la
mafia et
l’armée |
 par
Wolf-Dieter Vogel, le 26
juillet 2011
par
Wolf-Dieter Vogel, le 26
juillet 2011
Dans l’État de Guerrero, au Mexique, les
populations indigènes subissent violences mafieuses
militaires et discriminations, dans un pays
gangréné par la corruption et
l’impunité. Le Centre pour les Droits de
l’homme de Tlachinollan leur apporte un conseil juridique
gratuit et la possibilité de se défendre. Car
seulement 1% des crimes fait l’objet de poursuites
judiciaires, et les plaintes contre les exactions de
l’armée se multiplient, dans un contexte de guerre
contre les mafias de la drogue, lancée par le
président Felipe Calderón. Reportage.
Ils ont détruit sa vie, son avenir et sa famille. Pourtant,
quand Valentina Rosendo raconte ce que ces hommes lui ont fait subir le
16 février 2002, elle a l’air
étonnement calme : « Je faisais une lessive au
bord du fleuve, à 200 mètres à peine
de notre maison, quand huit soldats se sont posés devant moi
tout à coup. » Les hommes en uniforme voulaient
savoir de la jeune femme indigène, aujourd’hui
âgée de 26 ans, où se trouvaient les
rebelles. Ils lui ont montré des photos de
guérilleros supposés et lui ont pressé
une crosse d’arme dans le dos. « J’avais
peur, parce qu’ils étaient armés et
menaçaient de tuer tout le village. » Elle a perdu
connaissance. Les hommes étaient tout autour
d’elle à son réveil. « Deux
d’entre eux m’ont violée, les autres
regardaient. »
Retourner
au village est impossible
Elle a déjà raconté cela
très souvent. La douleur, la fièvre et la peur
ensuite. Comment elle est allée voir le médecin
du village, qui ne voulait pas la recevoir par peur des militaires.
Comment elle a marché pendant huit heures pour aller
à l’hôpital de la petite ville
d’Ayutla, où personne ne s’est vraiment
occupé d’elle non plus. Comment son mari
l’a quittée. Comment elle a dû
s’en sortir seule avec sa fille qui venait de
naître. « Mon mari m’a frappée
et m’a dit que je ne valais plus rien parce que
j’avais été violée.
»
Valentina Rosendo a changé durant ces neuf
années. Avec son bracelet argenté et son rouge
à lèvres, elle a l’air d’une
citadine, loin de la petite commune de 200 habitants de Barranca
où elle a grandi. Elle aimerait retourner un jour dans la
région côtière de Costa Chica, dans
l’État de Guerrero. Mais aujourd’hui,
elle vit dans un appartement situé dans une
arrière-cour d’immeuble dans une grande ville
mexicaine, entre les quatre-voies, des murs haut et nus, et des
câbles électriques dangereusement
arrangés. Pour des raisons de
sécurité, retourner au village est impensable
pour l’instant.
Briser
le mur de l’impunité
La jeune femme a dû fuir, parce qu’elle
s’est défendue. Parce qu’elle a
réclamé justice et qu’elle a
lutté pour que ses tortionnaires répondent de
leurs actes. Elle a porté plainte auprès de
l’administration locale. Mais des militaires sont ensuite
revenus dans son village : « Ils voulaient me forcer
à retirer ma plainte et disaient que le gouvernement allait
retirer les aides sociales à tous les habitants du village
si je ne le faisais pas. » Les voisins se sont
opposés à sa famille, le père de
Valentina a commencé à boire.
Elle a alors déménagé avec sa fille
dans la capitale de l’État à
Chilpancingo. Là encore, elle a dû fuir : elle
était surveillée et l’école
a refusé d’inscrire son enfant. La jeune femme
s’est donc retrouvée dans la métropole
mexicaine où elle vit aujourd’hui.
Malgré ses nombreux déménagements,
elle n’a pas abandonné. Même si aucun
policier, aucun avocat, aucun juge n’a voulu entendre son
histoire. Elle a même reçu une fin de non-recevoir
de la commission nationale des Droits de l’homme. Les
fonctionnaires lui ont dit « que les soldats ne faisaient pas
ce genre de choses » et ils se sont moqués
d’elle parce qu’elle ne parlait pas espagnol
à l’époque, mais juste sa langue
indienne, le Me’Phaa.
1%
des crimes fait l’objet de poursuites judiciaires
Valentina Rosendo n’a trouvé de soutien que dans
le centre pour les Droits de l’homme de Tlachinollan.
À près de cinq heures de bus de Chilpancingo, des
juristes, des travailleurs sociaux et des militants se sont
installés dans la petite ville de Tlapa. Ils accompagnent
des personnes qui ont eu des ennuis avec les administrations,
l’armée ou les notables locaux. Ici, les femmes,
hommes et enfants indigènes trouvent ce que personne
d’autre ne leur offre : des conseils juridiques gratuits et
un accompagnement solidaire, si besoin une traduction dans les langues
indiennes Me’Phaa, Amuzgo ou Nahuatl, et
l’assurance de ne pas être trompés par
des fonctionnaires corrompus ou des criminels.
Dans la salle d’attente, des photos accrochées aux
murs montrent les multiples activités du centre. On voit
l’image d’un petit garçon qui porte une
banderole « Combat pour notre sol ».
D’autres montrent des manifestations pour la
libération de prisonniers politiques. Deux femmes
indigènes apparaissent aussi sur un poster. Leur regard, en
colère, mais sans amertume, souligne leur revendication :
« Brisez le mur de l’impunité
». Ce sont les visages de Valentina Rosendo et
Inès Fernández Ortega. Elles réclament
que les soldats répondent de leurs crimes envers la
population civile.
Inès Fernández Ortega a aussi a
été violée par des militaires.
« Elle a aussi été
discriminée dans sa commune, explique Valentina Rosendo.
Toutes les deux, nous avons frappé à toutes les
portes du pays pour obtenir justice. » Abel Barrera
Hernández, le directeur du centre Tlachinollan, sait combien
il est difficile de poursuivre en justice les porteurs
d’uniformes au Mexique. Seulement 1% des crimes fait
l’objet de poursuites judiciaires dans le pays. Et de toute
façon, ceux perpétrés par des soldats
ne sont pas traités par un tribunal civil, mais seulement
devant un tribunal militaire.
Des
milliers de plaintes contre l’armée
Abel Barrera Hernández, âgé de 51 ans,
est né à Tlapa. Il a déjà
fait l’expérience des violences militaires, avec
la population civile de Guerrero quand il était enfant, dans
les années 1970. À l’époque,
les soldats chassaient les guérilleros du mouvement du
professeur Lucio Cabañas. Plus tard, les paysans qui
protestaient ont été
persécutés. Aujourd’hui, les militaires
cherchent, semble-t-il, surtout des champs de pavot et de marijuana.
Depuis que le président mexicain Felipe Calderón
a déclaré en 2006 la guerre à la mafia
de la drogue — et engagé pour cela 50.000 soldats
— les exactions des militaires ont partout
augmenté, selon le militant.
Les chiffres de la commission nationale des Droits de l’homme
(CDHN) le confirment. En trois ans, les administrations ont
reçu 3.430 plaintes contre l’armée,
selon une information du président de la commission,
Raúl Plascencia. Rien qu’en 2009, 1.800 plaintes
auraient été enregistrées. «
C’est le chiffre le plus élevé depuis
l’existence de la commission », indiquait
Raúl Plascencia. Son administration s’occupe des
cas de torture, de viols et de meurtres perpétrés
par des militaires sur la population civile. Abel Barrera
Hernández ne s’étonne pas de ces
chiffres. « Déjà il y a 17 ans, quand
nous avons fondé Tlachinollan, nous craignions un
effondrement du système judiciaire, que les organisations
criminelles n’infiltrent les autorités publiques
et qu’aucune force civile ne soit en pouvoir de
contrôler les militaires. » La « guerre
contre la drogue » est devenue selon lui une guerre contre
l’armée et a encore militarisé un peu
plus la région.
Le
gouvernement tente de contourner le jugement
Les nouvelles concernant la guerre mexicaine de la drogue —
et ses 40.000 morts — sont sinistres. Le directeur du centre,
Abel Barrera Hernández, n’est pas optimiste.
Pourtant, le petit homme, presque toujours habillé
d’un jean et d’une chemise de bûcheron,
ne semble pas amer. Ce sont les histoires comme celles de Valentina
Rosendo et Inés Fernández qui le font tenir. Les
avocats de Tlachinollan ont réussi à aller, avec
les deux femmes, jusqu’au tribunal inter-américain
des Droits de l’homme, au Costa Rica. Là-bas, en
août 2010, les juristes leur ont donné raison.
« J’ai pleuré quand le jugement a
été rendu, se souvient Valentina Rosendo. Tout
à coup, j’ai pensé à la
souffrance des dernières années, à la
séparation d’avec mon mari, à mon
village que j’avais dû quitter. »
« Maintenant, le gouvernement mexicain doit faire le
nécessaire pour qu’elles soient
réhabilitées », précise
l’avocat Santiago Aguirre, qui a accompagné
Valentina et Inés. Les prescriptions du tribunal du Costa
Rica sont claires : les faits doivent être traités
devant un tribunal civil et l’État doit
dédommager les victimes. Mais les autorités
gouvernementales de Mexico essaient de contourner le jugement. Cela ne
surprend pas Abel Barrera Hernández : « Ils
signent n’importe quelle convention internationale
qu’on leur met sous le nez, mais ne tiennent compte de rien.
» L’homme est tout de même satisfait
d’une chose : « Le vrai succès,
c’est que deux femmes issues de la population
Me’Phaa soient devenues des figures centrales du combat pour
la défense des Droits de l’homme. » Mais
ce ne sont pas ces « cas stratégiques »
qui vont faire changer le quotidien. « Les gens ne nous
connaissent pas parce que nous allons jusque devant les tribunaux
internationaux, ajoute le directeur du centre. Mais parce que nous
venons là où ils sont : dans leurs villages,
leurs maisons, leurs montagnes. »
L’argent
de l’étranger et celui de la drogue
Comme à Mini Numa, à trois heures de voiture de
Tlapa. Sur les 400 habitants de la commune, seuls quelques-uns ont
l’eau courante, et les huttes de bois protègent
à peine du froid âcre de la nuit. La plupart des
maisons n’ont pas de sol solide, comme c’est le cas
dans nombre de communes indigènes de
l’État de Guerrero. Quatre habitants sur cinq sont
analphabètes et presque la moitié des villageois
sont sous-alimentés. Les collaborateurs de Tlachinollan
viennent jusqu’ici pour aider à la construction de
latrines. Il y a deux ans, ils étaient
déjà là pour monter un centre de
santé. Plusieurs enfants étaient morts parce
qu’ils n’avaient pas été
soignés à temps. Les habitants ont alors
demandé une meilleure prise en charge médicale,
sans réaction du gouvernement. «
L’État laisse un vide que nous devons combler avec
les gens qui sont sur place », dit le militant.
Mais presque personne ne croit à un développement
ici. Une grande partie de la forêt est victime
d’abattage illégal. Et pour
l’agriculture, il fait trop froid à Mini Numa.
« Nous n’avons qu’une récolte
de maïs par an, dit Mauricio Montealegre, un habitant. Cela ne
suffit même pas pour quatre mois de tortillas. »
L’homme a tout de même pu construire une maison en
brique d’argile avec un toit stable, mais il le doit
à sa famille. Quatre de ses 11 enfants vivent à
New York. « Sans leur argent, rien ne va. » Presque
aucune famille ne pourrait survivre ici sans les virements de
l’étranger. Ceux qui n’arrivent pas
jusqu’aux États-Unis travaillent comme ouvriers
à la journée dans les grandes plantations du nord
du Mexique. Ou bien à Acapulco, plus proche, où
le tourisme assure quelques pesos.
Se
plier aux lois brutales des chefs de la mafia
Mais on ne parle pas volontiers des autres possibilités qui
existent pour gagner sa vie : la marijuana, l’opium et la
cocaïne. Environ 60% du pavot cultivé au Mexique
vient de l’État de Guerrero. C’est aussi
une région de transit pour la cocaïne colombienne.
Les conséquences sont énormes : des grandes
organisations mafieuses se livrent à de violents
affrontements pour la maîtrise des voies de transport. Des
gens meurent régulièrement au cours de fusillades
en pleine rue à Acapulco, des corps sont
retrouvés décapités.
Près de la petite ville de Tasco, la police a
découvert une fosse commune de 55 corps en juin 2010, dans
une mine d’argent à l’arrêt.
Maires, responsables politiques, policiers, juges et potentats locaux
sont mêlés à ces structures
criminelles. À l’autre bout de
l’échelle, il y a des jeunes et des petits paysans
sans perspectives. Ils doivent se plier à la pression des
prix des affaires illégales tout autant qu’aux
lois brutales des chefs de la mafia.
Abel Barrera Hernández reste prudent quand il
s’agit d’évoquer les violations des
Droits de l’homme perpétrés par les
cartels. « Nous ne nous occupons pas des violences qui se
produisent entre les différents groupes criminels,
ça c’est la tâche de
l’État. » Et le militant renvoie aux
projets de soutien des cultures alternatives par le centre Tlachinollan.
Militants
tués, collaborateurs emprisonnés
Retour au quartier général de Tlapa. Abel Barrera
Hernández est toujours très occupé. Il
n’aime pas les déplacements. Mais il court
d’un dernier rendez-vous dans un village à une
audition au ministère public, et doit probablement encore
aller à Mexico le lendemain. Cette année,
l’anthropologue et théologien s’est
rendu à Berlin, pour y recevoir le prix des Droits de
l’homme 2011 de la section allemande d’Amnesty
International. Mais le militant reste modeste : « Ce prix
revient aux victimes des tortures et des mauvais traitements.
À ceux qui passent leurs nuits à même
le sol et s’endorment la faim au ventre. »
L’homme rappelle aussi que le centre est né
à la suite du soulèvement zapatiste de 1994. Les
rebelles de l’État de Chiapas ont
été les premiers à attirer
l’attention sur la situation des Indigènes.
Mais Abel Barrera Hernández sait aussi que le prix
d’Amnesty lui apporte un peu plus de protection. Et
c’est important ici. Car celui qui se défend
contre la mafia des caciques locaux, des politiciens corrompus et des
soldats violents vit dangereusement. En avril, le militant
écologiste Javier Torres Cruz a été
tué par des paramilitaires dans la Sierra
Petátlan. Manifestement parce qu’il
s’était opposé, comme beaucoup de
paysans de la région, à l’abattage
illégal de bois. Dans la petite ville d’Ayutla
aussi, il y a eu des affrontements. Là-bas, Tlachinollan a
dû fermer une annexe en mars 2009 [jusque juin dernier]. Des
collaborateurs avaient été emprisonnés
et un membre de l’organisation de défense des
Indiens Opim, liée à Tlachinollan, a
été tué. La directrice
d’Opim, Obtilia Eugenio Fernández, vit depuis
à des centaines de kilomètres de chez elle, pour
des raisons de sécurité.
Pour Valentina Rosendo, les militants de Ayutla ont
été ses premiers interlocuteurs. Obtilia
Fernández était sa traductrice quand elle ne
parlait pas encore espagnol. Aujourd’hui, la jeune femme
aimerait pouvoir elle-même aider les habitants de sa
région d’origine. Elle va à
l’école, dans son exil citadin, et voudrait
devenir infirmière. « Dans mon village, le
médecin qui n’avait pas voulu me recevoir exerce
toujours », dit-elle. Et insiste : « Nous, les
Indigènes, nous avons aussi droit à un bon
traitement médical » Elle veut faire construire un
centre de santé dans son village. Mais ce sera possible
quand les administrations prendront au sérieux le jugement
de la cour inter-américaine. « Le gouvernement
doit avouer publiquement que les soldats m’ont
violée, réclame-t-elle. Alors, les gens de
Barranca Bejuco qui ne m’ont jamais cru
reconnaîtront que je n’ai pas menti. »
Source : Basta
Magazine
article paru dans Jungle World le
19 mai 2011
Traduction
de l’allemand : Rachel Knaebel
|
|
|
|
|
|
|
|
Mapuche du Chili :
Appel urgent à la société civile
internationale |
Nous, membres de la société civile
résidant en
France et en Europe, associations et comités solidaires du
peuple Mapuche, exprimons notre indignation contre la
décision
de la Cour Suprême du Chili, en date du 3 juin 2011, de ne
pas
annuler le procès du tribunal de Cañete, instruit
en
application de la loi 18 314 (1) et entaché
d’irrégularités. Le 22 mars 2011, ce
tribunal a
condamné à de lourdes peines quatre prisonniers
politiques Mapuche, Hector Llaitul, Jonathan Huillical, José
Huenuche et Ramon Llanquileo, qui poursuivent une grève de
la
faim depuis le 15 mars 2011 et sont actuellement
hospitalisés.
Pour
mémoire :
En avril 2009, des arrestations massives sont
opérées
dans plusieurs communautés Mapuche au sud du Chili et une
trentaine de leurs membres sont détenus en prison
préventive.
À partir du 12 juillet 2010, Hector Llaitul, Jonathan
Huillical,
José Huenuche et Ramon Llanquileo. entament avec 30 autres
prisonniers une grève de la faim qui va durer 82 jours pour
exiger des procès justes, l’élimination
des doubles
procès (mêmes délits jugés
à la fois
devant des tribunaux civils et militaires) et la non-application de la
Loi Antiterroriste à leur encontre. Cette
grève se
termine le 2 octobre 2010 avec un Accord du gouvernement de ne plus
appliquer cette loi dans les procès
déjà
entamés.
Le procès de 18 des 34 prisonniers commence le 8 novembre
2010
au tribunal de la petite ville de Cañete au cours duquel le
Ministère Public va finalement appliquer la loi
antiterroriste
et recourir aux déclarations de «
témoins sans
visage ».
Onze Observateurs Internationaux envoyés par des
organisations
de défense des Droits de l’Homme
dénoncent dans
leurs rapports les anomalies juridiques du procès
et le
manque de garanties données aux
défenseurs. Mme
Mireille Fanon Mendès-France, juriste internationale,
Présidente de la Fondation Frantz Fanon, membre de
l’Association Internationale des Juristes
Démocrates, est
envoyée en mission à ce procès comme
Observatrice
Internationale par la Fondation France Libertés - Danielle
Mitterrand et a rédigé depuis un rapport très explicite sur la tenue de ce procès.
Le 18 février 2011, la Fédération
Internationale
des Droits de l’Homme (FIDH) et ses organisations membres au
Chili, la Corporación de Promoción y Defensa de
los
Derechos del Pueblo (CODEPU) et l’Observatorio Ciudadano
(Observatoire Citoyen) appellent les tribunaux de justice chiliens
à ne pas appliquer la Loi Antiterroriste en manifestant la
nécessité de réviser cette loi
contraire aux
normes internationales.
Le 15 mars 2011, Hector Llaitul, Jonathan Huillical, José
Huenuche et Ramon Llanquileo, entament une seconde grève de
la
faim, dans l’attente de la sentencc du Tribunal de
Cañete.
Le 22 mars 2011, le tribunal de Cañete condamne Hector
Llaitul
à 25 ans de prison, et Jonathan Huillical, José
Huenuche
et Ramon Llanquileo à 20 ans de prison. Les treize autres
Mapuche, accusés des mêmes
présumés
délits sont acquittés, le 14e s’est
suicidé
pendant la procédure judiciaire .
Les quatre prisonniers politiques, plus que jamais
déterminés à poursuivre leur
grève de la
faim, demandent à leurs avocats de faire un recours de
nullité de leur procès auprès de la
Cour
Suprême du Chili.
Le 3 juin 2011, au lieu d’annuler le procès de
Cañete, la Cour Suprême, dans une
décision
contradictoire, a réduit les peines du délit
d’
« attaque contre le Procureur et son escorte
policière
», mais a maintenu les peines – de 10 ans et un
jour pour
Hector Llaitul, et 5 ans et un jour pour les trois autres –
établies pour « vol avec intimidation ».
Elle a
juste cherché une « solution
intermédiaire »
condamnant ainsi à 14 ans de prison Hector Llaitul et
à 8
ans : Jonathan Huillical, José Huenuche et Ramon Llanquileo.
Il nous est donc impossible de comprendre pourquoi l’autre
inculpation (vol avec intimidation), également instruite
sous le
coup de la loi antiterroriste et avec le recours à des
«
témoins sans visage », n’a pas
fait
l’objet du même réexamen. Il
paraît clair que
les pressions politiques exercées par l’Etat
chilien, son
Ministère Public et le groupe de pression des grandes
entreprises ont eu suffisamment d’effet sur les magistrats de
la
Cour Suprême pour que ceux-ci renoncent à annuler
le
procès dit de Cañete.
On constate aussi que les magistrats de la Cour Suprême ont
réduit les lourdes peines des quatre condamnés
concernant
la présumée « attaque du Procureur et
de son
escorte policière », pour laquelle ils avaient
pourtant
été déjà
acquittés, le 16
décembre 2010, par le Troisième Tribunal
Militaire de
Valdivia, acquittement confirmé par la Cour
d’Appel de
Conception, le 26 mai 2011.
De nombreuses organisations Mapuche ont déclaré
que
« si on les condamne, nous sommes tous condamnés
».
En effet, dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de membres
de communautés mapuche seront
déférés
devant des tribunaux et, en raison de cette décision de la
Cour
Suprême, ils risquent d’être aussi
jugés en
vertu de la loi antiterroriste et de ses « témoins
sans
visage ».
Précisons que même si les avocats des quatre
condamnés déposent dès maintenant un
recours
auprès de la Cour Interaméricaine des Droits de
l’Homme, la réponse prendra plusieurs
années et il
sera trop tard pour ceux qui sont actuellement à
l’extrême limite de leur grève de la
faim,
hospitalisés et alimentés de force.
Hector Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche et Ramon
Llanquileo ne demandent ni clémence, ni pardon, ni
grâce,
mais un procès respectant les garanties constitutionnelles
chiliennes et les normes internationales conformes.
Nous appelons la société civile chilienne, ses
parlementaires, ses syndicalistes, ses journalistes, ses artistes,
celles et ceux qui travaillent pour une autre
société au
Chili, celles et ceux qui luttent aussi, comme les Mapuche, pour
défendre leur environnement, à protester partout
au
Chili, comme elles et ils l’ont fait récemment
contre le
projet HydroAysén, en soutien aux revendications des
prisonniers
politiques Mapuche.
Nous appelons enfin la communauté internationale
à
protester auprès des autorités chiliennes et
particulièrement auprès du Président
Piñera
pour qu’il intervienne en urgence afin que les prisonniers
Mapuche soient libérés, dans l’attente
d’un
nouveau procès juste et équitable, et que soient
définitivement supprimés l’application
de la loi
antiterroriste et le recours aux témoins sans
visage dans
les prochains procès concernant des Mapuche
inculpés.
Dernières
informations :
Le
mercredi 8 juin,
au 86e jour de la grève de la faim des quatre Prisonniers
Politiques Mapuche, leurs familles ont commencé une
grève
de la faim liquide « Pour un Procès Juste et
l’élimination de la Loi Antiterroriste
». Trois des
quatre prisonniers ont été
transférés dans
différents hôpitaux (Jonathan Huillical est
à
l’hôpital de Nueva Imperial, José
Huenuche, à
l’hôpital de Los Angeles, Ramon Llanquileo,
à la UTI
de l’hôpital de Concepción et Hector
Llaitul reste
hospitalisé à l’hôpital de
Victoria).
Le
jeudi 9 juin,
après une rencontre de la directrice de l’Institut
des
Droits de l’Homme, Mme Lorena Fries, des
Archevêques Mgrs
Ricardo Ezzati et Fernando Chomali avec les ministres de la Justice,
Felipe Bulnes, et de la Présidence, Cristian Larroulet, il a
été décidé de
réunir de nouveau dans
l’hôpital de Victoria, les quatre prisonniers
politiques
Mapuche.
Dans la soirée de jeudi, une table de
négociations,
présidée par Mgr Chomali, Archevêque de
Concepcion,
a réuni Natividad LLanquileo Pilquimán et
Millaray
Garrido Paillalef, porte-parole des prisonniers, Pamela Pessoa, esposa
de Hector Llaitul, Lorena Fries, directrice de l’Institut
National des Droits de l’Homme, Amerigo Incalcaterra,
représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les
Droits de l’Homme, Mgr Pedro Ossandon, Evêque
auxiliaire de
Concepcion, Padre José Fernando Diaz,
représentant de la
Commission Nationale de la Pastorale Indigène de la Zone
Sud.
Cette rencontre a abouti à un Accord pour créer
une
Commission permanente de Défense des Droits du Peuple
Mapuche.
Cette Commission travaillera pour la « réforme de
la Loi
Antiterroriste pour qu’elle respecte les normes
internationales
». Une fois réunis de nouveau à
l’hôpital, les quatre prisonniers ont
assuré
que les accords obtenus à cette table de
négociation leur
donnaient les garanties pour continuer à lutter pour les
droits
de leur peuple, motif qui les amenés à cesser
leur
grève de la faim.
Dans l’attente que la Loi Antiterroriste ne soit plus
utilisée dans les prochains procès des Mapuche
liés à la lutte pour la
récupération de
leurs territoires, nous soutiendrons les travaux de cette Commission.
Les
premiers signataires :
Association Nuevo Concepto
Latino (France)
Association
Terre et Liberté pour Arauco (France)
Collectif
pour les Droits de l’Homme au Chili (France)
Comisión
de Apoyo a los Pueblos Originarios ACHG, Genève, Suisse
Comité
de Solidarité avec les Indiens des Amériques
– Nitassinan (France)
Comité
de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte - CSPCL
(France)
Defensoría
Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU),
Genève, Suisse
Mouvement
pour la Coopération Internationale (MCI), Suisse
Notes
:
(1) Loi Antiterroriste, héritée de la dictature
d’A. Pinochet et restée en vigueur au cours des
différents gouvernements de la Concertation.
(2) Richard Eduardo Neguey Pilquiman, jeune Mapuche,
âgé de 19 ans, de Puerto Choque, Tirua.
(3) Depuis hier, 7 juin 2011, au 85e jour de la
grève de
la faim des quatre Prisonniers Politiques Mapuche, leurs familles ont
commencé une grève de la faim liquide «
Pour un
Procès Juste et l’élimination de la Loi
Antiterroriste ». Trois des quatre prisonniers ont
été transférés dans
différents
hôpitaux (Jonathan Huillical est à
l’hôpital
de Nueva Imperial, José Huenuche, à
l’hôpital
de Los Angeles ; Ramon Llanquileo, à la UTI de
l’hôpital de Concepción et Hector
Llaitul reste
hospitalisé à l’hôpital de
Victoria).
|
|
|
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
|
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes, ... |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui est donc A.Miller? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 05/12/2011 |
|
|
|
|
|
| |