|

|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
|
 Informations sur
l'Amérique Latine Informations sur
l'Amérique Latine
Sommaire
année 2010, page 6
1 - Colombie : la
Sénatrice et l'Inquisiteur, Olga L. Gonzalez
2 - Mines
et changement climatique en A.L.,« un cocktail explosif
» !, Alter Echos
3 - Amérique
Latine - Chine : Les dangers d’une relation nouvelle, Daniela
Estreda
4 - Cuba
: Amnesty International demande le réexamen de l'affaire des
« Cuban Five »
&
« Défendre les 5, c’est
défendre une cause » entretien de
Sébastien Madau
5 -
Chili, une bataille de
gagnée n’est pas la fin de la lutte de la Nation
Mapuche
&
un dossier complet sur les raisons de la grève de
la faim des Mapuche
6 - Venezuela
:
(In)sécurité, Luis
Britto-Garcia
7 -
Équateur : retour sur une tentative de putsch,
entretien avec Marc Saint-Upéry
|
|
|
|
|
|
| Colombie : la
Sénatrice et l'Inquisiteur |
|

Olga L. Gonzalez (*), le.23 Novembre 2010
La récente destitution juridico-politique de la
sénatrice
Piedad Cordoba est symptomatique du très grave recul de la
démocratie après huit ans de
présidence d'Alvaro
Uribe. C'est aussi une nouvelle illustration du fait que les
élites colombiennes ont toujours
préféré la
violence et la guerre à la négociation et la
paix.
Rappelons les faits: Piedad Cordoba est une sénatrice du
Parti
libéral qui s'est fortement impliquée dans la
recherche
de négociations de paix avec les guérillas, en
particulier dans la libération des otages retenus par les
FARC.
A la fin de l'année 2007, elle a été
nommée
«médiatrice» par le gouvernement et a
obtenu la
libération des derniers civils et de plusieurs prisonniers
militaires retenus par la guérilla. C'est dans ce contexte
qu'elle a créé le réseau international
Colombiens
pour la paix. Par ailleurs, au sein du Congrès, elle
présidait la commission des droits de l'homme et celle de la
paix.
La sanction prise en
septembre
dernier à son encontre par le Procurador –
procureur
général de la République –
à savoir
l'interdiction d'intervenir en politique pendant dix-huit ans, sous le
prétexte de coopération avec les FARC, est
parfaitement
arbitraire (1) mais très intéressante
à
analyser. En
effet, elle se situe à la convergence de deux facteurs: la
mainmise des forces les plus réactionnaires sur plusieurs
institutions, et le refus catégorique des couches
dirigeantes
d'envisager des négociations de paix.
Depuis quelques années, les Colombiens se sont
habitués
à ce que le pouvoir politique soit de plus en plus
dominé
par les «forces émergentes»,
c'est-à-dire des
politiciens liés aux mafias et aux paramilitaires
d'extrême droite. Dans le cadre des procès contre
la
«parapolitique», plus de quatre-vingt
parlementaires sont
inculpés ou soumis à des enquêtes.
A cette dérive s'ajoute la transformation insidieuse que
subissent le pouvoir judiciaire et les organismes de
contrôle.
Ainsi, depuis un an et demi, la fonction de Fiscal (le chef de la
police judiciaire colombienne) est assurée par un
fonctionnaire
par intérim. La Cour suprême de justice, qui doit
choisir
son remplaçant, a voté vingt-cinq fois sans
réussir à trouver un successeur dans les
brochettes de
sombres personnages qui lui ont été
systématiquement proposés par
l'exécutif. Au
niveau local, il s'est avéré que plusieurs
fiscales
travaillaient, en fait, pour les narcotrafiquants, le plus
célèbre d'entre eux étant le
frère d'un
ancien ministre de l'Intérieur.
Un autre contrepouvoir important en Colombie était le
Procurador
(sorte d'Ombudsman ou de médiateur de la
République).
D'après la Constitution, celui-ci doit «veiller au
respect» de la Charte suprême,
«protéger les
droits humains», «défendre les
intérêts
de la société». Mais comment Alejandro
Ordoñez, membre important d'un groupe monarchiste
ultra-réactionnaire espagnol (2), pourrait-il
défendre les
intérêts des Colombiens du XXIe siècle
ou la
Constitution d'un Etat laïc? Ses actions, en tout cas, ne
prêtent pas à sourire. Dans le passé,
il a
organisé un autodafé de livres qu'il avait fait
retirer
de la bibliothèque publique de la ville de Bucaramanga.
Depuis
qu'il est Procurador, il s'est distingué par des
résolutions telles que la condamnation de
l'homosexualité
en tant qu'«acte dénaturé»,
le retour
à la pénalisation de toute forme d'avortement,
l'interdiction de l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, dans
l'organisme qu'il dirige, tous les emblèmes
républicains
ont été remplacés par des crucifix,
des cierges et
des vierges.
Or, c'est bien celui qui est appelé par la presse
«l'Inquisiteur» qui a décidé
du sort
politique de Piedad Cordoba, en lui infligeant une sanction
disciplinaire de dix-huit ans d'interdiction d'exercice, ce qui
équivaut à une mort politique.
L'acharnement du Procurador contre Piedad Cordoba est probablement
lié au franc-parler de la sénatrice et
à ses
positions progressistes, ainsi qu'à sa trajectoire
personnelle.
Le réalisateur Lisandro Duque rappelle ainsi qu'une femme
divorcée, féministe et noire – et
s'étant
battue politiquement sur tous ces fronts – incarne les
antipodes
des valeurs moralistes du Procurador et de ce qu'il entend
être
les devoirs d'une femme noire.
Pourtant, une décision de ce type n'aurait probablement pas
été prise sans un climat social et politique
propice, et
c'est là le deuxième facteur, symptôme
inquiétant de l'état actuel du pays. Le lynchage
médiatique qu'a subi Piedad Cordoba au cours de ces
dernières années est directement lié
à son
rôle dans la recherche de la paix. Rappelons qu'elle a
été espionnée illégalement
par les services
secrets, ainsi que par les gardes du corps qui lui ont
été assignés d'office –
sabotant, de fait,
son intervention dans la libération des otages. Elle a
été stigmatisée publiquement par le
pouvoir
«uribiste» et par les médias, qui ont
donné
libre cours à leur haine raciste et sexiste.
Dernièrement, elle a été la victime
d'un
étrange accident d'automobile, et elle craint toujours pour
sa
sécurité. La décision du Procurador
s'inscrit donc
dans cette ligne: celle du sabotage historique de tous les efforts
menés dans une perspective de paix avec la
guérilla des
FARC.
En effet, les initiatives de paix – sous la forme de
pourparlers,
dialogues, manifestations, mouvements sociaux – ont
été nombreuses dans l'histoire récente
de ce pays.
Elles ont été impulsées par des d'ONG
pacifistes,
des organisations liées aux églises, des
associations de
la société civile, des hommes et femmes
politiques et
aussi par des gouvernements comme celui du président Andres
Pastrana à la fin des années 1990.
Mais tous ces efforts ont été vains.
Déjà
en 1986, lors des premières tentatives de pourparlers
effectuées par le gouvernement, Gabriel García
Márquez expliquait que les différents actes de
sabotage
contre la paix étaient l'expression d'«ennemis de
la paix,
tapis à l'intérieur et à
l'extérieur du
gouvernement». Pour sa part, l'historien Medofilo Medina
considère que les résistances sont telles
qu'aucun
dialogue de paix avec la guérilla ne sera possible tant que
les
gouvernements n'auront pas préalablement reçu
l'accord
des militaires, des entrepreneurs, et des différents
secteurs
politiques ? dont aucun ne semble désirer
réellement le
dialogue, ni la paix.
Cette constante explique pourquoi les personnes qui jouent les
intermédiaires avec les guérillas ou qui
s'aventurent
dans les processus de paix risquent d'y laisser leur peau: rappelons
que le grand humoriste Jaime Garzon fut assassiné par les
paramilitaires en 1999, au sommet de sa popularité, parce
qu'il
intercédait dans la libération d'otages
économiques retenus par les FARC. Cette même
année,
et dans le contexte du processus de paix, fut également
assassiné l'ancien doyen de la Faculté
d'économie
de l'Université nationale et spécialiste des
processus de
paix, Jesus A. Bejarano. Au niveau régional, les
élus
locaux ayant établi des accords avec les FARC pour limiter
les
violences ont également subi des pressions et des menaces et
certains ont payé ces actes de leur vie. Enfin, lors de la
récente crise des otages, des intermédiaires
étrangers (comme le Suisse Jean-Pierre Gontard) ont
été accusés par les
autorités colombiennes
d'être non pas des
«intermédiaires» mais des
«auxiliaires» de la guérilla.
La plupart des hommes et des femmes politiques ont compris la
leçon. De ce fait, ils ne s'aventurent pas dans les eaux
périlleuses de la recherche de la paix et de
l'intermédiation avec les guérillas. C'est
même le
cas du parti de gauche, le Polo Democratico Alternativo.
C'est précisément dans cet échiquier
que Piedad
Cordoba est intervenue de tout son poids comme sénatrice,
multipliant les efforts afin de ramener des otages auprès
des
leurs et, surtout, afin, selon ses propres propos,
«d'apporter
l'espoir de la fin de ce sempiternel conflit
armé». Alors
que la guerre continue avec ses conséquences
désastreuses, que la situation des paysans et des trois
millions
de déplacés atteint des niveaux catastrophiques,
que les
institutions sont envahies par l'obscurantisme et que le nouveau
gouvernement Santos paraît bien décidé
à
continuer le même scénario guerrier, cette femme
courageuse fait face.
Le 2 novembre dernier, le Sénat a cautionné la
décision arbitraire du Procurador et Piedad Cordoba a perdu
son
siège. Parallèlement, la Cour suprême a
commencé à enquêter sur les agissements
de
celui-ci. Il est impossible, au stade actuel, de savoir s'il sera
déclaré incompétent et
déchu de son poste,
ou si une interprétation de la loi l'exonérera de
ses
fautes. Quel que soit le dénuement juridique, il serait
souhaitable que le sort politique de Piedad Cordoba dépende
moins des soubresauts de la justice colombienne et davantage de
l'intérêt qu'a toute une
société à
faire avancer les négociations de paix. Ce qui serait un
premier
espoir pour que la Colombie, sans nier qu'une guerre la
déchire,
fasse un pas en avant pour en sortir dignement. I
Notes
:
(*) Docteure en sociologie de l'Ecole des Hautes Études en
Sciences Sociales de Paris, présidente du Groupe
Actualités Colombie (GAC) à la Fondation Maison
des
Sciences de l'Homme de Paris.
1 - Légalement, la Cour suprême de justice est
l'instance
chargée d'enquêter sur les délits des
députés. Or son président expliquait
récemment n'avoir reçu aucune preuve contre la
sénatrice.
2 -Orden de la Legitimidad Proscrita, qui a notamment eu parmi ses
membre le dictateur de l'Uruguay Juan María Bordaberry.
Source : Le Courrier
http://lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447480
|
|
|
|
|
|
Mines
et changement climatique
en Amérique Latine, « un cocktail explosif » ! |
par Alter-Echos, le 23
novembre 2010
Du 18 au 20 novembre, Lima a été le
théâtre
d’un Forum des peuples indigènes sur la
thématique
Mines, Changement climatique et Buen-Vivir. Organisée par la
CAOI (Coordination Andine des Organisations Indigènes) en
partenariat avec différentes organisations
d’Amérique du Sud et
d’Amérique centrale,
cette rencontre a réuni près de 400 personnes
venues de
17 pays. En Amérique Latine, on dénombre
près de
cinquante millions de personnes autochtones appartenant à
671
peuples différents. Près de 90 % se concentre
dans 5 pays
: Guatemala, Mexique, Pérou, Bolivie et Equateur. Ces pays
sont
également ceux qui connaissent une expansion rapide des
activités minières, bien que
déjà
très présentes pour certains d’entre
eux. Miguel
Palacin de la CAOI, explique qu’en « travaillant
sur le
buen-vivir, on est à la fois confronté au
réchauffement climatique avec la fonte des glaciers andins
qui
réduisent la quantité d’eau disponible,
et aux
activités minières qui ne cessent de
s’étendre sur nos territoires ».
Joignant ces
thématiques, ce forum avait pour objectif
d’établir
une position dans l’optique du sommet sur le changement
climatique de Cancun (29 nov – 10 déc) et plus
largement,
en réunissant des communautés
affectées de
l’ensemble du continent, de travailler sur un agenda commun
d’initiatives pour l’année à
venir.
Les
activités minières, principale source de conflit
au Pérou
Dès l’ouverture, après une
cérémonie
traditionnelle, le ton est donné. Pour Magdiel Carrion
Pintado
de la CONACAMI (Confédération nationale
péruvienne
des communautés victimes des mines), « les mines,
ce sont
de nombreux conflits, des dommages sociaux et environnementaux
importants, au profit de quelques-uns ». Il poursuit :
« On
exploite nos terres, on cause des dommages à notre
environnement, à nos biens naturels et lorsque nous
résistons, nous sommes poursuivis et criminalisés
par le
gouvernement néolibéral de Alvaro Garcia
». La
situation au Pérou est en effet assez
préoccupante. Les
concessions pour prospections minières occupent
près de
19,6 millions d’hectares, soit plus de 16 % du territoire du
pays
et, selon Julia Cuadros Falla de l’organisation CooperAccion,
« cette expansion territoriale est une cause fondamentale de
conflits » . Selon les chiffres officiels, alors que le
nombre de
conflits sociaux s’accroît au Pérou, la
moitié d’entre eux sont des conflits
sociaux-environnementaux dont 70 % sont dus à des
activités extractives minières.
Présentées
et explicitées par de nombreux intervenants, les
conséquences des activités minières
sont
résumées par Miguel Palacin : « Les
activités minières détruisent et
dépouillent nos territoires, nous polluent, nous
intoxiquent,
nous divisent, nous déplacent », le tout bien
souvent
« avec des violences et la complicité des Etats
»
pour le « seul bénéfice des
multinationales
minières étrangères et des pays dits
développés ».
Résister
: l’exemple de Cocachacra
Tout au long des trois jours, les cas présentés
sont
éloquents. Citons le projet d’exploitation de
cuivre
à ciel ouvert de Tia Maria, situé dans la
vallée
de la rivière Tambo, près d’Arequipa,
la
région péruvienne où les concessions
sont les plus
nombreuses. Ce n’est encore qu’un projet mais
celui-ci est
rejeté par les communautés et, fait plus
surprenant, par
le maire local de Cocachacra, Juan Alberto Guillew Lopez. En organisant
une votation citoyenne rassemblant plus de 6400 votants et plus de 90 %
de NON au projet, ils ont réussi à repousser
l’ouverture de la mine, le temps de revoir
l’étude
d’impact environnemental. « Avec notre
équipe
technique, nous avons plus de 5100 remarques sur cette étude
qui
n’est pas très sérieuse et qui comprend
de
nombreuses erreurs » indique-t-il. Sur cette base, il entend
user
de tous les recours possibles pour annuler ce projet de
l’entreprise Southern Peru, à capitaux mexicains,
en
démontrant que le projet est « non-viable et remet
en
cause le développement actuel de la vallée
».
Faisant vivre plus de 15 000 familles, l’agriculture, dont le
« meilleur riz du Pérou », sera victime
des rejets
polluants de la mine dans les cours d’eau de la
région.
Travaillant sur l’amélioration de la
qualité et la
durabilité de l’activité agricole et
sur des
projets de tourisme soutenable, Alberto Guillew Lopez veut «
défendre la santé et la vie, en pensant le
développement à long-terme, et pas seulement
à des
bénéfices de court-terme ». Selon lui,
« il
n’est pas possible d’imaginer la cohabitation dans
notre
région d’une mine à ciel ouvert avec
les
activités agricoles
d’aujourd’hui».
«Où va aller la population si elle ne peut plus
vivre de
l’agriculture, demande-t-il ? Grossir les bidonvilles de Lima
?
»
Fonte
des glaciers et tensions sur l’usage de l’eau
Dans une région qui compte plus de 90 % des glaciers
tropicaux
de la planète – dont 60 % pour le seul
Pérou
– lier la thématique minière au
changement
climatique se pose comme une évidence. Ces glaciers servent
de
régulateur hydrique et leur fonte
régulière
liée au réchauffement climatique
réduit la
quantité d’eau disponible. Au Pérou,
deux glaciers
ont déjà complètement disparu, dont
celui de
Quilca à la frontière bolivienne en 2009. La
situation
est préoccupante, au point que des villes comme Lima
envisagent
aujourd’hui de dessaler l’eau du Pacifique,
solution
technique des plus onéreuses. « Quelle est
l’alternative si nous n’avons plus d’eau
et de
glaciers au Pérou ? » demande Rosa Guillen de la
Marche
Mondiale des femmes. L’eau se faisant plus rare, les
activités minières à la fois grande
consommatrice
d’eau et générant de multiples
pollutions des cours
d’eau ne sont donc pas les bienvenues. Par ailleurs, des
entreprises minières lorgnent sur certaines zones glaciaires
ou
péri-glaciaires de la région. La loi des glaciers
votée en Argentine est une première
étape pour
stopper ces velléités dévastatrices.
Les
activités minières, « sources de
transformations climatiques locales »
Il existe une « autre une relation vicieuse entre mines et
changement climatique qui est moins connue » selon Julia
Cuadros
Falla, s’appuyant sur des études
réalisées
en coopération avec l’Universidad Nacional de
Ingenieria.
Selon, elle, « si les activités
minières comptent
finalement assez peu dans le réchauffement climatique
global,
elles sont par contre à la source de profondes
transformations
climatiques locales ». Par leur immense emprise au sol, les
mines
à ciel ouvert, souvent situées sur les hauteurs
des
montagnes, modifient profondément le régime des
pluies et
des vents de lieux déjà très
vulnérables,
en plus de dégager des grandes quantités de gaz
à
effets de serre du simple fait de remuer des quantités
incroyables de roches et de terre. « On peut se retrouver
avec
par exemple des sécheresses d’un
côté de la
montagne où se situe la mine, et des inondations de
l’autre, là où il y avait avant un
équilibre
». Par ailleurs, nécessitant bien souvent des
grandes
quantités d’eau, les mines
s’accompagnent
généralement de grands barrages qui modifient
considérablement le climat le long des cours
d’eau.
« Si l’on rajoute le fait que le Pérou
est le
troisième pays le plus vulnérable au changement
climatique de la planète, on va obtenir un cocktail mortel
entre
mines et changement climatique » et cette combinaison
«
peut avoir des conséquences considérables sur
l’ensemble de la population péruvienne
», selon
Julia Carlos Falla.
Libérer
les pays des mines à ciel ouvert
Selon MarioValencia, du Réseau Colombien Face aux Grands
Projets
Miniers qui regroupe une soixantaine d’organisations
nationales,
il n’y a aucun doute à avoir, il est «
impossible de
regarder les problèmes miniers indépendamment du
modèle économique et du modèle de
société à l’oeuvre sur la
planète
». Selon lui, « les pays du Nord
désirent
contrôler physiquement les sols et le sous-sol de nos pays
pour
poursuivre leur modèle insoutenable ».
Là où certains, notamment en Amérique
du Nord
cherchent à négocier avec les multinationales
minières pour obtenir une part des
bénéfices et
réduire l’impact environnemental, ici, en
Amérique
du Sud, on prend plutôt exemple sur le Costa-Rica, qui
après une longue période de luttes, vient de se
déclarer « pays libre de mines à ciel
ouvert
». Pour Miguel Palacin, « c’est le chemin
à
suivre, tout comme la loi des glaciers en Argentine ».
«
Prochainement, nous, les peuples indigènes allons
déclarer nos territoires libres
d’activités
minières pour essayer d’enrayer cet
énorme pouvoir
politique et économique qui cherche à
étendre ses
activités minières pour faire perdurer son
modèle
». Pour lui, « il n’y a pas
d’autre alternative
si nous voulons construire le buen-vivir dans nos territoires
»,
car « des activités minières sans
conséquences néfastes sur nos territoires ou nos
communautés, il n’en existe pas ».
Construire
le buen-vivir…sans les mines !
« Récupérer les formes traditionnelles
d’échange, développer des technologies
appropriées, valoriser les modes de culture
agroécologique, assurer la sécurité
alimentaire et
l’intégrité de nos territoires,
créer des
centres autonomes pour nos semences, etc… » sont
quelques-unes des idées concrètes qui ont
été regroupées pour avancer vers le
buen-vivir.
Cet ensemble de propositions vont dès à
présent
circuler et être retravaillées d’ici la
prochaine
rencontre dans un an en Bolivie. Elles vont aussi être
portées à Cancun lors de la prochaine
conférence
internationale sur le climat (29 nov – 10 déc), et
au-delà, lors d’une journée de
mobilisations
continentale contre les activités minières le 21
juin
2011. S’appuyant sur la Convention n°169 de
l’OIT sur
les peuples indigènes et la Déclaration des
Nations-Unies
sur les droits des peuples autochtones, les participants se sont
engagés à faire respecter totalement le droit des
populations à exercer un consentement préalable,
libre et
éclairé sur toute initiative ayant des
répercussions sur leurs territoires. A ce titre, il a
été répété
à de nombreuses
reprises que les projets actuels autour des négociations
REDD
(Réduction des Emissions dues à la
Déforestation
et la Dégradation des Forêts) étaient
totalement
inacceptables et qu’il convenait de refuser ces dispositifs
à Cancun, selon Juan Carlos Jintiah de la COICA
(Coordination
des Organisations Indigènes du Bassin Amazonien). Plus
généralement, il ressort de ce forum la
nécessité de stopper la marchandisation des biens
naturels (terme préféré à
celui de «
ressources naturelles » trop ancré dans une
perception
utilitariste et prédatrice de la nature) et
s’assurer que
« nos minerais, nos forêts arrêtent de
traverser nos
pays sur nos routes et nos trains pour atteindre nos ports et quitter
les pays en laissant pauvreté et dommages environnementaux
irrémédiables derrière eux ».
|
|
|
|
|
|
|
Amérique
Latine - Chine :
Les dangers d’une relation nouvelle |
Daniela Estrada, le 2 novembre 2010,
Cet texte de Daniela Estrada, publié le 2 septembre 2010 par
IPS, propose une synthèse rapide des conclusions de quelques
études récentes sur les relations commerciales en
plein
essor entre l’Asie – et notamment la Chine
– et
l’Amérique latine. Il en souligne les enjeux et
les
risques.
Le taux des exportations de l’Amérique latine et
des
Caraïbes va de nouveau augmenter cette année et,
ceci,
grâce, en particulier, à la demande chinoise. Mais
l’actuel modèle « primaire »
des envois peut
dériver vers un schéma de dépendance
vis-à-vis de ce géant et de la zone asiatique en
général, selon le cri d’alarme
lancé par la
Commission économique pour l’Amérique
latine
(CEPAL).
« Il est clair que la relation commerciale entre notre
région et la Chine peut évoluer vers un
schéma
centre – périphérie. Nous sommes
fournisseurs de
matières premières, sans valeur
ajoutée, et ils
nous renvoient des produits manufacturés. » a dit
à
IPS Claudia Casal, chercheuse au Centre d’études
nationales de développement alternatif (CENDA –
non
gouvernemental) du Chili [1].
Claudia Casal a participé à
l’étude
Relations économiques et géopolitique entre la
Chine et
l’Amérique latine : alliance
stratégique ou
interdépendance asymétrique ? publiée
en 2009 par
le Réseau latino-américain de recherches sur les
compagnies multinationales, qui regroupe des institutions de recherche
sur le travail et des syndicats de sept pays de la région.
Ce thème est, précisément, mis en
évidence
dans le dernier rapport de la CEPAL à propos de
l’insertion internationale de la région, qui a
été présenté jeudi dernier
à son
siège de Santiago.
« La relation commerciale entre la région et
l’Asie
offre autant d’opportunités que de
défis »,
indique ce document de 216 pages.
Il précise que, parmi les défis, « il
est
particulièrement important d’éviter que
le commerce
croissant entre les deux régions ne reproduise ni ne
renforce un
modèle de commerce de type centre –
périphérie dans lequel l’Asie (et la
Chine en
particulier) apparaîtrait comme un nouveau centre et les pays
de
la région comme la nouvelle
périphérie. »
Le Panorama de l’insertion internationale de
l’Amérique latine et des Caraïbes 2009-
2010,
réalisé par la CEPAL, prévoit que les
exportations
de la région augmenteront de 21,4% cette année,
sous
l’impulsion, principalement, de la vente de
matières
premières en provenance d’Amérique du
Sud.
L’augmentation des envois, qui inverse la tendance de 2009,
marquée par une chute de 22,6% par rapport à
l’année antérieure,
s’explique par la demande
de l’Asie et en particulier de la Chine, indique
l’étude annuelle de cette agence
spécialisée
qui fait partie de l’Organisation des Nations unies.
Le taux d’évolution des exportations de la
région
vers la Chine est passé d’un recul de 2,2% dans
les
premiers mois de 2009, par rapport à la même
période pendant l’année
précédente,
à un taux de croissance de 44,8% cette année.
Selon la CEPAL, la Chine pourrait reléguer l’Union
européenne au deuxième rang des
échanges
commerciaux de la région au milieu de la décennie.
Le géant asiatique est déjà le premier
destinataire des exportations du Brésil et du Chili, le
second
de l’Argentine, du Costa Rica, de Cuba et du
Pérou, et le
troisième du Venezuela.
Cependant, en établissant un bilan de la composition des
exportations latino-américaines pendant la
dernière
décennie, la CEPAL a conclu que la tendance est à
un
retour à une dominante des matières
premières dans
les envois.
Par exemple : tandis qu’en 1999 les matières
premières constituaient 26,7% du total des ventes ; en 2009
elles ont constitué 38,8% de ce total.
Du fait des prix élevés au niveau international,
l’Amérique du Sud a doublé le montant
de ses ventes
à l’étranger, en ressources naturelles
majoritairement. En revanche au Mexique et en Amérique
centrale
elles ont baissé de plus de 50%.
La participation du Mexique aux exportations totales de la
région est tombée de 40% en 2000 à 30%
en 2009,
tandis que le Brésil augmentait sa participation en passant
de
13 à plus de 20% pendant la même
période.
« Un premier bilan de l’activité
d’export
pendant la décennie démontre que notre
région
n’a pas obtenu d’avancée significative
quant
à la qualité de son insertion commerciale
internationale
» indique le rapport de la CEPAL.
Il note que « le développement des secteurs
associés aux ressources naturelles, principalement
motivé
par la demande asiatique, n’a pas contribué
suffisamment
à la création de nouvelles compétences
technologiques pour la région ».
La secrétaire exécutive de la CEPAL, la mexicaine
Alicia
Bárcena, a renchéri en ajoutant que la triade que
la
région a besoin de renforcer est «
productivité,
innovation et convergence stratégique ».
L’étude du Réseau
latino-américain de
recherche sur les compagnies multinationales à laquelle a
participé Claudia Casal, fait remarquer, elle aussi,
qu’aujourd’hui « la relation Chine
–
Amérique latine se présente de façon
asymétrique, marquée par les besoins chinois et
renforcée par la composition limitée des
exportations des
pays » de la région.
« Une inégalité dans la relation
économique
se constitue – bien qu’elle s’exprime de
différentes façons selon les pays – et
elle peut
mener à un rétrécissement de la marge
de
manœuvre des pays latino-américains ».
C’est
ce que dont témoigne la recherche
réalisée
à partir d’informations en provenance
d’Argentine,
du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique, du
Pérou et
d’Uruguay.
Selon la CEPAL, les gouvernements latino-américains
devraient
encourager la compétitivité des petites et
moyennes
entreprises, former de la main d’œuvre,
développer
« des maillons » qui relient les secteurs de
l’exportation au reste de l’économie et
profiter des
avancées dans des secteurs comme la biotechnologie, entre
autres.
Cette agence a également appelé à
rechercher des
rapprochements en parallèle à ceux
réalisés
avec la Chine et la région Asie-Pacifique. Elle met en
avant,
par exemple, l’initiative de l’Arc du Pacifique
latino-américain qui inclut la Colombie, le Costa Rica, le
Chili, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le
Honduras,
le Mexique, le Nicaragua, Panamá et le Pérou.
Selon les estimations de la CEPAL, les exportations du
Marché
commun du Sud (Mercosur), qui comprend l’Argentine, le
Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, devraient
augmenter
cette année de 23,4%, par rapport à 2009, et
celles des
pays andins de 29,5%. Pendant ce temps celles du Marché
commun
centroaméricain n’augmenteraient que de 10,8%.
Note
:
[1] Claudia Casal est aussi l’éditrice en charge
de la section en espagnol d’AlterInfos – note DIAL.
Source
: Traduction d’Annie Damidot - Diffusin
Information Amérique Latine (DIAL)
|
|
|
|
|
|
|
Amnesty International demande
le réexamen de l'affaire des « Cuban Five
» |
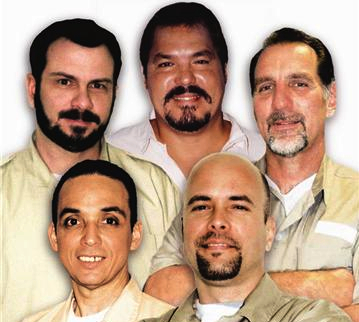
par Amnesty International,
le 13 octobre 2010
Dans un rapport envoyé au gouvernement des États-Unis et rendu public
ce mercredi 13 octobre, Amnesty International expose ses
préoccupations au sujet de l'équité du procès de cinq hommes
déclarés coupables en 2001 d'avoir, entre autres, agi comme agents de
renseignement pour le compte du gouvernement cubain. Ces hommes purgent
des peines allant de 15 ans d'emprisonnement à la réclusion à
perpétuité dans des prisons fédérales américaines.
Les cinq hommes – les Cubains Fernando González, Gerardo
Hernández et Ramón Labañino, et les Américains Antonio Guerrero et
René González – ont été jugés à Miami et déclarés
coupables de plusieurs chefs, notamment d'avoir agi et conspiré en vue
de mener des activités en tant qu'agents non enregistrés de la
République de Cuba, de fraude et utilisation abusive de documents
d'identité et, pour trois des accusés, de conspiration en vue de
fournir des informations relatives à la défense nationale. Gerardo
Hernández a en outre été déclaré coupable de collusion en vue de
commettre des meurtres en raison de son rôle présumé dans la
destruction par Cuba, en 1996, de deux avions opérés par
l'organisation américaine anticastriste Brothers to the Rescue,
attaque qui avait causé la mort de quatre personnes.
Dans une lettre qu'elle a envoyée le 4 octobre au ministre de la
Justice des États-Unis, Eric Holder, en y joignant son rapport The
Case of the ‘Cuban Five' (index AI : AMR 51/093/2010),
Amnesty
International indique que si elle ne prend pas position au sujet de
l'innocence ou de la culpabilité des cinq hommes elle estime toutefois
que l'équité et l'impartialité du procès sont douteuses et que ces
doutes n'ont pas pu être levés en appel.
L'un des principaux motifs de préoccupation est lié à la question de
savoir s'il était équitable de tenir ce procès à Miami compte tenu
de l'hostilité généralisée à l'égard du gouvernement cubain dans
cette région et dans les médias, et des événements qui se sont
produits avant et pendant le procès. Comme l'explique le rapport
d'Amnesty International, certains éléments incitent à penser qu'il
était impossible dans ces circonstances de garantir la totale
impartialité du jury.
Parmi les autres motifs de préoccupation figurent les incertitudes
quant à la valeur des preuves présentées à l'appui des accusations
de collusion en vue de commettre des meurtres dans le cas de Gerardo
Hernández, et les conditions dans lesquelles s'est déroulée la
détention provisoire des cinq hommes, durant laquelle ils n'ont eu
qu'un accès restreint à leurs avocats et aux documents utiles, ce qui
a peut-être porté atteinte à leur droit à une défense efficace.
Amnesty International a appelé le gouvernement à réexaminer cette
affaire et à modérer toute éventuelle injustice par le biais de la
procédure de grâce ou par tout autre moyen au cas où les autres
recours seraient inefficaces.
Amnesty International a également rappelé qu'elle était préoccupée
par le fait que le gouvernement des États-Unis a refusé à plusieurs
reprises de délivrer aux épouses cubaines de deux des détenus, René
González et Gerardo Hernández, des visas temporaires leur permettant
de rendre visite à ces derniers. L'organisation s'inquiète de ce que
cette interdiction permanente des visites des épouses représente une
sanction supplémentaire et est contraire aux dispositions des normes
internationales relatives au respect de la dignité humaine des
détenus et à l'obligation qu'ont les États de protéger la vie de
famille. Amnesty International continue d'exhorter le gouvernement à
accorder aux épouses des visas temporaires pour des raisons
humanitaires.
Informations
complémentaires
Les cinq détenus ont été arrêtés à Miami en 1998. Ils n'ont pas
nié agir en tant qu'agents du gouvernement cubain, mais ont nié les
accusations les plus graves portées contre eux et affirment que leur
rôle était centré sur les groupes d'exilés cubains à Miami
responsables d'actes hostiles à l'égard de Cuba et ne consistait pas
à porter atteinte à la sécurité nationale de États-Unis. Aucun
élément de preuve n'a été produit lors du procès montrant que les
accusés avaient effectivement traité ou transmis des informations
secrètes.
En mai 2005, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention
arbitraire a rendu un avis sur cette affaire ; il a estimé que le
gouvernement des États-Unis n'avait pas garanti un procès équitable
pour les cinq Cubains aux termes de l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Cet organe a fondé son avis
sur un certain nombre d'éléments, notamment sur les conséquences
préjudiciables de la tenue d'un procès à Miami. Il a également
estimé que les conditions de la détention préventive des accusés et
la décision initiale de classer « secrets » tous
les
documents liés à cette affaire ont réduit les possibilités d'une
défense efficace et compromis l'équilibre des forces entre
l'accusation et la défense.
En août 2005, un collège de trois juges de la cour d'appel fédérale
du onzième circuit a infirmé à l'unanimité les déclarations de
culpabilité rendues contre les cinq hommes, au motif que les
préjugés contre le gouvernement castriste très répandus au sein de
la population à Miami avaient, associés à d'autres facteurs, porté
atteinte à leur droit à un procès équitable. Le gouvernement
américain a formé un recours contre cette décision qui a par la
suite été à son tour infirmée par la cour d'appel réunie en
session plénière, avec une majorité de 10 voix contre deux. Les
déclarations de culpabilité ont été confirmées par la cour d'appel
en juin 2008, mais les peines de réclusion à perpétuité prononcées
contre deux des accusés ont été ultérieurement annulées puis
remplacées par des peines moins lourdes. Gerardo Hernández est le
seul parmi les cinq hommes à être toujours sous le coup d'une peine
de réclusion à perpétuité (il a été condamné à deux peines de
réclusion à perpétuité). En juin 2009 la Cour suprême des
États-Unis a rejeté sans aucune explication la demande de révision
du procès des cinq hommes.
En juin 2010, un nouveau recours a été formé devant le tribunal de
district fondé, en partie, sur de nouveaux éléments de preuve
indiquant que des journalistes qui avaient écrit à l'époque du
procès des articles préjudiciables au sujet de cette affaire
travaillaient pour des organes de presse anticastristes, sur le
territoire américain, où ils étaient employés et payés par le
gouvernement des États-Unis. L'audience d'examen de ce recours n'a pas
encore eu lieu.
|
«
Défendre les 5, c’est défendre une
cause »
Entretien avec Olga Salanueva et Adriana Perez

Entretien de Sébastien Madau
Olga Salanueva et Adriana Perez sont les épouses de deux
des cinq antiterroristes cubains emprisonnés depuis 12 ans
dans
les prisons américaines pour avoir voulu empêcher
le
terrorisme de frapper Cuba.
Olga Salanueva est l’épouse de René
Gonzalez;
Adriana Perez celle de Gerardo Hernandez, tous deux
emprisonnés
aux Etats-Unis, avec trois de leurs compatriotes, après
avoir
infiltré des organisations cubano-américaines
d’extrême-droite à Miami qui avaient
commandité des attentats sur des installations touristiques
de
l’île. En octobre dernier, elles étaient
de passage
à Paris pour sensibiliser l’opinion sur
«
l’Affaire des 5 ».
Quel
est le principal message que vous souhaiteriez passer aux
personnes avec lesquelles vous parlez du cas de vos époux ?
-Olga Salanueva : L’arrestation et l’emprisonnement
de nos
époux sont une injustice qui dure depuis trop longtemps. Ils
ont
été mis en prison avec des condamnés,
comme des
es- pions. On les a punis alors qu’il n’y a aucun
fait. Ils
sont restés 17 mois sans avocat. Ils n’ont pas pu
se
défendre, surtout quand on sait que 80% du dossier
n’est
pas déclassifié.
-
Leur cas n’a pas bénéficié
d’une
grande couverture médiatique aux Etats-Unis, si ce
n’est
de la part de la presse de Miami qui les a «
condamnés
» avant la fin du procès.
- Olga Salanueva : On a parfois l’impression que leur sort
n’intéresse personne. Contre eux, les Etats-Unis
mènent une véritable bataille
médiatique en
manipulant l’information. On sait de- puis que des
journalistes
ont été payés durant le
procès pour
écrire des articles contre eux. Dans ce cas où
est la
justice, où est la liberté de la presse ? Le
mouvement de
solidarité avec les 5 a dû payer 50.000 dollars
pour
obtenir une page dans le New York Time.
- Adriana Perez : Nous sommes victimes d’une histoire qui
nous a
aussi punis en tant que famille. Malheureusement, nous
n’avons
pas la chance de voir cette affaire beaucoup
médiatisée.
Pas beaucoup de monde s’est demandé pourquoi ils
étaient allés aux Etats-Unis. Depuis 12 ans, nous
ne
voyons pas nos maris. Nous voyageons dans
beaucoup de pays pour parler de leur cas. Nous invitons les
médias, mais les journalistes ne viennent pas souvent.
-
Ils ont été condamnés alors
qu’ils
luttaient contre le terrorisme dont a été victime
le
peuple cubain et des touristes étrangers, dont Fabio Di
Celmo,
un ressortissant italien tué dans une explosion.
N’est-ce
pas contradictoire ?
- Adriana Perez : Tout à fait. Aujourd’hui, on
commence
à connaître un peu mieux l’histoire. Les
preuves
sont à disposition de tous. De tous ceux qui veulent les
trouver. Mais les Etats-Unis ne veulent pas car on prouverait leurs
liens avec les milieux d’extrême-droite de Miami.
On accuse les 5 d’avoir infiltré des
organisations. Mais
depuis quelques temps, plusieurs états occidentaux
(Etats-Unis,
France, Allemagne, Grande-Bretagne...) ont aussi annoncé des
menaces terroristes envers leurs pays. Qui leur a donné ces
informations ? S’ils ont été
prévenus de
risques terroristes à leur en- contre, c’est bien
qu’ils ont des informateurs ? Pour nos époux
c’est
la même chose : ils ont informé notre pays pour
empêcher des bombes d’exploser. Sauf
qu’eux ont
été arrêtés !
-
Malgré cette injustice, les 5 lancent constamment
des messages de paix.
- Olga Salanueva : Ils se battent contre la violence qui a
frappé notre pays. Nous étions
attaqués par des
terroristes. Ils sont en prison pour avoir infiltré des
organisations qui nous ont remplis de douleurs et de deuils.
J’ai
vu ces personnes à Miami : elles ne veulent pas le
bien-être du peuple cubain, elles veulent tuer.
Dès 2000,
les 5 ont publié une lettre ouverte au peuple des Etats-Unis
dans laquelle ils disaient que le terrorisme était
l’ennemi de tous. Ils ont tout de suite subi des
représailles de la part de l’administration.
-
Juridique- ment, tous les recours légaux ont
été
épuisés. L’espoir persiste-t-il de les
voir rapide-
ment libres ?
- Adriana Perez : C’est vrai, tous les recours
légaux sont
finis. Par conséquent, aujourd’hui, nous misons
sur une
solution politique. Cer- tes, ce sont des hommes, mais c’est
aussi une cause. Les dé- fendre, c’est
défendre une
cause.
-
Vous parlez de « cause ». Pensez-vous
que si vos époux avaient trahi cette «
cause », ils seraient libres aujourd’hui ?
- Olga Salanueva : Bien sûr que oui ! D’autres ont
été arrêtés avec eux. Mais
ils sont
aujourd’hui libres parce qu’on les a
incité à
trahir leur frères. Nos époux ne l’ont
pas fait.
Ils préfèrent continuer à
défendre leur
cause, notre cause.
- Adriana Perez : On va continuer à défendre nos
époux, nos camarades.
|
|
|
|
|
Chili,
une bataille de gagnée n’est pas
la fin de la lutte de la Nation Mapuche
|
|
Lionel Mesnard, le 13 octobre 2010
En date du 9 octobre 2010, tous les prisonniers politiques mapuches ont
cessé leur grève de la faim. C’est
fini, et on ne peut
que se réjouir de ce qui s’est produit au Chili,
finalement grâce aux voies du dialogue. Si l’on a
abondamment traité le sujet des mineurs, il y avait de quoi
s’inquiéter pour la santé prisonniers
politiques
mapuches, qui pour certains montraient de grands signes
d’amaigrissement. A un certain stade les séquelles
peuvent
être irréversibles, et le risque mortel
à plus de
80 jours se posait pour 32 des grévistes sur les 34
jeûneurs (1). Des accords ont
été signés et vont ouvrir à
des amendements
aux lois antiterroristes en vigueur, en particulier de ne plus
considérer des incendies criminels comme des actes de
terrorisme.
Le traitement de l’information aura été
long
à se mettre en route, mais l’on peut souligner
qu’en
France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Espagne, et dans
beaucoup d’autres pays Sud Américain, de
nombreuses
actions de solidarité et manifestations auront eu lieu. A
Paris,
se sera tenu pendant plus de 3 semaines un piquet face à
l’ambassade du Chili, et des rassemblements dans
l’hexagone
se sont tenus. Il faut noter le rôle dynamique du Collectif
de
soutien au peuple Mapuche en France (2), et il est à
souligner le travail
fait par l’association Terre et Liberté pour
l’Arauco depuis plusieurs années concernant la
cause de la Nation Mapuche.
Pourquoi s’intéresser aux prisonniers politiques
mapuches
pourrait résumer l’interrogation de beaucoup en
France ?
Qui sont-ils, d’où viennent-ils,
qu’ont-ils fait ?
Entre 89 et 94 jours, une trentaine de détenus au Chili ont
voulu aux yeux du monde montrer leur détermination, pour
que cesse à leur encontre les lois de l’ancienne
dictature
de Pinochet. Ils étaient tous issus des populations mapuches
du
Chili. De nos jours, ils représentent dans le pays de
800.000
à 1,5 million de personnes, si l’on prend en
compte
ou non le métissage. Si l’on se
réfère
à l’histoire de la nation Mapuche, ils sont les
seuls
amérindiens à avoir résister non
seulement
à la colonisation des Incas, mais aussi à la
colonisation
espagnole. Avec l’avènement de la
République du Chili au dix-neuvième
siècle
leurs territoires vont être peu à peu conquis,
notamment
par les migrants venant d’Europe, et avec l’appui
de
l’état chilien. Comme de nombreuses populations
amérindiennes et ce depuis
l’indépendance, elles
ont été marginalisées, et il
n’y a pas
d’autres termes pour dire qu’elles ont connu un
ordre
raciste, où «l’indien» est
plus ressenti comme un
paria, qu’un être à part
entière.
La question n’est pas de vanter la résistance du
peuple
Mapuche, depuis 200 ans, ils sont à
l’égal de ce
qu’ont pu vivre les populations américaines
originaires de
la Gaspésie à la Terre de Feu. Si l’on
doit
prêter attention à la cause des
amérindiens de nord
en sud, c’est parce que leurs problèmes sont des
plus
contemporains, et que leurs luttes sont souvent très
signifiantes. A quoi résistent avant tout les mapuches ? A
ce
monde absurde, où l’on veut imposer une marche du
progrès
sans prendre en compte l’altérité de
tout à
chacun et le respect du vivant. Nous vivons dans une
économie
folle, et comme tous les citoyens de ce monde, ils pâtissent
de
choix dictés sans leur consentement. Peu importe si cela se
décide à Santiago où ailleurs,
c’est un peu
le même rouleau compresseur qui agit en tout lieu du globe et
pille à tour de bras les richesses naturelles, et nous n'en
mesurons pas vraiment les impacts à long terme.
Depuis le 12 juillet, ils étaient un peu plus
d’une
trentaine à vouloir que se termine cette double peine pesant
sur
les épaules d’un peu plus de 150 personnes en
cette année 2010. Un premier accord la semaine
passée
avec une vingtaine de prisonniers était intervenu. Il
restait 14
grévistes de la faim ayant franchi le cap des 90 jours
d’abstinence. Il semble que leurs revendications ont
été prises en compte, et clos partiellement un
chapitre
des violences politiques au Chili. Toutefois,
il faut souligner que toutes les demandes n'ont pas
été
prises en compte et qu'à tout moment d'autres conflits de la
même nature peuvent ressurgir. Les prisonniers politiques
dans
leur ensemble ne sont pas pleinement satisfait. Et ceux qui
étaient incarcérés à la
prison d'Angol ont
arrêtés au 89ème jour pour des raisons
humanitaires. Par ailleurs, ils ne voulaient
pas mettre davantage en danger la vie des 14 autres "comuneros" en
grève de la faim.
Concernant le traitement de
l’information, cette lutte a fini par retenir
l’attention
des médias, et c’est en soit une bonne nouvelle.
De plus,
la pression internationale a tenu un rôle important, et le
fort
mouvement de mobilisation au Chili aura permis l’ouverture de
négociations et un début de reconnaissance des
populations mapuches et de leurs spécificités. Et
espérons-le permettra de mettre un terme à la
violence
qui s’est abattue sur une minorité
opprimée depuis
au moins le coup d’état des
généraux
putschistes, il y a 37 ans de ça, et ainsi
régulera mieux
le dialogue entre les autorités civiles et de l'Etat.
Longtemps méprisée au sein de la
société
chilienne, la question Mapuche a franchi une étape
historique.
Ces « Indiens » qui n’en sont pas, les
originaires ou
natifs veulent surtout protéger certains de leurs
fondamentaux
et en une idée très respectable : le respect du
vivant.
Les mapuches que l’on trouve principalement au Chili et en
Argentine ont les mêmes particularités que tous
leurs
frères de lutte peuplant le continent de nord en sud. Ils
forment dans leur très large majorité des
nations,
c’est-à-dire bien plus que des constituants
ethniques ou tribaux au
regard de ce que l’on peut de temps à autre lire
à
ce sujet. Nous sommes au-delà d’une affaire
tribale, mais
face à des injustices qui au regard du droit international
fait
appel à une compréhension universaliste de ce
type de
situation.
Et c’est un peu là tout le problème, et
en quoi le
Chili même en ayant signé la Convention 169 de
l’OIT
(3) a traîné des pieds concernant
l’application des
textes internationaux. Ces dernières années, le
gouvernement de Madame Bachelet a mené une politique brutale
en
assimilant des militants indépendantistes ou autonomistes
à des terroristes, et en s’appuyant sur un arsenal
de lois
datant des restes de l’ancien dictateur Pinochet. Si les
militants de la cause Mapuche n’ont assassiné
personne. Du
pouvoir chilien, il restera un bilan assez sombre, une
répression injustifiable morts à
l’appui, notamment
de jeunes activistes.
Il en va de comprendre, non pas un
épiphénomène
culturel, mais une réalité très
prégnante
des populations originaires. Le terme «indien» pose
un
problème majeur, c’est un héritage
linguistique
espagnol datant de Christophe Colomb désignant de
la
sorte les hommes et femmes vivant depuis toujours
outre-atlantique, portant une confusion certaine et ayant
aidé
surtout à
noyer dans la masse les problématiques
amérindiennes. La
question n’est pas obligatoirement de partager une cosmogonie
commune, de vouloir singer les peuples originaires, mais de prendre en
compte leurs aspirations et ouvrir un peu plus grandes nos oreilles sur
cette communauté de destin qui s’ouvre
à nous dans
un monde ouvert. Internet offre la possibilité
d’une
meilleure circulation de l’information et cela change pour
beaucoup certains repères.
Dans le cas des mapuches et plus largement des populations natives de
l’ensemble continental, nous touchons là
à une part
de notre universel. Il en va de quel lien il est possible
d’entretenir avec des cultures qui n’ont rien
à nous
envier, notamment en ce qu’elles peuvent nous apprendre sur
notre
monde dans la relation que nous entretenons avec les
éléments naturels. Lévi-Strauss
soulignait sur
la question des savoirs, que les « sauvages »
avaient pour
connaissance, la maîtrise de plusieurs centaines de
végétaux. Ce que le quidam moyen vivant en Europe
ne
possède pas vraiment sur les richesses naturelles, ou ses
propres niches environnementales. Un savoir capital quand on sait les
menaces pesant sur les écosystèmes un peu partout
sur
cette planète, et de l’importance de ces savoirs
ancestraux qui tendent à disparaître du globe
à une
vitesse foudroyante.
Le combat des mapuches est à la fois exemplaire, et
significatif
parce que les habitants de l’Aurauco ont
été tout
simplement spoliés de leurs terres. Si, les mapuches
semblent
rejoindre les luttes écologiques contemporaines, en
réalité ils disposent en ce domaine de quelques
longueurs
d’avance. Les nations amérindiennes
amènent un
autre éclairage sur le vivant et le nier serait une
absurdité. Ce patrimoine universel, culturel et
écologique peut donner sens et aussi poser quelques
paradoxes
à nos pensées cartésiennes.
L’objet
n’est pas de légitimer un ordre des
différences,
mais de comprendre ce qui pousser tout à chacun à
comprendre des ensembles complexes et partager des savoirs essentiels
à la survie du genre humain. Protéger les
forêts,
les cours d’eau, les réserves minérales
ne sont pas
des abstractions. Ce sont des biens vitaux. Et rendre sa
dignité
à des peuples meurtris ne relève pas
d’un combat
passéiste.
Une bataille de gagnée n’est pas la fin de la
lutte de la
Nation Mapuche, il en va d’appliquer au mieux la Convention
169
de l’OIT (4) et l’on pourrait conseiller aux
autorités chiliennes de se référer
à ce
qu’a pu faire en ce domaine le Canada avec les Inuits. Quand
on
aborde la question des peuples originaires du continent
américain, on doit avant tout comprendre que l’on
ne parle
pas d’hommes et femmes d’un autre monde, leurs
revendications en apparence lointaines n’ont que peu de
différence avec les nôtres. Toutefois, il y en a
une
majeure pour la nation Mapuche, c’est un peuple que
l’on a
dépouillé de sa terre. Sa demande est de pouvoir
en
maîtriser ses ressources et selon des critères
propres au
respect de la vie, sous toutes ses formes. Cette demande est
légitime, pour autant tout reste à faire. Nous
devons ici
et ailleurs rester attentif à ce qui se passe en Argentine
et au
Chili concernant les mapuches. Plus largement nous devons accompagner
les peuples amérindiens à
s’émanciper et
à faire reconnaître leurs droits.
Notes
:
(1) Vidéos « liberté pour les
prisonniers politiques mapuches » (Pantuana TV) :
http://www.dailymotion.com/video/xeuhj2_liberte-pour-les-prisonniers-politi_news
(2) Le collectif de soutien au peuple Mapuche en France est
composé des associations suivantes : Fondation France
Libertés, l’AFAENAC, le Collectif des Droits de
l’Homme au Chili, MRAP, Comité de
Solidarité avec
les Indiens des Amériques - Nitassinan ,
l’association
Terre et Liberté pour Arauco, et l'association Bizikleta.
(3) Texte de la convention 169 de l’Organisation
Internationale du Travail
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C169
(4) Application de la Convention 169 par l’OIT :
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm
Cet article est sous la
mention tous droits
réservés
et ne peut faire l'objet d'une reproduction sans autorisation
|
|
|
|
|
| Vénézuéla
: (In)sécurité |
par Luis Britto Garcia, 8 oct.
2010
1.
La sécurité, comme le disait Montesquieu, est le
premier de tous les bien, car sans elle les autres n’existent
pas, et elle présente 2 aspects: elle-même, et la
perception que les citoyens en ont. En exacerbant la perception
d’insécurité, les mécanismes
de panique et d’agression de l’esprit saurien sont
déclenchés. C’est ainsi que
l’on crée les fascismes. Pour se sauver il est
nécessaire de désactiver cette perception
2
La presse publie des chiffres non-officiels selon lesquels le nombre
d’homicides par an serait passé de 5 968 en 1999
à 13 978 en 2009. En mai 2009 wikipedia nous donnait un taux
de 48 homicides pour 100 000 habitants par an ; ce qui nous
plaçait en sixième position mondiale. Que veulent
dire ces chiffres ? Les morts violentes dans des accidents de
circulation y sont-elles inclues ? Les chiffres sont-ils
pondérés par l’augmentation de la
population de presque un tiers, passant de 22 millions
d’habitants en 1999 à 28 835 849 en 2010 ? De
toute façon, ces chiffres sont les indices d’un
problème réel que nous devons analyser et auquel
nous devons remédier, au lieu de le renier.
3
Les enfants nés et ayant été
formés pendant le gouvernement bolivarien vont
bientôt avoir 10 ans. Leurs crimes ne peuvent pas
être plus importants que de voler le gouter de leurs
compagnons de classe. Les statistiques des délits se basent
sur des personnes nées et formées pendant la
Quatrième République. Les défenseurs
de la Quatrième République crachent contre le
vent, puisqu’ils accusent les actes d’une
génération qui a été
formée pendant qu’eux même
étaient au pouvoir.
4
Les difficultés de contrôler une
frontière de plus de 2 000 kilomètres ont permis
la pénétration de paramilitaires que nous
dénonçons depuis un certain temps. Il y a 2 ans,
le Président a reconnu que l’invasion
était parvenue jusqu'à Caracas. Les
infiltrés montent des cabales, supplantent la
pègre, assassinent des dirigeants agraires et syndicaux,
réduisent les communautés a la panique par
d’horribles crimes et blanchissent leurs capitaux a travers
des bingos, casinos, salles de jeux et maisons closes
parrainés par les autorités les plus corrompues,
immorales et nauséabondes. Selon le rapport 1998-2000 de
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, la
Colombie avait à cette époque un taux de 61,7847
homicides pour 100 000 habitants, le plus haut taux du monde et deux
fois plus élevé que celui du Venezuela qui
était de 31,6138 pour 100 000 habitants. Un ordinateur
magique a par la suite réduit le taux de la Colombie a 37 et
élevé le notre a 48. Ce sont des chiffres qui
font réfléchir, vérifier, rectifier et
agir.
5
Mais il ne s’agit pas d’un problème
purement quantitatif. La présence d’organisations
délictueuses avec une formation, une discipline et un
financement militaire facilite une criminalité
qualitativement différente. Les données que nous
apportons au Seniat (Service National des Impôts au
Venezuela) sur notre situation économique sont vendues le
jour suivant par des colporteurs garce à ce qui
n’est finalement qu’une base de données
pour la sélection de victimes. Des délinquants
avec de fausses cartes de l’administration tributaire
inspectent les comptes d’un entrepreneur dont les enfants ont
été enlevés ; des criminels en
uniformes de policiers interceptent la voiture des malheureux. La
téléphonie mobile et les distributeurs
automatiques sont les instruments de nouvelles fraudes et de
stratégies comme l’enlèvement express.
Le vol de véhicules est entretenu par des réseaux
de ferrailleries connus de tout le monde où la marchandise
est recyclée et vendue en pièces
détachées, et par des mafias de fonctionnaires
qui falsifient leurs titres de propriété. Le
Venezuela ne produit pas de drogue, mais des organisations
supranationales tentent d’utiliser notre territoire comme
voie de trafic. Les journaux colombiens obtiennent les confessions du
trafiquant Hernando Gómez Bustamante (connu sous le pseudo
de Rasguño, l’égratignure),
détenu à Cuba et envoyé en Colombie,
et dont l’ordinateur « pourrait contenir des
preuves qui lient certains anciens chefs de l’AUC
(Autodéfenses Unies de Colombie) détenus dans la
prison d’Itagüí, à des
activités de trafic de drogues postérieures au
cessez-le-feu (El Colombiano, 23-3-2007, 8ª).
«Rasguño» affirme dans ce journal que
“Le Venezuela est le temple du trafic de drogue. Il y a une
association de vénézuéliens,
colombiens, brésiliens. Il est très facile de
faire du trafic parce que la bas ils n’attrapent a personne.
» Il s’agit d’une guerre formelle, contre
un ennemi militaire ou militarisé. Avant de commencer cette
guerre, il faut faire le ménage dans la maison.
6
Pendant ce temps, selon l’Organisation
Panaméricaine de la Santé, à Cuba le
taux d’homicides est de 0,0057 pour 1 000 habitants (641
personnes par an). Cela explique tout. On a recours à la
violence pour obtenir ou conserver un bien quand les autres
procédés ont échoué. Dans
des sociétés ou une infime minorité
accaparent les biens indispensables, la majorité
dépossédée opte pour la violence ou
l’inanition. Si le système de communication les
convainc 24 heures par jour que seul celui qui possède vaut,
la violence se convertira en valeur.
7
Face a la violence, dans des sociétés pleines
d’inégalités, il faut faire attention
aux remèdes qui sont pire que la maladie. Il faut
éviter les opérations qui impliquent la
détention massive de tout un quartier pour le seul
délit d’être pauvre. Il faut recommander
l’abandon des armes, mais que les neofascistes et les
paramilitaires donnent l’exemple. Il faut
accélérer l’intégration de
la Police Nationale, qui convertit en un seul organisme
coordonné la myriade de milices féodales aux
ordres exclusifs des caudillos locaux. Le remède contre la
délinquance est simple, mais amère pour tous ceux
qui s’en plaignent. C’est exactement ce que
l’opposition déteste : réparer
l’extrême inégalité sociale.
Source : Luis Britto Garcia en
Francés
|
|
|
|
|
| Équateur
: retour sur une tentative de putsch |
 Propos
recueillis par Sophie Chapelle et Maxime Combes, le 6 octobre 2010
Propos
recueillis par Sophie Chapelle et Maxime Combes, le 6 octobre 2010
Que s’est-il passé lors de la tentative de coup
d’État en Équateur, qui a fait vaciller
l’un
des gouvernements de cette « gauche latino » aussi
diverse
que variée ? Existe-t-il des similitudes avec les tentatives
de
renverser la présidence d’Hugo Chavez au Venezuela
huit
ans plus tôt ? Ou s’agit-il d’une simple
contestation
corporatiste qui a dégénéré
?
Éléments de réponse avec Marc
Saint-Upéry,
journaliste et spécialiste de
l’Amérique latine qui
vit à Quito.
Que
s’est-il passé ce jeudi 30 septembre en
Équateur ?
Marc Saint-Upéry [1] : Le 29 septembre, le Parlement
approuve
une loi d’homogénéisation des salaires
du secteur
public impliquant la suppression de plusieurs primes
accordées
aux policiers et aux militaires. Des courriers électroniques
et
des tracts anonymes circulaient, semble-t-il, dans les casernes. Ils
dénonçaient ce que les membres des forces de
l’ordre considèrent comme une atteinte
inadmissible
à leurs avantages acquis. Alerté sur
l’agitation
régnant au sein d’un régiment de
policiers de la
capitale, le président de la République
décide de
se rendre en petit comité à la caserne en
question. Il
tente de convaincre les policiers des bienfaits de sa politique
salariale et leur rappelle les augmentations considérables
qu’il leur a accordées. Les policiers rebelles
continuent
à huer le chef de l’État. Certains
mentionnent que
le seul qui a vraiment fait quelque chose pour eux est
l’ancien
président Lucio Gutiérrez, un colonel
élu en 2003
et déposé en avril 2005 par une
rébellion civique
à laquelle a participé Correa. Dans le style
typiquement
provocateur qui est le sien, le chef de l’Etat
défie les
insurgés : « Si vous voulez tuer ce
président,
faites le ! ». Les choses tournent au vinaigre et, au moment
d’évacuer la caserne, le chef de
l’État, qui
souffre d’un problème au genou lui ayant valu
plusieurs
interventions chirurgicales, est violemment agressé,
notamment
par des policiers masqués. Il se réfugie dans la
clinique
adjacente du personnel de police, où il est
soigné.
Quelle
est la situation dans le reste du pays ?
Près de 40.000 policiers et quelques rares unités
militaires se mettent en grève, bloquant routes et
aéroports. Flairant l’impunité totale,
la
délinquance se déchaîne. La situation
est
particulièrement grave dans le port de Guayaquil, la ville
la
plus peuplée du pays. Des scènes de pillage, des
dizaines
d’agressions et des braquages s’y
déroulent. Rafael
Correa est ensuite « séquestré
» pendant une
demi douzaine d’heures dans la clinique de la police. Il y
est en
fait protégé à
l’intérieur par une
unité d’élite tandis que les policiers
insurgés l’empêchent de sortir. Des
négociations s’amorcent dans une ambiance de
chaos.
Pendant ce temps, le gouvernement impose un programme officiel unique
à toutes les chaînes de
télévision. Quelques
petits milliers de manifestants descendent dans la rue pour
défendre le Président. Le ministre de la
Défense
déclenche alors une intervention militaire qui se conclut
par un
combat très violent et la libération du chef de
l’État dans la soirée. Le bilan des
victimes est
d’au moins huit morts et une centaine blessés.
S’agit-il
d’une tentative de coup d’État
à
l’image de celui contre Hugo Chavez en 2002, ou de simples
manifestations de mécontentement qui ont
dégénéré?
Le coup d’État contre Chavez en 2002
s’est
déroulé dans une ambiance de polarisation sociale
et
politique hystérique. Avec d’énormes
manifestations
des deux camps à Caracas, le soutien actif de presque tous
les
partis et personnalités d’opposition, des chambres
de
commerce, de secteurs importants de l’armée et de
son
état-major, de la majorité des médias
privés, de la hiérarchie
ecclésiastique et du
Département d’État
américain. En
Équateur, aucun de ces acteurs ne s’est
prononcé en
faveur de la rupture de l’ordre constitutionnel.
Malgré
quelques mécontentements corporatifs latents,
l’hostilité de l’opposition de droite et
de certains
groupes d’extrême-gauche, ainsi que la critique
presque
systématique mais pas vraiment séditieuse des
médias, la situation dans le pays est beaucoup moins tendue.
L’ Équateur de 2010 n’est pas le
Venezuela de 2002.
Reste que l’opposant de droite Lucio Gutiérrez a
dénoncé depuis Brasilia – où
il était
présent en tant qu’observateur
électoral – la
« tyrannie » de Rafael Correa. Il est patent que
des hommes
de Gutiérrez et des individus infiltrés parmi les
policiers ont joué un rôle dans cette affaire,
mais il est
difficile de définir lequel.
Quelles
sont les hypothèses sur l’organisation du putsch ?
Selon l’une des hypothèses avancées
dans les
cercles officiels, les organisateurs de la déstabilisation
comptaient sur un effet domino qui, en quelques jours, aurait
mobilisé des unités importantes de
l’armée,
des secteurs de la fonction publique mécontents de la
nouvelle
loi et une partie du mouvement indigène,
aujourd’hui en
conflit ouvert avec le pouvoir. La majorité de
l’opposition et des élites économiques
aurait alors
fini par se rallier ouvertement au mouvement. L’intervention
impromptue de Correa aurait donc bouleversé leur plan et,
paradoxalement, étouffé le complot dans
l’œuf. Ce n’est pas
dénué de sens.
C’est bien là le modus operandi de certains
mouvements de
rébellion précédents. Je doute
cependant que les
conspirateurs aient pu parvenir à leur fin.
Malgré
certains mécontentements, le gouvernement jouit encore
d’une forte légitimité. La cote de
popularité de Correa tourne autour de 65%.
Certains
évoquent une tentative d’assassinat…
D’autres disent qu’il s’agissait
dès le
départ de tuer le président, notamment
à
l’occasion d’un prétendu « feu
croisé
», pour créer le chaos et décapiter son
mouvement,
Alianza País. Ensuite, une alternative de gouvernement
aurait pu
s’élaborer via des mécanismes
institutionnels ou
des élections. Il est presque certain que Correa a
été la cible de menaces de mort. Mais celles-ci
sont
surtout proférées à partir du moment
où les
policiers constatent que le président ne céderait
pas
à leurs revendications et que l’armée
allait
intervenir. Comment les conspirateurs pouvaient-ils savoir à
l’avance que le chef de l’État allait
venir les
défier dans leur propre fief ? S’il n’y
était
pas allé, comment auraient-ils pu l’assassiner ?
Cette
tentative de coup d’État a surpris à la
fois les
observateurs et le gouvernement. Que révèle-t-il
sur la
situation politique en Équateur ?
Le gouvernement prétend mener une «
révolution
» pacifique et construire une forme de « socialisme
»
assez peu défini. À mon sens, c’est
plutôt
une espèce de gouvernement « technocratique et
jacobin
» engagé dans une entreprise de modernisation
capitaliste
plus ou moins post-néolibérale, avec de forts
éléments de redistribution sociale et de relance
du
rôle de l’État, mais aussi une forte
dépendance du pétrole et d’autres
produits
d’exportation primaires. Le gouvernement Correa incarne
à
la fois une forme de rupture avec les gouvernements
précédents - davantage de transparence,
présence
de jeunes technocrates progressistes et de personnalités
liées aux mouvements sociaux... - tout en maintenant
certains
facteurs de continuité, avec le personnel politique des
régimes antérieurs ou la subsistance de vieilles
pratiques d’accumulation de pouvoir, voire de gestion de
négoces et de prébendes. Le tout sous la
direction
d’un président jeune, intelligent, dynamique et
charismatique, mais non dépourvu d’arrogance
messianique.
Le style agressif et provocateur de Correa agace non seulement ses
opposants, mais aussi une partie de ceux qui l’ont soutenu.
L’opposition politique est dispersée et sur la
défensive. Les grandes lois régulatrices
susceptibles
d’affecter les intérêts de certaines
élites
économiques n’ont pas encore
été
votées. L’accumulation, dans certains secteurs, de
ressentiments et de frustrations est bien réelle, mais trop
limitée et dispersée pour mettre en danger
l’hégémonie de la «
révolution
citoyenne ». Cela n’a toutefois pas
empêché un
secteur passablement aventurier de l’opposition de droite de
tenter de capitaliser certains mécontentements dans une
sorte de
« lumpen-putsch » étrangement mal
organisé.
Comment
ont réagi la population et la société
civile ?
Qu’en est-il du mouvement indigène, qui a par le
passé joué un rôle clef dans le
départ
d’anciens présidents?
À l’exception de certains
députés de droite,
proche de Lucio Gutiérrez, de certains secteurs syndicaux
contrôlés par un parti d’origine
maoïste en
rupture radicale avec le gouvernement et, semble-t-il, d’une
fraction régionale du mouvement indigène, tous
les
secteurs organisés, des mouvements populaires aux
organisations
patronales en passant par le maire de droite de Guayaquil et
l’état-major de l’armée, ont
manifesté
leur refus de la rupture de l’ordre constitutionnel. La
question
de savoir qui est plus ou moins sincère n’est
guère
pertinente, ce soutien formel est un fait politique majeur en soi. Le
parti Pachakutik, bras parlementaire du mouvement indigène a
demandé de façon virulente la
démission du
président et la constitution d’un front national
contre
son « autoritarisme » et son « attitude
dictatoriale
». Mais la puissante Confédération des
nationalités indigènes de
l’Équateur
(CONAIE), au terme d’un débat long et houleux, a
réaffirmé son opposition politique au
gouvernement tout
en dénonçant fermement ce qu’elle
considère
comme une tentative de coup d’État de la droite.
Dans la
rue, les mutins n’ont pratiquement pas réussi
à
mobiliser au-delà de familles de policiers et de quelques
groupes étudiants liés aux maoïstes. Du
côté du gouvernement, les manifestations sont loin
d’avoir été très massives,
mais elles ont
suffi à remplir la place du palais présidentiel
et les
rues adjacentes à la clinique de la police. Donc
à
étayer le sentiment de légitimité du
pouvoir.
À
quels défis sont confrontés Rafael Correa et son
gouvernement après ces événements ?
Correa affirme
que ce qui s’est passé ne sera « ni
oublié,
ni pardonné ». Qu’est-ce que cela
signifie?
Le président va probablement essayer de capitaliser sur ces
évènements pour revendiquer encore plus fortement
sa
légitimité, défier
l’opposition et resserrer
les rangs au sein de ses propres troupes. On y constate parfois
certains flottements, en particulier au niveau du Parlement. Il
n’est pas dit qu’il y parvienne totalement. Sur le
plan
juridique, la chose est assez délicate. Qui peut-on
considérer comme les auteurs intellectuels ou
matériels
d’un soulèvement policier assez
généralisé mais aux objectifs
hétérogènes ? Pour
l’instant, trois colonels
ont été arrêtés puis remis
en liberté
surveillée. Le gouvernement vient d’annoncer une
augmentation substantielle des soldes. Certains proches du pouvoir
signalent la présence parmi les insurgés de
personnages
obscurs et mal identifiés, peut-être
liés au monde
du renseignement policier et militaire et du narco-trafic,
peut-être avec des accointances colombiennes. Or dans un pays
comme l’Équateur, purger la police est
à la fois
justifiable et nécessaire, mais c’est aussi
prendre le
risque de fournir des recrues à des formes
particulièrement redoutables de criminalité
paramilitaire.
Note
:
[1] Auteur de Le
rêve de Bolivar. Le défi des gauches
sud-américaines, La Découverte, 2007.
|
|
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui es donc AM? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 29/12/2010 |
|
|
|
|
| |