|

|
| Cliquez
ci-dessus pour revenir à la page d'accueil |
|
 Amérique Latine, sommaire année
2010, page 4
Amérique Latine, sommaire année
2010, page 4
1 - Haïti, Vie
quotidienne, un Combat, Gerardo Ducos,
pour Amnesty International
2 - Colombie,
Fours crématoires en Antioqua, ARLAC
Belgique
3 -
Antanas Mockus, "l'homme du vaccin", par Gloria Gaitan
4 - Construire
ou reconstruire Haïti, Camille Chalmers
& Emile Brutus
5 - La Nouvelle
Démagogie en Amérique Latine, Álvaro
Cuadra
6 - Colombie - Chagas, une
maladie qui tue en silence, MSF
7 - Colombie : Le four des
paramilitaires ..., Verdad
Abierta
|
|
|
|
|
|
La vie quotidienne dans
les camps haïtiens, un combat
|
|
|
Gerardo Ducos, délégué
d’Amnesty International
en
mission à Port-au-Prince, en Haïti, 28 juin 2010
Deux mois après le tremblement de terre, des milliers de
personnes, à Port-au-Prince et ailleurs, continuent
à
attendre ne serait-ce qu’un début d’aide
humanitaire. Dans les quatre camps de fortune où nous nous
sommes rendus lors de nos premiers jours en Haïti, chaque jour
est
une lutte et les conditions sont terribles, c’est peu de le
dire.
Les gens sont privés d’eau, de nourriture,
d’installations sanitaires ou d’abri. La
résilience
et la solidarité qui les unit sont les seules choses sur
lesquelles les habitants de ces camps peuvent compter.
Il y a des camps partout. Chaque espace en plein air, que le terrain
soit public ou privé, est occupé par des
centaines, voire
des milliers de personnes. Les gens s’abritent pour la
plupart
sous des draps et des serviettes de toilette, des tentes, des
bâches ou, pour les plus industrieux, sous des structures
faites
de bois et de fer-blanc de récupération.
Dans les camps que nous avons visités à
Cité
Soleil, Delmas et Champ-de-Mars, des comités locaux se sont
créés, improvisant et prenant en charge les
tâches
d’intendance de base : coordination,
sécurité
pendant la nuit, enregistrement des familles, activités pour
les
enfants, creusement de latrines ou délimitation des espaces
communs. La participation des femmes et leur représentation
au
sein des comités est cependant restreinte.
Ceci dit, la plupart des femmes sont à
l’extérieur,
dans les rues de Port-au-Prince, vendant diverses marchandises et
essayant de gagner de quoi nourrir leur famille. À certains
points de distribution, d’autres femmes font patiemment la
queue
dans l’ordre et la discipline afin de recevoir du riz ou
d’autres articles proposés par des organisations
humanitaires, sous l’œil vigilant de casques bleus
de
l’ONU ou de soldats américains lourdement
armés.
La destruction de la ville est massive et la plupart des locaux des
institutions gouvernementales se sont écroulés ou
sont
trop endommagés pour fonctionner. Les
représentants des
autorités, comme des milliers d’autres
Haïtiens,
campent et travaillent au bord de la route.
Le poste de police de Port-au-Prince est situé à
quelques
centaines de mètres des vestiges du Palais
présidentiel
et surplombe le Champ-de-Mars, un des espaces en plein air de la ville
– désormais occupé par plus de 12 000
personnes.
Ce poste de police accueille l’une des quelques
unités
mises en place pour lutter contre la violence à
l’égard des femmes. Ce service se limite
désormais
à une table poussiéreuse installée sur
le trottoir
et est seulement opérationnel pendant la journée.
Depuis
le séisme, plusieurs pages d’un registre ont
été remplies de plaintes pour abus sexuels et
violences
déposées par des femmes, des jeunes filles et des
fillettes résidant dans le camp du Champ-de-Mars, de
l’autre côté de la rue.
Le jour où nous nous sommes rendus au poste de police, le
policier de service à cette table a compté pour
nous
à contrecœur le nombre de cas inscrits dans le
registre :
52 cas de violences physiques et sexuelles depuis le tremblement de
terre.
Il nous a dit que de nombreuses victimes étaient mineures,
âgées de 11 à 16 ans, et que la plupart
des
agressions se déroulaient la nuit. Bien qu’il
sache
où envoyer les victimes pour qu’elles
bénéficient de soins médicaux
après une
agression sexuelle, il n’a pas été en
mesure
d’expliquer pourquoi, la nuit
précédente, une femme
sollicitant l’aide de la police après que quatre
jeunes
gens eurent tenté de violer sa fille de 17 ans
s’est
entendu dire que la police ne pouvait rien faire et que le maintien de
l’ordre au sein des camps relevait de la
responsabilité du
président de la République. La confiance de la
population
envers la police en a été fortement
ébranlée…
La
vie surgit au milieu des décombres
Le petit Wilson est né au cours de la nuit
précédant notre second passage à
Cité
Soleil, un camp de fortune où vivent 272 familles. Sa
mère lui a donné naissance dans les conditions
les plus
insalubres que l’on puisse imaginer : par terre, à
quelques mètres d’un canal d’eau
stagnante à
l’odeur fétide, obstrué par des ordures
et couvert
de mouches et de moustiques.
Une autre femme du camp a aidé la mère de Wilson
pendant
l’accouchement, qui nous a été
décrit comme
difficile, sans eau propre, serviettes, ni instruments
stériles
pour couper le cordon.
Âgé d’un jour, Wilson se reposait en
toute
quiétude dans les bras de sa mère, en aucun cas
dérangé par notre présence, ni par la
nuée
de moustiques qui avaient envahi l’espace où nous
nous
trouvions, sous des draps de lit maintenus en l’air
grâce
à de la ficelle. Cette installation est sa maison natale.
L’abri improvisé apportait de l’ombre et
pas
grand-chose d’autre, n’offrant aucune protection
contre les
dangers environnants. Il laisse ainsi trois enfants et leur
mère, qui est veuve, exposés à la
pluie et aux
inondations récurrentes à Cité Soleil,
et à
la merci de maladies infectieuses.
La saison des pluies approche et toutes les personnes avec qui nous
avons parlé craignent le pire. Ce dont elles ont besoin, ce
qu’elles demandent, c’est un toit au-dessus de leur
tête. C’est leur priorité.
|
|
|
|
|
|
Les paramilitaires avaient
aussi
leurs fours crématoires dans l'Antioquia
|
|
|
Traduction via ARLAC (Belgique),
10 mai 2010
Pour la première fois, un ancien paramilitaire fait
état
de l'utilisation de fours crématoires dans la
Vallée
d'Aburrá. La Fiscalía (ministère
public)
enquête sur la base de son témoignage et l'on
espère que d'autres anciens combattants apporteront
davantage
d'informations.
L'ordre donné à la fin des années 1990
par les
commandants des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) de
faire
disparaître les ennemis “de quelque
manière que ce
soit”, pour ne pas laisser de traces et éviter que
les
chiffres des homicides ne croissent de manière
disproportionnée dans les zones urbaines, a
trouvé
à Medellín et dans la région
métropolitaine
l'une des expressions les plus cruelles de la guerre paramilitaire :
l'utilisation de fours crématoires.
Des preuves de l'existence de ce mécanisme macabre ont
été trouvées dans le nord du
Santander. Des
paramilitaires des AUC qui ont opéré dans cette
région du pays, dont Iván Laverde Zapata, alias
‘l'iguane’, ont avoué devant les juges
de
l'Unité nationale de Justice et Paix que dans les zones
rurales
du district de Juan Frío, de Villa del Rosario, et Puerto
Santander, des fours crématoires avaient
été
construits pour incinérer leurs victimes.
À Medellín, la question des fours
crématoires des
AUC ne cessait de faire l'objet de rumeurs depuis plusieurs
années. Dans le monde de la criminalité, on
disait avec
insistance que les paramilitaires enlevaient les gens et “les
brûlaient” pour les faire disparaître,
mais personne
ne donnait de renseignements précis permettant de confirmer
ou
d'infirmer les rumeurs.
Cependant, la réalité est en train de prendre le
pas sur
la rumeur grâce à l'acharnement de plusieurs
enquêteurs judiciaires affectés à
Justice et Paix,
qui passent la question au peigne fin depuis plusieurs mois. Ils
détiennent maintenant des renseignements concrets, bien que
partiels, qui les amènent à constater que cette
pratique
de disparition forcée a bien existé mais que,
comme ils
l'admettent eux-mêmes, il manque des informations.
Les premiers renseignements qui dévoilent cette
réalité sont fournis, depuis plusieurs mois, par
un
ancien paramilitaire qui a décidé de collaborer
avec la
justice. Verdadabierta.com a eu accès à plusieurs
extraits des témoignages remis aux fonctionnaires
judiciaires,
à la lecture desquels il est possible de mesurer la
cruauté extrême à laquelle sont
arrivés des
groupes armés illégaux d'extrême droite
à
Medellín, dans plusieurs municipalités de la
région métropolitaine et dans l'est de
l'Antioquia.
Verdadabierta.com ne révèle pas
l'identité de
l'ancien paramilitaire qui a apporté son
témoignage pour
contribuer à la vérité de ce qui s'est
passé dans la capitale de l'Antioquia et dans les communes
voisines pendant l'étape de
pénétration et de
consolidation des blocs paramilitaires des AUC.
“Beaucoup de morts n'ont pas été
retrouvés
parce qu'ici, à Medellín, dans les environs,
à une
heure d'ici, on trouve des fours crématoires. Beaucoup de
gens
ont été brûlés. J'ai
assisté à
ces faits", a avoué l'ancien paramilitaire aux
enquêteurs.
Selon son récit, entre les années 1995 et 1997,
les
paramilitaires capturaient leurs victimes, les tuaient, et beaucoup
d'entre elles ont été jetées dans le
Cauca, le
long des rives du sud-ouest de l'Antioquia. “Les corps
étaient éventrés, lestés de
pierres et
jetés dans le fleuve. De nombreux membres des AUC ont
été faits prisonniers alors qu'ils jetaient des
cadavres”.
À ce problème est venu s'ajouter celui de la
hausse du
nombre des homicides, surtout dans les communes de la Vallée
d'Aburrá et dans d'autres, où les paramilitaires
allaient
combattre la subversion. De l'état-major des AUC,
commandé à cette époque par Carlos
Castaño
Gil, est venu l'ordre de faire disparaître les victimes.
C'est
ainsi qu'est née l'idée de construire un four
crématoire : “L'idée du four a
été
suggérée par ‘Doblecero’ et
concrétisée par Daniel
Mejía”.
Pendant ces années-là, Mauricio
García, alias
‘Doblecero’, commandait le bloc Metro et Daniel
Alberto
Mejía Ángel, alias
‘Danielito’, avait
intégré le bloc Cacique Nutibara, relevant des
AUC que
commandait Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don
Berna’.
“ Daniel Mejía s'est chargé
de la
construction; il appartenait aux AUC et à la Oficina de
Envigado, a déclaré l'ancien paramilitaire.
“J'ai
entendu que le four coûtait entre deux cents et
cinq cents
‘bâtons’ (millions de pesos) et qu'il a
été étrenné avec un type du
nom d'Alberto,
de la Oficina de Envigado. Ils l'ont jeté vivant dans le
four
parce qu'il avait volé de l'argent. Le four était
manoeuvré par un homme qu'ils appelaient ‘pompes
funèbres’, je crois qu'il se nommait Ricardo; deux
hommes
entretenaient les grils et les cheminées, parce que la
graisse
humaine les bouchait”.
Pour ce qui est de la localisation du four, le paramilitaire a
indiqué qu'il se trouvait dans une exploitation de la
commune de
Caldas, au sud de la Vallée d'Aburrá.
“Il faut
passer le centre urbain. On sort de Caldas par là; il faut
une
demi-heure en voiture. Il se trouve dans une très grande
propriété. On entrait, à
l'époque, par un
portail blanc”.
L'ancien paramilitaire a décrit en détail
l'immeuble, une
fois entré dans la propriété :
“La
première maison était de construction noire;
ensuite, il
y avait comme une espèce de dépôt et
plus loin,
à 70 ou 80 mètres, quelque chose qui ressemblait
à
une briqueterie. On voyait deux cheminées sur le toit. Quand
on
entrait, il y avait un premier étage avec un jardin de recul
bien décoré, et de là, à
main droite, on
descendait un escalier d'environ cinq mètres, en bas duquel
on
remarquait un grand four de boulangerie industrielle”.
Voici les détails qu'il a donnés au sujet du four
:
“La porte était hermétique, et
s'ouvrait de haut en
bas; fermée, elle était encastrée dans
un pan de
mur; ses vitres étaient grasses, comme opaques. Dans la
partie
extérieure, il y avait trois boutons, un rouge servant de
poignée et deux autres pour réguler la
température. Au-dedans, le four était
métallique
et avait une espèce de plateau fixe; il y avait des
résistances, certaines sous le plateau, comme des grils. Il
y
avait aussi des résistances sur les
côtés du
plateau. Au fond de l'appareil, il y avait deux ventilateurs. On nous
disait que là, nous ne pouvions pas fumer. Ça
sentait la
viande roussie. Dans le four, il n'y avait de la place que pour une
personne. Les corps étaient accrochés au plateau.
Quand
la température montait, les corps se soulevaient. Beaucoup
de
personnes mouraient avant d'entrer dans le four".
D'après les calculs du témoin, entre 10 et 20
personnes y
étaient conduites chaque semaine. Et il y avait une
procédure à suivre : “Lorsque nous
arrivions avec
les personnes, vivantes ou mortes, nous sonnions et on nous disait
‘Mettez ces intrants au fond’. Nous entrions, nous
les
portions dans des sacs pour que le sang ne se répande pas.
Nous
les saignions. On nous demandait ‘Qui envoie ça
?’.
Alías ‘J’ et Daniel en envoyaient
beaucoup. Ils
avaient une fiche sur laquelle ils notaient tout. Celui qui notait
était un homme d'environ 45 ans, petit, trappu. Nous
entrions et
nous devions attendre les cendres. La procédure prenait
environ
20 minutes, mais lorsque le four était allumé,
cela
durait environ cinq minutes. Ensuite, nous les montrions à
‘J’ ou à Daniel, puis nous les jetions
dans le
fleuve ou là où on nous disait de le
faire”.
Devant les enquêteurs judiciaires, il n'a pas nié
sa
participation à plusieurs crimes commis de cette
façon.
“J'en ai amené qui étaient morts,
d'autres qui
étaient vivants. J'ai apporté plus de cinquante
morts et
plus de quinze vivants”.
Parmi les victimes dont il se souvient, il y avait deux
frères
du nom de Vanegas, éleveurs de profession, qui avaient
été arrêtés dans le secteur
de Belén,
au sud-ouest de Medellín, sur ordre de Daniel
Mejía.
Selon les paramilitaires, ces hommes avaient été
assassinés parce qu'ils finançaient un front de
la
guérilla des FARC. À partir de leur mort, le four
crématoire a été utilisé
pour toutes sortes
de personnes, mais auparavant, il n'était utilisé
que
pour des “personnalités”.
Il se souvient d'une autre personne incinérée
là-bas : le narcotrafiquant Julio Cesar Correa
Valdés,
connu dans le monde de la mafia comme Julio Fierro, et époux
du
modèle Natalia Paris. Son décès s'est
produit,
d'après le témoignage de l'ancien paramilitaire,
fin
août 2001. Selon les journaux de cette
année-là, ce
narcotrafiquant était en pourparlers avec la DEA pour se
soumettre à la justice des États-Unis et
collaborer comme
indicateur en échange d'avantages juridiques.
“Ils s'en sont aperçus en Antioquia, et Salvatore
Mancuso,
Carlos Castaño et Daniel Mejía se sont
réunis.
Castaño a donné l'ordre de capturer Julio Fierro.
Celui-ci a été pris dans la
municipalité de Guarne
par plusieurs hommes de Daniel. Ils avaient pour instructions de ne pas
le tuer. De Guarne, ils l'ont emmené en
hélicoptère jusqu'à
Córdoba, où se
trouvait Carlos Castaño. Ils voulaient lui prendre quelques
propriétés. Natalia Paris se rendit
également
jusque-là parce qu'ils allaient lui prendre des
propriétés qui étaient à
son nom à
elle. Julio fut ramené à Medellín en
hélicoptère, pour l'extinction du droit de
propriété, puis ils le tuèrent et
menèrent
sa dépouille au four”.
Le plus paradoxal du récit de cet ancien paramilitaire,
c'est
qu'il offre une version qui pourrait éclaircir ce qui s'est
passé avec ‘Danielito’, disparu le 25
novembre 2006,
deux semaines après avoir quitté le centre de
réclusion de La Ceja, Antioquia, où
étaient
détenus les chefs des AUC. Il avait quitté le
centre
parce qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre lui.
“Il a été victime de sa propre
invention”, a
déclaré l'ancien paramilitaire
interrogé par les
enquêteurs judiciaires. “Ils ont fait
disparaître
Daniel avec dix de ses gardes du corps dans ce four”. Un
soir, un
ami m'a appelé pour me dire ‘Ils ont pris Daniel,
le
patron’, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je ne
sais
pas non plus ce qu'il est advenu de ce four”.
Des chercheurs sociaux de l'Université de l'Antioquia qui
travaillaient sur ce type de phénomènes criminels
et qui
ont demandé de préserver l'anonymat de leur
source, ont
indiqué que l'existence de fours crématoires dans
le nord
du Santander et dans l'Antioquia montre qu'il s'agit d'une
manière “d'industrialiser la
criminalité”. Il
y avait un ordre supérieur de “faire
disparaître les
victimes à tout prix” et les
écartèlements,
les fosses, les fleuves et les fours apparaissent en ce sens comme des
techniques efficaces pour en finir avec le soi-disant
“ennemi”.
Ce que révèle ce type de criminalité,
ajoutent les
chercheurs sociaux, c'est son caractère
systématique et
sélectif, “ce qui veut dire que toute cette
criminalité a été
planifiée, de sorte qu'on
ne peut perdre de vue que les paramilitaires ont eu des
écoles
où on préparait les combattants par diverses
activités. Là, ils en faisaient des machines de
guerre” au moyen d'une division interne du travail,
spécifiée par des techniques criminelles.
La Fiscalía espère que d'autres anciens
paramilitaires,
qu'ils soient candidats aux bénéfices de Justice
et Paix,
privés de liberté en raison de crimes
jugés par la
justice ordinaire ou libres, sans requêtes de la justice,
contribueront à préciser davantage encore les
détails de ce type de disparition forcée, afin
non
seulement d'établir la localisation exacte du four
crématoire, mais aussi d'identifier les victimes qui ont
été conduites à cette macabre machine
de mort.
Source : Traduction ARLAC
(Belgique)
Association des Réfugiés de
l’Amérique Latine et des Caraïbes
|
|
|
|
|
| Antanas Mockus, l'homme du
vaccin |
|
Par Gloria Gaitán, 14
juin 2010
Paul de Tarse a du avoir les mêmes émotions que
moi hier,
quand sur le chemin de Damas il eut une vision inattendue, qui le
converti au christianisme. Hier, j'ai reçu deux courriers
qui
m'ont éclairé et me firent penser que
moi-même,
j’avais oublié ce que tout au long de ma vie,
j'avais
appris et essayé de transmettre.
Comme je suis la fille de Jorge Eliécer Gaitán,
il en a
résulté, que je n'ai pas pu faire autre chose
qu'écouter les autres se référant
à mon
père. La raison pour laquelle, je me suis
dédiée
à faire des recherches et à
décortiquer son
passé. Ce qui me permis de me plonger et connaître
sur le
bout des doigts l'Histoire de la Colombie du XX°
siècle,
parce que la vie de mon papa est notre histoire commune et qu'il a
laissé une trace indélébile en
Colombie, le
suivant jusque dans sa mort.
Avec tant de matières recueillies, ma conclusion a
été que les méthodes et les tactiques
de lutte de
l'oligarchie colombienne se répétaient comme une
noria ;
ainsi, j’en fis la démonstration dans un essai,
dont je
suis l’auteur et que j'ai intitulé des "Tactiques
de lutte
de l'oligarchie libérale - conservatrice". Pour
les
Colombiens, ces manoeuvres ont été une
"escroquerie", qui
année après année, élection
après
élection, et sans que mes écrits n'aient produit
autre
chose que l’ire collective du moment et, seulement avec le
temps,
la reconnaissance de sa validité ... mais "trop tardive".
Le plus surprenant a été
qu’à cette
occasion, je tombai moi-même dans le piège, et je
ne me
rendis pas compte, Alvaro Uribe et sa bande nous avait
appliqué
la même méthode nous ayant maintenu dans cette mer
de
corruption et d'exploitation.
Il est certain que pour mes parents proches il leur semblait qu'Uribe
devait projeter quelque chose de grand pour vouloir se maintenir au
pouvoir, après que tomba la possibilité
d'être
réélu une deuxième fois, mais je ne me
rendis pas
compte, il allait répéter les mêmes
méthodes
que ses prédécesseurs avaient
utilisées. Hier
quand je l'ai entendu et je me dois de remercier Isabelle et
Léonard, qui de par les diverses choses, qu’ils
m’ont signalé par courrier m’a ouvert
les yeux.
Pour saisir comment l'oligarchie colombienne a
répété plusieurs fois la
même tactique pour
manipuler les électeurs, il faut remonter à la
décennie de 1930, quand mon père, Jorge
Eliécer
Gaitán, rompit avec le Parti Libéral et rentra
à
l’"Union Nationale de la Gauche Révolutionnaire",
un
mouvement fondé par quelques jeunes combatifs
d'Antioquia
des années auparavant. Mon père avait eu une
brillante
trajectoire dans le Parti Libéral et son passage
à
« l'Unirismo » marqua d’un coup fort
l'opinion
publique. Alfonso López Pumarejo - chef "naturel" du
libéralisme - se trouvait à Londres,
où un
reporter lui demanda ce que les libéraux feraient pour
barrer la
"vague révolutionnaire" qui croissait avec Gaitán
depuis
l’UNIR. Et López a répondu : "Cela
n’a pas
d’importance, je reviendrai en Colombie et nous parlerons
aussi
d'une révolution, mais s’appuyant sur le surnom de
libéral, c’est ce qui entraînera le
peuple".
Et il en a été ainsi. López Pumarejo
est revenu au
pays et a lancé ce qu'il a nommé « LA
RÉVOLUTION EN MARCHE »
accompagnée de trois
« que vive » au "grand parti libéral" et
c’est
ainsi que le peuple s'est dirigé vers cette alternative, en
affaiblissant l’UNIR et en obligeant mon père
à
réintégrer le Parti Libéral, avec la
proposition
pour le peuple de s’emparer du parti et le changer en parti
du
peuple, - ou bien ce qu'il voulu hors de l’UNIR. Des
années plus tard, quand l'influence de la
Révolution
Cubaine a donné pour résultat en Colombie une
grande
vague révolutionnaire en des proportions gigantesques,
Alfonso
López Michelsen est apparu pour proposer la
création du
MRL (Mouvement Révolutionnaire Libéral).
A ce moment López Michelsen écrit au
Président de
la République, Carlos Lleras Restrepo, une lettre
qu’il
publia au journal El Espectador où il disait textuellement :
"Monsieur le président, je n'ai pas fait dissidence pour
nuire
au Parti Libéral, mais pour le sauver. En attendant, vous
avez
un étendard cloué au côté du
gouvernement,
le mien est du côté de l'opposition, pour
canaliser le
mécontentement et pour empêcher que le peuple
s’en
aille vers le communisme ou l'ANAPO" (Alliance Nationale Populaire).
Devant une confession semblable, j'ai écrit un article dans
la
revue cubaine la Maison des Amériques, je l’ai
intitulé "l'homme du vaccin", parce que, disais-je," il
injecte
des petites doses de révolution pour créer des
anticorps
et pour empêcher la révolution". Puisque
c’est la
même chose qui se passe aujourd'hui par le canal d'ANTANAS
MOCKUS.
Quand ont commencé à apparaître au
début les
dénonciations de corruption du gouvernement
d'Álvaro
Uribe, lui plus que personne, a su que les affaires pourraient
s'enfoncer et qu'il y avait bien plus à éplucher
; lui
savait qu'il s'agissait de délits bien plus nombreux,
complexes
et criminels que le "yidispolítica". Il a
immédiatement
pensé qu'une grande vague d'indignation se
lèverait
contre les corruptions nombreuses de son gouvernement. Il
était
à l'époque indispensable de canaliser le
mécontentement prévisible et pour cela il devait
être créé et être promu un
mouvement de fond
empêchant que l'opposition aille vers le PDA (Pôle
Démocratique Alternatif), où maintenant
étaient
unis les communistes et l'ANAPO, qui dans des années
antérieures, Alfonso López Michelsen avait voulu
freiner
avec la création du MRL.
L'homme adéquat était Antanas, qui avait
déjà démontré son
intérêt
d'être candidat à la Présidence de la
République. Il n’a jamais s'agit de le porter
à la
Présidence de la République, mais de "canaliser
le
mécontentement", comme l'avait dit López Pumarejo
dans
les années 1930, son fils spirituel, López
Michelsen dans
les années 1960.
Pareillement, Carlos Lleras Restrepo a eu recours aux mêmes
méthodes ; à cette même
période, Lleras
Restrepo a lancé dans l’arène
politique son
protégé, Luis Carlos Galán, d'abord
comme ministre
de l'Education, et l’a tout de suite
dénommé comme
le Nouveau Libéralisme, dans un processus
précipité ; puisque Galán n'avait pas
de
passé politique lui donnant un prestige populaire suffisant,
raison pour laquelle il fut à cette époque
surnommé "l’avocat", parce qu'il était
mûr et
à point nommé. Et la tentative a porté
ses
résultats, ainsi la gauche s’est
évanouie,
canalisée massivement par Galán, dont le
collaborateur
plus direct était César Gaviria (Parti
Libéral),
qui gouverna comme l’aurait fait son chef de ne pas avoir
été assassiné par la maffia, que
Carlos Lleras
voyait avancée, mettant en danger le pouvoir traditionnel de
l'oligarchie colombienne.
Déjà au XXI° siècle, en
première
instance, l'oligarchie ne souhaitait plus avoir recours à
l’émotion, au "kyste psychologique" d'attachement
au
libéralisme, qui avait perdu de sa vigueur
émotionnelle
dans l’inconscient collectif ; de toute façon, ils
ont
été amenés à jouer, comme
les pièces
secondaires d’un tableau, aux candidats libéraux
et
conservateurs ; parce qu'il existe une minorité qui vibre
encore
au cri de « que vive le grand parti libéral ou
conservateur ». Ils étaient là comme
des
pièces de rechange, pour entraîner certains
gardant encore
un lien aux appellations du XX° siècle et cela
explique
très bien aussi que, fini le premier tour, les chefs des
deux
partis sont partis en courant vers leur candidat naturel, monsieur Juan
Manuel Santos.
A l'heure actuelle, le vrai hameçon est une lutte
éthique
et moralisante. D’abord, il ne s'agit pas
déjà d'un
aimant émotionnel mais rationnel. Cela date de quand Antanas
est
apparu avec des slogans catalysant le goût amer de ce que
pensent
les gens honnêtes face à huit ans de corruption,
de
pécule amassé, de subornation et des crimes
d'État. Et ainsi - comme hier López
parlait
hypocritement d'une révolution - maintenant Antanas clament
les
slogans qui répondent au désir ardent
d'honnêteté et de la
nécessité de
changement, en plus du rejet d'une frange très importante de
l'opinion publique concernant la corruption rampante. Avec les faux
positifs, ils ont conduit Antanas à parler de la vie comme
d’un bien sacré.
Devant le scandale des cadeaux de terres aux riches, au lieu
d’être données aux paysans et devant la
subornation
vérifiée, Antanas a parlé du
bien public
comme étant sacré. En face de la violation des
principes
constitutionnels et légaux de tout caractère que
l'uribisme a joué pour obtenir la
réélection de
son chef, Antanas a commencé à parler du respect
de la
Loi et de la Constitution. Et, face à un candidat, comme
Gustavo
Petro, il démontrait au pays son intelligence et un
programme
qui défendait la justice sociale et
l'équité,
Antanas a commencé à marquer le PDA comme
allié
des FARC, mettant en danger la vie de ses militants après
avoir
répété les mêmes accusations
qu'Álvaro Uribe employait contre le parti qu'il avait uni
à toutes les forces et mouvements de gauche.
Là s'explique pourquoi, il explose à la
lumière
qu’Antanas au programme politique unique, duquel il a
divergé est allé vers
celui-là du PDA, parce
que sa candidature avait pour fondement de "canaliser le
mécontentement" pour empêcher que les non
conformes
s’en aillent.
ANTANAS EST L'HOMME du VACCIN DU MOMENT, QUI APPARAÎT POUR
CRÉER DES ANTICORPS ET POUR EMPÊCHER QUE TOMBE DU
POUVOIR
L'URIBISME.
Mais le mécontentement et le scandale national
étaient
tels, que la candidature d'Antanas s'est convertie en "vague verte", ce
qui n'était pas l’objet imaginé
initialement.
Canaliser le mécontentement, oui, mais porter Antanas
à
la Présidence de la République : NON !
Et c’est là quand Antanas a commencé,
dans les
débats, à dire toute sorte de sottises, que le
jour
suivant il rectifiait en montrant une inconsistance, une
insécurité et une incapacité de
gouverner le pays.
Antanas incapable ? Non ! Antanas s'acquittait du programmé.
Puis le succès atteint a été tel pour
cette
nouvelle politique du vaccin, qu’Antanas lui-même
s'est
enthousiasmé à l'idée de devenir
Président
; alors, le moment arriva de "dégonfler" une partie
importante
de son électorat, pour que la vague verte ne se transforme
pas
en tsunami ; et c'est pour cela que dans le dernier débat
par
télévision organisé de Cititv (le
canal de poche
de Juan Manuel Santos) a construit un scénario pour demander
à Antanas à l'improviste ce qu'il allait faire
avec les
impôts, et, comme Antanas ne s’appuyait pas sur un
programme solide, parce que l'idée n'était pas
d'être président, il a répondu qu'il
les
monterait - sans un fondement économique
sérieux -
alors que Santos a dit qu'il ne les élèverait pas.
Une farce préméditée et un coup mortel
pour
Antanas devant l'opinion publique. Une arme définitive au
premier tour, Santos gagnera bruyamment. Parce qu'il est certain, que
dans les strates 4, 5 et 6 ont voulaient moraliser le pays, parce que
la corruption affectait leurs affaires et enrichissaient seulement les
"cacaos" et les mafieux, mais qu'Antanas allait monter les
impôts
était de trop. Il était
préférable de voter
pour Santos, qui au moins garantissait de ne pas les affecter avec une
hausse des impôts.
C’est la raison pour laquelle Antanas est "le candidat sans
programme", en se contredisant d'une manière permanente et
en
montrant une ignorance absolue, de ce qu’est
gouverné.
Ce fut aussi à ce moment que les enquêtes ont
montré qu'Antanas dépassait Santos. Ainsi les
santistas
s'éveillaient et votaient en masse pour son candidat, pour
récupérer l'apparemment perdu, alors que les
partisans de
Mockus se sont jettés sur les étuis à
cigarettes -
comme nous disons en Colombie - et la vanité (toujours
traîtresse) les a amenés à
mépriser la
coopération des gens.
Pendant le deuxième tour, Antanas ne cherchera pas
à
gagner, mais à continuer de représenter la
comédie
qu'il a personnifiée dans le premier acte.
C’était
par cela que, depuis toujours, il a dit qu'il ne voulait pas
d'alliances avec le PDA, parce qu'il ne veut pas des votes du Polo, il
voulait "canaliser seulement le mécontentement" pour
empêcher que les gens partent vers une organisation de gauche
comme le PDA
Ils me diront maintenant la même chose que m'ont dit les
partisans du MRL et du Nouveau Libéralisme et tireront,
comme
argument facile, de me nommer folle, mais je prédis
qu'Antanas
suivra exprès et que le triomphateur, Juan Manuel
Santos,
le nommera comme intégrant son cabinet en qualité
de
Ministre de l'Education.
Cette comédie colorée est
démasquée et
celui qui veut continuer de jouer, qu’il vote pour Antanas au
deuxième tour.
Cordialement,
Gloria Gaitán
Traduction libre de Lionel
Mesnard,
Paris, le 14 juin 2010
Cet article est sous la mention tous droits
réservés
et ne peut faire l'objet d'une reproduction sans autorisation
|
|
|
|
| Construire
ou reconstruire HAITI ? |

Camille Chalmers & Emile Brutus, 7 juin 2010
Le séisme du 12 janvier 2010 a battu les records des
catastrophes naturelles qui ont frappé Haïti depuis
les dix
dernières années. [1] Dans les trois
départements
géographiques touchés, le nombre de personnes
affectées est estimé à trois millions
dont des
pertes en vies humaines de l’ordre de 222 000, des
blessés
s’élevant à plus de 300.000, des
mutilés
à plus de 45 000 tandis que les traumatisés
psychologiques ne sont pas encore évalués. Un
gigantesque
mouvement de population s’est ensuivi :
déplacements de
population (500 000 vers les provinces), déstabilisation du
tissu social (deuil et désolation, orphelins, rupture
familiale,
départ à l’étranger, perte
de revenus et de
richesses accumulées, litiges et contentieux potentiels),
désorganisation de l’habitat (250 000 maisons
détruites). L’ampleur des
dégâts est
estimée à 56% du PIB : destruction des
réseaux de
services publics Ed’H, Teleco, SNEP ; destruction des
infrastructures et des entreprises) et exacerbation de la
fragilité du pays (dramatique affaiblissement de ses
institutions et structures étatiques et un accroissement
accéléré de sa dépendance
aux points de vue
économique (CCI, DSNCRP, dette), financier (transferts de la
diaspora, dette publique externe), alimentaire et politique (MINUSTAH).
Pour de nombreux observateurs, les événements du
12
janvier 2010 ont provoqué la destruction violente
d’un
système vétuste qui a montré ses
limites par la
manifestation d’une crise permanente, structurelle et
multidimensionnelle. L’ampleur de la catastrophe ou
l’intensité du séisme [2] exige que des
réponses systématiques soient
apportées à
ce qu’il faut appeler désormais la «
crise
haïtienne ». C’est ainsi que
l’on assiste depuis
le séisme à la réactivation des
discours sur la
construction, la reconstruction du pays et, dans une grande mesure
également, la refondation de l’État et
de la
nation. De nombreux acteurs se sont ainsi prononcés sur les
orientations de sortie de crise ou de reconstruction du pays : le Plan
Stratégique de Sauvetage National (PSSN), les propositions
du
GREH, les « Voies et Moyens » des banquiers et
experts
financiers qui s’en remettent encore au FMI (Pierre-Marie
Boisson, F. Carl Braun, Kesner Pharel et Bernard Roy), le rapport de la
Commission Politique du Sénat, le Programme de Refondation
de la
Nation de FHONDILAC et le Programme du Gouvernement attendu pour le 17
mars 2010 avant sa présentation à la
réunion des
bailleurs de fonds internationaux le 31.
La réflexion proposée ici suggère
d’emblée qu’aucun projet ou programme de
reconstruction n’est valide s’il ne
s’inscrit pas
dans une démarche globale de rupture avec un ensemble
d’inégalités au fondement de ce
système
ancien dont l’état critique a
été maintes
fois révélé et aujourd’hui
aggravé
par l’intensité du séisme. Il
s’agit de ces
rapports de domination qui ont historiquement
sclérosé la
société haïtienne et bloqué
son expression et
sa marche vers la construction d’un modèle
fondé
sur l’humain, y compris à le considérer
comme un
symbiote d’un environnement plus global. Le raisonnement
interroge ainsi tous les rapports de domination liés
à la
propriété (rapport au bien commun, aux biens
publics, aux
biens sociaux, en général, y compris le pouvoir
politique), à la centralisation politique et la
concentration
administrative (rapport à la rétention du pouvoir
et des
services et équipements publics, rapport urbain/rural,
capitale/province), aux clivages sociaux, économiques et
culturels (rapport d’exclusion et rétention des
biens
sociaux, de prévarication), à la destruction de
l’environnement (tout le rapport à la soumission
de la
nature dans cette logique d’exploitation capitaliste) et
à
la dépendance (rapport de domination
impérialiste, y
compris vis-à-vis des Institutions Internationales et de
leurs
ONG). En effet, ces clivages et ces inégalités
ont
toujours dressé de grands obstacles à la
construction
nationale, à la redistribution des biens sociaux et
à la
démocratisation de l’État. Une petite
minorité de 1% de la population retient plus de 40% de la
richesse nationale et met en place un système
étatique de
prédation et de répression contre la
majorité des
masses paysannes et des classes populaires urbaines avec le soutien
d’une petite bourgeoisie protéiforme et des
puissances
impérialistes.
Confrontés aux ruptures en question, les
différents
projets de reconstruction connus à cette date laissent
transpirer plusieurs stratégies : une stratégie
humanitaire, des stratégies impérialistes, une
stratégie techno-souverainiste et une stratégie
démocratique et populaire. Chacune d’elle renvoie
à
des intérêts, des acteurs disposant
d’importantes
ressources susceptibles d’être
mobilisées mais dans
un contexte de « rationalité limitée
» [3],
et donc où aucun d’entre eux n’est parti
gagnant.
Certains peuvent seulement se croire donnés favoris...
Les
stratégies humanitaires - Ériger
l’humanitaire en
système : humanitaire caritative, humanitaire
d’État, humanitaire durable
La catastrophe a provoqué un élan de
générosité inestimable des peuples du
monde entier
: la levée de fonds de l’ONU, les dons
reçus par
les ONG, la levée de fonds des amis et partenaires, les dons
en
nature de toutes sortes, les visites de
délégations
venues du monde entier, etc. La mobilisation mondiale est à
la
hauteur du nombre de victimes et des destructions
matérielles.
De toute évidence, l’aide humanitaire massive est
d’une absolue nécessité «
dans une situation
aussi apocalyptique ». De plus, Haïti
était
déjà en état de catastrophe
« non naturelle
», reconnaît Jean Ziegler, compte tenu de
l’imposition des trois derniers plans d’ajustement
structurel du FMI ayant réduit les droits de douane du pays
de
50% à 3 % et privant ainsi l’État
d’une des
rares ressources à sa disposition. La production agricole a
été détruite dans le sillage de cette
libéralisation douanière occasionnant, du coup et
de plus
en plus, la dépendance alimentaire du pays consacrant plus
de
70% de ses revenus d’exportation à
l’importation de
biens alimentaires, soit 75 % de ses besoins. Des dizaines de milliers
de familles paysannes se trouvent ainsi ruinées,
d’où un exode rural massif vers les centres
urbains et une
importante migration internationale. À tout cela
s’ajoute
également la flambée des prix des produits de
premières nécessités dans le monde
entier en 2007
et qui a été à l’origine de
beaucoup
d’émeutes de la faim à travers le
monde, y compris
dans Port-au-Prince, la capitale haïtienne se trouvant
aujourd’hui ravagée par le tremblement de terre.
Donc, dans un mouvement d’empathie
générale
appuyé sur ce que Roland Barthes appelle les «
dramatis
personae » [4], c’est-à-dire sur le
dénuement, la misère et la pauvreté du
peuple
haïtien victime, de surcroît, d’un
séisme
destructeur, la conscience et la
générosité des
peuples du monde entier n’ont pas fléchi : il faut
apporter une aide d’urgence et une assistance aux
sinistrés. Ainsi, le pays a reçu des centaines de
milliers de tentes, de bâches, des aides en eau potable, en
vivres, en médicaments, en vêtements etc. Des
personnels
de santé et des professionnels divers y apportent leurs
aides et
leurs concours. Toutes les actions sont réalisées
et
administrées par un système très lourd
comprenant
à la fois des opérateurs
multilatéraux,
bilatéraux et des ONG et dont la transparence et la
cohérence ne sont guère les principales
caractéristiques. D’où une
asymétrie par
rapport aux ressources financières
récoltées pour
financer l’aide d’urgence. Par exemple, les appels
aux
donateurs lancés par les Nations Unies ont
rapporté au
début du mois de mars US $ 2,380,477,713 tandis les
engagements
non encore honorés à cette date
s’élèvent à US $
1,251,295,431. [5] Selon
des sources proches de l’Ambassade des États-Unis
en
Haïti, plus de US $ 750 millions auraient
été
dépensés dont plus de 400 millions pour seulement
les
troupes militaires américaines postées dans le
pays
depuis le 12 janvier. Quoique ces montants ne rendent pas compte de
tout le flux d’argent destiné aux interventions
humanitaires, leur importance indique clairement que la situation
d’urgence en Haïti tend à devenir un vrai
tonneau des
danaïdes.
De plus, l’aide d’urgence, et donc le double
mouvement de
générosité et de solidarité
mondiale
enregistré, se développe sur le terrain dans
l’inorganisation la plus totale entretenant malheureusement
des
réseaux maffieux et de corruption à
l’opposé
des motivations premières des personnes et institutions
ayant
cherché à manifester leur solidarité.
En fait, les
sinistrés continuent de réclamer des tentes
tandis les
camps de réfugiés manquent de tout. Le
gouvernement
paraît ne pas maîtriser grand-chose dans toutes ces
actions
tandis que des ONG d’une même famille se bousculent
pour
offrir les mêmes services sur les mêmes sites aux
mêmes populations entraînant ainsi des effets de
chevauchement et le mésusage des ressources. [6]
De toute évidence, derrière cette
stratégie
humanitaire s’activent de nombreux acteurs externes allant
des
petites associations de citoyennes et de citoyens des pays du monde
entier, en passant par les grandes institutions internationales et les
puissantes ONG aux États. Toutefois, la noble motivation
consistant à apporter des secours est polluée par
une
démarche stratégique trahissant les
différents
opérateurs : l’enjeu majeur est de se positionner
dans le
nouveau contexte redéfinissant les rapports de forces pour
la
défense d’intérêts divers.
L’humanitaire d’État (ou la «
stratégie
des vautours ») apparaît dans toute sa splendeur
avec cette
guerre diplomatique que livre la France aux États-Unis :
elle
dénonce pour ainsi dire la mainmise américaine et
la
volonté de ces derniers de mettre Haïti sous leur
tutelle.
Barack Obama, dans un article qu’il signe et paru dans
Newsweek,
en revanche, se défend de ne pas chercher à
asservir les
nations mais à les aider en se
référant
d’ailleurs au Plan Marshall ou aux interventions au Kosovo ou
à la Bosnie. [7] Mais personne n’est dupe des
dessous
électoraux de toute la médiatisation de la
démarche américaine en Haïti par ces
temps de
renouvellement d’une partie du Congrès. Le Canada
qui
compte 2,000 soldats dans le pays et le Brésil ne veulent
pas
rester en dehors du marché tandis la République
Dominicaine cherche la bonne position en raison de
l’importance
du marché d’Haïti qui
représente pour elle le
2e partenaire commercial après les États-Unis.
La stratégie humanitaire, très forte
aujourd’hui vu
l’incapacité de l’État
à intervenir et
à apporter des réponses aux différents
problèmes qui surgissent ou aggravés par le
séisme, est en train de se métamorphoser
dangereusement.
Dans un premier temps, il y a le fait que l’humanitaire
s’opère dans un mouvement de substitution des
structures
humanitaires aux structures étatiques
(l’ONU-OCHOA-Bill
Clinton, les ONG) : le gouvernement tout comme les administrations
d’État n’ont aucune emprise sur ce qui
se
décide pour venir en aide à la population
sinistrée. Dans un second temps, et dans une relation
à
la durée, l’aide humanitaire se
révèle
contre-productive et enlève à la personne toute
son
autonomie si ce n’est qu’elle tue
l’instinct de
survie des bénéficiaires. [8] Elle est
également
génératrice d’inflation tandis
qu’elle
détruit l’économie locale. Et pourtant,
un nouveau
concept prend place dans le paysage et marque une variation
à
travers ce qui a tout l’air d’une
stratégie
prônant une aide humanitaire durable. Ce concept
s’appui
sur l’idée simple que l’aide
d’urgence est
temporaire mais après il s’agit de continuer
à
assister la population qui a fait l’objet de l’aide
d’urgence. L’idée de l’aide
humanitaire
durable est illustrée dans les termes suivants :
à quoi
bon sauver quelqu’un de la noyade si c’est pour
l’abandonner ensuite sur la berge ? La stratégie
humanitaire en Haïti a de beaux jours devant elle puisque
prévue initialement pour six mois,
l’arrivée de la
saison des pluies et l’insuffisance de
l’accompagnement qui
est fourni aux sans abris va la doper et la conduire inmanquablement
vers la durabilité.
Au total, qu’elle se présente sous sa forme
d’urgence ou durable, l’aide humanitaire ne peut
qu’enliser le pays quoique paradoxalement la population en
ait
grandement besoin, ne serait-ce que dans les premiers moments. Ainsi,
elle devrait s’inscrire dans une stratégie
d’urgence
orientée vers la recapitalisation et
l’augmentation de la
production locale. C’est là une idée
assez
angélique par rapport aux enjeux extra-humanitaires
portés par tous les acteurs évoqués
précédemment. Ainsi, cette nouvelle
expérience de
l’humanitaire en Haïti se
révèle un
véritable cadre pratique d’expression des
intérêts de groupes et
d’États puissants
mettant en place des points d’ancrage pour le
développement de leurs stratégies
d’expansion et de
domination à l’extérieur de leurs
frontières
territoriales.
Les
stratégies impérialistes - « Adapter
»
Haïti au capitalisme néolibéral
mondialisé
L’intensité du séisme a
occasionné un net
regain d’intérêt de la «
Communauté
Internationale » et surtout des Pays dits « Amis
d’Haïti » en vue de la RECONSTRUCTION :
USA, France,
CANADA, BRÉSIL, République Dominicaine.
D’où
une multiplication des initiatives (aides humanitaires) et des sommets
internationaux (Montréal en janvier et mars 2010,
Saint-Domingue
et New York en mars) sur la reconstruction d’Haïti.
La
description faite par cette « Communauté
Internationale
» ne se démarque pas des catégories
traditionnellement utilisées pour caractériser la
situation du pays : État faible, Entité Chaotique
Ingouvernable, État en faillite, État corrompu,
le seul
PMA de l’hémisphère, le pays plus
pauvres des
Amériques qui, de surcroit, vient d’être
ravagé par un violent séisme causant des
dégâts estimés par la BID à
$ 14 milliards
US. Donc, devant la destruction et l’ampleur des
dégâts provoqués par le
séisme,
l’idée de la reconstruction
d’Haïti
paraît fonder une intersubjectivité
inédite qui
s’effrite vite dans le dédale des
rivalités
inter-impérialistes.
Barack OBAMA, le Président des États-Unis a
réagi
dans les minutes qui suivirent le tremblement de terre : «
les
États-Unis vont déployer les moyens de sa
puissance pour
reconstruire Haïti » : déjà 20
000 marines,
occupation et contrôle des voies et moyens de communication,
plus
particulièrement l’Aéroport
International Toussaint
Louverture, en vue de filtrer les arrivants et les sortants.
Bill Clinton, l’envoyé spécial de Ban
Ki-Moon et
Coordonateur de l’aide humanitaire en Haïti,
présente
peu après également les trois temps des
interventions :
« aide d’urgence, remise sur pied de
l’État et
reconstruction »
Edmond Mulet, nouveau représentant des Nations Unies en
Haïti en remplacement de Heidi Hannabi qui a péri
dans la
catastrophe, enjoint que : « La MINUSTAH y est pour au moins
les
dix prochaines années ».
S’opposant à l’activisme exclusiviste
des
États-Unis depuis le séisme, le
Président de la
France, Nicolas Sarkozy, exhorte les haïtiens à ne
pas se
laisser imposer une quelconque tutelle internationale : «
À ceux qui, tirant argument du dénuement actuel
des
Haïtiens et de leur État, caresseraient
l’idée
d’une tutelle internationale sur Haïti, je dis que
le peuple
haïtien est meurtri, le peuple haïtien est
épuisé mais le peuple haïtien est debout
».
[9] Il annonce des aides diverses à la reconstruction du
pays.
Il faut : « reconstruire les édifices publics, les
écoles, les hôpitaux, formation des cadres
administratifs
(40% du personnel n’a pas répondu à
l’appel),
décentraliser le pays ».
Enfin, Dominique Strauss-Kahn, le directeur
général
du Fonds Monétaire International (FMI), lui parle
d’« une aide plus vaste pour la reconstruction
», sur
le modèle du « Plan Marshall »
Les stratégies de reconstruction qui sous-tendent ces
positions
reposent sur les mêmes cadres du projet
néolibéral
que les pays du Nord et les Institutions Financières
Internationales (IFI) cherchent à imposer au pays depuis des
lustres. Les Sommets internationaux programmés tout comme le
Post Disaster Needs Assessment (PDNA) lancé par le
Gouvernement
ne devraient pas accoucher d’idées nouvelles pour
la
reconstruction d’Haïti. Ils doivent aboutir
normalement aux
mêmes formules contenues dans les Programmes
d’Ajustements
structurels (PAS) ou le Consensus de Washington, le Cadre de
Coopération Intérimaire (CCI en 2004) ou sa suite
logique
le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la
réduction de la Pauvreté (DSNCRP, 2007-2010), les
Lois
Hope 1 et 2 en 2008, le Rapport Paul Collier en 2009 et les Accords de
Partenariat Économique (APE) signés en 2010.
L’inventaire des projets pour Haïti pourrait aussi
bien
remonter à l’Initiative pour le Bassin des
Caraïbes
(CBI) de Ronald Reagan ou encore le Plan Américain pour
Haïti savamment analysé par
l’hebdomadaire
haïtien HAÏTI PROGRÈS à la fin
des
années 80.
Tous ces documents et accords ont en commun
d’opérer des
choix qui orientent l’économie du pays vers le
développement de zones franches et du tourisme, la
libéralisation du commerce extérieur, le
dépouillement de l’État des
prérogatives de
régulation et de redistribution des richesses : la
gouvernance,
la décentralisation et la participation du secteur
privé
aux processus de décision font partie des fondamentaux de ce
projet néolibéral.
La vision impérialiste est portée par un ensemble
d’acteurs puissants tissant des liens très forts
derrière un projet de modernisation reposant sur les
formules et
recettes du plan économique
néolibéral. Il
s’agit en effet d’un vieux projet des Etats-Unis
qui
remonte déjà aux années 80.
Malheureusement, il
n’a pas pu prendre pied en raison d’une importante
et
constante contestation populaire et démocratique. Toutefois,
ce
projet a connu des évolutions importantes depuis cette
période : vague de libéralisation en 1983, en
1986, en
1996 et en 2003, MINUSTAH et cadre de coopération
intérimaire (2004), lois Hope 1 et 2 (2007-2008),
stratégie pour la réduction de la
pauvreté
(2007-2010), plan Paul Collier(2009) et occupation militaire pour la
reconstruction en 2010.
Porteuses de cette vision également, la bourgeoisie
haïtienne et une classe politique
désespérée
cherchant à accéder au pouvoir par le truchement
d’une alliance avec l’impérialisme. Le
plan de
sauvetage national est l’illustration la plus
éloquente de
ce projet : il « appelle à une mobilisation
intensive de
la nation, de la diaspora, des bailleurs de fonds internationaux et des
pays amis d’Haïti (...), la construction du pays
représente un défi et pour le peuple
haïtien et pour
l’international ». D’autres voix
nationales
paraissent relayer des déclarations faites par un ensemble
d’acteurs internationaux et se prononcent en faveur
d’un
vaste plan de reconstruction sur le modèle du Plan Marshall
adopté par les États-Unis en 1947 au
bénéfice de l’Europe occidentale
ravagée par
la Seconde guerre Mondiale (1939-1945). D’autres encore
appellent
de leurs vœux la mise sous tutelle du pays puisque
l’État et les gouvernements se sont
effondrés le 12
janvier (Michèle Pierre-Louis dans une interview
accordé
au Figaro, Dumas M. Siméus fait à Ban Ki-Moon des
RECOMMENDATIONS FOR A NEW
‘’GOVERNANCE’’
STRUCTURE TO REBUILD HAITI).
Le projet de reconstruction concerne également la
reconstruction
physique, donc des infrastructures de masse telles que les routes, les
centrales électriques, les systèmes
d’adduction
d’eau potable, les édifices publics, les
écoles,
les hôpitaux etc., ce qui constitue un véritable
marché pour les promoteurs immobiliers et les firmes
d’ingénieries. Il est évident que ce
marché
constitue le butin de guerre pour les américains qui
manifestent
leur volonté de tout accaparer au grand dam de la France (et
des
autres impérialismes canadien ou brésilien) qui
essaie de
se positionner sur la reconstruction de l’État,
plus
particulièrement dans son relogement, la formation de ses
cadres, sa décentralisation et le déplacement des
populations vers le Grand Nord (Gonaïves et
Cap-Haïtien).
Par ailleurs, le projet de reconstruction que veut mettre en
œuvre la « Communauté Internationale
», et
surtout les États-Unis, comporte un volet
géostratégique identique à celui du
containment du
Plan Marshall. En effet, l’approche militariste du Pentagone
participe d’une démarche stratégique
globale
d’endiguement du socialisme cubain et du chavisme. Ainsi, le
débarquement des marines s’inscrit dans cette
dynamique de
remilitarisation de la région latino-américaine
pour
terroriser les peuples en effervescence dans la foulée de
l’Alba, du Banco del Sur, du PetroCaribe etc. Haïti,
en
fait, traine cette tradition de contestation radicale portée
par
la gauche et qui a toujours fait obstacle aux projets
impérialistes. Cette fois-ci, les Etats-Unis ont bien
compris
qu’il faut mettre le paquet pour parvenir à leurs
fins :
« les Etats-Unis vont déployer les moyens de leur
puissance pour reconstruire Haïti », a
déclaré
Obama dans les heures qui ont suivi la catastrophe. Et parmi les
premières mesures qu’il a prises, il y a
l’annonce
de l’envoie d’une expédition militaire
de 20 000
marines qui sont venus s’ajouter aux 7 000 militaires de la
MINUSTAH (2 000 autres sont annoncés par Edmond Mulet)
tandis
que l’Union européenne se prépare
à en
envoyer 11 000.
De plus, les États-Unis plus particulièrement
semblent
tirer les enseignements de leurs échecs
répétés en Haïti dans leurs
tentatives de
modeler le pays sur la base de leurs intérêts
économiques et géostratégiques. Ainsi,
ils ont
bien pris le soin d’associer la tactique militaire
à
l’adhésion d’une frange de la classe
politique :
Dumas M. Siméus (candidat à
l’élection
présidentielle de 2005 débouté par le
Conseil
Electoral pour cause de nationalité américaine)
recommande que les Nations Unies en coopération avec la
communauté internationale, les haïtiens
réformistes
et les haïtiens de la diaspora, étendent leur
rôle
chaque jour et sur le long terme dans la gestion du pays. Il
suggère que l’actuel gouvernement doit
être
remplacé immédiatement par un système
de
gouvernance internationale établi au moins pour les 10
prochaines années. S’inscrit dans la
même logique le
plan stratégique de sauvetage national dont la
rédaction
et le pilotage sont coordonnés par un ensemble de
personnalités issues des principaux partis politiques
recensés dans le pays. On y trouve des
représentants de
l’OPL, des représentants de la FUSION des
Socio-Démocrates Haïtiens, d’anciens
ministres du
pouvoir LAVALAS, des membres du Mouvement pour l’Instauration
de
la Démocratie en Haïti (MIDH) etc. À
rappeler aussi
que le coordonnateur général n’est
autre que
Rudolph Henri Boulos, ancien Sénateur département
du
Nord-Est exclu du Grand Corps en raison de sa nationalité
américaine.
La
stratégie techno-souverainiste - Reconstruire Haïti
sur des
bases modernes et à partir d’un projet national
porté par des haïtiens
Les tenants de cette stratégie s’appuient sur
l’idée de l’effondrement physique
d’un certain
nombre de structures dans le pays, y compris étatiques, et
l’incapacité du gouvernement en place à
apporter
les réponses qu’il faut à la
tragédie
engendrée par le séisme.
Cette stratégie repose sur le constat que le
séisme a
causé l’effondrement de la continuité
et la
légitimité du gouvernement,
l’effondrement de la
souveraineté de l’Etat et l’effondrement
de
l’avenir indépendant d’Haïti.
Il s’agit
donc de reconstruire tout cela : « des communautés
locales
et une nation intégrative, des réseaux de
communication
sociale et des centres de culture, des institutions politiques et la
souveraineté fragilisée de
l’État, en plus
des infrastructures et structures ». Cette nouvelle
société devra être construite par
« le peuple
haïtien unifié, soutenu par la
solidarité
internationale ».
Cette vision à l’origine de laquelle se trouvent
des
intellectuels haïtiens-québécois est
relayée
par la Fondation Haïtienne pour le Développement
Intégral Latino-Américain et Caribéen
(FONHDILAC).
En effet, ces acteurs proposent une vision d’un pays
«
moderne, administrativement et économiquement
décentralisée, politiquement stable et bien
intégrée dans le concert des nations, qui serait
l’exception de la Caraïbe au triple point de vue
politique,
économique et culturel et où il ferait bon vivre
».
La
stratégie démocratique populaire
Construire un pays nouveau fondé sur la
démocratisation
des décisions, la juste répartition des biens
sociaux et
la protection de l’environnement. Cette stratégie
met en
cause le mode d’organisation de
l’économie du pays
et ses externalités sociales et humaines
(inégalités), politiques
(appauvrissement/affaiblissement
de l’État) et environnementales (destruction et
gaspillage
des ressources naturelles).
Pour la stratégie démocratique et populaire, il
ne
s’agit pas de reconstruire ces mêmes rapports
obsolètes mais de construire un autre pays sur des bases
justes
et égalitaires. La voie socialiste, démocratique
et
populaire est celle qui est proposée dans le cadre de cette
construction alternative. Dès lors, le point de
départ de
cette construction réside dans la démocratisation
des
décisions pour permettre à toutes les citoyennes
et tous
les citoyens d’exprimer leurs revendications et leurs
aspirations
dans un pays nouveau libéré de toute domination
et des
injustices de toutes sortes. Cette stratégie
s’ouvre et
s’appuie clairement sur la solidarité des peuples
du monde
entier dans un mouvement global de mutualisation des ressources et des
expériences ou encore d’enrichissement
réciproque.
Elle s’oppose ainsi à l’approche
mercantile des
rapports économiques fondés sur la libre
concurrence, la
marchandisation universelle, l’expansionnisme (colonisation
et
mondialisation, pillage des ressources) au fondement du capitalisme.
Cette alternative est portée et débattue dans des
milieux
d’universitaires, d’organisations de base
(populaires
urbaines, paysannes, de femmes, de jeunes) et d’organisations
cadres d’éducation populaire, de droits humains et
de
développement alternatif.
Notes
:
[1] En 2004, le passage de l’ouragan Jeanne a jeté
le pays
dans une grande désolation avec un bilan de plus 80 000
victimes
dont 3 000 morts : la ville des Gonaïves était
totalement
submergée également. En 2008, le pays est de
nouveau
touché par quatre cyclones successifs causant 800 000
victimes
dont près d’un millier de pertes en vie humaine,
ravageant
la ville de Cabaret tandis que celle des Gonaïves est de
nouveau
totalement submergée par les eaux. Les
dégâts sont
estimés à des centaines de millions de dollars :
infrastructures routières détruites et champs
ravagés.
[2] Trois millions de personnes affectées : pertes en vies
humaines (+220 000 selon les estimations), blessés (+300
000),
de mutilés (+4 000) et de traumatisés (ND),
ampleur des
dégâts (56% du PIB : destruction des
réseaux de
services publics Ed’H, Teleco, SNEP ; destruction des
infrastructures et des entreprises), déplacements de
population
(500 000 vers les provinces), déstabilisation du tissu
social
(deuil et désolation, orphelins, rupture familiale,
départ à l’étranger, perte
de revenus et de
richesses accumulées, litiges et contentieux potentiels),
désorganise l’habitat (225 000 maisons
détruites)
et exacerbation de la fragilité du pays (dramatique
affaiblissement de ses institutions et structures étatiques
et
un accroissement accéléré de sa
dépendance
aux points de vue économique (CCI, DSNCRP, dette), financier
(transferts de la diaspora, dette publique externe), alimentaire et
politique (MINUSTAH).
[3] Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le
système. La logique de l’action collective, Paris,
Seuil,
1977.
[4] Roland Barthes, « Structure du fait divers »,
In Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, pp. 184-197.
[5] Source : http://ocha.unog.ch/fts/reports/dai..., 11 mars 2010,
10:21 AM heure d’Haïti.
[6] Pour une évaluation globale de
l’action/système humanitaire :
http://www.humanrights-geneva.info/...
[7] Barak Obama, “Why Haiti Matters... What America must do
now - and why”,
http://www.newsweek.com/id/231131, 11 mars 2010, 2:35 PM.
[8] Au colloque « Reconstruire Haïti » -
Le Premier
Ministre d’Haïti, Jean-Max Bellerive, dit craindre
que
l’aide humanitaire ne devienne une habitude.
http://www.ledevoir.com/internation...
[9] Sources : Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/, 11 mars 2010
|
|
|
|
|
|
La nouvelle
démagogie en Amérique Latine
|

Álvaro Cuadra (*), 7 juin 2010
Le
triomphe de Juan Manuel Santos au premier tour des élections
colombiennes met en évidence le déploiement de la
nouvelle démagogie latino-américaine, cette fois,
en tant
que discours de l’aile droite. Comme au Chili de
Piñera,
Santos, membre d’une famille nantie et ex-ministre de la
Défense de l’actuel président Uribe,
promet un
gouvernement d’unité nationale qui garantit la
sécurité démocratique.
La figure de Santos est liée à sa lutte contre
les FARC,
en fait les coups les plus spectaculaires lui sont attribués
contre le groupe de guerilleros. Comme l’actuel
président
chilien, il possède une solide formation
économique aux
États-Unis. La promesse des politiciens de l’aile
droite
dans plusieurs pays latino-américains est la même
: la
baisse de la pauvreté et de la création
d’emploi
à travers une modernisation
accélérée de
nature néolibérale.
La démagogie de droite réussit à
séduire
les masses d’électorales avec de rusées
promesses
de bien-être, spécialement destinées
à la
classe moyenne. Les arguments sont simples : une poigne de fer
utilisant la force militaire ou policière pour combattre la
délinquance ou les groupes de guerillas et, en
même temps,
la création de beaucoup de postes grâce
à la
croissance économique. De cette façon,
l’avenir
pacifique et prospère de nos nations reste résolu
par une
équation simple qui mélange répression
et
séduction.
Il est intéressant de remarquer comment ce type de discours,
répété jusqu’à
satiété
par les médias, a balayé de
l’imaginaire social
latino-américain ces drapeaux de lutte qui imploraient une
réelle justice sociale, une redistribution des richessses,
le
respect des Droits de l’Homme et un rôle
prépondérant de l’État face
aux grandes
entreprises nationales et étrangères.
Jusqu’à présent l’assaut
démagogique
de la droite latino-américaine n’a
donné des
résultats qu’au Chili et en Colombie.
Les gouvernements de droite arrivent au pouvoir avec l’appui
explicite du patronnat, mais avec en plus l’appui implicite
d’autres pouvoirs factuels comme les militaires. De sorte que
l’accord de sécurité
démocratique est en
fait l’instauration d’une démocratie de
sécurité nationale, un projet politique et social
en
continuité avec les thèses utilisées
par les
militaires latino-américains durant les année 80.
Il est probable que la même formule soit essayée
dans
d’autres pays de la région, en constituant un axe
continental s’opposant aux gouvernements de gauche, comme
c’est le cas de la Bolivie, du Venezuela et de
l’Équateur, parmis d’autres. Dans un
avenir
immédiat, la réalité de
l’Amérique
latine apparaît scindée entre deux grands
pôles
orientant la politique régionale. Une
réalité qui,
en dehors des doutes qu’elle véhicule, complique
les
processus d’intégration et défini une
nouvelle
scène pour la première décennie de ce
siècle.
Notes
(*) Chercheur et enseignant à l’École
Latino-américaine de Postgrades [1] ELAP,
Université
ARCIS.
[1] Postgrades : niveau d’études du
troisième cycle universitaire
Source : El Clarín,
traduction
de Primitivi
|
|
|
|
|
| Colombie - Chagas, une
maladie qui tue en silence |

Médecins Sans Frontières, 2 juin 2010
Angela
vit à Genareros, une communauté
indigène de l’Arauca, en Colombie. En
avril 2010, deux de ses sept enfants ont achevé leur
traitement contre
la maladie de Chagas, une infection transmise par un insecte qui
prolifère notamment dans les maisons en torchis des zones
rurales. Mais
alors que les jeunes Yosney et Maryeli fêtaient la fin de
leur
traitement, Angela s’est rendue compte que deux autres de ses
enfants
étaient aussi infectés.
La maladie de Chagas est endémique dans
la plupart des pays d’Amérique latine.
L’Arauca est l’une des régions
de Colombie les plus touchées par la maladie. Cette
dernière est
provoquée par le trypanosoma cruzi, un parasite transmis
essentiellement par la réduve, un insecte qui se nourrit de
sang. En
Colombie, cet insecte est connu sous le nom de « pito
». Les personnes
infectées ne développent parfois les
symptômes de la maladie qu’au bout
de plusieurs années. Toutefois, sans traitement, la maladie
de Chagas
peut provoquer de graves problèmes de santé,
essentiellement des
complications cardiaques et intestinales, parfois mortelles.
Intégrer la lutte contre la maladie de Chagas dans les
services de soins de santé primaires
Fin
2009, MSF avait intégré le dépistage
et le traitement de la maladie
dans ses services de soins de santé primaires
déjà assurés par ses
dispensaires mobiles dans l’Arauca, une région en
conflit, voisine du
Venezuela. C’est la première fois que MSF propose
un traitement contre
cette maladie dans une zone de conflit. « Proposer un tel
traitement
est un véritable défi. Il exige en effet un suivi
permanent sur une
période de deux mois. S’ajoute à cela
le risque de ne pas pouvoir
rejoindre telle ou telle communauté en raison de
l’insécurité, ou parce
qu’un groupe armé bloque certaines routes dans la
région, » explique
Patrick Swartenbroekx, coordinateur de terrain pour MSF dans
l’Arauca.
Genareros
est la première communauté à avoir
bénéficié d’un
dépistage de la
maladie. C’est là qu’habitent Angela et
ses sept enfants. Sur les 97
échantillons sanguins prélevés sur des
enfants âgés de neuf mois à 18
ans, 11 se sont révélés positifs.
« Nous avons été surpris par la
prévalence élevée de la maladie
à Genareros. Heureusement, nous n’avons
pas enregistré une prévalence aussi importante
dans les autres
communautés visitées », explique le Dr
Rafael Herazo, référent médical
pour le projet de MSF à Arauca.
Soixante
jours de traitement pour guérir une maladie silencieuse et
négligée
A
ce jour, l’équipe MSF à Arauca a
prélevé 1 617 échantillons de sang
dans 10 communautés et analysé 514
prélèvements en laboratoire. Ces
analyses ont mis en évidence qu’une personne sur
28 était infectée. Les
patients dont la maladie a été
confirmée font l’objet d’un examen
médical complet avant l’administration du
traitement qui durera deux
mois. Cette procédure est nécessaire car il faut
déterminer si les
patients ont déjà développé
la maladie. « L’existence d’une grave
complication cardiaque par exemple indique que le malade ne
répondra
vraisemblablement pas au traitement, » explique le Dr Herazo.
Pendant
cette phase de traitement, l’équipe de MSF
s’est rendue à Genareros une
fois par semaine. Les effets secondaires étant
fréquents, il est
essentiel d’assurer le suivi des patients et de les
encourager à ne pas
abandonner leur traitement. « Les gens nous disent en effet :
« Mon
enfant allait bien et puis, vous lui avez donné ces
médicaments qui
provoquent des démangeaisons, des douleurs dans les
jambes... » Autant
de raisons pour lesquelles les acteurs de santé rendent
visite aux
patients et à leur famille, afin de les sensibiliser au fait
que la
maladie de Chagas tue en silence. Ils insistent sur
l’importance du
suivi du traitement et sur le caractère transitoire des
effets
secondaires. Si le traitement est interrompu, l’enfant risque
de
développer ultérieurement de graves complications
cardiaques : il ne
pourra peut-être plus travailler dans les champs ni marcher.
Il se
fatiguera facilement et risque de mourir de la maladie, »
explique le
Dr Herazo.
Alors
que les onze premiers enfants viennent de terminer leur traitement,
d’autres difficultés subsistent
En
avril 2010, les onze enfants de Genareros souffrant de la maladie ont
terminé leur traitement avec succès. Dans un an,
Yosney et Maryeli
devront subir un autre test afin de confirmer leur guérison.
Une
réinfection est toutefois à craindre
étant donné que ces « anciens
»
malades continuent à vivre dans des maisons où
les pitos prolifèrent, à
Genareros et dans d’autres communautés de
l’Arauca.
MSF fait
ainsi pression sur les autorités de la santé de
l’Arauca afin qu’elles
assurent la vaporisation régulière
d’insecticides. Il s’agit là
d’une
mesure essentielle qui permet de réduire la transmission de
la maladie
et de prévenir les réinfections. « Ces
soixante jours de traitement,
tout ce travail de sensibilisation, ces effets secondaires à
surmonter
et ces visites aux communautés n’auront servi
à rien si les habitations
continuent à abriter des pitos qui vont
réinfecter les habitants. Nous
faisons pression sur les autorités de santé pour
obtenir un
renforcement des mesures sanitaires et pour leur montrer
qu’un
traitement peut être mis en place », conclut le Dr
Herazo.
En savoir plus
à propos de cette maladie négligée sur
le site de
l’initiative Médicaments contre les Maladies
Négligées (DNDi)
|
|
|
|
|
|
| Colombie
: Le Four Des Paramilitaires ... |
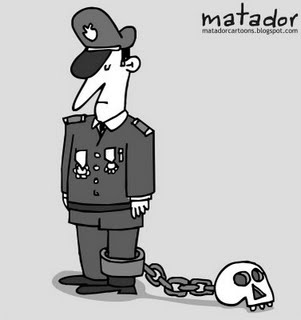 par
Verdrad abierta, 18 mai 2010
par
Verdrad abierta, 18 mai 2010
Un ex-paramilitaire a avoué qu’au moins un four
crématoire a été utilisé
dans la
vallée d’Aburrá. Il servait aux
Auto-défenses Unies de la Colombie (AUC) à se
débarrasser de leurs victimes, mortes ou ...vivantes.
Voici les différents choses à propos de ce four
qu’a indiqué l’ex-paramilitaires aux
officiers de
justice rattachés au programme Justicia y Paz, proprement
hallucinant.
Mais est-ce si étonnant : La France et la Bataille
d’Alger, les USA avec l’École des
Dictateurs
(toujours en fonction), Abou Grahib, et les différents
massacres
et tortures du 20° et du tout jeune 21°
siècle ? Ce dont
il faut également s’inquiéter
c’est
certainement la généralisation globale de la
suspicion
envers des populations supposées "subversives"
là-bas,
ici ou ailleurs.
Ils incinéraient certaines de leurs victimes vivantes : Les
paramilitaires avaient aussi des fours crématoires
à
Antioquia par Verdad abierta
Les paramilitaires ont mis en pratique la systématisation de
l’horreur dans différentes régions de
Colombie.
Pour la première fois, un ex-paramilitaire se
réfère à l’usage de ce
mécanisme de
disparition forcée dans la Vallée
d’Aburrá.
Le Ministère public fait des recherches sur la base de son
témoignage et on s’attend à ce que les
autres
paramilitaires apportent plus d’information.
A la fin des années 90 l’ordre des commandants des
Auto-défenses Unies de la Colombie (AUC) était de
faire
disparaître leurs ennemis "de toutes les façons",
pour ne
pas laisser de traces et ainsi éviter que les chiffres des
homicides ne croissent de manière
disproportionnée dans
les zones urbaines, a donné lieu eu à
Medellín et
dans l’aire métropolitaine l’une des
plus cruelles
expressions de la guerre paramilitaire : l’utilisation de
fours
crématoires.
On a des références sur l’existence de
ce macabre
mécanisme au Nord de Santander. Les paramilitaires des AUC
qui
ont opéré dans cette région du pays,
parmi ceux-ci
Iván Laverde Zapata surnommé
‘l’iguane’, ont avoué devant
les procureurs de
l’Unité Nationale pour la Justice et la Paix que
dans des
zones rurales du corregimiento Juan Frío, de Ville du
Chapelet,
et le Port Santander, des fours crématoires se sont
été construite pour incinérer ses
victimes.
A Medellín le sujet des fours crématoires des AUC
ne
passait plus pour une rumeur depuis plusieurs années. Dans
le
monde de la criminalité on disait avec insistance que les
paramilitaires emportaient les gens et “qu’ils les
brûlaient” pour les faire disparaître,
mais personne
n’offrait d’information précise qui
permettait de
valider ou de démentir ce fait.
Cependant, la réalité gagne du terrain sur la
rumeur
grâce à l’engagement de plusieurs
enquêteurs
judiciaires assignés du programme pour la Justice et la Paix
qui
enquête à ce propos depuis plusieurs mois.
Aujourd’hui ils ont des données
concrètes, bien que
partielles qui les ammènent à constater que oui
cette
pratique de disparition forcée a bien existé,
mais comme
ils l’admettent eux-mêmes, il manque encore des
informations.
Les premières données qui
révèlent cette
réalité sont apportées depuis quelques
mois par un
ex-paramilitaire qui a décidé de collaborer avec
la
justice. Verdadabierta.com a eu un accès à
quelques
apartés des témoignages reçus par les
fonctionnaires judiciaires, au travers desquels il est possible de
mesurer l’extrême cruauté à
laquelle en sont
venus les groupes armés illégaux
d’extrême
droite à Medellín, dans plusieurs
municipalités de
la zone métropolitaine et dans l’Orient
d’Antioquia.
Verdadabierta.com réserve l’identité de
l’ex-paramilitaire qui a apporte son témoignage
pour
participer à la vérité de ce qui
s’est
passé dans la capitale Antioquiaña et dans les
municipalités voisines durant l’arrivée
et
l’installation des blocs paramilitaires des AUC.
“Il y a beaucoup de morts qui n’ont pas
été
pas retrouvés parce qu’ici à
Medellín, aux
environs, à une heure, se trouvaient plusieurs fours
crématoires. Il y a eu beaucoup de gens
brûlés.
J’ai été témoin de ces
faits", a
avoué aux enquêteurs l’ex-paramilitaire.
Selon ses dires, entre les années 1995 et 1997, les
paramilitaires retenaient leurs victimes, les tuaient et plusieurs
d’elles ont été jetées dans
la
rivière Cauca, côté sud-ouest
Antioquiaño.
“Les corps étaient ouverts, on y mettait des
pierrres et
on les jetait dans la rivière. En plusieurs des AUC sont
tombés lançant des morts”.
À ce problème s’est ajouté
l’augmentation du nombre d’homicides dans les
municipalités de la Vallée
d’Aburrá en
grande partie et dans d’autres également,
où les
paramilitaires étaient entrain de combattre la subversion.
Durant ces année l’État-Major des AUC a
été dirigé par Carlos
Castaño Gil, qui
avait donné l’ordre de faire disparaître
les
victimes. C’est ainsi qu’a surgi
l’idée de
construire un four crématoire :
“L’idée du
four a été donnée par
‘Doblecero‘ et
Daniel Mejía l’a
matérialisée”.
Durant ces années, Mauricio García,
surnommé
‘Doblecero‘, était le commandant du Bloc
Mètre et Daniel Alberto Mejía Ángel,
surnommé ‘Danielito‘,
s’était
intégré aux blocs Cacique Nutibara, la faction
des AUC
qui a été sous le commandement de Diego Fernando
Murillo
Bejarano, surnommé ‘don Berna‘.
“Daniel Mejía s’est chargé de
la
construction, il était des AUC et du Bureau
d’Envigado”, a dit l’ex-paramilitaire.
“J’ai entendu que le four coûtait entre
200 et 500
’bâtons’ (millions) et ils
l’ont
étrenné avec un type du nom d’Alberto
du Bureau
d’Envigado. Ils l’ont jeté vivant parce
qu’il
avait volé de l’argent. Le four était
manipuler par
un monsieur, qu’ils appelèrent ‘pompe
funèbre‘, je crois qu’il
s’appelle Ricardo,
deux autres hommes lui faisaient la maintenance des grils et des
cheminées, parce qu’elles se couvraient de suie
humaine”.
Sur sa situation, le paramilitaire indique qu’il
était
dans une propriété de la municipalité
de Caldas,
au sud de la Vallée d’Aburrá.
“Il faut passer
le centre ville. A une demi-heure de la sorte de Caldas en voiture. Il
est situé dans une très grande
propriété,
à cette époque, l’entrée
était une
porte blanche”.
Dans la propriété, l’ex-paramilitaire a
décrit avec détails l’immeuble :
“la
première maison en noire et tout de suite après
la maison
il y avait comme une espèce de dépôt,
et encore
derrière, à environ 70 ou 80 mètres,
fonctionnait
ce qui ressemblait à une fabrique de briques. Deux
cheminées étaient visibles dans le toit. Dans
l’entrée il y avait un premier étage
avec
antejardín bien orné et de là
à une main
droite on descandait environ cinq mètres par des
échelles, est on arrivait enfin à ce qui
ressemblait
à un grand four de boulangerie industrielle”.
Sur le four en tant que tel le repenti détaille :
“la
porte était hermétique, elle se fermait et
restait
incrustée dans le cadre de mur, il y avait des vitres
très épaisses, comme blindées. La
partie
extérieure disposait de trois boutons, d’un bouton
rouge
pour allumer et les deux autres pour la température.
À
l’intérieur, le four était
métallique et
avait comme une espèce de mesón(?) ferme, avait
des
résistances, les unes en dessous de la mesón,
comme une
espèce de grils. Des chaques côtés de
la
mesón il y avait aussi des résistances. Au fond
de la
pièce il y avait deux ventilateurs. Ils nous disaient que
nous
ne pouvions pas fumer là. Ca sentait comme un petit piment
brûlé. Dans le four tenait une seule personne. Les
corps
étaient accrochés à la
mesón. Quand ils
montaient la température les corps gonflaient. Beaucoup de
gens
mouraient avant d’entrer dans le four".
Selon ses calculs, dans la semaine entre 10 et 20 personnes
étaient conduites là. Et il existait
procédé pour cela : “quand nous
arrivions avec les
personnes, mortes ou vivantes, nous frappions à la porte et
ils
nous disaient ‘ces insumos(?) portez-les au fond’.
Nous
jusqu’à l’intérieur, nous les
portions dans
des sacs pour qu’ils ne laissent pas de sang. Nous les
saignions.
On nous a demandé : ‘qui est-ce qui
contrôle cela
?’. ‘J‘ et Daniel commandaient beaucoup.
Ils avaient
un dossier où ils notaient tout. Celui qu’il
notait
était un homme d’environ 45 ans, bas,
cejón. Nous
entrions et nous devions attendre les cendres. Le
procédé
prenait comme 20 minutes, mais quand il était
allumé
c’était comme cinq minutes. Après nous
les
montrions ‘J‘ ou Daniel, et ensuite nous les
jetions
à la rivière ou où ils
disaient”.
Face aux enquêteurs judiciaires il n’a pas
nié sa
participation a plusieurs de ces ’corvées de
bois’.
“Certains je les ai mis mort et d’autres je les ai
amenés vifs. J’ai porté plus de
cinquante morts et
plus de quinze vivants”.
Parmi les victimes dont il se rappelle on trouve deux frères
de
la famille Vanegas, éleveurs de profession, qui ont
été retenus dans le secteur de
Bethléem, au
sud-ouest de Medellín, par ordre de Daniel Mejía.
Selon
les paramilitaires, ces hommes ont été
assassinés
parce qu’ils finançaient un front du groupe de
guerilleros
des Farc. Avec leur mort dans le four crématoire, ce dernier
s’est mis à fonctionner pour toute sorte de
personnes,
puisque selon le récit de l’ex-paramilitaire,
jusqu’à ce moment là il
n’était
utilisé que pour “des
personnalités”.
L’autre personne dont il se rappelle et qui a
été
incinéré là est le narcotrafiquant
Julio Cesar
Correa Valdés, connu dans le monde de la mafia comme Julio
Fierro et époux du modèle Natalia Paris. Son
décès s’est produit, selon le
témoignage de
cet ex-paramilitaire, à la fin d’août
2001. Selon
les récits journalistiques de cette année, ce
narcotrafiquant était en négociation avec la DEA
pour se
soumettre à la justice des États-Unis et pour
collaborer
comme informateur afin d’obtenir quelques
bénéfices
juridiques.
“Ils ont appris cela à Antioquia, alors Salvatore
Mancuso,
Carlos Castaño et Daniel Mejía se sont
réunis.
Castaño a ordonné qu’ils prennent Julio
Fierro.
Quelques hommes de Daniel l’ont retenu dans la
municipalité de Guarne. Ordre était
donné
qu’ils ne le tuent pas. De Guarne ils l’ont
ammené
en hélicoptère jusqu’à
Córdoba,
où était Carlos Castaño. Ils voulaient
lui prendre
quelques propriétés. Natalia Paris a aussi
voyagé
par là-bas parce qu’ils voulaient
également lui
prendre quelques propriétés qui
étaient à
son nom. Julio ils l’ont emmené à
Medellín
dans un hélicoptère, pour lui faire la
extinción
de dominio(?), après ils l’ont tué et
ils ont
porté le corps au four”.
Le plus paradoxal du récit de l’ex-paramilitaire
est
qu’il offre une version qui pourrait éclaircir ce
qui est
arrivé avec le surnommé
‘Danielito‘, disparu
depuis le 25 novembre 2006, deux semaines après avoir
abandonné le centre de réclusion de La Ceja
à
Antioquia, où étaient détenus les
chefs des AUC.
Il était sortie là parce qu’il
n’aucune
charge ne pesait contre.
“Il a été victime de sa propre
invention”, a
déclaré l’ex-paramilitaire aux
officiers
judiciaires. “Dans ce four ils ont fait disparaître
Daniel
avec dix de ses hommes”. Une nuit un ami m’a
appelé
et m’a dit ‘il a été
avalé, Daniel, le
patron’, et je n’ai jamais plus rien su de lui. Je
ne sais
pas non plus ce qui s’est passé avec ce four
après”.
Les enquêteurs sociaux de l’Université
d’Antioquia qui travaillent sur ce type de
phénomènes criminels et qui ont
sollicité la
réserve de la source, ont indiqué que
l’existence
de fours crématoires au Nord de Santander et à
Antioquia
met en évidence qu’il s’agit
d’une
façon “d’industrialiser le
crime”. Il y avait
un ordre qui venait d’en haut “faire
disparaître les
victimes à tout prix” et dans ce sens
c’est
là qu’on voit apparaitre les cas de
démembrements,
les fosses, les rivières et les fours comme techniques
efficaces
pour en finir avec celui qui est appelé "ennemi".
Ce que révèle ce type de criminalité,
ajoutent les
enquêteurs sociaux, c’est son caractère
systématique et sélectif, “ce qui veut
dire que
toute cette criminalité a été
planifiée,
puisqu’on ne peut pas perdre de vue que les paramilitaires
ont
été préparés dans des
écoles
où l’on formait les combattants à
différentes activités. Là ils les
transformaient
en machines de guerre” grâce à une
division interne
du travail, spécifiée par des techniques
criminelles.
Le Ministère public espère que les autres
ex-paramilitaires, qui ont déjà
postulés aux
avantages de collaborer avec le programme Justice et Paix,
qu’ils
soient emprisonnés ou encore libres, contribuent
d’eux-même à donner encore plus de
détails
sur ce type de disparition forcée, pour finalement non
seulement
pour établir la situation exacte du four
crématoire, mais
aussi pour identifier les victimes qui ont été
conduites
à cette macabre machine de mort.
Source : Verdad abierta
"Los
’paras’ también tenían
crematorios en Antioquia"
|
|
|
|
|
|
Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
|
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui est donc AM ? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 31/12/2010 |
|
|
|
|
| |