|

|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
VENEZUELA, une fin d'année difficile...
1 - Chronique d’une défaite annoncée ou les ratés d’Hugo Chavez?
2 - La démocratie vénézuélienne n'est pas en danger,
& Penser l'après Chavez, Benito Perez
3 - Le Venezuela à l’épreuve du socialisme ?
4 - Bourbons d’Espagne et vérités difficiles à entendre
5 - Petits calculs pétroliers, Jean-Luc Crucifix
6 - L’économie vénézuélienne sous Chavez, Luis Sandoval et Mark Weisbrot
|
|
Amérique
Latine
archives
des articles 2007
Sommaire
: 4ème partie

|
|
|
|
|
Chronique
d’une défaite
annoncée... ou
les
ratés
d’Hugo Chavez ?
Lionel Mesnard, le 6
décembre 2007
|
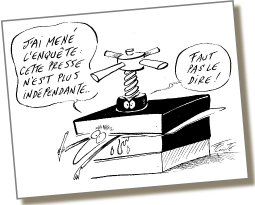 |
L’ampleur
de la désinformation est un élément
inquiétant pour les démocraties. C’est
une
véritable lame de fond et elle emporte tout
équilibre de
la pensée. L’exemple
vénézuélien est
à ce titre à la fois rageant et
révélateur.
Rageant, parce que tout citoyen a droit à une information au
plus fiable et qu’en ce domaine il y a formatage des esprits.
Révélateur en raison des nouveaux
équilibres
politiques du monde et d’une presse vide de toute analyse.
Toutefois des plumes tentent de mettre un peu de raison, elles ne sont
pas nombreuses. Ce qui domine ce sont des attaques sans fondements.
Elles partent généralement de
l’opposition la plus
radicale et atterrissent comme par enchantement dans les
médias
francophones, et plus exactement à
l’échelle
planétaire.
Le
phénomène interroge
fortement, même si il est à pondérer
selon les
pays, en France nous avons un problème épineux.
C’est un cancer pour la démocratie dont on
commence
à mesurer les dangers. Car si je prends certains arguments
concernant Hugo Chavez, je pourrais affirmer que nous vivons dans
l’hexagone dans «une dictature»
(concentration des
pouvoirs économiques, médiatiques et politiques).
Si nous
faisions une comparaison des deux constitutions, la nôtre ne
dispose pas de réels contre-pouvoirs et ne
délègue
pas grand-chose en matière de responsabilité
citoyenne
autre qu’un bulletin de vote. Le protagonisme est une
donnée absente, et les embryons de pouvoirs citoyens comme
les
conseils ou comités de quartier sont entièrement
contrôlés par les élus. De plus nous
avons un
ministère de l’immigration qui organise la chasse
aux
faciès et tente d’éthniciser le peuple
français, normalement la République
«est une et
indivisible».
À
regarder de près la cinquième
République du
Venezuela s’est empreint de certains mécanismes
propres
aux institutions françaises, à pas mal de ses
références. Si l’on reprend certaines
terminologies
administratives, on peut y voir des similitudes, mais le
cœur du pacte entre la nation et son peuple ne sont
certainement
pas aussi monarchiques que les nôtres. Chavez
n’est
pas bolivarien par hasard et préfère pour des
raisons
évidentes un système centralisé.
L’histoire
du Venezuela sait à quoi a abouti la
régionalisation,
c’est-à-dire construire des petits
états
concurrents avec des potentats à leur tête. Il a
choisi
par exemple de déléguer du pouvoir aux structures
de
base, pour faire en sorte que les financements arrivent où
ils
sont nécessaires et n’atterrissent pas dans les
poches de
quelques élus, oligarques ou fonctionnaires
véreux.
Je
ne vois pas vraiment pour Hugo Chavez une grande catastrophe avec
l’échec du oui à la modification de la
constitution, un raté tout au plus, comme fut sa tentative
de
présenter son pays au Conseil de
Sécurité de
l’ONU en 2006. En réalité
c’est une
preuve de plus des forces vives et démocratiques, et de ce
que
chaque journaliste souhaiterait faire de ce pays. Dans 95% des articles
soit tout est noir, soit tout est tout blanc, en
réalité
tout est gris. Dans le cas du scrutin
référendaire du 2
décembre, Hugo Chavez a fait peur à son aile
«sociale-démocrate» prise en tenaille
entre les
ultras des
2 camps. Si les arguments de l’organisation
PODEMOS avaient
pu être un peu moins méprisé et pris en
compte, et
ses représentants dénoncés comme des
«traites», il n’aurait pas
manqué au final
entre 130.000 voix et 200.000 voix (pour un peu plus de 9 millions de
votants).
Les défis à
ne plus contourner
La
quatrième République n’a jamais pu
vraiment
construire un état de droit, la nation
vénézuélienne malgré cette
évidence
est restée engluée face aux questions de
corruption,
faute d’une justice efficace. J’ai
entendu sur place
des inepties du genre, «il faut faire deux ou trois
exemples». Car beaucoup savent qui vit grassement du
détournement
des richesses du pays, ou qui sont, les élus, les
fonctionnaires et entrepreneurs
ne respectant pas la légalité. Selon un bon vieux
proverbe français, il n’y a pas de feu sans
fumée. La
justice doit pouvoir s’exercer face à tous les
délits, sinon c’est comme un instrument au service
d’une justice de classe, et ce sont les milieux populaires
qui en
paient la plus lourde charge. La loi est une colonne
vertébrale
et si elle s’affaisse le corps social dans son entier en est
victime. À Cela, on peut y joindre la question douloureuse
de la
violence, qui se trouve également en rapport avec le
deuxième défi de Chavez. Son premier
défi est de
s’attaquer aux fondements d’un état de
droit social,
la loi doit s’appliquer pour tous et sans exception.
Le
deuxième défi, réside à
savoir changer le
monde urbain et en particulier le devenir de Caracas (cela va de
concert pour d’autres métropoles du
pays). Sa
croissance est de 200.000 habitants supplémentaires par an.
À ce rythme, les caraquéens feront face
à des
déséquilibres sans cesse croissants, en raison
notamment
de la concentration des pouvoirs économiques et politiques,
facteurs évidents d’un afflux de nouveaux
habitants en
quête de travail. Paradoxalement elle est moins
bien
dotée ou soutenue que le monde rural, c’est une
des
capitales dans le monde disposant d'une des densités les
plus
faibles par habitant. Avec une augmentation de 20.000 voitures par an
en 2006, elle
est particulièrement anxiogène,
polluée et
consacrée plus à la circulation automobile,
qu’au
déplacement du piéton. La pollution sonore y
atteint des
records, les services publics de l’entretien sont trop
souvent
défaillants, et, en certains lieux, cela croule sous les
déchets, et l’eau et le gaz font
défaut, quand les
terrains ne s’affaissent pas en période de grosses
intempéries.
C’est au
cœur du quotidien
qu’il faut (ré)engager la révolution.
Il importe de
combattre
toutes ces petites et grosses injustices qui au final pèsent
lourd. La violence se conjugue sous diverses formes et
Caracas
encore pour exemple détient un triste record celui
d’être la troisième ville la plus en
proie à
la criminalité sur le sous-continent américain,
après Sao Paolo et Rio au Brésil. Sachant que la
criminalité sur le continent est sans nul rapport avec ce
que
nous connaissons en Europe (de l’ordre de un à
seize si
l’on établit une échelle de la violence
d’un
continent à l’autre).
Plus
d’une centaine
d’homicides, à Caracas, en fin de semaine
n’a rien
d’exceptionnel en période de fêtes.
L’alcool
et la circulation des armes sont des éléments
importants,
tout comme des systèmes mafieux agissants en particulier
dans
les régions. La réforme des polices est un sujet
brûlant mais essentiel. Une fois de plus c’est un
reste de
l’ancien président Carlos Andres-Perez, qui a eu
pour
idée géniale de supprimer la police nationale,
créant ainsi de multiples polices. Ces polices sont un des
rouages les plus corrompus au Venezuela et il est temps d’y
mettre une énergie certaine à
réformer de fond
en comble.
Socialisme un débat
ouvert et à ne pas clore
Pour
ce qui est du socialisme, le débat s’ouvre, et il
doit
vraiment tenir compte des erreurs commises au 20ème
siècle mais aussi tenir compte des résistances
actuelles.
Ce qui n’empêche nullement de procéder
à des
réformes comme la réduction du temps de travail.
Il
manque là aussi une construction, qui procède
à
penser la réduction du temps de travail en rapport avec
l’évolution de la productivité, et
aussi de
procéder à des aménagements selon les
besoins de
la production (lire André
Gorz ou se
référer au
travail de Dominique Taddéi sur ces questions). La
couverture
sociale universelle est aussi à mettre en œuvre,
cette
réforme serait un grand pas vers un grand service public de
sécurité sociale. Il y a de quoi largement
rassurer les
petites classes moyennes, les voix qui ont manqué le
soir
du 2 Décembre.
Mais le
socialisme demande une
élaboration idéologique, et point primordial une
réflexion sur le pouvoir. Oui certes, il y a Marx, mais pas
seulement, le vingtième siècle a
été
façonné par quelques grandes intelligences.
Freud,
Einstein, Gandhi, Mandela comme figures universelles ont
contribué à penser le monde en d’autres
termes.
À Chavez de savoir ce qu’il veut laisser
à
l’histoire de notre humanité présente
et fuure. Il
ne sera jamais le socialisme à lui tout seul et ne doit pas
reproduire certains travers. Soit il évolue comme il a su
faire
à plusieurs fois, soit il recommencera les mêmes
erreurs
et dans ce cas en 2013, il ne restera que des larmes sur nombre
d’illusions à ses partisans.
Le
pouvoir
n’est pas une fin en soit, et il temps de tenir compte des
erreurs et se soucier un peu moins des apparences mais plus du fond.
Chavez, tout comme Sarkozy, Uribe, Bush, Poutine abusent de la
société du spectacle. Et ce système
qui condamne
l’intelligence critique à de quoi nous
inquiéter.
Moins de causerie s’impose, et le Venezuela aura toutes les
chances de voir son «Phénix renaître de
ses
cendres». Il reste cinq années de plein exercice
pour
consolider les réformes et construire un appareil productif
au
niveau des nations occidentales. Et engager cela va de soit les
perspectives d’une société alternative
face au
modèle économique dominant.
Il
n’y a pas
vraiment de quoi chômer, sauf à remettre de
l’humain
dans la machine sans le broyer. Hugo Chavez a su conquérir
les
plus déshérités parce que son travail
a
consisté à répondre au quotidien des
gens.
Aujourd’hui, il doit se soucier de leur
émancipation. Il
peut servir d’exemple et susciter à ce que tout le
monde
prenne part efficacement aux changements. Je sais que le terme
n’est plus vraiment de vogue, mais le socialisme a
laissé
une belle idée. L’autogestion fait appel
à la
responsabilisation de tous, à ce que nous soyons plus
dépendant uniquement des pouvoirs centraux ou
bureaucratiques. Cette direction est la seule
crédible
quitte à passer pour un gauchiste
arriéré.
C’est totalement à contre courant, mais
à force de
s’en remettre à un sauveur suprême on en
connaît l’issue.
Même
si je m’accroche
à une perception peu optimiste, je garde un léger
espoir.
Il serait temps d’ouvrir les yeux et sortir un peu de nos
nuages,
ou de faire de la politique pas comme tout le monde. La politique est
une chose trop sérieuse pour la laisser à nos
seuls
élus, le fonctionnement du politique est en cause. Je ne
peux
expliquer en quelques lignes une conception économique qui
met
l’Homme au centre des enjeux, car se profile des
transformations
écologiques plus que menaçantes et qui prendront
effet
plus rapidement que prévu. Nous devons inventer ou nouvel
art de
vivre ensemble et dépasser certaines impulsions. Ras le bol
de
ces théories comploteuses, nous sommes en
présence de
mécanismes d’une très grande
complexité,
«des systèmes observables» pour
simplifier. Le
simplisme n’est pas de mise, mais je ne vois toujours pas
poindre
un vrai débat entre le monde des sciences et le politique,
autre
que celui de favoriser les armées et armements de la
planète, voire le marketing...
Le
prisme culturel me
questionne, il en dit beaucoup mais il ne répond
à rien,
il fragmente au lieu de rassembler l’Homme en une
humanité
pensante. Peut-être est-ce un nouvel humanisme que certains
cherchent à penser? Il n’y a pas
d’homme
nouveau à présumer et le terreau philosophique
n’est pas d’une très grande
fiabilité. Du
marxisme en fait, il ne reste plus grand-chose, sauf une bouillie.
Définir un nouveau socialisme passe néanmoins
à
travers une analyse historique, une critique du capital et des
phénomènes religieux et la prise en compte des
aspirations sociales à un mieux être.
Mais
c’est insuffisant pour comprendre les blocages, en
particulier les conséquences de l’inhibition
de l’action.
Oui nous aspirons tous aux bonheurs, mais oublions à quelle
économie nous répondons. Finalement, peu
importe
le lieu
de la planète, c’est un défi de
l’altérité au service de
l’intelligence
critique qui s’offre à nous. De nos erreurs
essayons
d’en faire une force et c’est ainsi que tous nous
nous
relevons de nos échecs.
|
|
|
|
|
|
Venezuela: penser l'après-Chávez
*
La démocratie
vénézuélienne n'est pas en
danger
2 articles de
Benito Perez, 4/12 et 30/11/ 2007
|
|
 |
|
|
|
Venezuela: penser
l'après-Chávez : Pari perdu
pour Hugo Chávez. La réforme constitutionnelle
voulue par le
président vénézuélien a
été rejetée dimanche de justesse par
le peuple.
Le choc est rude, après neuf années de faciles
victoires électorales. A
peine un an après sa réélection
jusqu'en janvier 2013, Hugo Chávez
avait choisi de rejouer son va-tout dans les urnes. Disposant d'une
écrasante majorité au Parlement, le
président aurait pu avancer
gentiment – de loi en loi – vers son
modèle de socialisme démocratique
«du XXIe siècle». Mais s'attendre
à une telle stratégie, c'était
méconnaître le personnage, ses ambitions
politiques et l'idée qu'il se
fait d'une fonction présidentielle organiquement
liée au peuple.
Dans
un vaste «paquet» constitutionnel, Hugo
Chávez avait rassemblé une
série de mesures qui visaient autant à
institutionnaliser son bilan
passé («Missions»[1],
nationalisations, coopérativisme) qu'à mener de
nouveaux projets
ambitieux, tels que l'instauration d'une protection sociale universelle
ou l'obligation pour l'Etat d'assurer la sécurité
alimentaire. La
réforme prévoyait en outre de diffuser le pouvoir
à la base – les
Conseils communaux participatifs – et,
parallèlement, de renforcer les
prérogatives de l'exécutif national.
Habitués
aux référendums, les Suisses savent à
quel point l'élaboration
de ce type de «paquet ficelé» est
périlleuse. Additionnant les
oppositions sectorielles à celles de la droite, la
réforme proposée par
Hugo Chávez a également suscité des
doutes chez certains de ses
électeurs habituels. La hausse de l'abstention (44%, contre
25% en
2006) témoignerait de ce scepticisme face aux nouveaux
pouvoirs qui
devaient être conférés au chef de
l'Etat ainsi qu'à sa possible
réélection jusqu'en 2020.
De ce point de vue, l'échec de dimanche pourrait
paradoxalement offrir
une nouvelle dynamique au camp bolivarien.
A
moins qu'elle ne s'entête
à instaurer la réélection
illimitée, la gauche
vénézuélienne est
appelée à se réinventer hors de sa
figure tutélaire. Les difficultés ne
manqueront pas, dont le risque de voir les cinq dernières
années du
mandat d'Hugo Chávez tourner à la guerre de
succession, mais l'enjeu en
vaut la peine.
L'autre crainte serait de voir un gouvernement, apeuré par
l'échec,
geler les projets les plus radicaux de sa réforme
constitutionnelle.
S'ils devaient être réactivés, le
passage à la journée de travail de
six heures ou l'expropriation des grandes
propriétés terriennes, par
exemple, se heurteront à une opposition
requinquée et à la difficulté
de «lire» la volonté populaire
derrière le rejet du «paquet»
constitutionnel... Mais, là aussi, la prise de risque est
nécessaire:
toute stagnation du processus bolivarien signifierait un recul de
l'espoir populaire qui le porte.
La mission
n'est de loin pas impossible. Car si elle a remporté sa
première victoire dans les urnes, l'opposition
vénézuélienne en sort
paradoxalement affaiblie. Son principal fonds de commerce est plus
qu'entamé: qui pourra encore décemment croire
qu'un président élu
démocratiquement qui reconnaît une
défaite électorale est un dictateur?
Note
:
[1] Affectation des revenus
pétroliers à des projets sociaux,
éducatifs et sanitaires.
Source : http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=438137
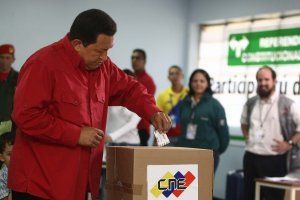 photo :
Agence ABN photo :
Agence ABN
La
démocratie vénézuélienne
n'est pas en danger : Peu avant la disparition
de la IVe République française, qui allait
déboucher sur un renforcement constitutionnel des pouvoirs
présidentiels, Charles de Gaulle avait manié
l'ironie pour apaiser les
craintes d'un journaliste sceptique: «Croit-on
qu'à 67ans je vais
commencer une carrière de dictateur?» avait
rabroué l'ancien militaire,
avec son légendaire sens de la formule. Mais, en 1958, le
général
français était bien loin d'affronter la
quasi-totalité de la
médiacratie internationale, qui instruit aujourd'hui le
procès d'Hugo
Chávez et de sa réforme constitutionnelle.
Pour les adversaires du
président vénézuélien, la
Charte
fondamentale proposée ce dimanche en
référendum serait la «preuve»
enfin révélée du caractère
«dictatorial» qu'ils prêtent depuis des
années à Hugo Chávez. Si la
réforme était acceptée, assurent-ils,
le
chef de l'Etat vénézuélien
concentrerait des pouvoirs semblables à ceux
de son ami cubain Fidel Castro. «Un modèle d'Etat
socialiste,
marxiste-léniniste, étatiste est contraire
à la nature de l'être humain
parce qu'il établit la domination absolue de l'Etat,
restreint la
liberté personnelle et la liberté religieuse, et
cause une très grave
détérioration de l'économie,
provoquant une pauvreté
généralisée»,
avertit par exemple la Conférence épiscopale
vénézuélienne.
On frémit. Pourtant,
en épluchant les soixante-neuf nouveaux
articles mis au suffrage, on ne trouve guère d'indices de la
«dictature
du prolétariat» annoncée. A contrario,
le nouvel article115 définit et
garantit expressément la propriété
privée au même rang que trois autres
types de possession (sociale, publique et collective)...
Le fonctionnement des
institutions n'est pas davantage
bouleversé. L'exécutif voit certaines de ses
attributions renforcées,
notamment en matière de gestion territoriale ou
d'état d'urgence, dont
l'application est élargie, afin de répondre
à des tentatives de
déstabilisation comme celles subies en 2002 et 2003. Mais on
note aussi
un processus de décentralisation du pouvoir, avec la
création
d'institutions communales participatives. Autre avancée
démocratique:
le retour de la Banque centrale dans le giron des pouvoirs publics.
Quant
aux «libertés personnelles»
invoquées par les évêques, elles
semblent particulièrement choyées. La nouvelle
Constitution prévoit
ainsi de réduire la journée de travail de huit
à six heures à l'horizon
2010 et d'instaurer une protection sociale au
bénéfice des travailleurs
indépendants, soit la majorité des actifs. Des
dispositions attendues
avec impatience par la population et qui expliquent certainement les
difficultés des anti-Chávez à faire
campagne sur le texte soumis au
vote. A une exception: le très symbolique article230 qui
allonge le
mandat présidentiel à sept ans et ouvre la
possibilité, pour un
sortant, de se représenter devant les électeurs.
«Présidence
à vie» déguisée, accuse
l'opposition, relayée avec
force par les médias internationaux. En particulier en
Europe, quand
bien même une dizaine de pays du Vieux-Continent connaissent
la
non-limitation du nombre de mandats –à l'instar de
la France– sans pour
autant disposer d'un référendum
révocatoire comme au Venezuela...
Il est
particulièrement pathétique de voir les
commentateurs
politiques d'outre-Jura «s'inquiéter»
dans une belle unanimité qu'un
président «autoritaire» et
«populiste[1]»
«conduise son pays avec le doigté habituel des
dictateurs[2]»,
alors qu'il soumet un changement constitutionnel au
référendum
populaire. Des médias qui, en même temps, saluent
la volonté de Nicolas
Sarkozy de faire adopter par la seule Assemblée nationale
une
Constitution européenne rejetée il y a deux ans
par le peuple
français...
Que le processus de
transformations sociales mené au Venezuela
provoque des réactions à la mesure des enjeux et
de la personnalité
impulsive d'Hugo Chávez n'a rien d'étonnant. Mais
l'outrance de la
critique disqualifie ceux qui la portent. Une remarque qui vaut
également pour Hugo Chávez, dont les diatribes
assénées à ses
adversaires («traître»,
«diable», fasciste»...) contribuent aussi
à
figer le débat autour de positions caricaturales.
C'est
d'autant plus regrettable que l'option prise par le leader
socialiste de renforcer les pouvoirs présidentiels afin
d'accélérer ou,
au besoin, de défendre «sa»
Révolution aurait mérité un vrai
débat
critique au sein du camp progressiste, au Venezuela comme à
l'étranger.
Pour notre part, cette concentration des pouvoirs ne nous
paraît ni
souhaitable ni nécessaire. Pas plus que de rendre le projet
bolivarien
d'émancipation populaire dépendant d'un seul
homme, fût-il Hugo Chávez.
Notes : [1] Le Monde du 20 novembre.
[2] Le Figaro du 23 novembre
Source
:
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=438116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le
Venezuela
:
à l’épreuve du socialisme?
Lionel Mesnard, le 17 novembre 2007
|
 |
Le
2 novembre 2007, l’Assemblée Nationale du
Venezuela a approuvé les 69
articles modifiant la constitution de la République
Bolivarienne. Il
devrait suivre un referendum populaire sur l’approbation des
articles
en question le 2 décembre prochain. Un mot
n’échappera à personne,
cette constitution sera « socialiste » en plus de
son appellation en
référence à Simon Bolivar. Si bien
sûr une majorité de
vénézuéliens se
prononcent en faveur d’un changement constitutionnel, cette
nouveauté
va provoquer un tollé politique et journalistique mondial.
En l’état,
rien n’est joué, mais les articles de la presse
dominante ou
cybernétique faisant part de ce choix commencent
à donner le la de la «tentation
totalitaire» (1). Il y aurait comme un aveuglement
pour
certains à soutenir un processus socialiste de
transformation sociale,
économique et politique au Venezuela?
Le
socialisme renvoie à
l’idéologie mise en pratique du temps du glacis
soviétique avant 1989.
À juste raison, il peut naître un sentiment de
peur, mais nous nous
éloignons de la raison. Nous ne pouvons analyser dans les
mêmes faits,
l’histoire de l’URSS, aujourd’hui
disparue, et ce qui se déroule en
Amérique Latine. Certes nous avons le cas cubain, mais il ne
faut pas
prendre cette exception continentale pour la règle commune.
Les
mouvements «marxistes» sur le continent
américain n’ont jamais eu les
mêmes capacités et le même devenir
historique qu’en Europe. On peut
chercher des comparaisons, des relations, mais dans
l’ensemble il ne
faisait pas bon de se réclamer d’une
idéologie du progrès et du partage
outre-atlantique. À ne pas étudier
l’Amérique dans son entier politique
et historique revient à ne pas comprendre grand chose des
peuples qui y
vivent, encore moins de ce que furent leurs luttes et ce qui fit
abondamment coulé le sang de 1492 à nos jours.
Même
si les
disparités sont grandes entre un canadien et un argentin, il
existe une
communauté de devenir qui nous échappe en Europe.
Nous avons trop
tendance à regarder notre histoire en posant une grille
d’analyse qui
vaudrait à l’ensemble du genre humain, et sans
tenir compte de toutes
les mémoires historiques, et ce qui échappe
à «l’histoire officielle».
Appréhender véritablement
l’Amérique, c’est lui
reconnaître toutes
ses facettes, ses paradoxes, c’est chercher à
comprendre comment s’est
constitué le continent de nord en sud.
L’anti-américanisme
est un non-sens
Il y
a avant tout à saisir, que
l’«américain» ne se
résume pas aux seuls
étasuniens. C’est un peu comme si nous assimilions
l’Europe entière au
destin des seuls anglais, français ou allemands…
Du moins l’image que
nous en avons ne correspond pas aux visages des populations, le trait
fort est un savant mélange de culture européenne,
africaine et des
premières Nations (peuples amérindiens). Nous
sommes face à 900
millions d’habitants dont environ 385 millions
d’hispanophones pour
environ 325 millions d’anglophones (plus 175 millions de
lusophones et
15 millions de francophones). La plupart des langues
d’origine ont
disparu ou sont très menacées, la Bolivie est un
des rares pays ou
subsiste 2 langues natives (le quechua et l’aymara) pour un
peu plus de
la moitié de la population.
Comment
ignorer les volontés
hégémoniques et militaires qui ont eu cours au
20ème siècle ? Qui peut
nier l’impérialisme étasunien et le
rôle de la doctrine de Monroe dans
cette réalité panaméricaine de
construire une seule voix pour les
Amériques? Il n’existe pas de nations
latino-américaines n’ayant pas
connu d’interventions directes dans ses affaires politiques
ou
économiques. Qui peut encore nier les soutiens pas si
lointain à des
régimes fascistes au nom de la lutte contre le communisme?
De nos
jours, il s’agit de lutter contre l’axe du mal,
d’imposer de la même
manière à l’échelle du monde
une idéologie impérialiste.
Jamais
les USA ne seraient devenus si puissants, si sa politique
extérieure ne
l’avait pas conduite à reprendre les jougs de la
domination espagnole,
et les leviers économiques mis en place par les
britanniques. Se sont
sur les ruines des colonies du royaume d’Espagne et dans les
pas des
intérêts de la Grande-Bretagne, que se dessinera
une politique de
domination sans égal. Au vingtième
siècle, de Théodore Roosevelt à
Georges Bush, hormis la parenthèse du président
Franklin
Delano-Roosevelt, les conservateurs comme les
démocrates imposeront
une doctrine de fer à l’ensemble des nations du
sud. Toute tentative
politique d’échapper au bloc continental se
traduisait par
l’élimination de l’opposant au pouvoir
ou des oppositions nationalistes
ou socialistes, pire révolutionnaire. Il ne fallait en aucun
cas
toucher à un système si juteux et
inégal dans la répartition des
richesses. Les plus values qu’ont pu enregistrer les groupes
de négoces
ou les multinationales US ont permis l’enrichissement et la
domination
d’une nation au détriment des autres. La
superpuissance des Etats-Unis
n’existerait pas si elle n’avait pas
préservé sa chasse gardée,
aujourd’hui une partie de ses ouailles cherchent à
s’en libérer.
Le plus
symbolique est la
question
linguistique, la langue dominante n’est plus
l’anglo-américain, les
hispanophones sont les plus nombreux et actuellement aux Usa, 40
millions, soit 10 à 15% de la population est
d’origine
latino-américaine. Je me suis souvent interrogé
sur «l’anti-américanisme», et
en quoi ce mot
pouvait comporter comme
erreurs dans la bouche d’un européen lambda. Je ne
me suis jamais
reconnu dans un système consistant à amalgamer
une critique du système
dominant et un peuple, étasunien soit-il. Il ne faut pas
confondre les
gestionnaires d’une mécanique,
c’est-à-dire les gouvernants ou
politiques et le reste de la population. Le premier constat
à poser est
que «l’Américain»,
sous-entendu sur le vieux continent, n’a plus
vraiment le reflet du «cow-boy» mais celui du
paysan andin ou du
travailleur migrateur d’Amérique centrale.
C’est beaucoup moins
romantique…
Depuis le début des
années 2000 un tournant s’est engagé
Personne
ne pouvait vraiment envisagé qu’une nation de
nouveau se déclarerait
«socialiste». Ce n’est pas une
décision
à la légère et mérite
d’abord
d’être resitué dans son contexte, mais
aussi de s’interroger si cette
idée est vraiment opportune? Si l’objet est une
redistribution des
pouvoirs, un meilleur contrôle des centres de pouvoirs, et la
construction d’une économie solidaire. Si ce
socialisme de plus
s’exerce dans des règles démocratiques,
pourquoi préfigurerait-il d’un
nouveau totalitarisme? La reconduction de Chavez à la
tête de l’État
vénézuélien est un
élément mineur de cette réforme, et le
mode de
révocation à mi-mandat n’est pas remis
en cause. L’important est de
résister aux pressions extérieures et engager une
réforme de l’État,
les missions deviendraient ainsi un outil étatique
d’intervention,
permettant de clarifier le rôle et les fonctions de ces
organismes de
soutien à caractère universel (elles sont
nées lors du dernier mandat
présidentiel). Les missions ne pouvaient échapper
à une réorganisation,
à une telle échelle d’implication,
elles ont toutes leur place au sein
des services publics.
Les pouvoirs grandissants du
président
Hugo Chavez posent toutefois un problème, et par ailleurs ce
n’est pas
en réduisant la semaine à 36H00 de travail que
pour autant, l’on
devient «socialiste». Le socialisme
n’est pas l’enjeu d’un individu,
personne en soit n’est propriétaire de cette
idéologie. Certes,
certaines mesures sont empreintes de la maison commune, mais
j’ai peur
que le socialisme ne soit vraiment à l’ordre du
jour, même si on
l’emmitoufle dans un vaporeux discours sur la transition. Le
mode
suivez-moi nous allons construire une autre
société, ne marche pas
vraiment au Venezuela, pas plus qu’ailleurs. Plus que les
dangers, je
me méfie de l’affichage et du culte de la
personnalité du leader
vénézuélien. On ne fait pas la refonte
du socialisme en quelques
années, du moins, l’on prouve que
l’action collective est plus forte
que l’individualisme en cours dans le camp chaviste. En ce
domaine, je
ne suis pas totalement myope et je crains des lendemains qui
déchantent.
Si le socialisme est une
évidence, il ne se
proclame pas, il se construit. Et, l’on ne passera pas de
l’économie
libérale à une économie socialiste
sans une meilleure prise de
conscience des enjeux collectifs. À contrario, il
n’y a pas un dogme
interdisant de se penser et d’agir en tant que socialiste. Je
crois
surtout que l’on confond avec le républicanisme,
cette empreinte
particulière toujours aux limites du social sans en
construire un
contrat du même nom. À moins d’un mois
du référendum sur les articles
modifiant la constitution de la République Bolivarienne, je
m’interroge
sur la pertinence de cette réforme. Si
j’étais
vénézuélien que
ferais-je? Je ne le suis pas, toutefois j’ai un
doute et j’ai
l’impression que quelque chose ne suit pas. Je crains
qu’Hugo Chavez
n’aille un peu vite en besogne. Je partage sa perception
à long terme,
mais est-il conscient du fossé à
résoudre?
Il fait état
d’une
transition vers le socialisme, mais il ne tient pas compte
d’une
société à mille lieu de
l’enjeu. J’ai peur que ne vienne qu’un
vernis
de socialisme, les réformes de structures vont certes
transformer la
donne politique, mais il risque d’y avoir un grand absent, la
redistribution des pouvoirs économiques et sociaux. Quoi
qu’on dise sur
le Venezuela, sa révolution a les atours d’une
grande surface
commerciale où chacun y fait son marché. On peut
saluer les évolutions
intervenues ces dernières années, mais en huit
ans, on ne change pas
une société ayant subit une dépendance
extérieure forte depuis
quasiment sa création.
Il existe trop
de contradictions entre
le discours et les réalités, le régime
bolivarien est certes de gauche
et progressiste, mais le pays est bel et bien capitaliste et vit
à
corps perdu dans l’illusoire de la consommation. Et pour ceux
qui ne
l’auraient pas encore compris, le socialisme, ça
ne se décrète pas. À
contre-exemple, Cuba est bien plus disposée à
devenir une société
socialiste que le Venezuela… Je
m’entends par le niveau scolaire et
culturel des cubains, et non au fait d’un article de loi.
Quand il
existera des millions de «Chavez» en mesure de
s’émanciper du système
nous pourrons nous satisfaire d’une avancée vers
le socialisme. Pour le
moment, tout tourne autour d’une personne et va à
contresens d’une
émancipation future du pays et de ses citoyens.
Les défis du
Venezuela
Difficile
de savoir à l’avance ce qui peut advenir du
Venezuela, ce qu’il importe
de saisir c’est la nature des défis à
entreprendre. Ils sont nombreux,
colossaux, et ils se résoudront seulement si, - il y a une
prise de
conscience collective des enjeux (si j’insiste!).
Redéfinir les bases
du socialisme est une question vitale, et pas simplement pour les
Vénézuéliens. Rendons un hommage clair
à ce peuple en mouvement. Il a
ouvert une nouvelle brèche, là où
depuis l’écroulement du mur de Berlin
nous contemplions les ruines d’un système
totalitaire, et subissions en
contrecoup un système inégalitaire. Toute
réflexion idéologique
semblait caduque, limitant nos champs à analyser le versant
Rhénan ou
anglo-saxon du capitalisme.
Le tout finissant par
ne faire
qu’un système global et devenant au fil des ans
une machine à broyer
toute forme d’intelligence, notamment critique.
L’imaginaire social et
économique était aux abonnés absents
et nous devions accepter
l’adaptation nécessaire à une
mécanique implacable, l’humain ayant
moins de liberté de circulation qu’une
marchandise. Le « libéralisme »
dans son sens propre de libertés ou
libéralités ne procède qu’en
faveur
du bien matériel, l’exigence éthique ou
morale n’a pas lieu d’être. Ce
qui procède de l’humanité,
c’est-à-dire nous, cet ensemble improbable
mais indispensable à la bonne conduite du marché,
n’a pas vraiment son
mot à dire et pourtant ?
Le Venezuela est
venu comme par
enchantement mettre un frein à ce tout régnant
global. Le socialisme
aurait pu passer à la trappe et n’être
plus qu’une vieille illusion. Il
a repris langue justement là où on ne
l’attendait pas. Qui aurait
imaginé avant l’année 2000 une nation
latino-américaine venir ébranler
la citadelle? Par citadelle, il faut comprendre la nation
étasunienne.
Ce bloc que l’on qualifie à tort
d’américain, parce que le continent du
même nom ne recoupe pas seulement un état, mais un
ensemble de nations
dont on néglige depuis longtemps l’existence.
L’Amérique aujourd’hui
c’est un territoire dont les équilibres culturels
et politiques sont en
profonde mutation.
Il ne s’agit pas
pour autant de nier la Nation qui
en l’état dicte au monde sa conduite, mais
à regarder ses bases et ses
potentialités. Nous sommes à l’aube
d’un changement, d’une prise de
conscience continentale, et face au déclin ou à
la décrépitude de
l’empire. Si Ernesto Guevara souhaitait «deux ou
trois guerres du
Vietnam» dans les années 1960, de nos jours il y
a «3 à 4, Venezuela
bolivarien», de quoi s’interroger sur les
changements à venir. Que
signifie en moins d’une décade ce bouleversement
de tendance, et a-t-il
vraiment un impact dans l’équilibre continental?
Pour nous béotiens de
la chose latino-américaine, ou notre connaissance se
résumait à Tintin
chez les Picaros, nous voilà amener à
réfléchir, à envisager les bases
du socialisme sur un héritage méconnu
jusqu’à peu. Une latitude où
l’idée du marxisme se résumait
à Cuba vient alimenter une approche
démocratique d’un nouveau type. Pour cela il faut
prendre en compte une
histoire, non point comme une nouvelle approche dialectique, mais comme
une histoire plus que mal traitée.
Voilà
maintenant 3 années
passées et actives à comprendre et rechercher
dans les entrailles de
cette nation. Des lectures, mais aussi un bon voyage de six mois
à
Caracas en deux séjours (2004 et 2006). Cette motivation est
venue
d’une envie forte d’aller bien plus loin
qu’un simple voyage de
tourisme. J’ai fait ce choix non en raison d’une
adhésion militante. Un
hasard est venu bousculer l’ordre de ma vie, et, en octobre
2004 un
billet en poche, je me retrouve à Caracas dans le quartier
de «Manicomio» (ce qui veut dire
communément en
langage populaire :
hôpital psychiatrique). C’est un tout petit coin de
mémoire, qui me
poussa à rejoindre cette destination
jusqu’à cette date inconnue. Une
de mes préoccupations premières fut
d’observer, par la suite d’engager
des lectures et saisir certaines questions qui échappent
à l’œil si
l’on ne se plonge pas dans le quotidien et une histoire plus
que
mouvementée.
Entre 2004 et 2006 mon
analyse a évolué, de plus
j’ai de nouveau atterri en pleine campagne
présidentielle lors du
dernier séjour, et j’ai pu en tirer certains
constats, aussi bien
positifs, que négatifs. Sortons de ce
manichéisme, qui fait du
Venezuela un champs de bataille souvent médiatique et
parfois
littéraire. Écrivons, comme nous
l’entendons, mais essayons de sortir
de cette guérilla propre à la « rive
gauche » parisienne. Certains
articles sont des feux de paille concernant des questions plus
conséquentes et pesantes au sein de la
société
vénézuélienne. Je ne
suis pas aveugle au sujet de Chavez, il se trompe notamment sur ses
vrais alliés et ils sont peu, et pas toujours au sein du
PSUV. Ils sont
surtout peu à pouvoir surmonter un défi colossal,
c’est un pari de
l’intelligence et de la capacité à
sortir ce pays de très lourds
déséquilibres. On ne peut changer la donne en un
retour de veste.
Certains problèmes sont endémiques. Les questions
sociales face à des
difficultés permanentes sont trop souvent
traitées dans le cadre de
l’urgence.
On ne peut pas regarder le
Venezuela que sous
l’aspect d’un homme politique, mais il
n’y a pas à être dupe sur un
traitement de l’information étatique, dont
certains angles ne sont pas
éloignés du culte de la personnalité.
Tout se passe à Caracas et
Caracas n’est pas le Venezuela, et fort heureusement pour le
reste des
Vénézuéliens. Mais cela
pèse, quand il suffit de constater la
médiocrité aussi bien des classes moyennes, que
de la bourgeoisie. On
retrouve même entre Paris et Caracas, la faune «
bobo » qui traîne son
ennui. Oui, il existe un tourisme « politique »,
mais il n’est pas du
fait du Venezuela, et il ne faut pas confondre un soutien aux
amérindiens Karina et des voyages organisés au
temps de l’Urss. La clef
de compréhension est ailleurs. Il faut remonter à
certaines racines
dans la complexité même du Venezuela. À
ce titre, s’il existe une
histoire de la nation française, il en va aussi de la nation
vénézuélienne. Deux
républiques qui ont une communauté de destin,
mais
qui se boude. En très résumé, cela
fait deux cent ans que nous nous
trompons en France sur nos échanges avec ce pays et plus
largement dans
la région, ou plus exactement en quoi nous gagnerions
à la soutenir à
s’autonomiser de sa tutelle économique actuelle.
Rien
que dans
le domaine agronomique, de la diversité biologique, il
existe des
chantiers économiques considérables dans le cadre
d’un développement
durable, qui passent en partie par une meilleure dotation en
infrastructure, notamment ferroviaire. En huit ans, il est
impossible
de changer une société, et la France qui se
cherche des poux et des
ennemis imaginaires se trompe quand elle dénonce Chavez
à tour de bras.
Elle fait la même erreur concernant Cuba. Sinon, sauf
à suivre
servilement l’impérialisme étasunien et
son martelage permanent. Ne
participons pas de la curie et ne facilitons pas ainsi «la
tentation
totalitaire». Je pense que sur place la
radicalité des débats débouche
trop souvent sur la violence, faut-il remettre une couche
supplémentaire à huit mille kilomètres
de distance ? Je ne suis pas
certain que cela participe «à écrire
vrai». Pour certaines plumes, le
principe de précaution est un peu
exagéré, outrancier parfois.
Il
importe et je le pense depuis le début de sortir des
caricatures, je
comprends que le terme «bolivarien»
déconcerte. Pourquoi cette
référence si présente à
Simon Bolivar ? Il y a là un pan d’histoire que
nul ne doit négliger sauf à être sur
les enjeux hors des clous. Ce
n’est pas un sujet tropical, mais une part oubliée
de comment s’est
construite l’Amérique Latine au début
du monde contemporain. Ce qui
n’est pas conforme devient un sujet à abattre, il
est ainsi facile de
juger. Comprendre est un exercice plus difficile, ce qui
n’absout pas
pour autant les échecs, les comportements verbaux un peu
hors-cadre du
président vénézuélien, mais
souvent avec une part de vérité qui
échappe
à beaucoup de journalistes francophones. Le socialisme sans
critique,
c’est un peu l’eau mais sans la source…
Ce qui est plus insupportable
est cette coupure rigide entre pro et anti-Chavez, et dans cette
histoire les deux camps sont souvent dans le faux et se ressemblent.
Le
parcours politique de Théodore Petkoff de
l’extrême gauche à la droite
est son problème, ancien ministre du gouvernement Caldera
(chrétien-démocrate), il ressemble pour beaucoup
à nos ministres «d’ouverture».
Ils ont fait le grand
écart sans craindre le claquement,
sans qu’on nous explique vraiment la raison du reniement. Et,
pourquoi
une part importante de la deuxième internationale
à abdiquer devant la
critique du capital? Carlos Andres-Perez (dit CAP),
«social-démocrate» et par 2 fois
président de la
République du Venezuela mériterait un
examen de ses mandats. De comment s’est
déroulé un détournement monstre
des richesses, sans que cela fasse vraiment de vague à
l’époque, sauf à
vivre de grandes désillusions et meurtrissures au sein de la
société
vénézuélienne. Je ne crois pas que
l’ancien guérillero Petkoff puisse
faire état d’une pensée sibylline,
quand il évoque un «totalitarisme
light», peut-être pense-t-il, à son
bilan comme ministre? Les
vertueux ne sont pas toujours ceux que nous croyons, Petkoff est comme
beaucoup au Venezuela à la fois un politique et un
journaliste, une
véritable confusion des genres. L’opportunisme au
Venezuela comme
ailleurs agit face à la question du pouvoir avec cynisme.
Pour
conclure, le processus qui s’est
engagé a peu de chance de tourner en
régime totalitaire. Pour ou contre la nouvelle constitution,
nous
verrons en décembre les résultats. En attendant
et comme en fait par
Amnesty International appelons au calme et que le
référendum puisse se
dérouler au mieux. Pour ce qui est de Chavez, beaucoup
d’attaques sont
basses et peu reluisantes. Qu’il s’attaque
à certains fondements de la
propriété privée va lui valoir de gros
soucis. Le pays va devoir faire
face à de vieux mécanismes, parce que cette
notion de propriété rend
fou quasiment l’ensemble humain. Je n’entrerai pas
dans une analyse
psychosociologique de la chose, mais
nous sommes face à des
mécanismes
de domination propre à l’économie de
l’Homme. C’est pourquoi le
socialisme, même transitoire soit-il, risque de buter sur
cette question fondamentale du rapport des humains à leurs
biens. Elle se
trouve ici même la prise de conscience, et pour le moment je
crains que
l’Humanité n’y soit pas
préparée. Ce qui ne veut pas dire ne pas
l'envisager, cette étape de l'histoire humaine est la seule
qui nous permettra de construire une autre
société, et le chemin est encore lointain et
très chaotique.
Note :
(1)
Hugo
Chávez ou la tentation totalitaire par Rudy Reichstadt
http://www.reichstadt.info/index.php?action=article&numero=32
|
|
|
|
|
|
|
|
Bourbons
d’Espagne
et
vérités
difficiles à entendre
Lionel Mesnard, le 16 novembre 2007
|
 |
L’altercation
entre Juan Carlos de Bourbon (1) et Hugo Chavez Frias si l’on
en
croit les médias dominants serait le seul fait du
président vénézuélien. Les
accusations
portées par le président du Nicaragua et son
homologue du
Venezuela sont du coup un peu passées rapidement
à la
trappe. Que dire néanmoins sur une entreprise espagnole,
ayant
une dette de 50 millions de dollars US avec
l’État
nicaraguayen, et dénoncée comme un
système mafieux
(2) ? Pareillement sur une vérité difficile
à
saisir, Juan Maria Aznar est bel et bien un produit du fascisme du
temps du général Franco, et il fut
impliqué dans
le coup d’état intervenu en avril 2002
à Caracas
(3). Il n’y a vraiment rien d’étonnant
à ce
qu’en France nous aillons des difficultés
à saisir
la réaction furibarde du roi. Le malaise va
au-delà du
seul cas « Aznar », le fond politique touche tout
ce que
cette monarchie refuse à entendre ou à voir. Pour
nous
français, il y a une certaine méconnaissance qui
dans
certains cas s’avère du domaine du ridicule.
Si en
France, Juan Carlos est quasi adulé, en Espagne la monarchie
se
trouve actuellement très critiquée et sans
véritable légitimité. Le roi
d’Espagne est
lui-même un reste du franquisme, en soit le dernier
vœu
post-mortem du caudillo de ne pas voir renaître une
République. En Effet de 1939 à 1975 les Espagnols
ont
subi une tyrannie, et bon nombre d’européens y
passèrent leurs vacances sans se soucier du sort de ce
peuple
(comme ces dernières années en Birmanie). Bizarre
cette
république journalistique qui se vautre à
reproduire
«Point de vue (et anciennement) images du monde».
Nous
les enfants de la Révolution dont on connaît ce
qui fut le
sort de la famille Capet et Bourbon en 1793 « nous
voilà
» à défendre un avatar de la dynastie
(à la
fois autrichienne, espagnole et française). Si le sujet
était drolatique. Nous pourrions en rire. Mais les Bourbons
n’ont rien de comique et le sujet est hautement explosif.
D’un
point de vue stricto local, la branche française
s’est
évanouie après 1830 dans les querelles entre les
Orléanistes et la branche «dits des Bourbons
d’Espagne», de l’autre
côté des
Pyrénées elle est toujours en
activité.
C’est une survivance dont on ne connaît pas
vraiment du
côté français les implications et le
rôle de
cette dynastie castillane. Pourtant, au début de
l’époque contemporaine les relations entre la
«
Maison de France » et celle qui est en place à
Madrid sont
indissociables. À une différence prêt
Louis XVI fut
un monarque bien plus « libéral » que
ses parents
espagnols. «Los Borbones» furent des
cours
d’Europe, la plus rétrograde et la plus
conservatrice. Il
n’y a pas à s’étonner
à voir Franco
après la chute de la monarchie en 1931 reprendre le
flambeau, et
dans le sillage de ce qui se passait en Italie et en Allemagne. Cette
facette des fascismes en Europe est resté en
suspend.
Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir les yeux sur une
histoire occultée. Car chaque fois que l’on
cherche
à tordre des mémoires historiques, le retour de
flamme
n’est jamais bien loin. Il existe suffisamment
d’exemples
avérés (l’Argentine sous Videla, le
Chili sous
Pinochet, etc…) pour savoir que ce qui est mis sous silence
resurgit toujours. Le peuple espagnol plus que d’autres
peuples
en Europe a subi pendant 40 ans un joug sans que cela ne perturbe
vraiment les grandes consciences du moment.
Certes Juan Carlos
a rétabli la démocratie, mais pour autant a-t-il
vraiment
manifesté une condamnation du franquisme? Peut-on croire
seulement trente années après que
l’héritage
doit être esquivé, que l’Espagne de
Franco ne
mérite pas plus que quelques raclements de gorge. Le Premier
ministre Zapatero de son côté sera le premier
à
avoir ouvert le dossier de la répression et a avoir
engagé l’indemnisation des victimes
républicaines
restantes de la guerre civile. De son côté, Rome a
canonisé quelques cléricaux tués par
les
républicains pour faire face à sa propre
participation
à un ordre fasciste. Mais c’est trop tard, cette
fois-ci
les faits ne vont pas vraiment du côté du cloaque
des
anciens inquisiteurs. L’Espagne monarchique et
ecclésiastique a quelques comptes à rendre avec
sa propre
histoire, et en particulier dans ses rapports avec
l’Amérique Latine. Si Hugo Chavez a
manifesté une
opinion sobre sur Aznar lors du sommet des pays de langues
ibériques, qu’est-il arrivé comme pet
de plomb au
roi pour exiger qu’il se taise ou la ferme ? Ce que disait en
outre Zapatero était une réponse
équilibrée, très diplomatique. Sur le
fond Juan
Carlos 1er est sur des braises, et ce qu’ajouta Daniel Ortega
le
poussa dans une colère très
révélatrice. Le
menant tout seul vers la sortie dans une sorte de «fuera
Juan
Carl».
Et oui, il y a de l’eau
dans le gaz et
certaines vérités ne sont pas bonnes à
entendre.
De plus qu’au sein de la nation la plus à cheval
sur ces
traditions républicaines, l’on vienne à
absoudre
les Bourbons castillans, c’est d’une insignifiance
assez
consternante. Tel fut le cas de ma surprise. Je me trouvais
à
l’écoute de la «matinale» de
Canal Plus (du
14-11-07, entre 8h00 et 8h30). Exemple de ces commentateurs types, ils
ne connaissent rien, mais ils ont un avis, jusqu’à
présenter un «dictateur» et
étonnamment «élu»,
et se nommant bien
évidemment Chavez. La colère
néphrétique du
roi les émoustillant n’a rien de surprenant quand
on donne
la parole à une spécialiste
dénommée
Daphné, très connue pour sa «
géopolitique
» des tendances de la mode (sa rubrique). Il ne manquait que
l’assentiment de BHL, hélas absent, il aurait
aimé
de telles inepties, lui le dernier pourfendeur en date du mouvement
bolivarien.
Un roi qui n’a jamais
été
élu et mis en place par le dernier potentat des fascismes
européens, il vaut bien évidemment un pourfendeur
de
vérités comme Chavez, pourtant lui
légitime et
réélu trois fois. Concernant notre pauvre Aznar,
il y a
probablement un hasard au fait qu’il ait
été
ministre sous Franco et membre des phalanges. Cela fait au final pas
mal d’anciens adeptes à un ordre, bien connu sous
la
notion idéologique «d’occident
chrétien». Si l’on rajoute en plus la
contribution de
l’Opus
Dei, cet ensemble politico historique nous donne un relief du vrai
malaise. Bien plus conséquent que ce que l’on
cherche
à nous montrer. Qui peut véritablement
nier
qu’une bonne part des dirigeants franquistes après
la mort
du caudillo a rejoint le Parti Populaire. Comment des fascistes ont pu
faire peau neuve grâce à un parti
prétendument de
la droite classique. Juan Maria Aznar est un ancien militant et acteur
d’extrême droite, il se peut que l’on ne
puisse plus
le qualifier en Europe comme tel. Toutefois, il a su conserver quelques
réflexes musclés de ses jeunes années.
Sa
participation inconditionnelle aux côtés de G.
Bush
à la guerre en Irak n’est pas le
témoignage
d’une droite molle ou centriste.
Le
débat
n’est pas clos, il s’ouvre ! Car les accusations
portées aussi bien par Daniel Ortega et Hugo Chavez sont
importantes à comprendre. Le fait colonial ou
impérialiste à laisser plus que des traces
outre-atlantique. 300 ans de colonialisme du monde ibérique
s’est traduit par la naissance de républiques et
la
tentative de Simon Bolivar d’émanciper les
populations
latino-américaines. Mais une fois, ces nations
libérées du joug castillan les
impérialismes de la
Grande-Bretagne, puis des États-Unis sont venus piller les
richesses et permettre aussi bien à l’Europe
occidentale,
qu’aux étasuniens d’instrumenter les
marchés
en leur faveur. Au final 500 ans d’histoire qui ne plaide pas
vraiment par souci de générosité et
l’attitude de Juan Carlos conforte
l’idée
d’une nouvelle République en Espagne ! Souhait que
partage
un grand nombre de citoyens du versant sud
pyrénéen…
Notes
:
(1)
Les
Bourbons d’Espagne proviennent de la branche
d’Anjou, ou
d’Espagne. Elle est issue de Philippe de France, duc
d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, proclamé en 1700
roi
d’Espagne sous le nom de Philippe V. Cette branche a
régné en Espagne de 1700 à 1808, de
1814 à
1868, de 1878 à 1931 et depuis 1975, avec Juan Carlos de
Bourbon.
(2)
SOMMET
IBÉRO-AMÉRICAIN • Ne
condamnons pas
Chávez trop vite par Mercedes López San Miguel
(Página 12) "Le
Nicaraguayen
Daniel Ortega, dans l'allocution qui a suivi celle de Chávez
au
Sommet ibéroaméricain [il s'est tenu du 8 au 10
novembre
à Santiago du Chili], est revenu sur un cas
emblématique
: la compagnie d'électricité Unión
Fenosa, qui a
une dette de 50 millions de dollars avec l'Etat du Nicaragua. Le leader
sandiniste l'a décrite comme "une structure mafieuse
(…)
au sein de l'économie mondiale". Source : AFP -
Courrier International
(3) (Página12) "L'ambassadeur espagnol a
reçu des instructions pour soutenir le coup d'Etat contre le
Venezuela" -
Source : http://www.elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=1963
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petits calculs
pétroliers
Jean-Luc Crucifix, 10
novembre 2007
|
|
 |
Tiens, le prix du baril
de pétrole vient de battre un nouveau record (on est
habitué) : 98,62 US$… En même temps,
à la pompe au Venezuela, nous continuons à
bénéficier de l’essence la moins
chère du monde : 70 bolivars le litre de normale (soit 0,032
US$ au taux de change officiel –ne parlons pas ici du dollar
parallèle, ce serait franchement indécent) et 97
bolivars le litre de super (soit 0,044 US$). Arrondissons le tout
à 0,04 US$ le litre. Non, vous ne rêvez pas : 25
litres pour un dollar, 35 litres pour un euro! Que les
incrédules examinent la photo ci-dessus!
Or un baril de
pétrole brut vaut 159 litres. Le litre de pétrole
brut vaut donc : 98,62 US$ : 159 = 0,62 US$
Nous obtenons donc
qu’au Venezuela, un litre d’essence à la
pompe vaut 15,5 fois moins qu’un litre de pétrole
brut sur le marché international! Vous me suivez?
Mais attention!
D’un baril de pétrole on ne tire pas 159 litres
d’essence, mais bien moins. Je n’entrerai pas dans
les détails, mais cela dépend du cru et des
traitements qui lui sont apportés. Soyons bon prince, et ne
tenons pas compte de ces futilités techniques…
Ne tenons pas compte non
plus :
- du coût du
transport du brut jusqu’aux raffineries
- du coût du
raffinage
- du coût du
transport des raffineries aux stations-services
- des coûts
d’exploitation d’une station-service
Sinon, on
arriverait à la conclusion que l’essence
vénézuélienne se vend à un
prix 25 fois moindre que son coût de production.
Qui perd gagne
Qui gagne et qui perd
à ce petit jeu distortionné? Le consommateur
gagne, cela ne fait aucun doute. Il ne se préoccupe pas du
tout du prix de l’essence lorsqu’il se trouve
à la pompe (mais se préoccupe plutôt du
prix du lait, 25 fois plus cher, qui a disparu du marché!).
On pourrait croire que
l’État, grand propriétaire des
ressources pétrolières, y perd. De fait,
d’un point de vue strictement économique, il perd
quelque chose comme un dollar US chaque fois qu’un litre
d’essence est débité à la
pompe. Cela fait beaucoup si l’on pense aux quelque 5
millions de voitures qui font en moyenne un plein de 30 litres par
semaine! Un petit calcul nous indique que le manque à gagner
serait d’environ 8 milliards de dollars par an!
Mais
détrompez-vous : l’État ne perd pas,
l’État ne perd jamais lorsqu’il fait des
cadeaux… Il se gagne l’opinion publique, et cela
n’a pas de prix! Idéologiquement, le concept qui
se diffuse, c’est que le pétrole appartient aux
Vénézuéliens, donc qu’il est
juste qu’ils ne le paient pas, ou si peu. Ce fondement est
sacré : tout gouvernement qui a tenté de changer
de paradigme s’est allègrement cassé la
pipe. Hugo Chávez, friand de peuple, est encore moins enclin
à prendre un tel risque. Il a besoin de voix pour sa
réforme constitutionnelle, et pour le reste!
Et le grand perdant
est…
Par contre, il y a un
grand perdant dans toute cette affaire, et non des moindres :
l’environnement. Les statistiques indiquent que le Venezuela
est de loin le plus gros producteur non seulement de
pétrole, mais aussi de CO2, en Amérique Latine!
Pour vous en assurer, voyez la carte sur le nouveau site des
Nations-Unies qui monitorise les objectifs de développement
du millénaire.
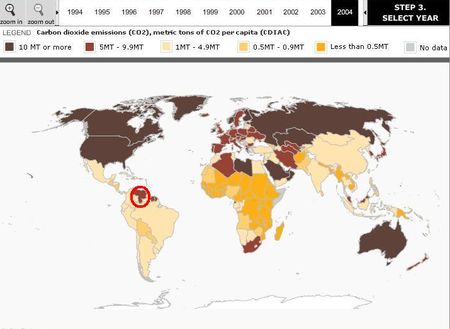
Émission
de CO2 par habitant dans le monde en 2004 (tonnes) :
Le
Venezuela (cercle rouge) se distingue en Amérique latine
Selon le Carbon Dioxide
Information Analysis Center (CDIAC) du Département de
l’Énergie des États-Unis (je sais, on
va encore me dire que c’est une source tendancieuse), le
Venezuela a en effet émis 6,57 tonnes de CO2 par habitant en
2004. Cela le situe certes bien en dessous des gros pollueurs que sont
les États-Unis, le Canada, l’Australie et la
Russie. Il se trouve cependant dans la même tranche que la
plupart des pays européens. La petite différence,
c’est que ces derniers sont des pays hautement
industrialisés dont le revenu par habitant est
très élevé. Cela ne justifie pas, mais
cela explique, le niveau relativement élevé
d’émission de CO2 dans ces pays. Mais au Venezuela?
Avec quelques autres pays
(la Lybie, l’Arabie Saoudite, Oman, l’Iran, les
anciennes républiques soviétiques
d’Asie centrale … –comme par hasard des
producteurs de pétrole), le Venezuela se
révèle être l’un des
champions d’émissions de CO2 dans le dit
Tiers-Monde. Triste record…
Je ne dis pas que le prix
ridicule du carburant en est la cause unique, mais à
n’en pas douter c’en est l’une des
principales. Quand le prix de l’essence n’est une
préoccupation pour personne, on obtient un parc automoteur
éminemment pollueur : les vieilles américaines
aux énormes moteurs mal réglés des
plus pauvres côtoient les SUV dernier cri des plus riches. Un
cocktail véritablement catastrophique pour
l’environnement.
Source
article et photos : venezueLATINA
http://venezuelatina.com/2007/11/10/petits-calculs-petroliers/
|
|
|
|
|
|
|
|
L’économie
vénézuélienne
sous Chavez
Luis Sandoval, Mark
Weisbrot, 29 octobre 2007
|
|
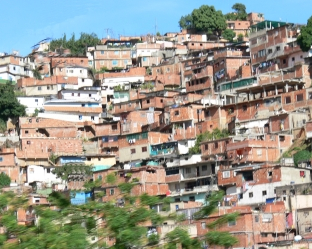 |
L’économie du Venezuela
a connu un
rythme de croissance assez rapide - 10,3% en 2006 - après
avoir touché
le fond au cours de la récession de 2003.
L’opinion la plus répandue
sur cette expansion actuelle du pays se résume à
évoquer la « manne
pétrolière »,
stimulée comme par le passé par les prix
élevés du baril,
et à prédire une inévitable
« banqueroute »
résultant d’une chute à
venir de ces prix ou d’une mauvaise gestion du gouvernement
en matière
de politique économique.
Il existe pourtant
une grande quantité
de données qui vont à l’encontre de ces
prévisions. La croissance
économique du Venezuela a connu un grave effondrement dans
les années
80 et 90 après un pic du Produit Intérieur Brut
(PIB) réel en 1977. Sa
situation est similaire à celle de la région dans
son ensemble, qui,
depuis 1980, a réalisé les pires performances en
matière de croissance
économique depuis plus d’un siècle.
Hugo Chavez Frias a
été élu président
en 1998 et est entré en fonction en 1999. Les quatre
premières années
de son administration ont été marquées
par une grande instabilité
politique qui a eu un effet négatif sur
l’économie du pays. Cette
situation culmina avec le coup d’Etat qui chassa
provisoirement le
gouvernement constitutionnel en avril 2002 et avec la
désastreuse
« grève »
pétrolière de décembre 2002
à février 2003. Celle-ci plongea
le pays dans une grave récession économique au
cours de laquelle le
Venezuela vit son PIB chuter de 24%.
Mais cette
situation politique a
commencé à se stabiliser à partir du
second semestre de 2003 jusqu’à
aujourd’hui, favorisant une reprise puis une
accélération de
l’expansion économique. Le PIB réel
(c’est à dire corrigé par les
effets de l’inflation) a crû de 76% depuis son
niveau le plus bas lors
de la récession de 2003. Il est probable que les politiques
fiscales et
monétaires expansionnistes, ainsi que le contrôle
des changes mis en
oeuvre par le gouvernement, ont contribué à cet
essor spectaculaire.
Les dépenses du gouvernement ont augmenté de
21,4% du PIB en 1998 à 30%
en 2006. Les taux réels
d’intérêts à court terme ont
été négatifs
pendant pratiquement toute la période de
récupération économique.
Au cours de cette
période, les revenus
du gouvernement ont augmenté encore plus vite que les
dépenses, passant
de 17,4% du PIB à 30%, ce qui lui a permis de boucler un
budget en
équilibre pour 2006. Le gouvernement a planifié
ses dépenses sur base
de prévisions prudentes par rapport au prix du
pétrole. Pour 2007 par
exemple, le plan budgétaire prévoyait un prix de
29 dollars le baril,
soit un chiffre inférieur de 52% à la moyenne du
prix de vente du baril
vénézuélien au cours de
l’année précédente.
Autrement dit, le
gouvernement a toujours maîtrisé ses
dépenses vu que les prix
pétroliers ont toujours été plus
élevés que ce qui avait été
prévu dans
le budget. Mais, évidemment, si les prix du
pétrole chutent, les
dépensent publiques devront être revues
à la baisse.
Toutefois, le
Venezuela dispose de
réserves monétaires confortables auxquelles il
peut avoir recours en
cas de chute des prix. Une baisse de 20% ou plus pourrait
être absorbée
par les réserves internationales officielles qui atteignent
aujourd’hui
quelque 25 milliards de dollars, une somme d’ailleurs
amplement
suffisante pour annuler toute la dette extérieure du pays.
De plus, ce
montant ne reprend pas d’autres comptes de l’Etat
vénézuélien à
l’étranger dont le total est estimé
entre 14 et 19 milliards de
dollars. Avec une dette extérieure relativement faible
(14,6% du PIB),
le gouvernement pourrait en outre accéder aux
marchés de crédit
internationaux en cas de chute des prix pétroliers.
D’autre
part, il est peu probable que
les prix pétroliers connaissent un effondrement dans un
futur proche.
Le pronostic à court terme publié le 10 juillet
dernier par l’Agence
d’information sur l’énergie des
Etats-Unis (US Energy Information
Agency) prévoit des prix pétroliers tournant
autour de 65,56 dollars le
baril pour 2007 et de 66,92 dollars pour 2008. Apparemment, le risque
le plus réel est celui de changements brutaux et
imprévus dans l’offre
de pétrole – particulièrement au vu de
la situation instable au Moyen
Orient. Dans un tel scénario, une diminution de
l’offre provoquerait
une nouvelle flambée des prix et non leur chute.
Le gouvernement de
Chavez a augmenté
très significativement les dépenses sociales,
tant dans le domaine de
la santé que dans ceux de l’éducation
ou de l’alimentation.
Le contraste le plus frappant avec le passé concerne la
santé. En 1998,
par exemple, il y avait 1 628 médecins prodiguant des soins
de première
ligne à 23,4 millions d’habitants.
Aujourd’hui, ils sont 19 571 pour
une population de 27 millions de personnes. De 1998 à
aujourd’hui, le
nombre de salles d’urgences est passé de 417
à 721, celui des centres
de rééducation, de 74 à 445 et celui
des centres d’attention médicale
primaire, de 1 628 à 8 621, dont 6 500 sont
situés dans les quartiers
pauvres. Depuis 2004 jusqu’à
aujourd’hui, 399 662 personnes ont été
opérées des yeux et ont recouvré la
vue. En 1999, 335 personnes
infectées par le virus du sida
bénéficiaient d’un traitement
anti-rétroviral dans les services de santé
publique. En 2006, ils
étaient au nombre de 18 538.
Le gouvernement
vénézuélien a également
énormément élargi
l’accès aux aliments subsidiés. En
2006, il y avait
dans tout le pays 15 726 établissement commercialisant des
aliments à
prix subsidiés (permettant une économie moyenne
de 27% et 39% en
comparaison avec les prix du marché, respectivement, de 2005
et de
2006), bénéficiant ainsi à 67% de la
population en 2005 et à 47% en
2006. En outre, les programmes spéciaux destinés
aux personnes vivant
dans une extrême pauvreté ont
été étendus : les maisons
d’alimentation
et le programme de distribution gratuite par exemple. En 2006, 1,8
million d’enfants ont
bénéficié du programme
d’alimentation scolaire,
contre 252 000 en 1999.
L’accès
à l’éducation a également
été
considérablement augmenté. Par exemple, le nombre
d’élèves dans les
écoles bolivariennes de l’enseignement primaire
est passé de 271 593
pendant l’année scolaire 1999/2000 à 1
098 489 en 2005/2006. En outre,
plus d’un million de personnes ont participé aux
programmes
d’alphabétisation pour adultes.
Les
dépenses sociales du gouvernement
central ont connu une croissance exponentielle, passant de 8,2% du PIB
à 13,6% en 2006. En termes réels
(corrigés par l’inflation), les
dépenses sociales par personne ont augmenté de
170% dans la période
1998-2006. Notons que celles réalisées par
l’entreprise pétrolière
nationale PDVSA ne sont pas prises en compte par ces chiffres. Or, ces
dépenses se sont élevées à
7,3% du PIB en 2006. Si nous ajoutons cette
donnée, les dépenses sociales totales ont
représenté 20,9% du PIB en
2006, ce qui constitue une croissance d’au moins 314% par
rapport à
1998 (en termes de dépenses sociales réelles par
personne).
Le taux de
pauvreté a rapidement
diminué, passant de 55,1% en 2003, le chiffre le plus haut,
à 30,4% en
2006 – comme on aurait pu le prévoir au vu de la
forte croissance
économique des trois dernières
années-, soit une diminution de 31%.
Cependant, ce taux ne prend pas en compte l’augmentation de
l’accès à
la santé et à l’éducation
pour les plus pauvres. Les conditions de vie
de la population pauvre se sont ainsi significativement
améliorées,
bien plus que ce que n’indique la réduction
substantielle de la
pauvreté dans les chiffres officiels qui ne mesurent que les
revenus
monétaires que les gens reçoivent en poche . Le
taux de chômage a
également connu une diminution substantielle, atteignant
8,3% en juin
2007, soit le niveau le plus bas de la décennie,
à comparer avec le
taux de 15% en juin 1999 et de 18,4% en juin 2003 (à la fin
de la
récession). Le taux d’emploi dans le secteur
formel a connu quant à lui
une hausse significative depuis 1998, passant de 44,5% à
49,4% de la
population économiquement active.
Les
défis principaux qu’affronte
l’économie du pays concernent le taux de change et
l’inflation. La
monnaie vénézuélienne est assez
surévaluée. Le gouvernement est
réticent à la dévaluer, car cela
augmenterait l’inflation – dont le
niveau actuel est de 19,4%. Du fait du contrôle
gouvernemental sur le
taux de change et d’un excédent
budgétaire important (8% du PIB), il
n’y rien qui peut obliger le gouvernement à
dévaluer dans un proche
avenir. Mais cela représente tout de même un
problème à moyen terme car
malgré la stabilisation de l’inflation, cette
dernière détermine le
taux de change réel de la monnaie
vénézuélienne (le
« Bolivar »). De ce
fait, les importations sont rendues artificiellement bon
marché tandis
que les exportations en produits non pétroliers sont
beaucoup trop
chères sur le marché mondial, affectant ainsi le
secteur commercial et
créant une situation intenable à terme. Cela rend
en outre beaucoup
plus difficile la diversification de l’économie et
la possibilité de
rompre la dépendance au pétrole.
L’inflation,
qui atteint donc
aujourd’hui 19,4%, est, en soi, un problème. Il
faut toutefois signaler
qu’une situation d’inflation à deux
chiffres dans un pays en
développement n’est pas comparable à un
même phénomène dans un pays
européen ou aux Etats-Unis. L’inflation au
Venezuela était beaucoup
plus élevée dans les années
antérieures au gouvernement Chavez,
atteignant un taux de 36% en 1998 et même 100% en 1996. Elle
a connu
une diminution continue au cours de la phase actuelle de
récupération ;
de 40% en février 2003, elle a diminué de 10,4%
par an depuis lors
avant de remonter au taux actuel et de se stabiliser.
Du fait de son
excédent budgétaire
important, de ses grandes réserves en monnaie
étrangère et de sa
relativement faible dette extérieure, le gouvernement
dispose de
différents instruments pour stabiliser et réduire
l’inflation – ou pour
éventuellement ajuster sa monnaie – sans devoir
sacrifier la croissance
de l’économie. Tout semble indiquer que le
gouvernement est décidé à
maintenir un taux de croissance élevé. Ainsi,
aujourd’hui, il n’y a pas
de signaux indiquant que l’expansion économique
actuelle arrive à son
terme dans un futur proche.
Pour terminer,
notons que les mesures
du gouvernement vénézuélien tendant
à augmenter la participation de
l’Etat dans l’économie n’ont
pas donné lieu à des nationalisations
à
grande échelle, ni à des politiques publiques de
planification et elles
ont évité d’obliger
l’État à assumer des fonctions
administratives de
l’économie qui dépassent ses
capacités actuelles. Le gouvernement n’a
même pas augmenté significativement la part du
secteur public dans
l’économie. Les dépenses
gouvernementales tournent autour de 30% du
PIB, ce qui reste très en deçà des
pays capitalistes européens tel que
la France (49%) ou la Suède (52%).
Ce texte est un
résumé du rapport qui est
téléchargeable dans son
intégralité en espagnol.
Source :
Center for Economic
and Policy Research (www.cepr.net), juillet
2007.
RISAL - Réseau
d'information et de
solidarité avec l'Amérique latine URL:
http://risal.collectifs.net/
|
|
|
|
|
|
Cet espace d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le
contenu est sous la responsabilité de son
créateur, en tant que rédacteur.
|
|