|
1 - Venezuela : vidéo en ligne "À contre courant ", avec Roberto Hernandez Montoya
2 - Venezuela : Merci RCTV, bonjour TVes ! + un documentaire en vidéo : "Es el señal de todos"
3 - Venezuela : Affaire RCTV ... Il faut d’abord balayer devant sa porte, Diana Cariboni
4 - Venezuela : Je n'ai rien vu au Venezuela, Sébastien Brulez
5 - Venezuela : Huit questions et réponses provisoires, Marc Saint-Upéry
6 - Venezuela : Liliane Blaser et l'IFC-COTRAIN
|
Amérique Latine -
Archives
des
articles 2007
------
Sommaire : 1ère partie
))
|
"À contre-courant, une nouvelle chaîne
de télévision publique au Venezuela"
Réalisation de Alice Emsalem
Montage de Alice et Gilles Emsalem,
les propos sont recueillis par Suzanne Körösi
Un document de 17 minutes
(enregistré à Caracas, le 25 mai 2007)
Production les films du réveil
Beaucoup
d'encre coule dans le monde entier sur les atteintes à la liberté
d'expression au Venezuela. Mais qu'en est-il en réalité ? Cet entretien
avec un membre du directoire de la nouvelle chaîne publique TVes
(ou TEVES) tente de rééquilibrer le débat. |
Pour regarder la vidéo de l'entretien : Ciquez ici !
Ci-après " Merci
RCTV, bonjour TEVES !
un
documentaire en ligne : "Es el señal de todos" sous-titres en français
----
|
|
Merci Rctv,
bonjour TVes !
Par
Lionel Mesnard
4 juin 2007
photo : Mme Lil Rodriguez,
présidente de TVes
|
|  |
Le
Venezuela vit à nouveau une période
inquiétante. La levée d’indignation
intervenue - suite à l’arrêt de la
diffusion hertzienne de Rctv (Radio Caracas
Télévision), pose de nouveau la question de la
souveraineté de ce pays ? Contrairement à ce que
pourraient faire croire certains canaux journalistiques, il ne
s’agit pas d’une fermeture totale. Rctv
continue et demeure sur le câble, le satellite et aussi sur
le web, mais n’a plus d’autorisation depuis le 28
mai 2007 sur les ondes hertziennes nationales. Sa concession arrivait
à terme, et il a été
décidé en toute légalité
d’attribuer le canal numéro 2 à une
nouvelle chaîne de télévision du
service public, Televisora Venezolana Social (Teves). Les
polémiques sur la question des médias
n’est pas nouvelle du côté de Caracas,
chaque décision dans ce domaine est contestée. Un
tel acharnement, une telle volonté de désinformer
ou sous informer interroge. Dans ce qui ressemble à des
nouvelles orientées, où se trouve
l’équilibre de la raison de ceux qui
écrivent ou parlent du Venezuela?
Cette
information aurait pu passer pour mineure, elle a fait le tour du
monde. En plus, difficile de traiter un dossier dont on ne montre que
l’aspect liberticide. Qui n’a pas de plus amples
connaissances de la situation, peut prendre à la lettre les
commentaires des dépêches des grandes agences de
presse (AFP, AP, Reuters). Au mieux quelques articles, livres si rares
peuvent répondre à certains questionnements de
fond. Mais à force d’utiliser un type de
vocabulaire, un banal communiqué peut au final devenir un
objet de désinformation. Dans l’ensemble, il
n’aura pas été vraiment
évoqué les problèmes juridiques
soulevés par Rctv. Les difficultés
étant déjà antérieures au
régime actuel, la
décision intervenue du Tribunal Suprême de Justice
confirmant cette décision est à prendre comme une
décision émanant d’un Etat de droit,
souverain de ses décisions. La question de
l’ingérence à ses limites, le Venezuela
n’est pas le Darfour, et à jouer avec le feu, ou
à crier au loup, que cherchent certains groupes de pression
à l’égard de cette nation?
Pourquoi
quand il existe une telle domination des médias
privés être indigné au point de hurler
à un nouveau diktat d’Hugo Chavez ? Quand on a
remis en cause en France 2 canaux hertziens en 1987 (à une
époque où prédominait cette forme de
transmission), cette information n’a pas fait le tour de la
planète en dénonçant
l’horrible dictature du Premier ministre d’alors,
Jacques Chirac. Faits non pris en compte par tous les médias
français, depuis l’arrivée du
président vénézuélien en
1999, ce sont des dizaines de médias et en particulier
associatifs (Tv, radio, presse) qui ont vu le jour, dont 4
télévisions de service public. Le cas
français n’est pas une exception,
d’autres pays depuis 1987 ont en fait de même, en
particulier en Amérique Latine, mais pour le Venezuela cela
devient une affaire internationale.
L’Organisation
des Etats d’Amérique et l’Union
Européenne ont été saisies.
Bizarrement en Europe, cette condamnation fut
téléguidée à
l’initiative des groupes de droite (PPE et Libéraux), avec
l’appui bienveillant du groupe parlementaire auquel
appartient Jean-Marie Lepen, drôle de coïncidence.
En 2002, année du coup d’état contre
Hugo Chavez, en Espagne le Premier ministre est le conservateur Juan
Maria Aznar (le Parti Populaire Espagnol est rattaché au sein de L'U.E. au PPE). Sa proximité de
l’époque avec George Bush n’avait
trompé personne. Et en novembre 2004, le ministre des
affaires étrangères du gouvernement socialiste
Zapatero mettait en cause Aznar dans l’organisation du
renversement d’un pouvoir légitime à
Caracas, le 11 avril 2002. Même cinq ans
après, les vénézuéliens
n’ont pas la mémoire courte. On peut
écrire que Chavez a des problèmes « de
paranoïa », mais il existe des faits nombreux pour
souligner une volonté réelle de
déstabilisation.
S’agissant
de la liberté d’expression et des
prétendues menaces pesantes, j’ai pour exemple ce
que j’ai pu découvrir en lieu et place
à la fin de l’année 2006. Il existe
dans la capitale un peu plus d’une dizaine de
télévisions hertziennes : 3 au lieu de 2
appartiennent à l’état
dorénavant (Vtv, Vive Tv, Teves), une est
propriété de l’agglomération
de Caracas (Avila TV), 2 ou 3 sont associatives (dont Catia TV), 5 ou 6
sont aux mains du privé (Venevision, Seven, Globovision,
…) . Je n’ai pas le détail des autres
modes de transmissions, mais qu’on le veuille ou
pas l’état
vénézuélien est minoritaire
à l’échelle de la capitale
(représentant plus d’un cinquième de la
population).
Pour la presse nationale et
régionale, vous retrouvez quasiment tous les quotidiens
en opposition avec les choix politiques de la
majorité du pays et ce depuis 1999. À Caracas,
vous pouvez trouver un journal progouvernemental, et un ne cachant pas
ses critiques, mais ne participant pas comme le reste de la presse
nationale à la meute. Également, il ne faut pas
oublier l’émergence des autoroutes de
l’information : l’essor de l’internet est
comme partout ailleurs important et sans aucune censure. Pour
information aussi vraiment bizarre, notre
présumée dictature
vénézuélienne met en plus à
la connaissance de tous les textes légaux en ligne.
Paradoxes pour un pays que l’on souhaite assimiler
à Cuba. Il n’y a aucun cybernaute
jusqu’à présent menacé, et
si des journalistes ont maille à partir avec la justice,
il s’agit de cas relevant de malversations et non
le cas de la censure gouvernementale.
Par ailleurs,
j’invite quiconque à se rendre ou regarder
certaines chaînes du Venezuela, de parler aussi avec des
vénézuéliens de leur goût en
la matière. Nous pouvons être en France
très critique sur la qualité, le contenu, le
formatage, la déontologie. Il n’en demeure pas
moins qu’une petite cure de télévision
outre-atlantique peut lever de fortes critiques, et à trop
forte dose provoquer le vertige ou la nausée. Difficile de
ne pas constater que les médias français
audiovisuels n’ont pas vraiment
d’équivalent, même ce qui peut sembler
de pire, c’est-à-dire TF1, à
côté de RCTV, télé Bouygues
apparaîtrait presque pour un must en la matière,
un sommet de la culture… Dans les quartiers populaires quand
on parle de Globovision, l’on parle de
Globo-terreur… - et autres expressions pour expliquer la
tonalité de ses infos. Cela retourne d’une
instrumentalisation de la télévision, et surtout
en terme de qualité et de contenu équivaut
à un sous-produit hollywoodien.
Pareillement
que dire du traitement de l’info, de l’abus abusif
des images et du son, de la médiocrité profonde
des programmes des télévisions privées
latino-américaine. Imaginez un instant un journaliste de
télévision en France se mettre en pub dans son
propre journal pour vendre un produit. C’est le cas
outre-atlantique et cela ne choque pas grand monde. Je ne vais pas vous
aligner toutes les qualités des
télévisions
vénézuéliennes, c’est
à la limite du pathétique. Le rôle
détenu par les patrons de la presse privée en
Amérique Latine est considérable dans les
affaires économiques et politiques. Pour exemple au Chili en
1973, ils furent aux côtés des putschistes, et
cette situation s’est reproduite en 2002 au Venezuela.
Aujourd’hui encore le Chili ne dispose pas d’une
pluralité médiatique aussi vive et
développée qu’au Venezuela, pour autant
Michèle Bachelet n’est pas mise à
l’index.
Exemple frappant
(constaté sur place), ce fut comment sur Globovision,
l’on annonça par avance comment allait
s’organiser au lendemain du 3 décembre 2006 (soir
de la présidentielle) le renversement du pouvoir chaviste,
du 3 au 5 décembre. Un plan fut expliqué
à l’antenne, se déroulant sur
3 jours.
Il allait de soit que les
élections
seraient truquées. À aucun moment, le journaliste
ne recadra les propos de l’invité. Ce Monsieur
Rafael Poleo, en plus traita ni plus ni moins de nazi le gouvernement,
rien à redire en face. À la même
époque, une rumeur circulait, Manuel Rosales serait
assassiné au soir ou au lendemain du scrutin. De
même au titre du bizarre, Manuel Rosales à 20H00
pétantes le soir du 3D reconnaissait sa défaite
et la réélection d’Hugo Chavez Frias.
Une première pour une opposition naguère si
frontale. Rumeur fondée ou pas, Manuel Rosales a
préféré vivre, et garder le leadership
de l’opposition, semble t’il?
Que
tout ceci est bizarre, tant de rappels ici ou là sur le
droit à la liberté d’expression. Il
serait bien plus utile de parler de comment fonctionne la
réalité du droit au Venezuela, ou ce qui
ressemble à un détournement des droits et devoirs
les plus usuels. Je ne suis pas certain, que nous accepterions de tels
mécanismes, ou le droit deviendrait une donnée
floue. Si mérite il y a de la part de Hugo Chavez
c’est de l’appliquer dans sa pratique de
gouvernant. Et d’avoir mis en place par la
constitution des organes en principe indépendants et pouvant
dire la loi (Conseil National Electoral, Tribunal Suprême de
Justice). Mais, venons à la cause fondamentale du
problème de cette société, que sont
les mécanismes corrupteurs gangrenant la
société
vénézuélienne, et ne pas rentrer dans
ce type de schéma local relève du sacerdoce. Il
va de soit que les plus pauvres ne sont pas les gagnants
d’une telle compromission, et occasionne de fait une
injustice aux plus laborieux.
Quand un pays entier
joue sa monnaie au marché noir en spéculant sur
des devises en euros et en dollars, il y a plus qu’une
épine dans le pied. Quand les entreprises cachent leurs
dividendes et ne déclarent pas les recettes aux
impôts, ou bien quand on s’assoit sur le droit du
travail, c’est du domaine du normal. Quand des fonctionnaires
ne viennent pas travailler ou s’opposent aux
décisions de l’État, ou même
ont pu s’attaquer dans le cas de PDVSA (compagnie nationale
des pétroles) à l’outil de travail,
faut-il être un dictateur un peu étrange pour
vouloir faire appliquer la légalité
républicaine ? Et ceci n’est que le haut de
l’iceberg et de comment est détournée
la loi et profite à quelques
privilégiés. Cette opacité des
mœurs et coutumes de la bourgeoisie et des élites
entrave la justice. Depuis plus de 50 ans, l’on forme
à tour de bras des juristes dans les universités
aisées, loin des besoins spécifiques du pays.
Cette même jeunesse dorée qui a
manifesté une nouvelle fois de plus son hostilité
furibarde.
En avril 2002, le rôle actif
de Rctv et autres médias dans la désinformation
du public, ce soutien aux auteurs du putsch a été
mis en lumière par des cinéastes documentaires,
des journalistes vénézuéliens. Ces
éléments ont même servi de preuves, et
expliqué les manipulations et dessous du coup
d’état. Cette réalité en
Europe n’a pas vraiment été prise en
compte. Il faudrait à cela rajouter le travail
d’enquête, mené par l’avocate
Eva Golinger sur les soutiens financiers et les appuis du
département d’état
étasunien, et certaines O.N.G paravents du parti
Républicain ou des néo-conservateurs US (la NED
et SUMATE entre autre). Il existe possiblement une volonté
d’éliminer non seulement Hugo Chavez mais de
même l’ensemble de ses partisans. Il est hors de
question pour les administrations étasuniennes
d’accepter qu’une nation sud américaine
puisse avoir le droit de s’émanciper. 300 ans de
colonialisme, plus 200 ans d’impérialisme
économique devraient offrir à cette jeune nation
de vivre ses rythmes démocratiques comme elle
l’entend. À Washington il est imposé
une chasse gardée, ou des réserves indiennes
à l’échelle de tout un continent. Ce
cynisme qui prévaut aussi pour l’Afrique pour nous
autres européens est un non-sens pour un
développement mondial plus harmonieux.
Les
déstabilisations sont régulières,
à l’exemple des communiqués de
l’ambassade des Etats-Unis. Cela a provoqué fin
novembre, début décembre 2006 des
réactions dans la capitale. Une prétendue
pénurie allait s’installer, et beaucoup de
caraquéens se ruèrent sur les produits des
magasins alimentaires. Il avait été
notifié aux résidents étasuniens de
faire des réserves de médicaments et de
nourriture et de rester chez eux à l’approche des
élections. L’ambassade de France sur son site
internet mettait en garde contre certaines rumeurs et incitait
simplement les français à se tenir à
distance des rassemblements. À l’annonce
de la fin des programmes de Rctv en hertzien le 27 mai dernier, un
communiqué de l’ambassade étasunienne
quasi comparable à un autre d’avril 2002
décrétait l’alerte maximum pour ses
concitoyens. Doit-on y voir un lien à la semaine de
désordre qui s’est déroulé
notamment à Caracas ? Pour quelques petits milliers de
personnes hostiles et très déterminées
sur tout le pays, les manifs ont donné lieu à de
nombreux blessés et à deux morts.
Samedi 2 juin, la réponse a été
cinglante, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues
soutenir le choix de réappropriation par la nation
vénézuélienne de ses canaux hertziens.
Cette décision qui aurait pu
presque passer pour inaperçue a donné lieu
à une information reprise le plus souvent sans
développement. Victoire du superficiel sur le fond,
l’enjeu demeure de sortir le Venezuela de certaines
caricatures. Pouvons-nous vraiment juger une
actualité si lointaine ? Il y a peu de monde en
France à être en mesure d’y
répondre, relativement peu de journalistes capables
d’analyser ce qui se passe là-bas. La question
n’est pas de s’abstenir de toutes critiques, ou
encore moins d’idolâtrer Hugo Chavez.
C’est trop de bruits pour pas grand-chose, quand ce qui
pourrait être plus utile, plus constructif et loin de la
confusion pourrait soutenir ce pays dans sa marche vers le
progrès.
Aussi étonnant
soit-il le Venezuela est très proche des Usa culturellement,
les vénézuéliens, en
réalité une petite minorité a très bien vécue et continue encore
à vivre dans une opulence certaine. La grande
majorité a été
relégué à l’état
d’invisibles, certaines minorités le demeurent
encore. Socialement il s’agit de 80 % de la population qui
ont pu grâce aux actions du gouvernement sortir un peu de
l’ombre. Le pétrole est à la fois une
chance mais en partie son malheur. Cette contrée ne
retiendrait pas l’attention si elle ne disposait pas de
telles réserves en hydrocarbure et pouvant peser sur les
besoins de la planète. Il y aurait un véritable
échec d’Hugo Chavez s’il ne
réussissait pas à industrialiser, à
mettre en œuvre l’autonomie alimentaire,
à faire tomber un à un les mécanismes
corrupteurs. Selon un schéma, qui se reproduit dans les pays
mono producteurs, il n’existe pas en
l’état de pays qui a pu sortir de la
dépendance extérieure. Il ne s’agit pas
d’un commerce équilibré, mais
d’un marché annexe et subalterne et une
population livrée aux aléas des cours boursiers.
Le
bilan depuis 1999 serait à pondérer, des
réussites et aussi quelques échecs, mais
globalement l’économie fonctionne à
plein. Le socialisme de Chavez a les traits d’une
économie mixte, qui fut très chère
à François Mitterrand. Qui veut faire fortune, le
peut, et je ne crois pas que le Venezuela ira vers une
économie à la cubaine, sauf si elle venait
à connaître un embargo, mais il y aurait
là une volonté ni plus ni moins de guerre
à l’égard de cette nation libre. La
France accepterait-elle une telle ingérence dans ses
affaires intérieures ? Accepterions-nous tant de
remontrances paternalistes sur des questions au demeurant
minimes ? Pourquoi ce mépris ? Que cherche t-on à
montrer ou à cacher concernant les besoins vitaux de la
société
vénézuélienne ? Ce qu’ont
fait les gouvernements chavistes en huit ans par leur travail de
réforme vaut largement les 30 ans d’alternance bi
partisane, et sans les milliers de victimes ou coupables
d’avoir lutté pour une meilleure redistribution
des richesses.
Ceux qui aiment et
s’intéressent au Venezuela ne sont pas dupes.
Sortir le Venezuela de sa situation de pays pauvre ne se fera pas en
quelques années après plus deux
siècles de domination économique. Faire tomber un
emblème de la toute puissance étasunienne ne
m’a pas gêné, et je suis
plutôt satisfait de voir la naissance d’une
nouvelle télévision du service public. Ces
dernières années nous fûmes
habitués au contraire. L’on cherche à
le traduire en des vérités intangibles, sans rien
nous expliquer du paysage audiovisuel
vénézuélien et d’ailleurs.
Une télévision comme
Télésur, chaîne internationale
d’information est un sacré bol d’air
frais, Vive Tv est un espace de création et de la
mémoire populaire de qualité, et souhaitons que
Teves, la nouvelle vienne donner à la
récréation toute sa place sans avoir à
parodier le mercantilisme des télévisions
latino-américaines.
Ah si
j’oubliais, c’est une femme qui dirige le nouveau
canal deux : TEVES ou TVes. Madame Lil Rodriguez,
s’occupait jusqu’à présent de programmes culturels sur
Télésur. Journaliste, elle est connue pour son
goût pour la culture et la musique Afro-Caraïbe. De
quoi envisager une télévision aux figures du pays
réel…!?
En complément un documentaire en vidéo de 57 minutes sur RCTV :
----
"Es el señal de todos" (vost)
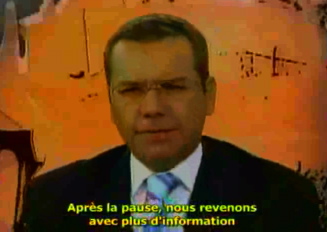 -----------Une réalisation collective de cinéastes et journalistes vénézuéliens(Version originale espagnole sous-titrée en français) -----------Une réalisation collective de cinéastes et journalistes vénézuéliens(Version originale espagnole sous-titrée en français)Vous pouvez à partir de ce lien, regarder la vidéo ou la télécharger !-------
Attention, le film est en mp4 (fichier de 124 Mo) en grand format et adapté à du haut débit,
et fonctionne de préférence avec le logiciel Quicktime version 7
----------
Équipe de réalisation :
--------------
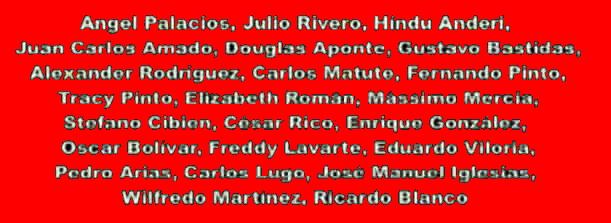
C'est une production de Panafilms, ANMCLA, FIPP, et Avila TV (2007)
Ce
document est libre de droit, mais ne doit en aucun cas être
le fait d'un usage commercial, ou autres interventions sur le contenu sans
l'autorisation des auteurs. Donc chacun est libre de l'utiliser pour
son usage personnel, familial, ou associatif.
|
|
|
|
Affaire RCTV ...
Il faut d’abord balayer
devant sa porte
Diana Cariboni, 4 juin 2007 |  |
En
Amérique latine, certains font tout un plat de la fin des
transmissions de la chaîne de télévision RCTV,
à laquelle le gouvernement vénézuélien
n’a pas voulu renouveler la concession d’une
fréquence qu’elle exploitait depuis 1956.
Trois
ex-présidents panaméens, Mireya Moscoso, Guillermo Endara
et Ernesto Pérez-Balladares planifient d’exercer un
intense lobby pour que l’Assemblée générale
de l’Organisation des Etats Américains (OEA) traite le cas
RCTV lors de sa réunion du week-end prochain [week-end du 1er et
2 juin 2007, ndlr]. Le président péruvien Alan
García a affirmé, à propos de la mesure
vénézuélienne, que « jamais une telle chose
ne se fera » dans son pays.
Une telle chose comme quoi,
pourrait-on se demander. Nombreux, au Venezuela, affirment que Radio
Caracas Télévision (RCTV) en est arrivée à
cette situation parce qu’elle s’oppose au gouvernement
d’Hugo Chavez. D’autres la qualifient de putschiste pour
avoir soutenu l’attentat contre la démocratie
d’avril 2002 [le coup d’État des 11-12-13 avril
2002, ndlr].
Dans la Colombie voisine, le journaliste Juan
Gossain, de RCN Radio, a demandé au président Alvaro
Uribe : « L’expression que vous avez utilisée sur
votre respect de la liberté de la presse me conduit à
supposer que vous n’ôteriez pas par exemple à Radio
Caracas sa licence de fonctionnement ».
« A
personne. Pour mieux dire, qu’ils exercent le journalisme sans
licence, qu’ils disent ce qu’ils veulent, qu’ils
parlent partout », a-t-il répondu.
Uribe ne peut
pas fermer de chaîne de télévision
d’opposition parce qu’elles n’existent pas.
Toutefois, il a mis un terme en octobre 2004 à l’Institut
de Radio et Télévision (Inravisión), un organisme
public qui gérait trois signaux ouverts avec des franges
horaires éducatives et culturelles, un programme radio
d’interviews sur le mouvement social et des documentaires aux
contenus souvent dérangeants pour le gouvernement.
Le
président colombien avait annoncé la fermeture
d’Inravisión un lundi et le jeudi suivant, « la
police est entrée et a délogé les travailleurs la
nuit même », raconte le sociologue Milciades
Vizcaíno à IPS. Celui-ci a travaillé presque 27
ans dans le secteur de la télévision éducative,
qui a été éliminée.
Bogota
alléguait que Inravisión était inefficace. «
Mais le fond de l’affaire était la force dont disposait le
syndicat », soutient Vizcaíno, auteur du libre «
Université et moyens de communication. De l’état de
bien-être au marché », publié en avril et
dans lequel il analyse le processus inverse à celui qui a
été entamé au Venezuela, en destinant la
fréquence de RCTV à une chaîne publique.
Inravisión
a été remplacée par Radio Televisión
Colombia (RTVC) qui « sous-traite » des activités
moyennant des contrats de concession, en évitant la
création d’un syndicat. Elle économise 72% des
coûts opérationnels. Les transmetteurs sont
gérés par une autre entreprise, Telecom.
En octobre, au cours du discours du sénateur d’opposition Gustavo Petro [1]
sur les liens entre paramilitaires d’extrême droite et des
politiciens des départements de Sucre et Córdoba [2],
le signal de la chaîne publique, géré maintenant
par RTVC et qui retransmet fréquemment depuis le parlement, a
disparu dans ces deux département du nord de la Colombie.
Face
aux plaintes, RTVC a remis l’affaire à Telecom. Mais
« là, personne n’a pu donné
d’explication », a signalé Hernán Onatra,
responsable presse du sénateur.
« Il n’y a
pas que la télévision publique. Des opérateurs
privés par câble ont également suspendu le signal
dans certains secteurs de Bogotá et de villes principales, comme
Cúcuta (nord-est) et ils n’ont jamais fourni
d’explication. On nous l’a rapporté durant le
débat ou le jour d’après », a-t-il
ajouté.
Au Honduras, le président Manuel Zelaya a
initié depuis le lundi 28 mai une série de 10
transmissions d’un heure chaque jour par « cadena » [3]
de radio et de télévision, en prime time pour
contrecarrer ce qu’il qualifie de « désinformation
» de la presse sur sa gestion.
La loi stipule qu’on
ne peut transmettre de « cadenas » que pour convoquer des
élections, dans le cas de désastres naturels ou
d’urgence nationale. Par conséquent, la mesure rappelle
l’usage fréquent que faisaient les militaires de ce
mécanisme dans les années 70 quand ils gouvernaient et a
été critiquée par des associations de
journalistes, des médias et même par le président
du parlement Roberto Micheletti.
L’analyste politique Juan
Ramón Martínez a affirmé à IPS que la
décision « porte atteinte à la liberté
d’expression » et constitue un abus, « même les
militaires n’ont pas été aussi loin que ce que nous
annonce l’actuel gouvernement ».
Le journaliste
Edgardo Escoto, qui couvre l’actualité gouvernementale
pour la radio d’opposition Circuito Radial Voces, a confié
quant à lui à IPS qu’il a été
censuré par les porte-parole de la présidence «
pour ne plus poser de questions ». « Ils refusent de me
donner la parole, ils me cachent l’agenda du président
», a-t-il dit.
Le dernier média au Nicaragua dont
la concession fut révoquée pour d’apparents motifs
politiques a été Radio La Poderosa en 2002, durant le
mandat d’Enrique Bolaños. Ses équipements ont
été confisqués sans procès judiciaire. La
radio critiquait le gouvernement avec acharnement et était
proche de l’ex-président Arnoldo Alemán,
condamné par la justice [pour blanchiment, fraude et
détournement de fonds, ndlr].
Quand Alemán
gouvernait (1997-2001), des journaux critiques comme La Prensa ou El
Nuevo Diario ont dénoncé le harcèlement fiscal et
le boycott commercial du gouvernement pour avoir informé de
faits de corruption de fonctionnaires publics.
RCTV n’est
pas le seul média qui « cesse » ses activités
par une mesure du pouvoir au Venezuela. Durant les deux jours
d’avril 2002 au cours desquels Chavez fut écarté du
pouvoir par la force, les putschistes avaient fermé le Canal 8,
la chaîne publique.
En 2003, le maire du district de
Caracas, Alfredo Peña, un opposant à Chavez, avait aussi
fermé la télévision communautaire Catia Tv.
Les
partisans du gouvernement se vantent qu’« ici, les seuls
qui ont fermé des médias, c’est l’opposition
» et ils insistent sur cela. Dans le cas de RCTV, « il ne
s’agit pas d’une fermeture mais d’un non
renouvellement de la concession », a répété
à IPS l’ex-ministre de l’Information et
président de la chaîne régionale Telesur,
Andrés Izarra.
Mais la gestion discrétionnaire des
concessions « met dans une situation difficile, presque
d’incertitude, plus de 150 radios privées qui sont dans
l’attente d’un renouvellement de leur licence
», observe Ciro García, président de la Chambre de
radiodiffusion.
De plus, l’organisme national des
impôts [le SENIAT, ndlr] a dressé une amende de 13 000
dollars et a fermé durant deux jours, en octobre 2005, le
quotidien centenaire El Impulso - dont la ligne éditoriale est
d’opposition - dans la ville de Barquisimeto, dans le
centre-ouest du pays
Des amendes de millions de dollars ont
été dressées contre RCTV et la chaîne
d’information en continu Globovisión, plusieurs
équipements satellitaires leur appartenant ont été
retenus indéfiniment il y a deux ans [4],
quand une inspection les a retrouvés orientés dans une
direction distincte à celle autorisée. Aucune
d’elles ne reçoit de publicité du gouvernement.
Mais
« si nous comparons la diversité des médias au
Venezuela, il y a beaucoup plus de liberté d’expression
qu’au Chili », par exemple, pour le coordinateur du
Programme de liberté d’expression de l’Institut de
Communication et d’Image de l’Université publique du
Chili, Felipe Portales.
Même si au Chili, on n’a pas
enregistré de mesures arbitraires contre les médias au
cours des dernières années, la liberté est
restreinte de par la concentration de la propriété, selon
Portales et la directrice de l’Observatoire des médias
Fucatel, Manuela Gumucio.
« A l’exception de Cuba,
le Chili est le pays avec le moins de liberté d’expression
en Amérique latine, en termes de pluralité des
médias », avec une situation « pire
qu’à la fin de la dictature » d’Augusto
Pinochet, en 1990, fait remarquer Portales. [5]
La
couverture du cas RCTV est une preuve. « Les médias
chiliens n’ont diffusé qu’une seule version, celle
qui s’oppose à Chavez. Nous n’avons pas les
éléments nécessaires pour nous faire une opinion
sur cette affaire », affirme-t-il.
Tant Portales que
Gumucio expliquent le manque de diversité à cause de la
distribution inégale de la publicité d’État.
Comme
en Colombie, mais pour des raisons différentes, à Cuba
non plus il n’y a pas de chaîne d’opposition à
fermer.
La propriété privée des
médias est morte dans les années 60, après
l’avènement du processus révolutionnaire. La presse
écrite, la radio et la télévision sont
régies par une politique que conçoit, dirige et
contrôle le Parti communiste de Cuba.
Les opposants,
considérés comme des « mercenaires à la
solde de l’Empire » (les Etats-Unis) n’ont pas
accès à ces médias. Un groupe de journalistes
autonomes du gouvernement ou ouvertement critiques ont
été sanctionnés en 2003 par de lourdes peines de
prisons sous l’inculpation de transmettre ou de faciliter des
informations à des médias ennemis. [6]
L’exception
sont les revues catholiques Palabra Nueva et Vitral, fondée en
1994 dans le diocèse de la province de Pinar el Río, dans
l’ouest du pays. L’équipe éditoriale de
Vitral est entrée en crise au début de cette
année, après l’arrivée du nouvel
évêque Jorge Enrique Serpa.
Vitral a acquis de la
notoriété par son approche critique de la
réalité cubaine, mais Serpa a décidé que la
publication évitera dorénavant l’ «
agressivité » et sera moins contestataire.
La
censure au Mexique, commune à tous les gouvernements du Parti
Révolutionnaire Institutionnel (PRI) depuis 1929 a
commencé à reculer au milieu des années 90.
Mais
le Diario Noticias de Oaxaca, qui circule depuis 31 ans dans
l’état du même nom, dans le sud du pays, et qui est
très critique envers le très contesté gouverneur
Ulises Ruiz, a été la cible d’attaques depuis 2005,
dont des agressions contre des journalistes et des tentatives de
délogement par la force.
Radio Monitor, en
activité depuis 1975, a été un des rares
médias à s’être affronté aux
années de censure du PRI. Son propriétaire, José
Gutiérrez, affirme que le Parti d’Action Nationale (PAN),
au pouvoir, le punit en le privant de publicité gouvernementale
à cause de ses prises de positions critiques et en lui refusant
des interviews et des informations.
L’unique parti qui,
quand il gouvernait, a révoqué une concession de
fréquence en Uruguay, le Parti National (PN), de centre droit, a
réclamé sans succès du gouvernement du Frente
Amplio (gauche) une déclaration de condamnation pour le cas RCTV.
La
gauche a rappelé que le gouvernement du nationaliste Luis
Alberto Lacalle a été le seul à prendre une mesure
similaire dans l’histoire uruguayenne et « sans attendre
que le permis arrive à expiration », a rappelé le
sénateur de la majorité Eleuterio Fernández
Huidobro.
Lacalle a expulsé CX 44 Radio Panamericana des
ondes en 1994 pour avoir convoqué la population à une
manifestation, durement réprimée, contre
l’extradition vers l’Espagne de trois citoyens de ce pays
accusés d’appartenir au groupe séparatiste basque
ETA.
Cet article a été rédigé
grâce aux contributions de Constanza Vieira (Colombie), Daniela
Estrada (Chili), Patricia Grogg (Cuba), Thelma Mejía (Honduras),
Diego Cevallos (Mexique), José Adán Silva (Nicaragua),
Humberto Márquez (Venezuela) et Darío Montero (Uruguay).
NOTES :
[1] [NDLR] Gustavo
Petro, sénateur de gauche, membre du Pôle
démocratique alternatif, est certainement la figure politique la
plus en vue dans les dénonciations du scandale connu comme la
« parapolitique », à savoir l’infiltration de
l’État par le paramilitarisme, un scandale qui touche tout
l’entourage du président Uribe.
[2] [NDLR] Consultez
à ce propos sur le RISAL le dossier « Paramilitarisme et
parapolitique » dans notre rubrique sur la Colombie.
[3] [NDLR] Procédé
qui consiste à imposer à toutes les radios et
chaînes de télévision de diffuser un même
programme, une allocution du président par exemple.
[4] [NDLR] Lire
à ce propos Thierry Deronne, Difficile naissance d’un
État au Venezuela : la vérité comme pot de terre,
RISAL, 4 octobre 2003.
[5] [NDLR] Consultez à ce propos sur le RISAL le dossier « Médias » dans notre rubrique sur le Chili.
[6] [NDLR] Lire notamment Wayne S. Smith, Pourquoi les arrestations à Cuba ?, RISAL, 8 avril 2003.
Sources : IPS Noticias (http://www.ipsnoticias.net/), traduction : Frédéric Lévêque,
pour le RISAL (http://risal.collectifs.net/).
|
"Je n'ai rien vu au Venezuela"
par Sébastien Brulez, 1er juilet 2007
|
|  |
En
janvier 1990, quelques semaines après son retour de Roumanie,
Colette Braeckman publiait dans le journal Le Soir un article
intitulé "Je n'ai rien vu à Timisoara", constatant le
mensonge médiatique qui avait entouré la supposée
découverte de charniers dans la ville du même nom. On
avait retrouvé des centaines de corps dans les fosses communes,
des jeunes gens vidés de leur sang. "Dracula était
communiste" avait même titré, le 28 décembre 1989,
le journal français L’événement du Jeudi (1).
Il s'avérera plus tard que tout n'était que montages et
mensonges. Et pourtant tout le monde y avait cru, la
télévision avait même montré des images,
c'est dire si c'était vrai!
La journaliste du Soir écrivait alors (2)
: "J'y étais et je n'ai rien vu : honte sur moi. Car par contre
en arrivant à Bucarest le lendemain, et plus encore en rentrant
en Belgique, tout le monde en savait plus que moi sur le sujet. Nul
n'ignorait rien de ces corps affreusement torturés, de ces
centaines de corps alignés, de ces hôpitaux envahis, la
télévision avait tout montré, tout
expliqué. Et si c'était passé à la
télévision, c'était vrai. Cela devenait vrai.
Alors moi, qui n'avais rien vu à Timisoara, j'ai
préféré me taire..."
Un Dracula tropical?
En
voyant la façon dont la presse européenne traite
l'information sur ce qui se passe actuellement au Venezuela, je ne peux
m'empêcher de repenser à cet article de Colette Braeckman,
véritable cas d'école du journalisme contemporain. Parce
qu'aujourd'hui et depuis bientôt dix mois, moi non plus je ne
vois rien au Venezuela. Évidemment personne ne parle de
charniers ni de corps mutilés. Cependant on essaie sans cesse de
nous créer l'image d'un Chávez "dracula-communiste".
Les
prétextes pour attaquer la révolution bolivarienne sont
légions. Ce fut d'abord la loi dite "habilitante",
approuvée en janvier dernier par l'assemblée nationale.
Cette loi donne au président de la République la
possibilité d'émettre des décrets ayant force et
valeur de loi dans 11 domaines spécifiques (transformation des
institutions, participation populaire, sciences et technologies,
économique et social, énergétique, etc.) et ce
durant 18 mois.
Vint ensuite le projet de réforme
constitutionnelle et la pseudo présidence à vie du
Comandante. Alors que l'idée évoquée est
simplement qu'un président puisse se représenter aux
élections autant de fois qu'il le souhaite, comme c'est le cas
en France.
Plus récemment, on a entendu parler du
Venezuela pour la "fermeture" d'une chaîne de
télévision. Il ne s'agissait en fait que d'une
décision légale pour un Etat de ne pas renouveler une
concession. Pour l'envoyé spécial du Monde à
Caracas, le président du Venezuela est "le lieutenant-colonel
putschiste" (3). Et selon
le quotidien catalan La Vanguardia, "la fermeture de la chaîne de
télévision privée accentue le caractère
totalitaire du gouvernement de Hugo Chávez".
Pourtant,
lorsque l'on se promène dans les quartiers, on a du mal à
percevoir l'autoritarisme dont nous parlent les médias. "Le
président sait très bien qu'il ne peut pas faire ce qu'il
veut. De la même manière que le peuple l'a amené au
pouvoir, le peuple peut l'en révoquer", me commentait une
vendeuse ambulante au lendemain des élections, en
décembre dernier.
Et elle n'est pas la seule à
tenir ces propos, l'article 74 de la Constitution approuvée par
référendum en 1999 va dans le même sens : "Seront
soumises à référendum, pour être
abrogées total ou partiellement, les lois dont l'abrogation
serait sollicitée à l'initiative d'un nombre non
inférieur à 10% des électeurs (...) ou par le
Président ou la Présidente de la République en
Conseil des Ministres. Pourront également être soumis
à référendum abrogatoire les décrets ayant
force de loi que dicte le Président ou la Présidente de
la République en vertu de l'attribution prescrite dans
l'alinéa 8 de l'article 236 de cette Constitution (ndlr :
l'alinéa 8 de l'article 236 fait référence
à la loi "habilitante"), si cela est sollicité par un
nombre non inférieur à 5% des électeurs (...)" (4).
Drôle d'autocratie que celle qui soumet ses lois à
référendum à la demande de moins de 5% de ses
électeurs.
Les miradors de Juan
Lorsqu'on
demande à Juan Contreras ce qui a changé pour lui depuis
l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez, il n'hésite
pas un instant avant de répondre : "Avant Chávez, ma
maison avait été fouillée 49 fois par la police.
Ces huit dernières années, on ne m'a plus ennuyé
une seule fois." Juan est actif dans les luttes sociales depuis son
plus jeune âge. En décembre dernier son association, la
Coordinadora Simon Bolivar, fêtait son treizième
anniversaire. Depuis 2005, elle dispose enfin d'un siège : un
ancien commissariat de police occupé par les habitants du
quartier et transformé en centre culturel. "Pour nous il
s'agissait d'une question de principe. Occuper ce commissariat qui,
depuis 1975, avait été le centre de torture et de
répression contre les mouvements contestataires du quartier,
c'est tout un symbole." Les miradors bétonnés qui
surplombent l'urbanisation du 23 de Enero ornent toujours le
bâtiment, comme pour rappeler le temps où la
répression était bien réelle.
Mais les
médias occidentaux ne font que rarement référence
à cette époque pourtant pas si lointaine. En
février 1989, à peine deux semaines après la prise
de possession du social-démocrate Carlos Andrés
Pérez, c'est l'explosion sociale. L'application du paquet de
réformes néolibérales imposées par le FMI
donne le coup de grâce à la population. Le
mécontentement éclate dans les rues de la capitale, c'est
ce qu'on a appelé le Caracazo. Pour contenir les manifestations
et les pillages, le président Pérez envoie l'armée
qui tire sur la foule. Les médias parleront de 300 morts, la
répression dans les jours suivants fera monter le bilan à
près de 3000. A ce moment-là personne ne parlait de
totalitarisme ni de "régime à dérive autoritaire".
Mais
finalement qu'est-ce qui dérange chez Hugo Chávez? Est-ce
vraiment son "autoritarisme", son "populisme", comme on aime souvent le
qualifier? Ou est-ce simplement le fait que les réserves du
cinquième producteur mondial de pétrole (qui est
également le troisième fournisseur des Etats-Unis)
profitent aujourd'hui non plus (autant) à nos multinationales
européennes et américaines mais bien aux couches les plus
démunies de la population? Ou serait-ce encore que ce pays,
grand comme 26 fois la Belgique, est en train de donner le mauvais
exemple en démontrant qu'une alternative au sacro-saint
modèle néolibéral est possible?
Car
au-delà de la figure de Chávez, c'est un peu le
réveil latino-américain tout entier qui est
critiqué par nos médias. Evo Morales est lui aussi devenu
un "dangereux extrémiste" depuis qu’il a
décrété la nationalisation des ressources
naturelles de la Bolivie. "L'Amérique latine ne vit pas une
époque de changements mais un changement d'époque"
répète sans cesse Rafael Correa, élu
président de l'Equateur il y a quelques mois et
immédiatement critiqué par la presse pour son
rapprochement avec le Venezuela.
La question qu'on peut se poser
est de savoir si l'Europe (ses politiciens, ses journalistes... et ses
citoyens) est prête à ouvrir les yeux sur ce changement.
Est-elle aussi tolérante qu'elle le prétend et
acceptera-t-elle qu'un continent base son développement sur un
modèle distinct? Arrêtera-t-elle un jour de faire
l'amalgame entre libéralisme économique et
libertés individuelles (5)?
Le président de la chaîne latino-américaine
TeleSur, Aram Aharonian, écrivait récemment :
"Arrêtez de nous répéter que les
Latino-américains ont une crise d'identité. En fait, on
dirait que ce sont les Européens qui ont une crise
d'identité : pour nous, il est de plus en plus difficile de ne
pas les confondre avec les Etasuniens." (6)
Finalement,
le titre de cet article est peut-être mal choisi, car on peut
voir et entendre tellement de choses au Venezuela. Entre
avancées et déviations, la complexité de la
situation mérite bien plus que de simples clichés.
Malheureusement ce qui nous parvient n'est qu'une infime partie de la
réalité. Et nous savons tous qu'une réalité
incomplète est une réalité tronquée. Il
serait temps que nos médias arrêtent de se cacher
derrière une pseudo objectivité et qu'ils fassent preuve
d'un peu plus d'honnêteté intellectuelle... Ou alors
qu'ils assument clairement leurs orientations politiques.
Notes :
(1) Serge Halimi, "Les vautours de Timisoara", Acrimed, http://www.acrimed.org/article1.html#nh5, octobre 2000.
(2) Colette Braeckman, "Je n'ai rien vu à Timisoara", Le Soir, 27 et 28 janvier 1990.
(3)
Paulo A. Paranagua, "Miguel Angel Rodríguez, une voix de trop
pour Hugo Chávez", Le Monde.fr, 25 mai 2007,
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-914730@51-897252,0.html
(4) Article n°74 de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela.
(5)
Lire aussi Raoul Marc Jennar, "Le libéralisme, ennemi des
libertés", Le Journal du Mardi, 30 janvier 2007,
http://www.urfig.org/chronique_mensuelle-petit.htm
(6) Aram Aharonian, "No : no compramos más espejitos", Question, n°50, janvier 2007.
Source : La voix du sud,
http://voixdusud.blogspot.com/2007/07/je-nai-rien-vu-au-venezuela.html |
|
Huit questions
et
huit réponses
provisoires
sur la «
révolution
bolivarienne »
Marc
Saint-Upéry, janvier 2007
photo : revue Mouvements n° 47/48
|
| 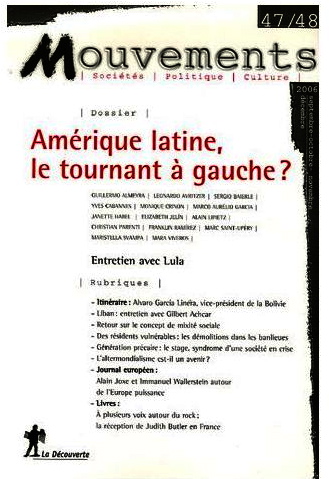 |
Il
n’est guère de phénomène de
la scène politique latino-américaine qui
soit à la fois plus commenté et plus
méconnu dans sa dynamique réelle
que la « révolution bolivarienne » au
Venezuela. Pour les uns, le
chavisme est un régime populiste autoritaire, tendant
à étouffer la
société civile et à menacer les
libertés démocratiques. Pour les
autres, le « socialisme du XXIe siècle »
défriche la voie des
lendemains qui chantent pour les peuples de la région. La
vérité est un
peu plus compliquée, et parfois plus surprenante
[1].
«
Le
problème de fond, c’est que le Venezuela a une
société très peu propice
à la révolution, telle que, nous, les marxistes,
nous l’entendons. Le
pétrole a créé dans ce pays une
société fort semblable à celle de
l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Mendiants,
quémandeurs, intrigants
de cour et bureaucrates constituent l’essentiel de nombreuses
couches
de la société, ou du moins y ont un poids
considérable. Une société de
ce type produit des révoltes mais pas de
révolutions, des mutineries
mais pas de tempêtes sociales. Et surtout, dans une
société de ce type,
tous espèrent des changements sans pratiquement faire
d’effort et des
solutions plus rapides que l’éclair. »
Domingo Alberto Rangel
Chávez est-il de
gauche?
Dans
sa jeunesse, Chávez a subi l’influence du petit
milieu communiste de sa
province de Barinas, sans pour autant jamais s’engager dans
une
militance active. Dans les années 1970 et 1980, il a
participé aux
intrigues entre divers cercles de jeunes officiers et les secteurs de
la gauche radicale vénézuélienne qui
pratiquaient une forme d’entrisme
en milieu militaire. C’est à la tête
d’une coalition de petits partis
de gauche alliés à son propre mouvement, le MVR
(Mouvement pour la Ve
République), qu’il a accédé
au pouvoir fin 1998. Nombre de hauts
fonctionnaires du gouvernement bolivarien proviennent de la
guérilla
des années 1960 ou de la gauche socialiste qui lui a
succédé.
Dans
les années 1990, Chávez s’est
laissé séduire par le nationalisme
anti-impérialiste exacerbé de Norberto Ceresole,
un idéologue argentin
antisémite et proche des militaires
d’extrême droite « carapintadas
»,
qui prônait une espèce de
nasséro-péronisme autoritaire et «
post-démocratique » - selon ses propres termes -
fondé sur la pyramide
caudillo-armée-peuple. Sans doute lassé des
frasques idéologiques de
son conseiller, Chávez finit par l’expulser du
Venezuela en 1999. Au
début de son mandat, il invoquait à tout bout de
champ L’Oracle du
guerrier, un manuel de sagesse new age à la Paulo Coelho
écrit par un
autre Argentin, Lucas Estrella. Plus récemment, il
s’est employé à
faire partager à ses collaborateurs son enthousiasme pour
Les
Misérables, de Victor Hugo. Jadis admirateur
déclaré de la troisième
voie de Tony Blair, qu’il voue maintenant aux
gémonies, il profite
souvent de ses visites à l’étranger
pour multiplier les professions de
foi les plus hétéroclites, se
déclarant volontiers castriste à Cuba,
maoïste en Chine ou admirateur du Livre vert de Kadhafi en
Libye.
D’aucuns voient en lui un opportuniste cynique
obsédé par le pouvoir et
totalement dépourvu de véritables convictions
idéologiques. Pourtant,
Chávez est sans doute sincère lorsqu’il
dit que son cœur saigne pour
les pauvres, d’autant plus qu’il se
perçoit lui-même comme un petit
provincial plébéien et «
zambo » (c’est-à-dire porteur
d’un phénotype
afro-indien) rejeté par l’oligarchie et
« la gente bien », les
« gens
biens ».
En l’absence
d’un corps de doctrine très
élaboré, il
est parfois difficile de discerner ce qui rassemble autour du projet
bolivarien les communistes orthodoxes du PCV, qui n’ont pas
vraiment
digéré la chute du mur de Berlin, les divers
sociaux-démocrates
repeints aux couleurs bolivariennes, les populistes radicaux de
l’UPV
(Union du peuple vénézuélien)
liés à la figure haute en couleurs de la
pasionaria plébéienne Lina Ron, animatrice
d’un célèbre programme de
radio chaviste, les militants qu’exalte la mythologie
guévariste, les
activistes sociaux issus des luttes urbaines des années
1990, les
courants de la gauche syndicale porteurs de traditions
d’autonomie
ouvrière datant des années 1980 ou les adeptes de
la participation
populaire et de l’économie sociale. Au sein du
principal véhicule
politique du processus bolivarien, le MVR, on voit se côtoyer
orphelins
de la gauche radicale et vieux renards de la politique traditionnelle
opportunément convertis à la
rhétorique révolutionnaire.
Caractérisé
par une structure organisationnelle tout à la fois
ectoplasmique et
très verticale, ce parti constitue aussi une commode
plate-forme
électorale et professionnelle pour les centaines de
militaires
reconvertis en entrepreneurs publics ou privés qui peuplent
aujourd’hui
l’appareil d’État.
Face
au chavisme, il existe aussi une gauche
anti-chaviste. C’est le cas des réformistes du MAS
(Mouvement vers le
socialisme, à ne pas confondre avec son homonyme bolivien),
entrés en
opposition après un peu plus d’un an de
participation au gouvernement,
mais aussi des marxistes-léninistes de Bandera Roja, qui
contrôlent des
secteurs substantiels du mouvement étudiant et
prêtent leur service
d’ordre musclé aux manifestations de
l’opposition. Une bonne partie des
plus éminents intellectuels marxistes
vénézuéliens ayant
participé aux
luttes armées et civiles des années 1960, 1970 et
1980 dénoncent de
façon parfois virulente un régime
qu’ils considèrent comme une vaste
escroquerie idéologique. C’est le cas de Domingo
Alberto Rangel,
historien renommé et ancien dirigeant du MIR (Mouvement de
la gauche
révolutionnaire), de l’ex-leader
guérillero Douglas Bravo et de
dizaines de leurs homologues.
La majorité
des figures les plus
prestigieuses ou les plus qualifiées de la culture
vénézuélienne semble
de fait assez hostile au régime. Fait symptomatique, les
deux
principaux « théoriciens » du processus
bolivarien et du « socialisme
du XXIe siècle » sont des étrangers :
Heinz Dieterich, un universitaire
allemand résidant au Mexique et Martha Harnecker, philosophe
marxiste
d’origine chilienne vivant à La Havane et
très liée au régime
castriste. D’autres clercs progressistes, comme
l’historienne Margarita
López Maya, assument une position plus «
anti-anti-chaviste » que
proprement chaviste. Sans manifester de grand enthousiasme à
l’égard de
la figure d’Hugo Chávez, ces intellectuels ne
veulent pas être associés
à une opposition qu’ils considèrent
comme largement factieuse,
classiste et raciste.
La gauche radicale au
Venezuela n’a jamais
été très forte, n’ayant
presque jamais dépassé 8 % à 10 % de
l’électorat. Le compromis historique entre la
démocratie-chrétienne et
la social-démocratie modérée
d’Acción Democrática -
formulé en 1958
sous le nom de pacte de Punto Fijo -, après
l’avoir marginalisée et
persécutée, a bloqué son
développement politique en intégrant une bonne
partie de sa potentielle base sociale. Chávez a
pulvérisé ce qui en
restait depuis 1998. Cohabitant avec néolibéraux,
putschistes et
résidus de l’appareil « puntofijiste
» dans l’opportunisme de la survie
électorale, la gauche d’opposition est
vouée à l’impuissance et au
déclin. Du côté bolivarien,
Chávez n’admet pas d’alliés
que ne soient
complètement domestiqués : c’est le cas
du PPT (Patria para todos), qui
regroupe la majorité des cadres de l’ex-Causa
Radical (une espèce de
petit PT vénézuélien
aujourd’hui moribond), et qui survit en colonisant
des secteurs de l’appareil d’État au
prix d’un suivisme passablement
servile, alors que sa trajectoire lui aurait permis
d’être la
conscience critique et démocratique du bloc chaviste.
Il
y a des
forces assez intéressantes dans la gauche syndicale, mais
leur
dépendance à l’égard de la
mystique révolutionnaire chaviste et la
grande faiblesse démographique et sociale du secteur
salarié formel
tendent à exclure qu’elles puissent être
la base d’une alternative
crédible. L’avenir de la gauche au Venezuela passe
sans doute par des
recompositions avec des secteurs du chavisme, mais il est
aujourd’hui
impossible de savoir comment pourraient se produire des ruptures et des
recompositions organisationnelles durables au sein de la mouvance
bolivarienne. Chávez est encore jeune et la forme
caudilliste,
personnaliste et charismatique de l’adhésion au
chavisme garantit le
contrôle et la régulation verticale de ses
nombreuses contradictions
internes, et ce de façon relativement efficace pour le
moment.
Chávez
est-il démocrate?
Pour
les secteurs les plus durs de l’opposition, qui dominent une
bonne
partie des médias
vénézuéliens, il n’y a pas
de doute : Chávez est un
dictateur implacable et son régime est totalitaire et
oppressif. Dans
une interview récente, Marcel Granier, directeur
général de Radio
Caracas Televisión de Venezuela (RCTV),
définissait le gouvernement
bolivarien comme « fasciste ». Des esprits moins
échauffés émettent
toutefois des critiques suffisamment circonstanciées pour
qu’on se pose
la question d’une dérive autoritaire du
régime chaviste. Entre les
accusations qui reviennent avec insistance, citons : le
contrôle des
organes judiciaires, en particulier du Tribunal suprême de
justice, et
de l’autorité électorale ; la
politisation partisane de l’armée et la
militarisation de la vie sociale à travers la
création d’un corps de
réserve de type cubain contre la soi-disant menace
d’invasion
américaine ; la volonté de discipliner et de
contrôler les ONG à
travers une législation restreignant leur sources de
financement ;
l’idéologisation du système
éducatif à travers l’inculcation des
«
valeurs de la révolution » ; les menaces
répétées à
l’encontre de
l’autonomie des universités sous
prétexte de lutte contre leur «
élitisme » ; et les attaques
systématiques contre la presse.
La
tension entre le gouvernement et les médias est bien
réelle - et cela
n’est guère étonnant si l’on
se souvient qu’une grande partie de ces
derniers ont appelé et soutenu ouvertement le coup
d’État contre Chávez
en avril 2002. Le harcèlement verbal et, parfois, juridique,
est
indéniable, mais il n’y a pas au Venezuela de
censure ni d’intervention
directe contre les rédactions. Comme l’admet le
journaliste
d’opposition Fausto Masó, exilé
anticastriste, « Chávez a gouverné en
faisant peur aux Vénézuéliens sans
fusiller aucun adversaire ni fermer
un seul journal ». La nouvelle loi dite «
mordaza » (bâillon) par
l’opposition, censée entre autres choses prohiber
les commentaires
insultants contre la personne du président, n’est
pas appliquée dans
les faits. Elle constitue plutôt une menace latente qui
viserait,
dit-on, à susciter l’autocensure des
médias. Cette autocensure n’est
guère perceptible : le ton d’insulte
grossière hystérique - et souvent
bassement raciste - contre Chávez a baissé
d’un cran depuis deux ans,
mais la presse et la télévision
d’opposition - cette dernière toujours
majoritaire en audience - continuent de manifester un niveau de
belligérance et de haine personnalisée assez
impressionnant. Le
gouvernement n’exerce par ailleurs aucun contrôle
sur Internet alors
que le niveau d’hostilité des sites anti-chavistes
relève de l’hystérie
apocalyptique, exprimée dans un langage
systématiquement obscène et
injurieux. Bien entendu, du côté chaviste, on
n’est pas en reste au
niveau des insultes.
Pour ce qui est de
l’habeas corpus et des
droits civiques, comme dans beaucoup de pays
d’Amérique latine, ils
sont tout aussi précaires pour les prisonniers, les
délinquants et les
citoyens victimes circonstancielles de la police que sous les
régimes
précédents, même si le gouvernement
bolivarien essaie parfois d’y
remédier, comme dans le cas des exécutions
judiciaires de délinquants
pratiquées par la police de l’État de
Falcón. De fait, la police
torture sous Chávez de même que sous Lula et
Kirchner ; ce n’est pas la
faute de ces mandataires, même c’est leur
responsabilité d’essayer d’y
mettre fin malgré le peu de pouvoir qu’ils ont sur
certaines polices
locales. En revanche, la grande époque des «
disparitions » politiques
au Venezuela est la IVe République (1958-1998), pas la Ve.
La situation
y est de ce point de vue bien meilleure qu’en Colombie,
fidèle alliée
des États-Unis. Citons le Rapport 2005 du
Département d’État américain
sur les droits de l’homme au Venezuela : « La loi
garantit la liberté
de réunion, et le gouvernement respecte
généralement ce droit dans la
pratique. [...] Les médias imprimés et
électroniques sont indépendants.
[...] Le gouvernement n’exerce aucune restriction sur
Internet ou
contre la liberté académique. [...] La loi
garantit aux citoyens le
droit de changer pacifiquement de gouvernement, et les citoyens
exercent ce droit par le biais d’élections
régulières sur la base du
suffrage universel. »
Il est
exact que le Conseil national
électoral (CNE) est contrôlé par une
majorité chaviste, mais toutes les
accusations de fraude lancées par l’opposition ont
été systématiquement
démenties par les organismes de contrôle
internationaux. Quant au
monopole actuel du chavisme sur l’Assemblée
nationale, il est dû au
boycott suicidaire des élections législatives de
décembre 2005 par
l’opposition. En vue des élections
présidentielles de décembre 2006, où
elle a cette fois décidé de participer,
l’opposition a demandé aux
recteurs anti-chavistes des principales universités
d’auditer le
registre électoral. Leur conclusion a
été sans appel : « Il n’y a
pas
d’indice de fraude dans le registre électoral.
»
On cite souvent
comme preuve de dérive dictatoriale la liste de signataires
en faveur
du référendum révocatoire de 2004,
dite liste Tascón, du nom du député
chaviste qui l’a faite circuler : elle aurait
donné lieu à des
interdictions professionnelles et à des discriminations
administratives
à l’encontre d’opposants
déclarés. Ces accusations semblent
avérées
dans certains cas. Ladite liste noire a toutefois
été officiellement
désavouée par Chávez, qui a
déclaré qu’il fallait
l’« enterrer ». La
dynamique de l’autoritarisme chaviste semble souvent
répondre au schéma
suivant : belligérance verbale et parfois ciblée
(contre telle ou telle
personnalité ou institution) du caudillo, initiatives plus
ou moins
autonomes de menace-intimidation de la part de serviteurs
zélés du
régime, cris d’orfraie des médias
d’opposition, désaveu officiel de la
part des organes de justice et/ou du président - ce dernier
parfois sur
un ton ironique et agressif réaffirmant les droits des
opposants tout
en les outrageant verbalement. Chávez vient par exemple de
déclarer que
ses fonctionnaires qui font des procès pour injure ou
calomnie à des
journalistes en vertu de la loi sur la presse votée par la
majorité
chaviste ont « la peau trop sensible » et
devraient laisser les
chacals aboyer sans broncher.
La concentration des
pouvoirs et
la manipulation de la justice sont réelles, bien que pas
absolues : la
justice « chaviste » a quand même
validé la tenue du référendum
révocatoire de 2004. Il faudrait toutefois comparer la
situation avec
celle qui prévaut dans les autres démocraties de
la région. Le régime
de Fujimori, qui présentait des ressemblances en termes de
manipulation
des institutions, mais était bien pire en matière
de droits humains et
de légitimité démocratique, a
été un favori de la Maison blanche
pratiquement jusqu’à la fin. Dans de nombreux pays
d’Amérique latine,
la justice est fortement corrompue et manœuvrée
par des mafias
politiciennes sans que personne ne parle de faire intervenir
l’OEA.
La
présence d’une tendance à
l’autoritarisme et au verticalisme militaire
dans le chavisme est indéniable, mais elle est loin
d’être univoque ou
irrésistible. D’une part, il s’agit
d’une espèce d’autoritarisme
anarchique et désorganisé dont le
résultat est plus une
désinstitutionnalisation rampante que la suppression
violente des
libertés démocratiques. D’autre part,
elle a pour contrepoids une
impulsion participative réelle des « masses
» et de solides réflexes
démocratiques de la société, chavistes
compris. Citons à ce propos un
incident très révélateur. Dans une
réaction typique de la culture
marxiste-léniniste autoritaire de type cubain, la
députée Iris Varela,
pasionaria révolutionnaire du MVR, avait menacé
de licenciement les
fonctionnaires qui s’abstiendraient aux
législatives du 4 décembre
2005. Elle suscita la réaction indignée de
représentants de l’Union
nationale des travailleurs (UNT, proche du gouvernement), qui
désavouèrent cette attaque contre le droit
« bourgeois » de ne pas être
obligé à voter, lequel coïncide en
l’occurrence avec le droit des
travailleurs à ne pas être licencié
pour délit d’opinion.
La
même Iris Varela, interrogée sur sa vision de
l’opposition par un
journaliste, a lâché un jour cette perle
symptomatique : «
Personnellement, je vivrais très bien sans opposition, mais
je sais que
ce n’est pas possible. » COMMENT le
sait-elle, et POURQUOI au juste
cela n’est-il pas possible, nous n’en serons pas
informés, et il est
fort probable qu’Iris Varela ne le sache pas très
bien elle-même. Dans
l’indétermination de cette réponse
gît toute l’ambiguïté du
rapport du
chavisme à la démocratie. Une
ambiguïté en fait plutôt productive et
rassurante si, au lieu de se poser la question parfaitement idiote de
savoir si Chávez est « sincèrement
démocrate » ou non, on considère les
contraintes qu’impose à son action
l’ensemble du contexte et des
tendances socio-politiques locales et régionales.
Chávez a-t-il
fait quelque chose pour les pauvres?
Selon
les statistiques du gouvernement bolivarien lui-même, la
pauvreté avait
augmenté de 17,8 % entre 1999 et 2004. Pourtant, fin 2005,
l’Institut
national de statistiques (INE) annonçait une baisse
drastique de la
pauvreté : de 53,1 % à 38,5 %. Même en
tenant compte de la forte
croissance du PIB (plus de 9 %) et des effets collatéraux
des missions
bolivariennes - dont certaines sont associées à
des aides monétaires
aux ménages défavorisés -, une baisse
de 14 points en un an est
matériellement impossible de l’avis des
spécialistes. Ceux-ci ajoutent
toutefois qu’il est peu probable que l’INE ait
inventé ces chiffres
alléchants, se contentant de « cuisiner
» les données, pratique qui
n’est évidemment pas une exclusivité du
chavisme. Il est ainsi aisé de
faire sortir du chômage les centaines de milliers de
personnes qui
reçoivent une modeste bourse en échange de leur
participation aux
missions éducatives de niveau primaire et secondaire. Les
critiques
affirment qu’on ne connaît pas la technique
employée par les
statisticiens du gouvernement pour évaluer le coût
du panier de biens
permettant de mesurer l’inflation, l’INE utilisant
un indice de prix
différent de celui de la Banque centrale
vénézuélienne, censé faire
référence. Il y a en outre des contradictions
dans les statistiques de
moyen terme de l’INE. Selon les chiffres officiels, la
pauvreté serait
passée de 43,9 % en 1998 à 37 % en 2005. Et
pourtant, pendant la même
période, le revenu réel moyen des
Vénézuéliens aurait diminué
à un
rythme de 0,9 % par an, soit une baisse totale de 6 % en sept ans. Le
taux de chômage, lui, serait passé de 11 % en 1998
à 12,2 % en 2005.
Spécialiste
de la pauvreté, Matías Riutort, directeur de
l’Institut de recherches
économiques et sociales de l’Université
catholique Andrés Bello, avance
des chiffres un peu différents et plus
circonstanciés : « Si on prend
la période 1995-2005, on constate que la pauvreté
a augmenté certaines
années et diminué pendant les autres. [...] Si
vous prenez comme
référence 1995, le taux de pauvreté a
été inférieur pendant toutes les
années suivantes. Mais si vous partez de 1998
[début du mandat de
Chávez], le taux de pauvreté a
été constamment supérieur pendant les
années suivantes. On constate toutefois une tendance
à la diminution de
la pauvreté à partir de 2004, il est possible
qu’on arrive en 2006 à un
niveau inférieur à celui de 1998. [...]
D’après les dernières
informations disponibles, le taux de pauvreté des individus
était de 57
%, contre 65,7 % en 2003. Calculé au niveau des
ménages, il était de 48
%, dont 16,6 % d’indigents [personnes ayant un revenu
inférieur à la
valeur d’un panier de biens alimentaires de base], contre
plus de 60 %
en 2003. » Confirmant que
l’année 2005 se profile comme un tournant
important, Riutort signale que c’est cette
année-là que, pour la
première fois, le nombre de travailleurs employés
dans le secteur
informel a commencé à baisser en dessous du
niveau de 1998 et que taux
de chômage a commencé à diminuer, tout
en restant supérieur aux niveaux
atteints entre 1995 et 1998. Il souligne toutefois qu’entre
1999 et
2005, le PIB réel par habitant n’a jamais
dépassé le niveau atteint en
1998 et que si le salaire minimum a augmenté en termes
réels [216
dollars par mois en 2006], le pourcentage de salariés qui
reçoit un
revenu inférieur au salaire minimum a également
augmenté.
Les
statistiques du gouvernement sont donc à prendre avec des
pincettes,
mais les extrapolations catastrophistes de l’opposition, qui
prophétise
à peu près tous les mois l’apocalypse
sociale pour demain, ne sont
guère crédibles. Deux conclusions provisoires,
d’apparence
contradictoires, s’imposent :
1) En
l’absence d’une modification
profonde de la structure productive et du fonctionnement de
l’État, il
est très peu probable qu’on assiste à
une réduction durable de la
pauvreté et de la marginalité
socio-économique au Venezuela. Le secteur
informel, qui emploie près de 47 % de la population active
selon l’INE,
plus de 50 % selon divers organismes internationaux, continue
à peser
d’un poids considérable. Pour l’instant,
la « révolution bolivarienne »
offre aux secteurs populaires plus de « reconnaissance
» (certes
assortie de toute une gamme de programmes d’urgence) que de
réelle «
redistribution ».
2) Pour une
mère célibataire au chômage, par
exemple, l’accès aux consultations et aux
médicaments gratuits auprès
d’un dispensaire médical de la mission Barrio
Adentro (« Au cœur du
quartier »), l’achat d’aliments
à moitié prix dans un centre de
distribution populaire Mercal, l’éventuelle
obtention d’une bourse de
rattrapage éducatif de la mission Robinson et le fait que
l’école
bolivarienne du quartier garde ses enfants toute la journée
en leur
offrant diverses activités socio-éducatives et
trois repas équilibrés
par jour au lieu de les renvoyer au foyer ou à la rue en
début
d’après-midi ne peut pas ne pas se traduire par
une nette amélioration
de son niveau de « développement humain
».
Pour des millions de
Vénézuéliens
déshérités, les missions bolivariennes
signifient que
l’État les prend enfin en compte et les soustrait
à l’invisibilité
sociale. Reste qu’il est à la fois pertinent et
légitime de
s’interroger sur la soutenabilité à
moyen et long terme de ces
programmes, sur leur articulation institutionnelle en une politique
sociale d’ensemble cohérente et sur
l’absence de mécanismes fiables et
transparents de suivi et de contrôle administratif de leur
mise en
œuvre et de leurs résultats, vu le
caractère totalement opaque et
discrétionnaire de leur financement. L’absence de
débat sérieux sur les
politiques publiques ne facilite pas les choses. Ainsi, les centres de
soins primaires de Barrio Adentro, où travaillent plus de 15
000
médecins cubains, sont très contestés
par l’opposition pour des raisons
essentiellement idéologiques, alors que leur
véritable talon d’Achille
est leur articulation avec le reste du système de
santé, en particulier
avec les hôpitaux publics, qui sont dans un état
souvent catastrophique.
Dans
un autre domaine, celui de la réforme agraire
initiée en 2001, on
rencontre le même type de controverses et la même
confusion des enjeux.
De 2003 à 2005, le gouvernement a distribué plus
de deux millions
d’hectares à 160 000 familles paysannes. Les
objectifs explicites de la
réforme sont de stimuler la croissance agricole, de
pénaliser les
terres improductives et la spéculation foncière,
de limiter la taille
maximale des grandes propriétés rurales et de
combattre la
concentration des terres. Le Venezuela avait déjà
connu dans les années
1960 une réforme agraire qui avait distribué des
terres appartenant à
l’État à plus de 200 000 familles. Mais
le boom pétrolier des années
1970 entraîna une chute de la
compétitivité de la production agricole
et un exode rural massif et les gouvernements de
l’époque finirent par
se désintéresser totalement de la question. En
l’absence d’aides et de
crédits, nombre de paysans
bénéficiaires de la réforme
abandonnèrent ou
revendirent leurs terres aux grands propriétaires (on parle
d’un taux
d’abandon de plus de 30 %). La répartition des
terres se maintint ainsi
pratiquement aussi inégalitaire qu’avant la
réforme.
La réforme
de Chávez n’est pas spécialement
radicale. Elle concerne elle aussi en
premier lieu les terres appartenant à
l’État et affirme clairement que
les grands propriétaires privés ont des droits
sur leurs terres. Ce
n’est que dans le cas où elles ne sont pas
cultivées et dépassent une
certaine taille qu’une partie peut être
confisquée et redistribuée
contre une indemnisation calculée à hauteur des
prix du marché. Le
processus ne suscite d’ailleurs pas que des critiques
idéologiques. De
nombreux spécialistes lui reprochent un certain niveau
d’improvisation
et d’inefficacité administrative. Les paysans se
plaignent souvent des
crédits qui n’arrivent pas, du manque de formation
et de la déficience
des infrastructures.
Avec son habituel
génie de la mise en
scène, Chávez a fait tout un plat de la
« lutte contre le latifundio »,
multipliant les grands discours et faisant parfois intervenir les
militaires sur le terrain dans les litiges avec les grands
propriétaires. Les médias d’opposition
ont aussitôt crié au «
communisme » et à la «
collectivisation ». La vérité
est plus
prosaïque. Une nouvelle réforme agraire
était certainement nécessaire
pour corriger l’injustice des rapports sociaux à
la campagne. Celle de
Chávez sera à juger sur pièces, mais
le pouvoir du latifundio est
essentiellement résiduel. La réalité,
c’est que le Venezuela est un
pays ultra-urbain (90 % de la population), que la réforme
agraire ne
concernera sans doute en fait qu’environ 2 % de la population
et que
malgré les discours officiels sur l’autosuffisance
alimentaire, il
reste le seul pays d’Amérique latine qui soit un
importateur net de
produits agricoles et celui dont la production agricole
représente la
plus petite part du PIB : 6 % (contre 5 % en 1998). Le Venezuela
importe en effet près de 75 % des aliments qu’il
consomme, phénomène
aggravé par le contrôle des changes mis en place
par le gouvernement
pour contrôler l’inflation et la fuite de capitaux,
mais qui tend aussi
à rendre les importations relativement bon marché
et à renchérir les
exportations.
Tout
s’explique-t-il par le pétrole?
Pas
tout, bien entendu, mais avec un baril à plus de 60 dollars,
contre 7
dollars au début du mandat de Chávez (le revenu
pétrolier par habitant
est passé de 226 dollars à 728 dollars entre 1998
et 2005), beaucoup de
choses dépendent du pétrole, qui
représente plus de 50 % des recettes
fiscales. Les critiques du régime considèrent que
la politique
économique de Chávez consiste «
essentiellement [à] administrer la
rente pétrolière en fonction de
d’objectifs purement politiques et sans
guère prêter attention [...] aux exigences de
transformation ». D’après
l’économiste marxiste Enzo del Búfalo
[2], la dynamique de
désindustrialisation amorcée dans les
années 1990 a continué sous
Chávez : « L’objectif numéro
un est d’utiliser l’industrie
pétrolière
comme une source de revenus fiscaux et d’essayer de maximiser
ces
revenus pour financer des dépenses croissantes, mal
organisées,
caractérisées par un énorme gaspillage
et une très faible efficacité,
mais par une forte rentabilité politique. [...] Le Venezuela
est de
nouveau un pays pratiquement monoexportateur, et les industries
nationales de base (publiques), qui pesaient d’un poids non
négligeable, ne représentent plus
qu’une part minime des exportations.
» De fait, au premier semestre 2005, les exportations
pétrolières
représentaient 85,3 % du total des exportations
vénézuéliennes (secteur
public et secteur privé), contre 68,7 % en 1998.
Les
défenseurs
de Chávez soutiennent pour leur part qu’il existe
une véritable
stratégie de diversification industrielle et avancent
d’autres chiffres
à l’appui de leur thèse.
D’après la Banque centrale du Venezuela,
disent-ils, la croissance vigoureuse de l’économie
vénézuélienne depuis
2004 (plus de 9 % en 2005) est largement attribuable au secteur non
pétrolier : construction (28,3 %), commerce
intérieur (19,9 %),
transports (10,6 %), et manufacture (8,5 %), contre seulement 2,7 %
pour le secteur pétrolier. Tandis qu’au
deuxième trimestre 1999, la
part du PIB non pétrolier était estimé
à 70,5 % du PIB total, elle
était passée à 76 % en 2005. Et le
fait que, depuis début 2003, la part
des biens de consommation finale dans les importations soit
passée de
37,6 % à 24,2 % tandis que celle des biens de capital
passaient 12,3 %
à 25,7 % tendrait à prouver que le Venezuela a
bien amorcé une nouvelle
phase d’industrialisation. Sans contester ces chiffres,
d’autres
commentateurs économiques n’y voient
qu’un effet collatéral de l’«
ivresse rentière » : ce n’est que
grâce à l’abondance des revenus
pétroliers que les entreprises, tout comme les particuliers,
augmentent
leur consommation de biens et de services, mais rien ne garantit pour
autant qu’il s’agisse d’une dynamique de
diversification économique
durable et soutenable.
Le pétrole joue
bien entendu un rôle
stratégique tant dans les initiatives diplomatiques tous
azimuts de
Chávez (relance de l’OPEP, aide à Cuba,
rapports Sud-Sud, alliance avec
l’Iran) que dans le financement des programmes sociaux.
Ainsi, en 2004,
sur un chiffre d’affaires de 60 milliards de dollars, la
contribution
de la compagnie pétrolière nationale PDVSA au
budget national (sous
forme d’impôts, de redevances et de dividendes)
s’est élevée à 11,4
milliards de dollars. Quelque 3,7 milliards sont allés au
financement
d’infrastructures et des fameuses « missions
» bolivariennes.
Dans
les années 1980-1990, affirment les chavistes, PDVSA
fonctionnait comme
un véritable État dans
l’État sans rendre de comptes à la
société. La
part des recettes perçues sur les exportations et
versée par PDVSA à
l’État s’était constamment
amenuisée, passant de 70,6 % en 1981 à 38,6
% en 2000. Paradoxalement, la reprise en main de PDVSA a
été favorisée
par l’entrée en dissidence ouverte de la direction
et des cadres du
groupe, la « méritocratie
pétrolière », convertie en fer de lance
de
l’opposition pendant les grèves et manifestations
de 2002 et début
2003, qui ont déstabilisé le pays au point de
provoquer une chute
catastrophique de 9 % du PIB. Cette insubordination massive mais
finalement sans succès offrit à Chávez
l’occasion rêvée pour « faire
le
ménage » en licenciant 18 000 employés
sur un total de 42 000, dont 80
% de ses cadres.
La nouvelle législation
sur les hydrocarbures
redéfinit le cadre contractuel entre PDVSA et les
transnationales
pétrolières, relevant l’impôt
sur les bénéfices et le niveau de la
redevance pétrolière. Les majors ne pourront plus
opérer seules dans le
pays, mais devront le faire par l’intermédiaire de
sociétés mixtes dans
lesquelles PDVSA disposera de 51 % du capital. Malgré les
proclamations
de souverainisme énergétique et les dizaines de
millions de dollars de
retards d’impôts réclamés
à certaines d’entre elles par le fisc
vénézuélien, la plupart des grandes
multinationales comme Shell,
Chevron Texaco et British Petroleum ne semblent pas
s’émouvoir outre
mesure des conditions de ce dispositif. Au vu des gigantesques
réserves
de brut, estimées entre 100 et 300 milliards de barils, les
perspectives de profit sont toujours juteuses et l’ouverture
en amont
aux capitaux étrangers reste plus
généreuse au Venezuela qu’en Russie
ou en Arabie saoudite.
Si le gouvernement
défend son projet
pétrolier comme une arme dans le combat pour
l’« indépendance vis-à-vis
des entreprises transnationales, l’autonomie, la
souveraineté, la lutte
contre la pauvreté et la revitalisation de
l’OPEP », un certain nombre
d’experts pétroliers appartenant à la
gauche antichaviste voient au
contraire dans le pragmatisme contractuel de PDVSA et
l’association
avec des multinationales étrangères à
la fois un renouvellement sous
déguisement bolivarien des pratiques crypto-privatisantes de
la «
méritocratie pétrolière »
d’antan, une reddition face au capital
transnational et une soumission aux critère
néolibéraux d’exploitation
et de commercialisation. Bref, le pétrole
vénézuélien n’a pas fini de
susciter des controverses.
Chávez
encourage-t-il la « cubanisation » du Venezuela?
Chávez
a des liens politico-personnels intimes avec Fidel Castro,
qu’il
consulte pour une partie de ses décisions et les services
secrets
cubains sont très présents au Venezuela. Dans de
nombreux domaines, la
coopération étroite est bien réelle,
et parfois absurdement intrusive
de la part des Cubains, ce qui agace même une partie de la
base
chaviste. Cela ne veut pas dire que le Venezuela est en train de
devenir une « colonie cubaine », comme le proclame
à grands cris
l’opposition. À terme, ça pourrait
même finir par vouloir dire le
contraire, une espèce de «
vénézuélisation » de Cuba
plutôt qu’une «
cubanisation » du Venezuela. Politiquement, le
régime bolivarien
présente une garantie de stabilité et une
espèce de modèle approximatif
pour une transition post-Castro vers un capitalisme
d’État contrôlé par
la nomenklatura militaire cubaine. Économiquement,
l’alliance avec le
Venezuela représente un ballon
d’oxygène inespéré pour
Cuba. Chávez ne
fait pas « cadeau » de son pétrole
à Cuba, même s’il lui offre des
conditions très avantageuses, et La Havane signe des
reconnaissances de
dette qui pourraient un jour avoir des conséquences
inattendues, voire
explosives. Le Venezuela n’est pas
dénué d’ambition
hégémonique (en
rivalité avec le Mexique) dans le bassin
caribéen, et cela ne date pas
de Chávez.
Sur le plan
idéologique, même si Chávez a pu
déclarer
que les Cubains vivaient dans une « mer de
félicité », toutes les
enquêtes sont formelles sur le fait que le peuple
vénézuélien, y
compris la majorité écrasante de
l’électorat chaviste, ne veut pas d’un
modèle de type cubain. On voit d’ailleurs mal
comment il pourrait être
imposé à une société aussi
complexe, diverse, ouverte au monde et
irrévérente que la société
vénézuélienne de 2006, qui
n’a rien à voir
avec une société de type Cuba en 1959. Et le
contexte international lui
aussi a changé.
Enfin, quand on me parle
de la « cubanisation »
du Venezuela, je dis toujours que les
Vénézuéliens laisseront
peut-être
sans trop broncher piétiner
l’indépendance du Tribunal suprême de
justice ou du Conseil national électoral, au moins pour un
temps, mais
que pour les priver du centre commercial Sambil ou d’autres
immenses «
malls » qui parsèment la capitale et les
principales métropoles, il
faudra passer sur leur cadavre. Il n’y a
qu’à voir le style et le
niveau de consommation des dizaines de milliers de nouveaux riches
chavistes.
Qu’est-ce
que le « socialisme du XXIe siècle?
L’idée
du « socialisme du XXIe siècle »,
lancée à brûle-pourpoint au Forum
social mondial de Porto Alegre, en janvier 2005, a de quoi laisser
perplexe. Six mois avant de la sortir de son chapeau, Chávez
expliquait
à l’intellectuel marxiste anglo-pakistanais Tariq
Ali « [qu’il ne
croyait pas] aux postulats dogmatiques de la révolution
marxiste » et
que « l’abolition de la
propriété privée ou une
société sans classes »
n’étaient nullement à l’ordre
du jour au Venezuela. Chávez explique
aujourd’hui qu’il ne croit plus possible
d’humaniser le capitalisme,
mais que son socialisme sera débarrassé des vices
bureaucratiques, des
dogmatismes idéologiques et des erreurs du passé
et que son appel est
avant tout une « invitation au débat [...] y
compris avec les chefs
d’entreprise », dont on ne sait pas
très bien quelle sera leur place
dans ce système, mais qui n’ont apparemment pas
à craindre
d’expropriation massive. Le socialisme selon
Chávez est « avant tout
une éthique », «
l’amour du prochain », la «
solidarité avec nos
frères ». Le premier socialiste fut
Jésus Christ. Judas, qui a vendu
le Christ pour trente deniers, « est le premier
capitaliste ».
Bolívar, défenseur de la liberté et de
l’égalité, aurait
été socialiste
s’il avait vécu plus longtemps. Bref, le
socialisme c’est l’altruisme,
le capitalisme, c’est l’égoïsme.
Depuis
bien avant Chávez, le
Venezuela est un capitalisme d’État rentier
où le plus gros employeur
formel est l’État et où le secteur
privé entretient avec celui-ci des
relations de type clientéliste souvent incestueuses. La
Constitution
bolivarienne de 1999 sanctionne l’existence de la libre
entreprise et
la propriété privée des moyens de
production. Sur le terrain, les
chavistes défendent l’idée que le
socialisme vénézuélien se
développera
à partir des formes de participation populaire et
d’économie solidaire
que promeut le régime à grand renfort de
pétrodollars. Il s’agit là
d’une dynamique bien réelle qui concerne sous une
forme ou une autre
plusieurs centaines de milliers de personnes, mais qui recouvre une
gamme assez complexe et variée de pratiques sociales. Cela
va des
expériences autogestionnaires les plus en pointe
jusqu’à la simple
mobilisation clientéliste de type péroniste, en
passant par toute une
frange intermédiaire de pratiques
d’auto-organisation populaire liées
aux missions sociales (comités de gestion des terres
urbaines, comités
de santé, etc.).
De l’aveu
même des militants bolivariens, les
Conseils locaux de planification, censés impliquer les
citoyens dans la
gestion municipale, ont complètement
échoué face à la résistance
de la
bureaucratie municipale chaviste qui ne souhaite guère que
ses
administrés mettent le nez dans ses affaires (parfois
illégales et
juteuses). Le gouvernement vient de définir le cadre
législatif et de
dégager les ressources destinées à
faciliter le fonctionnement d’une
nouvelle structure conçue pour être plus proche de
la population, les
Conseils communaux de planification. Il est également
question
d’introduire à Caracas une version du budget
participatif de Porto
Alegre. Cette initiative aura sans doute quelque mal à se
concrétiser
dans le cadre d’une architecture municipale assez baroque,
avec deux
maires chavistes (dont un ancien policier
soupçonné d’avoir appartenu
à
un escadron de la mort anti-délinquants) aux juridictions
enchevêtrées
et qui se détestent cordialement entre eux, au point que
Chávez a dû un
temps les faire chapeauter par un général
censé « coordonner l’action
municipale ».
Les
activités impulsées par les « noyaux de
développement endogènes » - dont la
présence est surtout significative
en zone rurale - ne sont pas très différentes des
micro-projets de
développement (agricole, éco-touristique, etc.)
promus dans d’autres
pays de la région par les ONG internationales, voire la
Banque
mondiale. Simplement, au Venezuela, elles sont
subventionnées par
l’État et ornées d’une couche
de vernis révolutionnaire. Enfin et
surtout, le gouvernement impulse fortement le secteur
coopératif. Il y
aurait actuellement près de 100 000 coopératives,
employant environ 7 %
de la population active contre seulement 762 en 1998. À
côté
d’authentiques projets d’économie
sociale soutenable, cette éclosion
compte pas mal de fleurs de serre qui vivent sous perfusion
financière
de l’État. Plus grave, nombre de
coopératives sont créées ad hoc par
des entrepreneurs bien en cour auprès de potentats chavistes
locaux et
visent essentiellement l’obtention de subsides
gouvernementaux ou
d’exonérations fiscales, la
légalisation de formes de sous-traitance
sauvage et la flexibilisation de la main d’œuvre.
D’après le
superintendant des coopératives, Carlos Molina, dans la
majorité des
cas, on constate « une faiblesse [de ces entreprises] au
niveau des
valeurs et principes » : « moins de 1 %
des coopératives honorent
vraiment les principes du coopérativisme, comme la
solidarité et le
bénéfice collectif », et sur 2 376
coopératives auditées par le
gouvernement, on a constaté des malversations dans 2 110 cas
(soit 88
%).
Outre son caractère
extrêmement vague, le discours sur le «
socialisme du XXIe siècle » se heurte à
trois réalités fondamentales.
Premièrement, l’énorme importance du
secteur informel : d’après une
enquête publiée par le Financial Times, 25 % des
Vénézuéliens entre 18
et 64 ans se déclarent « entrepreneurs
», ce qui ferait du Venezuela le
pays le plus « capitaliste » du monde devant la
Thaïlande (21 %), les
États-Unis (12 %), l’Espagne,
l’Allemagne et la France (6 %) et le
Japon (2 %) ! Deuxièmement, l’usage
néopatrimonial de l’appareil
d’État
: la nomenklatura chaviste, la « bolibourgeoisie »
(bourgeoisie
bolivarienne) et l’armée ont remplacé
la nomenklatura bipartidiste de
la IVe République, la « méritocratie
» de PDVSA et la bureaucratie
syndicale de la Centrale des travailleurs
vénézuéliens (CTV, liée
à
Acción Democrática) dans
l’appropriation mafieuse des ressources
publiques. Le niveau exorbitant de la corruption est
dénoncé y compris
par une partie des médias chavistes. Enfin, la conception
assez floue
et parfois perverse de la « démocratie
participative » qu’ont certains
secteurs du chavisme, au lieu de servir à approfondir,
enrichir,
consolider et socialiser la démocratie
représentative (qui est
rhétoriquement diabolisée par les
idéologues du régime), encourage une
prolifération de structures parallèles
para-étatiques sans réelle
plus-value démocratique. La « participation
populaire » devient dès
lors une arme de plus dans la panoplie chaviste de
délégitimation des
institutions en général, y compris des quelques
institutions qui
fonctionnaient de manière plus ou moins
démocratique et transparente.
Contrairement à l’illusion caressée par
l’extrême gauche chaviste, loin
d’anticiper l’instauration d’un
« double pouvoir » révolutionnaire,
elle risque simplement de finir par contribuer à
l’autoritarisme
anarchique mentionné précédemment et
à ses sursauts de fièvre
plébiscitaire.
Chávez est-il
anti-impéraliste?
Depuis le
sommet des Amériques de Mar del Plata, en novembre 2005,
Chávez est à
l’apogée de sa popularité en
Amérique Latine, tant à cause de sa
virulente rhétorique anti-Bush que de sa diplomatie de
Père Noël
pétrolier. Caracas vend du combustible bon marché
aux petits pays des
Antilles, achète des bons de la dette argentine et
équatorienne, signe
des contrats avantageux avec Brasilia et Buenos Aires et surfe sur la
vague de défiance continentale à
l’égard de la politique américaine. Il
ne faut toutefois pas confondre discours et
réalité : le Venezuela n’a
pas de querelle avec le FMI, paye sa dette rubis sur l’ongle
et
entretient les meilleures relations du monde avec des multinationales
comme Chevron Texaco. L’ambassadeur
vénézuélien à Washington,
Bernardo
Alvarez, l’expliquait récemment avec candeur :
« Nos relations avec les
entreprises américaines sont excellentes. En un an, nous
sommes passés
du rang de 16e à 13e partenaire commercial des
États-Unis. Et nous
sommes leur deuxième partenaire au niveau
latino-américain. » De fait,
le commerce avec les États-Unis a augmenté de 36
% en 2005, atteignant
40 milliards de dollars. Parmi les entreprises qui vendent des services
à l’industrie pétrolière
vénézuélienne, le groupe Halliburton,
symbole
exécré de capitalisme prédateur
lié à l’administration Bush, a ainsi
considérablement accru sa présence et ses profits
au Venezuela.
Par
ailleurs, il convient d’observer que si Chávez a
initié des polémiques
sanglantes avec toute une série de mandataires
latino-américains
considérés comme proches de Washington, comme Fox
et Toledo, il n’a
jamais déclenché de confrontation verbale ou
d’escalade diplomatique
majeure avec le président colombien Alvaro Uribe, qui est
pourtant le
plus solide allié de Bush dans la région. De
fait, malgré des tensions
récurrentes et inévitables, essentiellement
liées aux acteurs du
conflit armé colombien et aux infiltrations et
ingérences frontalières
mutuelles, Chávez entretient des relations plutôt
sereines avec Uribe,
dont il ne manque jamais de vanter les qualités de chef
d’État et de
souligner que c’est un « ami ». Il est
vrai que le Venezuela est le
premier marché de l’industrie colombienne et
qu’un projet commun
d’oléoduc vers le Pacifique est susceptible
d’aplanir bien des
aspérités idéologiques. Comme dit
l’ancien ambassadeur américain à
Caracas John Maisto, il faut s’occuper de « ce que
Chávez fait, pas de
ce qu’il dit ».
Faut-il soutenir
Chávez?
En termes
diplomatiques, toute forme de déstabilisation ou de
délégitimation
organisée du gouvernement
vénézuélien par la «
communauté
internationale » à la demande de Washington sous
prétexte de déficits
démocratiques réels (il y en a) ou imaginaires
(il y en a aussi) est
une monstrueuse hypocrisie. Il faut défendre les choix
démocratiques du
peuple vénézuélien et
dénoncer l’agression impériale contre
le
Venezuela chaque fois que cela est nécessaire, ce qui ne
veut pas dire
que l’on approuve toutes les provocations diplomatiques
fanfaronnes et
un peu infantiles de Chávez, encore moins tous les aspects
de sa
politique intérieure. Il faut par ailleurs exposer sans
aucune crainte
de « faire le jeu de l’ennemi » toutes
les failles et les
contradictions du régime de Chávez et lutter
contre l’imbécillité des
raisonnements binaires et de la pensée pieuse qui
règne à ce sujet dans
une partie de la gauche radicale et altermondialiste.
Faire
une
critique équitable du chavisme consiste en grande partie
à essayer de
distinguer ce qui relève de la pathologie
générique du modèle rentier
et/ou du système politique
vénézuélien et ce qui
relève des
caractéristiques spécifiques du
régime. C’est souvent assez difficile,
vu la complexité inextricable de certains
phénomènes et la pénurie de
sources d’information et d’instruments
d’analyse fiables, mais cela est
nécessaire pour combattre l’impressionnante
mauvaise foi des chavistes
(tout le mal vient de la IVe République et ce que nous
faisons est
radicalement différent) et des antichavistes (tout le mal
vient de
l’horrible dictateur Chávez).
Concrètement,
que devrait faire un
militant de gauche vénézuélien sur le
terrain ? D’une part, il peut
essayer d’accompagner les expériences sociales les
plus intéressantes
qui se développent au sein du processus bolivarien sans
faire aucun
compromis avec la manipulation bureaucratique et le chantage
idéologique. C’est ce que font certains militants
du tiers secteur, par
exemple. Il ne faut toutefois pas se cacher que c’est une
option
subalterne, assez incommode et pas toujours viable. Le terrain
où se
définissent les enjeux majeurs est celui du politique, et
l’extrême
polarisation oblige en général même les
militants les plus lucides et
critiques à se définir comme « dans
» ou « hors » de la «
révolution ».
Sans parler de l’aliénation idéologique
et de la terrible confusion
mentale engendrée par l’omniprésence
d’une logorrhée révolutionnaire
parfaitement creuse : en dernière instance, il
s’agit toujours de
savoir si on est « patria o muerte » en
faveur de la révolution et de
se prosterner face aux portraits du Che ou de Bolivar, presque jamais
de définir des contenus programmatiques et
opérationnels concrets. Bien
entendu, les hiérarques les plus odieux et les plus
opportunistes de
l’appareil du MVR sont passés maîtres
à ce petit jeu de surenchère
loyaliste.
D’autre
part, on peut et on doit encourager la
formation de cercles de réflexion et de réseaux
de dialogue
politico-intellectuel afin de :
—
Combattre la polarisation
artificielle et grossière promue tant par
l’opposition factieuse que
par le chavisme bureaucratico-opportuniste « dur »,
lequel joue le
sectarisme agressif (mais en réalité sans aucun
contenu idéologique
cohérent) pour serrer les rangs et masquer les
contradictions du
processus et sa propre médiocrité abyssale ;
—
Créer un tissu d’interlocution susceptible de
contribuer à freiner les dérives
antidémocratiques du chavisme ;
—
Favoriser un climat de perméabilité du
« chavisme intelligent » à des
propositions de politiques publiques progressistes plus
cohérentes et
rationnelles que celles qui émergent spontanément
des rangs du régime ;
—
Préparer le terrain à de futures recompositions
progressistes, tout en
sachant qu’il s’agira probablement d’un
processus de très longue
haleine.
NOTES
:
[1] Ce texte
reprend une partie des arguments
développés dans M. Saint-Upéry,
« L’Enigme bolivarienne », Vacarme,
n°35, printemps 2006.
[2] Voir
aussi l’entretien avec Enzo del
Búfalo paru dans Brecha en septembre 2005 et repris dans
Mouvements,
n°44, mars-avril 2005.
Source :
RISAL -
Réseau d'information et de solidarité avec
l'Amérique latine
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2023
|
|
|
L'Institut
de Formation Cinématographique
COTRAIN
| 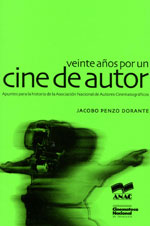 |
Ses 20 ans à la
Cinémathèque de Caracas (VENEZUELA)
Le Collectif de Travail
et de Recherche (COTRAIN) s'est construit au sein d'un espace pour la
réflexion et la production d'un outil audiovisuel. Pour
fêter ses 20 annnées d'enseignements et
d'apprentissages, il a été
préparé à cette occasion un programme
avec des réalisations peu connues de sa production.
Le rendez-vous s'est tenu le jeudi 9 mars 2006
à la Cinémathèque Nationale de
Caracas, à la Galerie d'Art National (Place des
Musées -Parc Los Caobos). Le programme des
projections : 7 films courts
d'étudiants : Ils ont
été réalisés au sein du
cours de documentaire lors du premier semestre. Un travail qui a
été mené dans l'atelier de
réalisation dirigé et conduit par la professeure
Lucia Lamanna, aussi fondatrice de l'Institut COTRAIN. Ces films courts
font partie de la série "personnages"
et sont une première approche du documentaire.
Les
travaux réalisés par Lucia Lamanna : "4i000mf"
, une perception personnelle sur
l'artiste vénézuélienne Magdalena
Fernández, pendant la production et le montage de cette
oeuvre ; et " 1i003mf " : un
regard sur une autre création de l'artiste.
Le
travail de LIlaine Blaser : " Vargas, las huellas del
agua "" (2001) co-réalisée
avec Lucia Lamanna , sur la tragédie de
Vargas (1999). Ce film a reçu le premier prix dans la
catégorie vidéo du concours de la
Bibliothèque Nationale "Vargas 99, avant, pendant
et ensuite ". Puis, un dernier documentaire produit en
collaboration avec VIVE TV " El fantasma
de la libertad " (aussi en co-réalisation - 2006)
: Il s'agit d'un documentaire sur le projet de globalisation
néo-libérale, ses conséquences pour
l'humanité, et les luttes contre ce projet
hégémonique, une menace pour le sens et le futur
de la vie.
Source
d'origine : http://www.aporrea.org LILIANE BLASER - AZA
Fondatrice, directrice
et enseignante de l'Institut de Formation Cinématographique
COTRAIN. Réalisatrice cinéma documentaire et
fiction, et anthropologue Sa filmographie de 1976
à 2001 : FILM expérimental
: "El juego de siglos" Super 8.
Mentión Experimental - ACA 1976. Documentaire: "Octubre" S 8. Participation au
Festival de Cortos M Trujillo Durán, Maracaibo,
1981. Fiction : "Rosalía" Super 8.
Co-réalisation. Festival de Mérida 1996. Documentaire : "Apocalipsis no,
urbanismo" Super 8. Co-réalisation. Documentaire : "8 en torno al Super 8" Participation au
Festival International de Super 8. Documentaire : "Convivencia" video.
Mención CONIVE Festival de Cinéma des
peuples indigènes. Documentaire : "Venezuela, Febrero 27
(de la concertación al des-concierto)"
Meilleur Doc Mérida, Meilleur Doc. D'information Festimagen
Merida 92. Mention du Jury Badalona España 91. Mention du
Jury,
Fribourg,
Suisse. Documentaire : "La otra mirada" .Mention du jury
Festival de Río de Janeiro et de Montevideo, 1991.
Documentaire : "Llamado a la paz desde
los EEUU" 1991. . Documentaire : "1992: El
des-cubrimiento (jugar o ser jugado)" II Coral
Documental Festival Nuevo Cine Latinoamericano, Habana, 1993.
Meilleur son Documentaire Argentine, Mention du Jury,
Bahía. l994 Expérimental
: "El
último panfleto" 1996.
Première Bienale CONAC, l998 Documentaire : "Venezuela 1998:
¿del voto a la elección?" 1998 Documentaire : "Chavez, dos
años (los laberintos de un proceso)" 2001 Documentaire : "Vargas, las huellas del
agua"
2001
(co-direction avec Lucía Lamanna) _______________________________________________________________________________ Institut
de Formation Cinématographique COTRAIN (Collectif de Travail et
de Recherche) L'Institut de Formation
Cinématographique COTRAIN ne forme qu'une partie du Collectif
de Travail et de Recherche (COTRAIN). Une institution sans
but lucratif ayant un projet : "Image et
Société", dans laquelle se développe
la recherche, l'enseignement et la production de moyens, que les
sciences humaines et sociales, l'art et le travail culturel se
renvoient dans la production d'un reflet-réflexion sur la
vie sociale et culturelle d'un pays en transformation, et en
même temps une recherche-réflexion sur les
médias audiovisuels et la création artistique
propre. Le cours
général sur le Cinéma documentaire
continu le travail du cursus complet de Cinéma qui
commença en 1986, et qui à partir de 1997 s'est
reconverti en ateliers de documentaire (dans nos locaux ou au sein de
groupes ou collectivités, et des ateliers libres). Cette
reconversion a pour raison, qu'il n'est plus possible d'assurer la
continuité des études sur 2 ans, ceci impliquant
une logistique humaine et enseignante que la COTRAIN n'est pas en
mesure de soutenir. Toutefois, la mise en
fonctionnement de ce cours général s'appuie sur
l'expérience de 20 années consacrées
à l'enseignement, à la production et à
la recherche, au sein d'un équipement technique à
taille humaine, et dans une infrastructure qui durant ces
dernières années a été
optimisée. Nous disposons des
ressources suivantes : - Un service de
documentation avec plus de 5.000 livres sur le Cinéma, la
Communication, la Culture et les Arts, avec environ 4.000
vidéos, quelque 8.000 disques anciens, et d'innombrables
documents sur le cinéma, la culture et sur les
événements sociaux, politiques et historiques. - Un service de
production et des services audio-visuels avec des
équipements d'enregistrement, de photographie, de tournage
et de postproduction non linéaire, avec un
laboratoire photographique, une étude de son des espaces,
des équipements pour les transferts, et la projection de
vidéo, de diapositives et documents. -
Une équipe enseignante et de chercheurs dans les
secteurs socio-culturels et cinématographiques |
| | |
Cet espace d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le
contenu est sous la responsabilité de son
créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
Amérique
Latine
depuis 2005
|
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes, ... |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui est donc A.Miller? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
F. de
Miranda
: Citoyen du monde |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 05/02/2011 |
|
|
|
|
|

