|
|
|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
Sommaire de la page,
1 - Au sujet de Jean-Marie Roland, ministre de
l’intérieur et des cultes
2 - M. Condorcet, au nom du comité d'instruction publique, le 21 avril
1792
3 - M. Roland, à l'Assemblée, le 25 avril 1792
4 - Chronologie du 1er avril au 19 juin 1792
|

|
|
|
|
|
|
|
Au
sujet de Jean-Marie Roland,
ministre
de l’intérieur et des cultes

Portrait de Jean-Marie Roland de la Platière
|
« Le registre conservé aux Archives nationales sous la cote
F-12-178,
qui renferme la correspondance du Ministre de l'intérieur, d’avril à
octobre 1792, relative au commerce, manufactures, aux subsistances et
autres objets d'administration générale dans les attributions de la 6e
division, mérite d'autant plus de retenir l'attention qu'il est le seul
de cette correspondance qui soit arrivé jusqu'à nous à travers les
orages de la période révolutionnaire et ses multiples causes de
destruction qui ont atteint les archives de nos ministères, surtout
celles du Ministère de l'intérieur. Ce registre contient la
transcription de plus d'un millier de lettres, embrassant la période du
16 avril au 14 octobre 1792 et se rapportant aux moments les plus
troublés de la Révolution, notamment aux journées du 20 juin et du 10
août, à la suite desquelles sombra la monarchie. »
Bienvenue aux enfers ou sous-sols des archives, des éléments souterrains par excellence, l’objet n’est pas en soit de
critiquer le travail d’un archiviste et historien reconnu, les travaux
d’Alexandre Tuetey sont une somme et participe à une connaissance sur
le mouvement révolutionnaire, dans la tradition de
l’Ecole nationale des Chartes. Mais il y a de quoi rester alerte sur la nature
des archives, ou sur telles pièces qui ont pu échapper aux flammes, où
est la part de vrai et de faux, telle est la question? Que des
documents aient pu brûler, oui notamment des actes paroissiaux et
titres de noblesse, et le filon a été plus qu’exploité pour
expliquer certaines lacunes et impossibilités de restituer avec
précision certains faits. Mais plus de 200 ans après l’étendu des
textes ou des fonds ne fait que grandir au fil des décennies au sein des
bibliothèques ou universités dans le monde, le tout participant des analyses
sur la Révolution.
Enfer parce que l’organisation de son collectage et
la mise en carton ont été probablement l’objet de nombreuses
manipulations et malveillances volontaires, des dépouillements pas
toujours menés de manière exhaustive. Si "l’histoire officielle" a
bien pu se cacher dans nombre de recoins
(notamment au titre des cours d'histoire de la troisième République,
mais pas seulement), ce qu'il est nommé aujourd'hui le roman national,
se trouve dans l’organisation, de comment ont pu être administré les
Archives nationales et
les différentes structures rattachées à cet office de la mémoire
collective, qu'une part des contenus a pu se perdre, ou être
volontairement éliminée, voire être insuffisamment traitée.
Tout comme Pétion de Villeneuve et parfois en plus caricatural,
Jean-Marie Roland a comme une odeur de souffre, parent pauvre de la
mémoire historique, victime lui aussi des légendes dorées et noires,
comment parler d’un pur produit de son époque et d’un homme, que l’on a
peu tendance à mettre en arrière plan? Pourtant il fut un de ceux qui
le mieux connut les rouages administratifs, ses incohérences comme ses
faiblesses. Sur la plan intellectuel, il n’est pas simple à situer, ses
sujets n’étant pas une littérature romanesque, il pourrait passer pour
ennuyeux, mais il maîtrisa aussi bien le droit et l’économie et un
domaine ayant perdu de son prestige : les arts et métiers.
« On
serait tenté de croire que la gravité des événements qui se déroulèrent
alors eût dû faire rejeter à l'arrière-plan les affaires de pure
administration; mais d'une part si l'Assemblée législative, entraînée
par le courant révolutionnaire, ne put s'occuper d’une façon suivie des
matières administratives soumises à son examen; d'autre part, il n'en
fut pas de même des rouages administratifs, qui continuèrent à
fonctionner avec une régularité remarquable. On voit donc tout
l'intérêt, que peut offrir pour l'histoire si peu connue de
l'administration à cette époque cette correspondance du Ministre de
l'intérieur, surtout si l’on se rend compte que, sur les six mois
qu’elle comprend, quatre au moins se rapportent au premier et au second
ministère de Roland : savoir du 16 avril au 12 juin 1792 et du 10 août
au 14 octobre 1792. La période intermédiaire étant remplie par les
ministères éphémères de Mourgues, Terrier de Montciel et Champion de
Villeneuve, qui restèrent trop peu de temps en fonctions pour avoir eu
la possibilité de suivre les affaires et durent le plus souvent s'en
rapporter à leurs bureaux. Par conséquent, c'est par les lettres
écrites pendant le double ministère de Roland que l’on pourra le mieux
juger la marche de l'administration, celles de ces lettres qui
traitaient de questions importantes ayant été libellées non seulement
sous l'inspiration du ministre, mais encore rédigées de sa main ». (…)
« A la fin de septembre 1791, l'Assemblée constituante avait mis à la
disposition du Ministre de l'intérieur un crédit de 12 millions pour
achat de subsistances. Le 5 juin, Roland, appelé à justifier devant
l'Assemblée législative de l'emploi de ces fonds, démontra que la somme
en question se trouvait à peu près dépensée, sauf un reliquat de
500.000 livres ».
Jean-Marie Roland, une fois nommé ministre une première fois allait à la
fois concentrer certaines colères pas toujours fondées sur les échecs
passés et celles de son collègue Clavière aux finances, et en retour de
balancier, toute une série de reconnaissance pas toujours sincère lors
de son retour au ministère deux mois après. A la recherche d’un
équilibre, s’il y a eu de quoi contester certaines mesures, Roland n’avais pas
dérogé sur ces principes ou idées de ce que pouvait représenter un
ministère pour un homme qui avait passé sa vie durant dans l’administration
publique royale. Robespierre a été l’Incorruptible aux vues de
ses valeurs ou de sa morale, M. Roland représentait au même titre la
droiture et le respect de ses idées. Au titre des vertus, l’un et
l’autre furent conformes à ce qui les engageait dans l’adversité. Le vertueux fut un des qualificatifs pour désigner Jean-Marie Roland en
positif, comme en négatif sous la plume d’Hébert.
De
plus, il faut être réservé sur la bonne gestion de l’administration
ou sur « la régularité remarquable », le terme est flatteur, la réalité
peu reluisante. De quoi rester songeur quand à cette
anecdote montée par la presse et qui nous est resté jusqu’à ce jour
d’un Roland mal vêtu, où cherchant en son sein ses fonctionnaires à la
tête d’un ministère où sur le papier tout était parfait. Mais à gratter
la gestion des affaires publiques, il existait peu de positif à
découvrir pour les administrés. Notamment pour les usagers pauvres du
pays, et à l'examen du comité des secours aux indigents de l’Assemblée,
difficilement soupçonnable de thèses radicales. L'état des choses était
plus que souffrant. Il y a le versus et le
verso, pourrait-on penser tout en restant prudent, et entre autres sur
ce qui a pu advenir de toutes les lettres ou courriers des mains de M.
Roland. Il se vit confier l’activité de l’ancien «
Secrétaire de la Maison de roi », cette continuité des pouvoirs, lui
donna une lourde charge, en raison des champs
de compétence et d’actions les plus sensibles parmi les missions de
l'État. Clavière jonglait avec
les chiffres et Servan mobilisait comme il pouvait dans l’esprit de la
Fédération, le rôle très ingrat de ce ministère de l’intérieur était parti en
quenouille entre 1790 et 1792, en fait, un sujet explosif.
Roland aurait nécessité un temps plus long pour qu’il puisse exprimer
tous ses talents. Par ailleurs, il est impossible de dire que lui ou sa
femme n’ont pas
commis d’erreurs politiques. La première a été de croire que
l’honnêteté y suffirait. Les époux Roland ne furent pas très habiles
politiquement ou des tacticiens. Aux manettes du pouvoir,
l’application des lois primait. Des intellectuels mal compris, qui
ne cherchèrent pas vraiment la publicité, comme relégués aux mémoires et
pas
suffisamment dignes des grandes pages de notre histoire. Tous les
recollements des écrits de ce couple sont éclatés, faisant que l’on
passe à des tonalités et lectures souvent accusatrices, ou sur le ton
péremptoire des académiciens marginalisant un duo pour le moins peu
conventionnel ; et non libertin au plus cru de la chose, que des
malveillants tentèrent de faire croire de leur vivant.
Son épouse lors du premier ministère fut en retrait des activités de
son mari et s'était tenue à son rôle de plume, plus présente et active,
une fois celui-ci
éjecté du pouvoir en juin 1792. Manon Roland tenait
aussi bien sa maison, qu’elle
circulait sur le terrain baignant comme un poisson dans sa ville
natale.
Elle fut présente lors de la fusillade au champ de Mars et son regard ne
fut pas tendre à l’égard des Cordeliers. Elle se fit aussi remarquée à
l’Assemblée ou aux Jacobins, avec son ami Bosc, au sein du comité de
correspondance. Elle a su être présente et tenir un rôle d’observatrice
sans
concession, sur certaines scènes, comme celle du 17 juillet 1791 au
champ de Mars. Son regard et ses critiques acerbes sur les mêmes qui
allaient les démolir d'ici quelques temps, s'avère très cocasse et pas
totalement inexacte, du moins
fidèle à sa perception d’un événement conducteur et donnant un angle
moins glorieux à certains agitateurs. Le couple fit un peu office de
boulet des jacobins, toute tendance confondue, à partir de première
scission des Amis de la Constitution. Leur donner un peu d’espace
n’entre pas dans la cohérence habituelle, tant de récits les ont
négliger
et vus au sein des « girondins » comme le fait d’un seul tenant ou
carcan, n’a pas aidé à les sortir de l’ombre.
Les Roland, Marie-Jeanne et Jean-Marie sont deux acteurs importants de l’année
1792, avant la venue de la première République, jusqu’à la condamnation
à mort de Louis Capet. Ce couple si particulier a été
finalement l’objet d’assez peu d’écrits. Si l’on prend pour base la
masse de documents existants et le ministre passe pour beaucoup à la
trappe. Même s’il existe des raisons évidentes à ce qu’ils aient été
l’objet de moins d’attention que d’autres ; ils furent présents et
actifs, mais pas pour autant des tribuns. Ils pâtissent d’avoir été des
révélateurs et aussi des observateurs des malaises et contradictions.
Mais ils rejoignent le lot de nombreux participants dont à fait plus
parler, que restituer ou re-situer - à savoir - leur rôle véritable dans
le processus. Les suivre en cette année de toutes les turbulences
permet néanmoins de trouver un point d’observation, qu’on ne peut pas
qualifier de totalement neutre, mais qui permet de découvrir sans
pareil la création en quelques semaines d’une République de 28 millions
d’âmes et les raisons de son improbable existence. Et qui à la première
heure ne résista pas aux outrances et sèma l’effroi dans la
capitale dans les prémices de ce que l’on nomme la « Terreur ».
Grâce
à un auteur et historien, Claude Perroud, il fallut
attendre le vingtième siècle, pour les sortir d’une forme d’oubli, ou
bien
d’avoir été l’objet d’auteurs plutôt conservateurs comme Sainte Beuve.
Le travail de Claude Perroud a été de faire le tri et ne pas se fier à
tous les écrits
et les authentifier avant toute publication. Il eut été dommage d’avoir
consacré une page particulière à Marie-Jeanne Roland, sans à un moment
se
concentrer un peu plus sur son mari et leurs relations avec
Jacques-Pierre
Brissot. Jusqu’à présent dans cet écrit, il a été peu abordé les
fonctions des ministres,
en dehors du rôle de Necker et des finances du royaume, et un court
tour d’horizon des prisons et hôpitaux parisiens. Les responsabilités
confiées en cette année 1792 à Jean-Marie Roland étaient loin
d’être insignifiantes.
Sa femme participa à son deuxième cabinet et
ils se virent confrontés aux débuts à de grosses tourmentes. Même à titre métaphorique, ils se
trouvèrent dans l’œil du cyclone. Le ministre de l’intérieur et des
cultes, mais aussi en charge des postes, de l’approvisionnement, et de
fait au maintien de l’ordre, ce ministère s'afférait de nombre de dossiers
sensibles et hautement politiques. Loyal avec le roi et se tenant aux
règles, il n’hésita pas rapidement à afficher ses désaccords et à
démissionner suite au veto royal avec son collègue Clavière aux
finances. Le parcours de Dumouriez s’engageait dans ce qui allait lui tenir
de gloire (la bataille de Valmy), et de sortir d’un gouvernement sitôt
né, sitôt avorté.
Quatre changements de cabinets ministériels pour la seule période de décembre 1791 à juillet 1792, les
remaniements ministériels démontrèrent une instabilité, rarement évoquée, mais qui ne peut que retenir l’attention.
Par ailleurs, rien ne démontre que Madame Roland fut en situation
dominante face à son mari, Jean-Marie, cette approche consistant à
vouloir faire porter "la culotte" à l’un des deux ne correspond
pas à ce couple difficilement classable. Ce jugement général est très
illustratif chez Adolphe Thiers, plus politique et phallocrate
qu’historien, nous avons toute la mesure d’un jugement masculin de son
temps. Voici ce qu’il dit du couple :
« Cet homme, avec des mœurs
austères, des doctrines inflexibles, et un aspect froid et dur, cédait,
sans s'en douter, à l'ascendant supérieur de sa femme. Madame Roland
était jeune et belle. Nourrie, au fond de la retraite, d'idées
philosophiques et républicaines, elle avait conçu des pensées
supérieures à son sexe, et s'était fait, des principes qui régnaient
alors, une religion sévère. Vivant dans une amitié intime avec son
époux, elle lui prêtait sa plume, lui communiquait une partie de sa
vivacité, et soufflait son enthousiasme non seulement à son mari, mais
à tous les girondins, qui, passionnés pour la liberté et la
philosophie, adoraient en elle la beauté, l'esprit et leurs propres
opinions. »
Source : Gallica-Bnf, Histoire de la Rev. fr., Adolphe Thiers – tome II, page 63
Ce
qui est dit sur les Roland de la Platière laisse pantois sur la
relation aux femmes, le reflet du siècle suivant, quand le genre féminin
connut plus de liberté au XVIIIe siècle, et notamment au sein de l’aristocratie. Mais
Thiers en son étroitesse d’esprit ne sera pas le seul à servir des
clichés et approximations sur ce mariage peu conventionnel et cousu de
fil blanc...
Quand Jean-Marie Roland se rendit à son ministère pour les premières
fois, il provoqua un scandale et se répandirent des railleries à son
sujet. Ô grand drame de la futilité, ce dernier ne portait point de
boucles à ses souliers et un chapeau ordinaire, rond. Il ne s’habillait
pas en conformité à ce que l’on pouvait attendre d’un ministre ou un
personnage de son rang. C’est ainsi que la presse royaliste se
déchaîna contre cet homme. La moquerie est à ce titre la marque d’une
époque, ou le fait de ridiculiser une personne pouvait s’apparenter à
une mort sociale, ou une volonté de nuire à autrui. Ce détail d’un
intérêt en apparence mineur aurait plutôt tendance à le rendre
sympathique. Dire qu’il était froid et dur, d’autres écrits peuvent
prouver le contraire, ne serait-ce qu'a pu écrire sa femme, et sa fin
de
vie n’est pas l’empreinte de l’insensibilité. Mais l’objet du portrait
psychologique, nous renvoyant à trop d’à peu près, et son caractère
important peu, c’est la nature de ses activités et ce qu’il a pu
laisser comme trace qui doit attirer l’attention. Il semble surtout que
son arrivée bouscula les habitudes, et obligea les
fonctionnaires jusqu'alors, plus aptes à la rumeur qu’à la conduite
d’un ministère.
Cette extrême dureté semble avoir tenu en l’idée d’avoir des
collaborateurs présents et répondant aux besoins d’une administration
clef. Et la
raison de la présence de sa femme à ses côtés en août, Manon Roland
s'occupa des courriers du ministère face à des fonctionnaires d’une
efficacité relative ou très peu nombreux pour parler d’une
administration véritablement structurée, en particulier sur la nature
de ses
recrutements.
Au mieux ce que l’on peut juger, c’est l’attitude de Monsieur Roland
pendant la Révolution, il vaudrait mieux parler de principes à son
sujet et d’un esprit très rigoureux. Inspecteur des manufactures, il
venait de prendre sa retraite après 38 ou 40 ans de loyaux services,
quelques mois auparavant et a cru un moment à une retraite paisible
dans son clos de la Platière, héritage familial. De là en faire un
simple fonctionnaire, cet homme âgé de 58 ans fut aussi l’auteur
d’ouvrages techniques ou du ressort des arts et métiers, mais pas
seulement, il existe un intérêt vif au savoir et à l’écriture.
Monsieur Roland était à Lyon avec sa femme quand éclata la révolution.
Elu en 1790 au Conseil général de la commune, il était envoyé par son
département l’année suivante à Paris pour défendre les intérêts des
manufactures lyonnaises, tout en favorisant la création d'un club
jacobin local et en
écrivant dans le Courrier de Lyon. Ce même journal était en
lien avec
le Patriote Français de Brissot. Les deux hommes se
connaissaient
depuis 1787, et l’on peut penser que sa nomination comme ministre ne
fut pas totalement fortuite, mais semble-t-il d’à propos.
M. Roland pourrait ressembler à ce que l’on nomme un ministre «
technique » ou provenant de la société civile. Sa nomination en mars
comme ministre de l’intérieur et des cultes tenait au fait qu’il n’avait
pas été député. Et ceci en vertu de la séparation des pouvoirs à la
Constituante ou à la Législative. S’étant installé depuis peu dans la
capitale, il profita de l’effet d’aubaine et Marie-Jeanne née Phlipon ou Me Roland,
souhaitait vivement revenir à ses sources parisiennes. Les voilà non
seulement installés et lui tutélaire d’un portefeuille plus que
sensible. Car non seulement le ministre, à sous ses responsabilités les
questions de l’ordre, mais aussi il devait assurer l’approvisionnement
des denrées, notamment les greniers de blé du pays, ce fut même, son
premier courrier ministériel que l’on trouve dans l’ouvrage
d’Alexandre Tuetuey.
Sa première décision fut de traiter avec les vendeurs de blé des
ports de Gènes, d’Angleterre ou de Hollande en différents achats. Dans
l’exposé de ses motifs, il expliqua que les 12 millions devaient se
répartir en deux tranches (6 millions pour Gènes et 6 autres pour les
deux autres marchés, les Italiens étant moins chers) de façon à
ce que les ports de Marseille, Bordeaux, etc., puissent remplir les
greniers avant la récolte et ainsi stopper la spéculation au plus vite
et prévenir la demande interne avec des prix en baisse. Non seulement
il rendit compte précisément de ses objectifs et en expliqua la teneur.
Par ailleurs, dans les correspondances du ministère, on le découvre
écrivant au sujet d’une école à Maison-Alfort expliquant à
l’administration que les pièces demandées n’ont pas être exigé pour ce
qui est une délégation de service. L’objet du litige se résumant à
payer le séjour des élèves au directeur de l’établissement et
permettre, que ces derniers puissent se nourrir. Face à la paperasserie
et les tracasseries administratives, il tenta d’en expliquer la teneur
et les raisons à une administration tatillonne ou oppressive.
Si son style d’écriture n’est pas équivalent à celui de son épouse, on
dénote rapidement des compétences et des capacités à régler en toute
légalité des affaires délicates et d’État. Son premier ministère dura
de mars à juin, puis de nouveau à partir du 10 août jusqu’en mars 1793,
il resta à la même fonction. Bien qu’il eût pu devenir député à la
Convention, son ministère de courte durée s’avéra être une sérieuse
épreuve et un exemple à citer. Il y a bien évidemment des critiques à
mener, ses positions sur les prêtres réfractaires et les mesures à
prendre ne le fait pas entrer dans la colonne des saints. Seulement et
ce qui peut sembler incroyable, on ne peut pas dire qu’il a été un
sujet d’étude très approfondi, il est surtout mentionné et en dehors de
Claude Perroud, les Roland et même Brissot semblent trop effacés dans
les récits historiques. Si le terme girondin est donné, on le doit notamment à M.
Vergniaud et Guadet, députés de Bordeaux et à un très grand nombre
d’interventions au sein de l’Assemblée législative.
| Fin
1791, l’on usait plus du terme de « Brissotins », pour
désigner la coalition, le point fort de Brissot était d’avoir en partie
les rênes sur les clubs jacobins et d'avoir été un puissant patron de
presse
et d’attirer les élus du marais. Lui et ses amis avaient tous les
atouts en
main, peut-on présumer en ce début d’année, et s’il y avait à retenir
un
terme générique pour définir un peu mieux les « girondins », il
faudrait comprendre le camp des fédéralistes. Quand Michelet pour
l’année 1792 parle de « Girondins et Jacobins » pour opposer
fédéralistes et centralistes, il écrit une erreur assez monumentale au
regard des faits, il nomme mal l’état politique du moment. Pour ce qui
fera clivage
plus tardivement l’objet d’une guerre civile, et de la forte position
des Girondins
dans certaines provinces de France. Faut-il aussi souligner que
Robespierre était minoritaire au sein des Jacobins de la capitale, il y
joua plutôt profil bas ou ce qui pouvait se résumer à une stratégie
politique, et il se savait sous les menaces des ultras royalistes. S’il
trouva
écoute et lecteurs, son discours s’affûta, et pour toute la galaxie
démocrate et républicaine, certains événements parisiens et la guerre
provoquèrent un tumulte, et une peur plus que compréhensible, vers des
lendemains plus qu’incertains. |
|
Légende : Le feu du patriotisme
les animent tous
|
Marie-Jeanne Phlipon, alias Manon, et Jean-Marie Roland à la croisée des
chemins
et des opinions
La « sorcière girondine » pour quelques-uns et cet étrange
homme mettant l’intérêt commun au-dessus de tout, tous deux ont eu
droit à l’exagération et même des portraits tronqués. Pour le moins, ils
ont été sous-estimés, voire incompris. Dans la postérité et ouvrages
biographiques, Manon Roland par rapport à Olympes de Gouges ou de Théroigne de Méricourt,
est restée la figure historique la plus en retrait, la confinant à un
ordre social très bourgeois ou conforme. Ils n’avaient pas comme d’autres
la folie des grandeurs ou bien les comportements adéquats, même si Hébert a
bien cherché avec son journal
le Père Duchêne à les faire passer pour triviaux et aimant un peu trop
les ors du ministère. Alors que tout démontra que sur la question des
principes et de l’argent et de l’enrichissement, à l'instar de Robespierre, comme de
Marat, que tous se trouvaient à mille lieu de tels enjeux et même dans la manière
d’être, l'intérêt général primait.
Il est vraiment étrange ce ministre rendant compte des sommes employées
dans son ministère et sous son exercice, faisant des compte-rendus
moraux de ses activités, se souciant de l’argent public fut une
attitude qui marqua son passage au ministère de
l’Intérieur. Jean-Marie Roland et son épouse firent cause commune, et
elle a été pour tous les témoignages la petite et grande main anonyme
des écrits de cette période incertaine, ce fut elle sur la scène
révolutionnaire qui resta le plus en retrait ou à l’arrière-plan.
Pourtant, ce fut lui dont on a évoqué assez peu les évolutions, sur qui
tombèrent les foudres et les haines. Leurs crimes, une certaine idée
de la vérité, et quoi que veuille les moralistes des exceptions à la
règle. Le vertueux M. Roland comme le dépeignait Hébert était
du ressort de la satire ou des excès de plume.
Cependant, Jean-Marie Roland, et les ministres Servan, et Clavière,
protégés de Brissot ou inversement, plus Dumouriez ne composaient pas un
véritable projet politique et sur l’homogénéité du groupe, il y aurait
à émettre des réserves. Personne n’a pu échapper à des contradictions et
Brissot comme chef de file, entre la morale et la pratique,
l’engagement dans la guerre allait devenir totale et le fruit de tous
les malheurs, plus les mauvais choix économiques ou une certaine
continuité ne fit pas illusion longtemps. Ils n'étaient que le paravent
d’une bourgeoisie élitaire ouverte aux idées d’outre-Manche. La
sincérité des Roland fut aussi leur ruine morale et politique, des
intellectualités isolées ne firent pas un courant d’idée et encore moins
des canaux d’opinions solides. L’égalité, la vraie, si présente dans les
discours participait de l’illusion, les masses inexpertes parce que ne
résonnant pas d’une voix, les peuples jugent à l’aune des résultats, et
tout allait empirer. Là où la lumière aurait pu briller! Les belles idées,
même une fois dépliées de leurs enveloppes, ou contenus, sans
confrontation au réel ne pouvaient que s’effondrer.
Bien sûr que la famille girondine était bien plus large. En l’état
ne sont cités que les hommes de pouvoirs. Chaque personnage représente
une étude propre, le risque de dispersion est grand et l’on touche à
certaines limites de l’esprit humain, celui de tout historien n'est pas de
pouvoir répondre à tout, mais de répondre à ce qu’il peut et
avec prudence. Avec en premier lieu à un impératif se nommant le temps.
Qui plus est comme la mémoire est toujours faillible, chacun est amené
à se rendre compte des erreurs, plus exactement des siennes. L’épreuve
chronologique, du temps passant, est une base, et, à chacun d’engager
ses
propres recherches, d’aller plus loin. Il n’est pas totalement fait
exprès de choisir de zones d’ombres ou méconnues. Mais il est
impossible d’expliquer que telle partie de l’opinion à basculer, c’est
une abstraction, dans le détail du quotidien, quand il y a moyen de
faire
remonter des inconnu-e-s ou ce qui ressemble à des énigmes?
La première, ce Peuple si louangé est en général assez lointain, et
avec la Gironde nous touchons le haut du panier de la bourgeoisie
française et ce qui composait sa frange intellectuelle. Probablement
la plus féconde était née dans l’encyclopédisme du siècle. Nous sommes
loin des thèses de Marx ou de Keynes, tout découlait du courant
des économistes dits physiocrates. Ce n’était pas l’école libérale
française à proprement parler, il s’agissait avec Nicolas de Condorcet d’un
mouvement qui démontra déjà ses limites sous Turgot, l’expérimentateur
du libre commerce.
C’est à chaque fois le même problème, à tout vouloir unifier d’un seul
tenant, entre une part d’imprécision et rien n’est plus azimuté que ce
terme : libéral. Qui repose à la fois sur des évolutions communes et
disjointes, mais qui est né en France non point d’une école laïque,
mais d’une critique du système religieux et de la répression qui
s’abattit tout au long du dix-huitième siècle sur les Jansénistes ou
supposés tels.
Les
prisons allaient regorger de ces critiques qui avaient pour prétention
d’être du côté des sciences, et qui avaient été à l’origine de nombreux
libelles. Ceci a posé une grille de lecture peu orthodoxe ou propre à
nourrir l’idée d'une lutte des classes. Cela pose aussi dans ce travail de
rappeler que l’entité géographique choisie, la capitale est de ce point
de vue peu représentative du pays ou de la majorité de ses concitoyens, qui vivait en
France et dans les colonies. Faire un récit ou 99,99% de la population
serait amener à s’exprimer est une inconnue, et, dont on connaît bien à peine 3 à
5% de ses membres : noblesse ou gens de robe et grande bourgeoisie
notamment. Cela pose de sérieuses difficultés à établir ou laisser
s’exprimer, la voix d’un Peuple, pas plus que ne le furent les
Montagnards, plus représentatifs de la petite bourgeoisie et de
certaines formes d'arrivisme. Nous sommes encore dans une logique de
caste, plus que de luttes des classes, ou bien à l'intérieur des
classes bourgeoises?
Une fois cette parenthèse écrite, revenons à la matrice du temps et aux
réalités observables. La crise économique était à vif depuis janvier 1792, la
non
observance de droits égaux pour tous les humains et les esclaves en
particulier, sauf pour les affranchis, cette maigre avancée avait de quoi ternir
cette nouvelle équipe dirigeante. Cet ordre raciste de la société a été
manifeste, et il n’est pas possible de gommer les mots, qui plus est,
ils étaient une source de revenu pour une infime minorité. Les mots «
nègres, mulâtres, gens de couleurs » sont présents dans les actes
légaux, sous les plumes et dans les têtes le genre humain restait à naître. Découvrir un
comité des colonies au sein de la Législative, et Roland signer avec le
roi en avril, interpelle. Surtout quand de l’autre côté de la rive
atlantique la majorité était soumise et ne pouvait se libérer des chaînes de l'esclavage,
que dans la violence.
Paris faisait en partie illusion, quand tout cela se
voulait à l’unisson, les Parisiens toujours aux premières loges
allaient
vivre les grands spasmes d’une nouvelle liberté. Quand certains font
appel au meilleur de l’humain, ils s’illusionnent de leurs propres
intentions et ne font que reproduire partiellement et de génération en
génération une histoire crépusculaire, une folie héréditaire… Les
politiques veulent le pouvoir et les mots les couvrent des plus belles
intentions pour l'humanité, mais au final à l’heure de rendre des
comptes, il peut y
avoir une tendance à enjoliver les choses. C’est justement ce léger
décalage qui fait des Roland des personnages peu conventionnels. Les
Roland ont cru trop tôt, eux aussi, que la Révolution était arrivée à
son
terme en août avec l’arrivée des démocrates et républicains aux
manettes, et à
la tête de l’appareil d’État. Erreur tragique, les difficultés ne
faisaient que
commencer…
Texte de Lionel Mesnard
|
|
|
- M. Condorcet, au nom du comité
- d'instruction publique
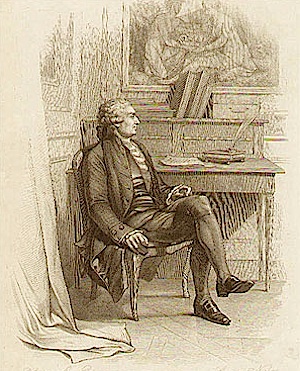
Assemblée
nationale, le 21 avril 1792
|
Suite à son rapport
ayant débuté le 20 avril, Nicolas
de Condorcet présente un
projet de décret sur l'organisation
générale de l'instruction publique. Il s'exprime ainsi :
« Les conférences
hebdomadaires proposées pour ces 2 premiers degrés ne
doivent pas être retardées comme un faible moyen d'instruction. 40 ou 50
leçons par année peuvent renfermer une grande étendue de connaissances,
dont les plus importantes répétées chaque année, d'autres tous les 2
ans, finiront par être entièrement comprises, retenues, par ne pouvoir
plus être oubliées. En même temps, une autre portion de cet
enseignement se renouvellera continuellement, parce qu'elle aura pour
objet, soit des procédés nouveaux d'agriculture ou d!arts mécaniques,
des observations, des remarques nouvelles, soit l'exposition des lois
générales, à mesure qu'elles seront promulguées, le développement des
opérations du gouvernement d'un intérêt universel. Elle soutiendra la
curiosité, augmentera l'intérêt de ces leçons, entretiendra l'esprit
public et le goût de l'occupation. Qu'on ne craigne pas que la gravité
de ces instructions en écarte le peuple. Pour l'homme occupé de travaux
corporels le repos seul est un plaisir, et une légère contention
d'esprit un véritable délassement : c'est pour lui ce qu'est le
mouvement du corps pour le savant livré à des études sédentaires, un
moyen de ne pas laisser engourdir celles de ses facultés que ses
occupations habituelles n'exercent pas assez. L'homme des campagnes,
l'artisan des villes, ne dédaignera point des connaissances dont il
aura une fois connu les avantages par son expérience ou celle de ses
voisins. Si la seule curiosité l'attire d'abord, bientôt l'intérêt le
retiendra. La frivolité, le dégoût des choses sérieuses,
le dédain
pour ce qui n'est qu'utile ne sont pas les vices des hommes pauvres ;
et cette prétendue stupidité, née de l'asservissement et de
l'humiliation, disparaîtra bientôt, lorsque des hommes libres
trouveront auprès d'eux les moyens de briser la dernière et la plus
honteuse de leurs chaînes.
Le troisième degré d'instruction
embrasse les éléments de toutes les
connaissances humaines. L'instruction considérée comme partie de
l'éducation générale y est absolument complète.
Elle renferme ce qui
est nécessaire pour être en état de se préparer à remplir les fonctions
publiques, qui exigent le plus en lumière, ou de se livrer avec succès
à des études plus approfondies ; c'est là que se formeront les
instituteurs des écoles secondaires, que se perfectionneront les
maîtres des écoles primaires, déjà formés, dans celles du second degrés
Le nombre des instituts a été porté à 114, et il en sera établi dans
chaque département. On y enseignera non seulement ce qu'il est utile de
savoir comme homme, comme citoyen, à quelque profession qu'on se
destine, mais aussi tout ce qui peut l'être pour chaque grande division
de ces professions, comme l'agriculture, les arts mécaniques, l'art
militaire, et même on y a joint les connaissances médicales nécessaires
aux simples praticiens, aux sages-femmes, aux artistes vétérinaires.
En jetant les yeux sur la liste des professeurs», on remarquera
peut-être que les objets d'instruction n'y sont pas distribués suivant
une division philosophique, que les sciences physiques et mathématiques
y occupent une très grande place, tandis que les connaissances qui
dominaient dans l'ancien enseignement y paraissent négligées.
Mais
nous avons cru devoir distribuer les sciences, d'après les méthodes
qu'elles emploient par conséquent, d'après la réunion de connaissances
qui existent le plus ordinairement, chez les hommes instruits ou qu'il
leur est plus facile de compléter.
Peut-être une classification
philosophique des sciences n'eût été dans l'application
qu'embarrassante et presque impraticable.
En effet, prendrait-on pour base les
diverses facultés de l'esprit,
mais l'étude de chaque science les met toutes en activité, et contribue
à les développer et à les perfectionner. Nous les exerçons même toutes
à la fois, presque dans chacune des opérations intellectuelles. Comment
attribuerez-vous telle partie des connaissances humaines à la mémoire,
à l'imagination, si lorsque vous demandez par exemple à un enfant de
démontrer sur une planche, une proposition de géométrie, il ne peut y
parvenir sans employer à la fois sa mémoire, son imagination et sa
raison? Vous mettrez sans doute la connaissance des faits dans la
classe que vous affectez à la mémoire, vous placerez donc l'histoire
naturelle à côté de celle des nations, l'étude des arts auprès de celle
des langues, vous les séparerez de la chimie, de la politique, de la
physique, de l'analyse métaphysique, sciences auxquelles ces
connaissances des faits sont liées, et par la nature des choses, et par
la méthode même de les traiter. Prendra-t-on pour base la nature des
objets? Mais le même objet, suivant la manière de l’envisager,
appartient à des sciences absolument différentes. Ces sciences exigent
des qualités d'esprit qu'une même personne réunit rarement et aurait
été très difficile de trouver et peut-être de former des hommes en état
de se plier à ces divisions d'enseignement.
Ces mêmes sciences ainsi distribuées
ne se rapporteraient pas aux mêmes
professions, leurs parties n'inspireraient pas un goût égal aux mêmes
esprits, et ces divisions auraient fatigué les élèves comme les
maîtres.
Quelque autre base philosophique que l’on choisisse, on se
trouvera toujours arrêté par des obstacles du même genre. D'ailleurs,
il fallait donner à chaque partie une certaine étendue, et maintenir
entre elles une espèce d'équilibre; or, dans une division philosophique
on ne pouvait y parvenir qu'en réunissant par l'enseignement ce qu'on
aurait séparé par la classification. Nous avons donc imité dans nos
distributions la marche que l'esprit humain a suivie dans ses
recherches, sans prétendre l'assujettir à en prendre une autre, d'après
celles que nous donnerions à l'enseignement. Le génie veut être libre,
toute servitude le flétrit, et souvent on le voit porter encore,
lorsqu'il est dans toute sa force, l'empreinte des fers qu'on lui avait
donnés au moment où son premier germe se développait dans les exercices
de l'enfance. Ainsi, puisqu'il faut nécessairement une distribution
d'études, nous avons dû préférer celle qui s'était d'elle-même
librement établie, au milieu des progrès rapides que tous les genres de
connaissances ont faits depuis un demi-siècle.
Plusieurs motifs ont déterminé
l'espèce de préférence accordée aux
sciences mathématiques et physiques. D'abord pour les hommes qui ne se
dévouent point à de longues études, qui n'approfondissent aucun genre
de connaissance, étude même élémentaire de ces sciences est le moyen le
plus sur de développer leurs facultés intellectuelles, de leur
apprendre à raisonner juste, à bien analyser leurs idées. On peut, sans
doute, en s'appliquant à la littérature, a la grammaire, à l'histoire,
à la politique, à la philosophie en général, acquérir de la justesse,
de la méthode, une logique saine et profonde et cependant ignorer les
sciences naturelles. De grands exemples l'ont prouvé ; mais les
connaissances élémentaires dans ces mêmes genres n'ont pas cet avantage
; elles emploient la raison, mais elles ne la formeraient pas. C'est
que dans les sciences naturelles, les idées sont plus simples, plus
rigoureusement circonscrites ; c'est que la langue en est plus
parfaite, que les mêmes mots y expriment plus exactement les mêmes
idées. Les éléments y sont une véritable partie de la science,
resserrée dans d'étroites limites, mais complète en elle-même. Elles
offrent encore à la raison un moyen de s'exercer, à la portée d'un plus
grand nombre d'esprits, surtout dans la jeunesse. Il n'est pas
d’enfant, s'il n'est absolument stupide, qui ne puisse acquérir quelque
habitude d'application, par des leçons élémentaires d'histoire
naturelle ou d'agriculture. Ces sciences sont contre les préjugés,
contre la petitesse de l'esprit, un remède sinon plus sûr, au moins
plus universel que la philosophie même. Elles sont utiles dans toutes
les professions, et il est aisé de voir combien elles le seraient
davantage si elles étaient plus uniformément répandues. Ceux qui en
suivent la marche voient approcher l'époque où l'utilité pratique de
leurs applications va prendre une étendue à laquelle on n'aurait osé
porter ses espérances, où les progrès des sciences physiques doivent
produire une heureuse révolution dans les arts, et le plus sûr moyen
d'accélérer cette révolution est de répandre ces connaissances dans
toutes les classes de la société, de leur faciliter les moyens de les
acquérir. » (page 227 et 228)
(…) « Le plan que nous présentons à
l'Assemblée a été combiné d'après
l'examen de l'état actuel des lumières en France et en Europe; d'après
ce que les observations de plusieurs siècles ont pu nous apprendre sur
la marche de l'esprit humain dans les sciences et dans les arts; enfin,
d'après ce qu'on peut attendre et prévoir de ses nouveaux progrès.
Nous avons cherché ce qui pourrait plus sûrement contribuer à lui
donner une marche plus ferme, à rendre ses progrès plus rapides.
Il
viendra sans doute un temps où les sociétés savantes, instituées par
l'autorité, seront superflues, et dès lors dangereuses, où même tout
établissement public d'instruction deviendrai inutile : ce sera celui
où aucune erreur générale, ne sera plus à craindre, où toutes les
causes qu'appellent l'intérêt ou les passions au secours des préjugés,
auront perdu leur influence ; où les lumières seront répandues avec
égalité et sur tous les lieux d'un même territoire, et dans toutes les
classes d'une même société; où toutes les sciences et toutes les
applications des sciences seront également délivrées du joug de toutes
les superstitions et du poison des fausses doctrines, où chaque homme
enfin trouvera dans ses propres connaissances, dans la rectitude de son
esprit, des armes suffisantes pour repousser toutes les ruses de la
charlatanerie; mais ce temps est encore éloigné, notre objet devait
être d'en préparer, d'en accélérer l'époque; et en travaillant à
former ces institutions nouvelles, nous avons dû nous occuper sans
cesse de hâter l'instant heureux où elles deviendront inutiles. (Ce
discours a été interrompu presque à chaque phrase par les
applaudissements unanimes de l'Assemblée et des spectateurs.) »
Source : Suivi du
projet et décret des Titres, le premier concerne l’instruction
publique,
à la
séance du 21 avril 1792 (tome 42) et débats
avec amendements proposés
Archives
Parlementaires - Librairie de l'université de Stanford (E.U.)
|
|
|
|
|
M.
Roland à l'Assemblée
le 25 avril 1792

Buste de J.M. Roland de la Platière par Joseph Chinard
|
|
« Messieurs, les troubles intérieurs dont
la France est agitée tiennent à
des causes générales ou particulières, dont l'examen demande en ce
moment la plus sérieuse attention. Les dernières convulsions du
fanatisme et de l'aristocratie tendent à les prolonger et à produire,
par eux, une dissolution dont les ennemis extérieurs voudraient
profiter. Il est évident, pour ces derniers, que leurs efforts seront
inutiles, si nous sommes unis pour leur résister. Je n'offrirai point à
l'Assemblée les détails immenses de toutes les agitations qui se sont
manifestées dans les diverses parties de la France ; les événements les
plus remarquables ont été mis sous ses yeux, et l'historique de chacun
emporterait un temps considérable; mais après avoir appelé son
attention sur les troubles excités par divers prétextes ou par la
conduite et les menaces des ennemis de la Révolution, je viens la fixer
essentiellement sur ceux que nous devons au fanatisme.
Ici s'ouvre une carrière sans bornes, dont chaque place est marquée par
des maux incalculables et des désordres sans cesse répétés. Quelque
affligeant que soit le détail des excès qu'on doit principalement
attribuer aux causes indiquées dans mon dernier rapport, il ne peut
être comparé à la multiplicité de ceux produits par l'intérêt et la
vengeance de quelques prêtres forcenés à l'ombre des opinions
religieuses. Ce ne sont pas quelques départements seulement où des
tumultes passagers aient élevé des craintes, sollicité la vigilance des
administrateurs ; c'est une fermentation universelle, dont le levain
existe dans toutes les parties de la France, et a soulevé plus ou moins
les esprits dans tous les départements. Ici, des prédications
incendiaires, faites par des prêtres non assermentés, retentissent de
village en village, préviennent les habitants contre les prêtres
assermentés, et les portent à s'opposer à leur installation. Là, des
écrits séditieux, des menaces violentes multiplient les émeutes,
propagent le désordre. De toutes parts, on insinue le mépris des lois,
le refus de payer les contributions.
La licence et l'anarchie,
inspirées par le fanatisme, font chaque jour de nouveaux progrès. Des
femmes séduites et furieuses croient travailler pour le ciel, en
portant leurs maris à soutenir des prêtres hypocrites, et en accablant
d'outrages ceux que ces prêtres leur indiquent pour ennemis. Les lois,
insuffisantes ou méconnues, ne peuvent contenir ou réprimer une foule
aveugle; le germe des dissensions civiles se développe de tous côtés ;
la division règne dans les familles ; la discorde ravage l'Empire. Il
est impossible d'offrir à l'Assemblée les faits nombreux, les
événements tragiques, résultats terribles des passions les plus sombres
et les plus exaltées. Ils sont consignés dans une correspondance
immense que je puis donner en extrait à l'Assemblée. Le salut de
l'Empire demande des mesures que la sagesse des législateurs peut seule
calculer et ordonner.
C'est dans les différentes crises de l'état violent que je viens
d'esquisser, qu'environ 30 à 40 départements se sont vus forcés de
prendre des arrêtés qui n'étaient ni prescrits, ni autorisés par la
Constitution. Je joins ici l'énumération des départements et
l’indication de leurs arrêtés. Injonction aux prêtres non assermentés
de quitter les paroisses qu'ils desservaient précédemment, et où ils
abusaient de leur ascendant ; ordre de s'en éloigner à telle distance
dans un temps donné ; désignation de résidence dans une même ville ou
chef-lieu de département, avec ordre de les y surveiller ; telles sont
généralement les bases et les principales dispositions de ces arrêtés.
Ils ne sont pas l'ouvrage isolé d'un petit nombre de départements, dans
les administrateurs desquels on puisse soupçonner de l'exagération et
de la partialité ; ils ont été pris, presque partout, à des temps très
différents ; ils sont le produit des malheurs passés, des craintes pour
l'avenir et des dangers présents. Dans beaucoup d'endroits, ils ont été
demandé par des pétitions de citoyens justement alarmés ; partout ils
ont été sollicités par la gravité des circonstances et l'excès d'une
fermentation dont il fallait prévenir les derniers effets. On le
jugeait sans doute ainsi, puisqu'on a laissé le temps s'écouler;
plusieurs de ces arrêtés remontent à une date ancienne ; cependant les
hommes qu'ils concernaient, et ceux qui prenaient part au sort de ces
hommes, ont réclamé contre leur illégalité.
Mon prédécesseur (Ndr : Cahier de Gerville) avait écrit aux
départements pour le leur observer et l'on projetait une proclamation
pour les casser. Nul doute, messieurs, que la rigueur de la loi n'exige
du ministre chargé de la faire exécuter, d'anéantir tout acte qu'elle
réprouve ; nul doute aussi que l'application rigoureuse de ce principe
ne puisse, dans un temps de crise, compromettre le salut public ; nul
doute encore que le moment où nous sommes est extrêmement orageux.
Placé entre, l'obligation de me conformer au texte de la loi et le
devoir non moins sacré de ne rien faire qui puisse plonger la France
dans de nouveaux malheurs, j'ai dû commencer par remontrer aux
départements les vices de leurs arrêtés, la nécessité où je serais de
les frapper et le bien qu'ils feraient s'ils les retiraient eux-mêmes.
Quelques-uns ont eu égard à ces représentations, plusieurs n'ont pas
répondu, d'autres ont observé que les arrêtés qu'ils avaient pris
n'ayant pas été mis à exécution, devaient être regardés comme non
avenus ; d’autres enfin ont répliqué qu'il était impossible de retirer
les leurs sans exciter les plus grands maux ; ce sont ceux de
l'Ille-et-Vilaine, de l'Orne et de la Mayenne. Notre soumission,
disent-ils, est un de nos premiers devoirs; mais si l'impôt ne se lève
pas, ce sont les prêtres réfractaires qui en sont la cause. Si le
langage des lois a peine à se faire entendre, c'est toujours à ces
hommes qu'il faut s'en prendre, puisqu'ils ont porté partout
l'égarement et le désespoir. Nous ne pouvons le dissimuler, la
fermentation dans nos campagnes est à son comble, les gardes nationales
sont armées; elles poursuivent ces prêtres réfractaires, ou plutôt leur
redemandent cette paix dans leur ménage, qui semble en être bannie pour
toujours. En retirant notre arrêté, nous exposerions nos concitoyens
aux plus grands dangers ; au lieu d'un parti, nous en aurions deux en
sens contraire.
Que peut la tolérance religieuse contre l'ambition, l'orgueil et
l'avarice des prêtres? Libres de toute crainte, ils grossissent leur
parti des ignorants et des faibles qu'ils effraient et de ceux dont ils
ont surpris la bonne foi par des manœuvres ou des sophismes. La honte
et l'infamie attendent tout dépositaire de l'autorité qui, froidement
assis sur la borne posée par une loi imprévoyante, refuserait de
s'élancer au-delà pour prévenir ou empêcher le meurtre, qu'un jour,
qu'une heure, qu'un moment peut amener (Applaudissements dans les
tribunes) ; que le conseil du roi, auquel vous soumettrez votre arrêté,
le casse si telle est sa volonté, nous attendrons sa décision avec
résignation ; mais le rétracter, est une condition impossible. Nous
n'examinerons pas qu'en le faisant, nos jours seraient exposés; le
danger qui nous est propre, est le moindre à nos yeux; mais nous
sentons qu'il n'y aurait plus le confiance pour nous dans nos
administrés ; que nous serions pour eux comme si nous cessions
d'exercer nos fonctions ; que la fureur du peuple n'aurait plus de
bornes, que le sang coulerait, que les prêtres, dont le salut fait
l'objet de votre sollicitude et de la nôtre, seraient les tristes
victimes de notre rétractation.
Si malgré ces raisons, que nous sommes
bien éloignés de vous rendre avec l'énergie dont elles sont
susceptibles, vous croyiez devoir employer contre nous des poursuites
rigoureuses, nous abandonnerions sur-le-champ un poste où notre but
cependant n'a jamais été que de prouver notre fidélité à la nation, à
la loi et au roi, et de nous y rendre aussi utiles qu'il dépendait de
nous. Ce n'est point une multitude mutinée qui se soulève contre les
non-conformistes, c'est la voix de la nation entière
(Applaudissements.) Tant qu'on laissera une libre carrière à leurs
trames perfides, jamais la tranquillité publique ne se rétablira;
l'expérience, qui est plus forte que tous les raisonnements, le prouve
avec évidence.
Je n'ai rien à ajouter, messieurs, à ces rigoureuses expériences, sinon
que les dispositions de quelques-uns de ces arrêtés peuvent être
considérées comme des mesures de police et les autres paraissent avoir
été dictées par l'impérieuse nécessité ; je les soumets tous à
l'Assemblée, comme seul juge compétent de ce que les circonstances ont
pu exiger au delà de la loi et de ce que la sûreté commune doit faire
excuser. Je dois faire remarquer cependant, parmi ces arrêtés, celui du
département de la Loire Inférieure, contre lequel je viens de recevoir
les réclamations de plusieurs communes, ou plutôt celles de la
municipalité de Clisson, auxquelles ont adhéré 20 municipalités
voisines. Il paraît que, dans ce département, presque tous les prêtres
sont réfractaires ; que leur ascendant est considérable ; que la
circonstance des Pâques peut l'avoir augmenté et que l'idée dans ce
moment de demeurer sans prêtres, si ceux-là leur étaient enlevés, a
effrayé les habitants. Je dois dire encore que le directoire actuel du
département, séant à Saintes ayant cru devoir casser un arrêté
répressif contre les prêtres, qu'avaient pris les administrateurs
précédents, il en est résulté des agitations dont me font part de
nombreux pétitionnaires.
Je terminerai par les observations que m'adressent les administrateurs
du département de la Moselle, dans une lettre du 15 de ce mois. La
fermentation est extrême dans tous les districts ; partout des citoyens
justement irrités de l'abus indigne qu'on fait de la religion pour
soulever les esprits faibles et crédules et des manœuvres criminelles
qui, toujours ourdies dans l'ombre, échappent presque toujours à la
surveillance de la police et à la vengeance des lois, se livrent ou
sont prêts à se livrer à des mouvement impétueux et désordonnés ; nous
ne pouvons trop répéter qu'il est instant et même très urgent que
l'Assemblée nationale et le roi prennent un parti rigoureux et de
grandes mesures, pour nous assurer la tranquillité intérieure et nous
mettre à l'abri des troubles et des désordres qui désolent déjà
plusieurs points de notre département.
Je viens aussi de recevoir des observations détaillées des
administrateurs des départements des Landes et du Gard, sur la
nécessité de maintenir leurs arrêtés. J'en remets une copie sous les
yeux de l'Assemblée. Nous n'avons ni à nous flatter sur nos maux, ni à
nous effrayer sur leur nombre. Partout la masse du peuple est saine,
partout l'amour de la Constitution prédomine, partout le cri de la
liberté s'est élevé, partout son règne doit s'établir; mais il faut à
la fois combattre vigoureusement les ennemis du dehors, contenir ceux
du dedans, maintenir la paix entre les frères, assurer le triomphe des
lois par elles-mêmes et les rendre assez puissantes pour atterrer les
malveillants en épargnant leur sang.
La même réclamation se fait entendre dans toutes les parties du royaume
; les mêmes agitations s'y font sentir. Une grande résolution, une même
pensée, doivent occuper aujourd'hui tous les Français ; c'est au moment
où le patriotisme rend un nouvel essor, appelle la victoire et
brûle de la fixer sous nos drapeaux, qu'il vous paraîtra sage de
décréter une mesure efficace pour anéantir dans leur principe les
divisions intestines qui nous déchirent et la discorde dont le
fanatisme s'est fait un jeu cruel.
15 avril. Je reçois dans ce moment une lettre du
directoire du
département du Finistère, sur un arrêté qui confirme une délibération
du district de Brest, qui fait marcher une force armée de 600 hommes, 2
pièces de canon et 4 commissaires civils, sur la paroisse de Plouzané,
qui est en insurrection complète, suscitée par le fanatisme religieux,
par la suggestion et les discours incendiaires des prêtres non
assermentés et leur coalition coupable avec une municipalité égarée.
18 avril. Par le même courrier, le procureur syndic du département
de
la Corrèze me rend compte que la fermentation étant à son comble dans
le département, puisque dans la ville de Tulle les deux partis avaient
été au moment d'en venir aux mains, ils avaient cru devoir prendre un
arrêté, portant : « que tous les prêtres non assermentés seraient tenus
de se retirer, dans les 24 heures, dans le sein de leur famille ; que
les municipalités où ils se retireraient, les prendraient sous leur
protection et surveilleraient avec soin leur conduite, sous leur
responsabilité (*). (...)
|
(*) Copie de la
lettre de M. le procureur général syndic du département de la Corrèze,
au ministre de l’intérieur, datée de Tulle, le 11 avril 1792.
Je
m'empresse de vous prévenir, Monsieur, que la ville de Tulle vient
d'éprouver une violente secousse. Depuis longtemps, un des quartiers de
cette ville, séduit par les ennemis de la Révolution qu'il renfermait
dans son sein, et qui étaient répandus dans le reste le la ville,
excité d'ailleurs par des prêtres fanatiques, a enfin levé le masque en
se réunissant en armes le lundi de Pâques, sous prétexte qu'il était
menacé d'être incendié ; les autres citoyens, surpris de cette
démarche, se sont armés de leur côté. La municipalité, pour prévenir
les malheurs dont on était menacé, a ordonné sur-le-champ à tous les
citoyens de se retirer tranquillement et de poser les armes ; les seuls
patriotes ont obéi à cette réquisition.
En vain les corps
administratifs ont employé la voie de la persuasion auprès des autres;
sourds à toute réquisition, ils se sont précipités sur les patriotes
désarmés, heureusement la gendarmerie nationale secondant les efforts
des corps administratifs, on est parvenu à les faire rentrer dans leur
quartier ; toute la garde nationale, sur la réquisition des 3 corps
administratifs, qui avaient décidé de se réunir dans une circonstance
aussi critique, s'est rassemblée et a passé la nuit sous les armes ; le
lendemain matin, les citoyens des campagnes, avertis des mouvements qui
se passaient dans la \ille, ont accouru en foule de tous côtés ; à 10
heures du matin, 6.000 hommes réunis en ont imposé aux malintentionnés.
Alors les corps administratifs,
ayant une force imposante à leur
disposition, ont pris un arrêté pour faire désarmer les
malintentionnés, dont une partie s'était enfin retirée dans leurs
maisons, et quelques-uns avaient fui. Le désarmement s'est fait sans le
moindre désordre ; 5 personnes sont déjà arrêtées et conduites dans la
maison d'arrêt. Depuis 3 jours, il se rend continuellement ici des
gardes nationales des campagnes, dont le zèle ne se ralentit pas. Il
m'est impossible de vous donner les détails de ce qui s'est passé
depuis lundi : le directoire vous enverra copie du procès-verbal, mais
nous sommes tous si harassés et nous avons été si occupés, qu'il n'a pu
encore être rédigé ni copié.
Malgré une affluence continuelle
de plus de 15.000 habitants des
campagnes, malgré l'animosité et la juste fureur qu'a excité cette
entreprise, les jours de tous nos ennemis ont été respectés. La garde
nationale de Tulle s'est conduite avec une modération, avec une
humanité qui méritent les plus grands éloges, et si vous trouvez dans
le procès-verbal le détail de quelques désordres occasionnés par des
individus aigris par l'atrocité de l'entreprise méditée contre les
patriotes et égarés par la vengeance, vous serez encore plus frappé de
ce qu'aucun citoyen n'a péri et de ce que les coupables ont été
conduits et livrés aux tribunaux au milieu du désordre inévitable qu'a
occasionné un rassemblement considérable de communes étrangères.
Le procureur
général syndic du département de la Corrèze,
Signé :
Viel, procureur général.
|
P.S. J'étais si préoccupé, monsieur, en faisant ma lettre, que
j'ai
oublié de vous dire que les brigades de gendarmerie qui ont été
requises de se réunir à celle de Tulle se sont conduites d'une manière
digne des plus grands éloges.
Pour copie
conforme à l'original, Le ministre de l'intérieur,
Signé : Roland.
Source : Bib. de Stanford, Archives
Parlementaires
|
|
|
- Chronologie
du 1er avril au 19 juin 1792
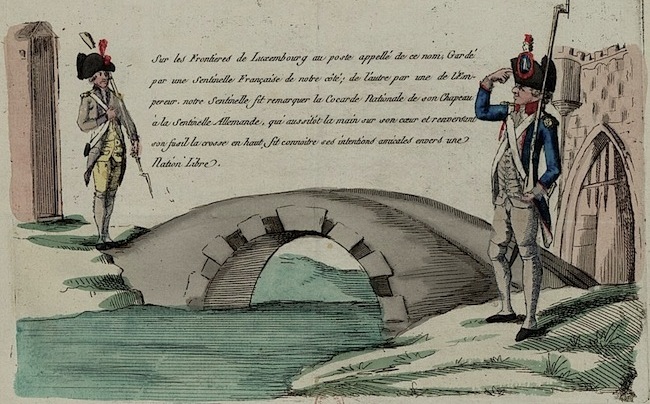
|
IV – Le
mois d’avril 1792
1er avril : A Ajaccio, Bonaparte est élu et promu lieutenant-colonel
d’un régiment de volontaires Corses. La Législative adopte le
logographe optique de Claude Chappe à des fins militaires, suite au
rapport de Gilbert Romme. A la Législative, la baronne hollandaise Etta Palm d'Aelders se présente à la barre avec d'autres femmes : « Après un long éloge des vertus féminines, après avoir soutenu que les
femmes égalent les hommes en courage, en talent, et les surpassent
presque toujours en imagination, elle prie l'Assemblée de prendre en
considération l'état d'avilissement auquel se trouvent réduites les
femmes, quant aux droits politiques, et réclament pour elles la pleine
jouissance des droits naturels dont elles ont été privées par une
longue oppression. Pour arriver à cet but, elle demande que les femmes
soient admises aux emplois civils et militaires et que l'éducation des
jeunes personnes du sexe soit fondée sur les mêmes bases que celle des
hommes. Les femmes ont partagé les dangers de la Révolution ; pourquoi
ne participeraient-elles pas à leurs avantages. Les hommes sont libres
enfin, et les femmes sont esclaves de mille préjugés. Elles demandent
donc :
1° que l'Assemblée nationale accorde une éducation morale et
nationale aux filles ;
2° qu'elles soient déclarées majeures à 21 ans ;
3° que la liberté politique et l'égalité des droits soient communes aux deux sexes ;
4° que le divorce soient décrété.
Source : Bib. de Stanford - Archives parl. - tome XLI, pages 63 et 64
2 avril : A l’Assemblé
est pris
un décret précisant qu’il n’y aurait pas de poursuites contre M.
Narbonne (ex. ministre de la guerre). Aux Jacobins, M. Grammont, comédien et membre de la Société
: « relate
un incident survenu au Palais royal, alors qu'il lisait un écrit
concernant les soldats de Châteauvieux : un nommé Dugué, se disait
membre de la Société, a ameuté la foule contre lui. Vérification faite,
il ne se trouve pas parmi les membres de la Société, ni parmi ses
employés, aucune personne de ce nom. On reconnaît là une ruse déjà
employée plusieurs fois par les ennemis des patriotes. Robespierre en
profite pour demander que la liste des membres de la Société soit
imprimée et affichée dans le lieu des séances. Un membre propose que
cette liste soit divisée en autant de tableaux qu'il y a de sections.
La motion de Robespierre est arrêtée avec l'amendement ». Il
semblerait que cette motion n’ait donné lieu à aucune publication
(Source : Œuvres complètes de Robespierre, les discours, Tome VIII, PUF 1954)
3 avril : Camille Desmoulins écrit à son père au sujet de Danton, il précise que celui-ci est passé « au camp opposé ».
Mieux encore et malgré son opposition à Brissot et son pamphlet à son
encontre Brissot démasqué, Desmoulins négocie en coulisse pour un
ministère pour son ami : « J'ai espéré deux jours que je
parviendrais à faire nommer Danton, un camarade de collège que j'ai
dans le parti opposé, et qui m'estime assez pour ne pas étendre jusqu'à
moi la haine qu'il porte à mes opinions. Je m'étais employé de mon
mieux et l'avais fortement recommandé à qui il appartient. Nous avons
échoué. » (Source : Danton et la Paix, Albert Mathiez, 1919)
4
avril : Le roi donne son aval au décret donnant aux métis (libres de couleurs) et noirs
affranchis des droits politiques et annonce l’envoi de commissaires
dans les
colonies d’Amérique. Le ministre de
l’intérieur, Jean-Marie Roland s’adresse par courrier aux
départements et paraphe les décisions au sujet des colonies, signé ce jour par Louis XVI. A la
Législative, il est décrété une émission supplémentaire de cinquante millions
en assignats pour un total 1,65 milliards en circulation et 6 millions
sont mis au compte du Trésor national.
5 avril : A Paris, mise entre parenthèse de la Sorbonne et fermeture
des facultés de théologie.
6 avril : Aux Jacobins, ce n’est pas la première fois que les soldats
de Château-Vieux sont à l’ordre du jour, pendant une intervention
tournée contre le général Lafayette et citée plusieurs fois,
Collot-d’Herbois coupe « l’Incorruptible » pour dire : « M.
Robespierre
oublie un fait : qu'est-ce qui fait faire tous les jours ces libelles
infamants? Lafayette. », le tout suivi d’applaudissements. Reprenant
la
parole, c’est l’occasion pour Robespierre de rappeler et de conclure
« qu'au lieu de dire Bouillé seul est coupable, on dise, les
tyrans seuls sont coupables » et « quand tous les bons citoyens verront
que Lafayette est le seul moteur de ces intrigues, tout se ralliera.
»
A l’Assemblée, il est pris un décret pour l’envoi de troupes en
Seine-et-Marne. Un autre autorise les départements voisins à envoyer
des
gardes nationales en Ardèche.
8 avril : A Ajaccio, débute les "Pâques sanglantes" qui vont durer une
dizaine de jours entre citadins et paysans, à la tête de la répression
Napoléon Buonaparte, âgé de 23 ans, et il est lieutenant-colonel. Suite
à ces incidents le colonel Maillard désapprouve les agissements de
chaque part et enverra le jeune officier rendre des comptes à Paris et
recevra une condamnation pour ses actes de Pasquale Paoli. A Lyon,
l’église des Clarisses est évacuée, les jacobins
locaux s’opposent à la célébration de la messe de Pâques. A
Paris, au couvent des Jacobins, l’on reparle à nouveau des
soldats de Metz, et dans le cadre des lectures des correspondances, le
commandant d’une division de la ville, M. Maçon propose de ne laisser
d’armes qu’aux gardes nationales. Robespierre remarque la supercherie,
signée par M.
Pain d’Avoine, qui n’est autre qu’un écrit de la
propagande royaliste.
9 avril : Dans la presse est commentée la séance du jour du couvent des
Jacobins et les militaires suisses de « Châteauvieux » sont arrivés
dans la capitale : « Enfin, M. Robespierre (écrit «
Roberspierre » dans
le texte original) a pris la parole, et il a rappelé à la société
que
par l'accueil qu'elle faisait aux soldats de Château-Vieux, elle
s'engageait à venir au secours de tous les soldats, de tous les
patriotes persécutés. Il a juré de consacrer tous ses soins à leur
défense. et la société a uni son serment au sien. M. Robespierre a
terminé en jetant un coup d'œil sur la fête qui se prépare, pour
inviter les citoyens à se tenir en garde contre toutes les occasions de
désordre que les malveillants se proposent d'y faire naître. (…) Tous
les symptômes d'une crise prochaine se font sentir. La fête destinée
aux soldats de Château-Vieux est l'époque qui a paru favorable. On sait
que depuis longtemps les agents de la cour, des Lameth, des Lafayette,
etc., ont cherché à souiller ce projet patriotique de tout ce que leur
esprit peut enfanter de plus immonde ; la rage du parti feuillant à
l'assemblée nationale contre l'admission des quarante victimes de
Bouillé ; le complot dénoncé par la municipalité de Pans, dont nous
avons publié la lettre hier, l'arrivée mystérieuse et inattendue du
flegmatique Lafayette ; enfin, l'apostrophe menaçante faite par un aide
de camp de M. Lafayette à M. Robespierre, apostrophe que M. Robespierre
a dénoncée, lui-même aux jacobins, sans désigner les personnes : tout
prouve une conspiration. Mais nous sommes prévenus, mais nous sommes
sur nos gardes, mais le choc sera terrible, si le choc a lieu. ». Note
du Journal : M. Robespierre se promenait seul avant-hier au matin. Un
aide de camp de M. Lafayette s'approche, et, du ton le plus menaçant,
lui dit : « Vous êtes un f... gueux ; dans trois jours nous nous serons
défaits de vous, etc. » (Source : Gallica-Bnf, Le Thermomètre du jour, n°102). A Lyon
est
inauguré le théâtre des Variétés.
11 avril : Aux Jacobins, Robespierre s’oppose à ce que soit examinée
une nouvelle arme de guerre, et fait une nouvelle intervention contre
Lafayette : « Ah comme le patriote Robespierre, qu'on ne peut
empêcher
de dire la vérité qu'en l'assassinant, et que les mouchards de
Lafayette veulent égorger ; le patriote Robespierre a tracé avant-hier
devant les amis de la constitution, devant le peuple assemblé, le
portrait de cet homme né, s'écriait-il, pour le malheur de la liberté.»
(Journal Universel N°873)
Samedi 12 avril : Retour de Marat après un séjour en Angleterre, pendant sa
nouvelle absence londonienne, il publie courant mars un prospectus se
nommant « l’Ecole des citoyens » qui donnera lieu à une publication en
deux volumes résumant ses pensées politiques. Ce jour reparaît L’Ami du
Peuple pour son 627e numéro. Pendant sept jours, le journal met en exergue
un appel des Cordeliers demandant à Marat de reprendre sa plume, c’est
fait ! Voici sa conclusion du jour : « Depuis la mort de
Léopold,
la cour est tremblante, la faction contre-révolutionnaire est
tremblante, l'Assemblée vénale est tremblante : le peuple devrait donc
enfin profiter de cette heureuse conjoncture pour demander la
révocation immédiate des décrets qui font son malheur, et qui
consommeront infailliblement sa ruine : ses mortels ennemis sont trop
faibles aujourd'hui pour s'y opposer. Voyez le législateur revenir sur
ses pas à la voix des hommes de couleur et des nègres. Quoi donc une
poignée de serfs à dix-huit cents lieues, feront révoquer le décret
oppressif qui les prive (lire la note) des droits du citoyen, et les
Français ne réussiraient pas à révoquer ceux qui les désolent, s'ils
faisaient entendre le cri de réforme ! réforme ! au milieu du sénat!
Mais pour s'élever contre les abus, il faut les connaître. Développer
les vices de la constitution, en indiquer le remède, former l'esprit
public, démasquer les traîtres, déjouer les machinations, sera l'étude
constante de l’ami du peuple, comme le bonheur de la nation sera
constamment l'objet de ses vœux. (Note de Marat) La réhabilitation dans
leurs droits des mulâtres et des noirs affranchis aura cet effet
infaillible, d’être bientôt suivie de l’affranchissement de tous les
nègres jaloux de l'affranchissement de tous les nègres, jaloux des
avantages de quelques-uns des leurs, et furieux d'en être privés».
(Source : Gallica-Bnf, Conclusion de Marat, l'Ami du peuple n°627, à la page 8)
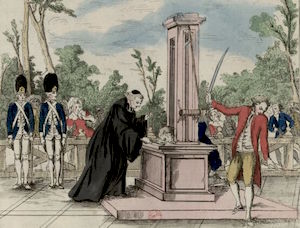
Machine proposée à l'Assemblée nationale
pour le supplice des criminels par M. Guillotin, crédits Gallica-Bnf
Le docteur Louis adresse à "Monsieur Cullerier, chirurgien principal, de l'hôpital-général au château de Bicêtre", un billet au sujet des premiers essais sur la guillotine (pas encore nommée ainsi) dans les jours à venir (le 17/04) :
« Le
mécanicien, Monsieur, chargé de la construction de la machine à
décapiter, ne sera prêt à en faire l'expérience que mardi. Je viens
d'écrire à M. le procureur général syndic, afln qu'il enjoigne à la
personne qui doit opérer en public et en réalité de se rendre mardi à
dix heures, au lieu désigné pour l'essai. J'ai fait connaître au
Directoire du département avec quel zèle vous avez saisi le vœu général
sur cette triste affaire. Ainsi donc, à mardi, pour l'efficacité de la
chute du couperet ou tranchoir (qu'il a choisi en biseau), la machine doit avoir 14 pieds
d'élévation. D'après cette notion, vous verrez si l'expérience peut
être faite dans l'amphithéâtre, ou dans la petite cour adjacente. Je
suis de tout mon cœur, Monsieur, le plus dévoué de vos obéissants
serviteurs. »
Source : Bib. numérique Medica (BIu Santé), Michel Cullerier, chirurgien de Bicêtre
et de l'Hôpital des vénériens (1758-1827), Roger Besombe, page 23, Paris 1929.
|
13 et 14 avril : Aux Jacobins, en début de séance, Robespierre présente
une délégation de la Société constitutionnelle de Manchester, cette
société anglaise devient affiliée à la Société des Amis de la
Constitution. Par la suite, il demande que la journée du 14 soit tenue
une séance extraordinaire et évoque de nouveau les soldats de
Château-Vieux. Dans son intervention, il fait une allusion voilée aux
ministres girondins et précise qu’il jure ne vouloir « aucune place ».
Dans la même journée se présente une délégation de la Société des
défenseurs des droits de l'homme et ennemis du despotisme du faubourg
Saint-Antoine, elle vient dénoncer Mademoiselle Théroigne de Méricourt.
Celle-ci provoque des troubles en réunissant plusieurs fois par semaine
des femmes du quartier et des activités autour d’un « repas civique »
et de plus se réclamant, de Collot-d’Herbois, Santerre et Robespierre.
Ce dernier prend sa défense et annonce qu'elle s’est engagée à renoncer
à ses projets, il déclare aussi n’avoir aucune relation avec cette
citoyenne. Sur ces explications, les membres de la Société retourne à
leur ordre du jour. Le lendemain et sur le même sujet de préoccupation
du moment, Robespierre conclu par « Et j'engage le peuple et
les
soldats de Château-Vieux à les prendre par la main et à les unir à eux
dans le triomphe de la liberté. » Le 14, un nouveau garde des Sceaux
est nommé et reprend les attributions en ce domaine de M. Roland, il
s’agit aussi d’un "girondin" et originaire de la Gironde, Antoine
Duranthon, il est de la même génération que Servan et de la Platière.
15 avril : A Rennes, le Directoire départemental s’oppose à
l’enfermement des prêtres réfractaires demandés par les jacobins
locaux. A Paris, au Champ-de-Mars est organisé la « Fête de la Liberté
» en l'honneur des Suisses du régiment de Château-Vieux. 300 à 400.000
personnes auraient assisté à l’événement selon Jean-Marie Roland. Lors
de cette célébration est décliné la devise et les principes : « liberté, égalité et fraternité ». Toutefois ces 3 vocables durent attendre la révolution et la constitution de 1848 pour être inscrit dans les textes légaux.
17
avril : Dans une petite cour de l'hôpital-général de Bicêtre à
Gentilly, à sept du heures du matin, il est procédé à l'essai à la
machine à décapiter (la future guillotine) sur deux cadavres en
présence entre autres de MM. Sanson le bourreau, Guillotin, Louis,
Pinel et de M. Cabanis chargé de faire un rapport, etc. Aux Jacobins,
après la lecture des correspondances, s’engage
un débat sur la présence ou pas des bustes de Robespierre et Pétion aux
côtés de Mirabeau, ou plus exactement sur la présence de statues de
personnages vivants au sein des sociétés ou clubs. Il ne sera donné
aucune consigne à ce sujet, laissant le choix à ses affiliés sur la
question. Pour la célébration et le souvenir Robespierre demande une
inscription pour « Le 15 avril 1792, l'an IV de la liberté, la
pauvreté et le peuple triomphèrent avec les gardes françaises, les
soldats de Châteauvieux et tous les bons citoyens persécutés pour la
cause de la Révolution ». Dans son intervention, il met en cause
le
département de Paris, ce qui est traduit par la presse comme une attaque
adressée au Procureur Syndic, M. Roederer, et il prévient qu’il faut
toujours se méfier des lendemains de fêtes et il est appelé à la vigilance.
18 avril : Le ministre Dumouriez présente au roi un rapport favorable à la
guerre. Dans la capitale, aux Jacobins, la présence du buste de
Lafayette et Bailly dans l’enceinte du Conseil général fait
l’objet d’un débat. Cet échange reprendra en début de séance le 20
avril avant d’aborder le sujet de fond et du moment : l’entrée en
conflit sur fond de grande désorganisation des armées, et la montée des
actes d’insoumissions face aux officiers. « M. Robespierre
reglapites
(Ndr : Glapir : pousser des cris aigus ou des aboiements stridents) des
invectives contre MM. Lafayette et Bailly, et dit cent inepties
déplorables. » (Source : Gallica-Bnf, Feuille du jour, n°124).
19 avril : En Corse, le lieutenant-colonel Bonaparte envoie un mémoire à l'Assemblée nationale : « Tel
est, magistrats, l'exposé des événements qui ont bouleversé l'ordre et
manqué de ruiner la ville principale de Corse, la plus florissante par
sa situation, son commerce, sa position et même par le caractère
fortement trempé de ses habitants ». A Paris, Marat la veille de la déclaration : « La guerre aura-t-elle
lieu? Tout le monde est pour l'affirmative ; on assure enfin que l'avis
a prévalu dans le cabinet d'après les représentations du sieur Motier
(Lafayette) qui, sans doute, l'a donnée comme l'unique moyen de
distraire la nation des affaires du dedans pour l'occuper des affaires
du dehors, de lui faire oublier les dissensions intestines pour des
nouvelles de gazettes ; de dissiper les biens nationaux en préparatifs
militaires, au lieu de les employer à libérer l'État et à soulager les
peuples; d'écraser le pays sous le poids des impôts et d'égorger les
patriotes de l'armée de ligne et de l'armée citoyenne, en les
conduisant à la boucherie, sous prétexte de défendre les barrières de
l'empire». (Source : Gallica-Bnf, L'Ami du Peuple, n° 634)
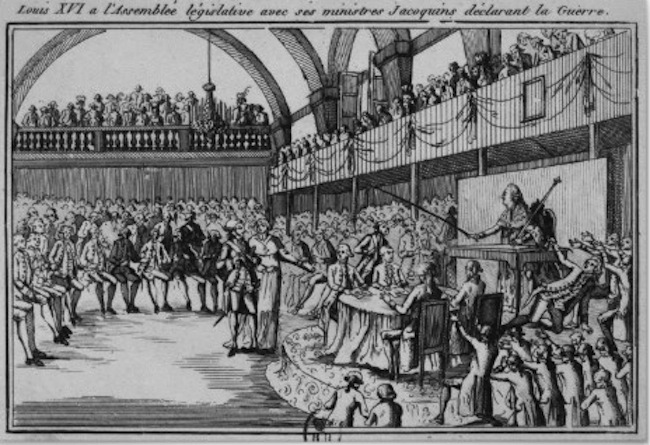
Légende : Louis XVI
à l'Assemblée avec ses ministres Jacoquins déclarant la guerre
20 avril : En France, la Législative approuve par une très
large
majorité la déclaration de guerre contre l’Autriche en la personne du
roi de Bohème et de Hongrie, mais aussi empereur du Saint Empire,
François II. Il faut noter que seul 7 députés votent contre du côté
légaliste. « Nul alors, parmi ceux qui votèrent la guerre, n’en
prévit
l’immensité et la durée (Note : Plus de 20 ans). Ou bien ils
croyaient
qu’elle serait limitée à l’Autriche, ou bien ils imaginaient que
l’esprit révolutionnaire déchaîné sur le monde allait en quelques jours
plier les vieux pouvoirs comme des herbes sont pliées et flétries par
un vent d’orage. Mais il y avait dans la France révolutionnaire une
telle force de passion, un orgueil si véhément de la liberté que même
si elle avait pu mesurer exactement l’étendue de la lutte où elle
entrait, elle n’aurait pas reculé. Seul, le fantôme du despotisme
militaire, grandissant à l’horizon, l’aurait fait hésiter peut-être. La
ferveur et le rayonnement de l’enthousiasme lui cachaient le péril.
»
(Source : Wikisource, Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Rev. fr.). Aux Jacobins, voici ce que
déclare en introduction Robespierre : « Messieurs, puisque la
guerre
est décrétée, je suis d'avis aussi de conquérir le Brabant, les Pays
Bas, Liège, la Flandre, etc. La seule chose qui doive nous occuper
désormais, ce sont les moyens d'exécuter cette utile entreprise ;
c'est-à-dire, dans ce moment il faut faire, comme je l'ai proposé
plusieurs fois, non pas la guerre de la cour et des intrigants dont la
cour se sert, et qui à leur tour se servent de la cour, mais la guerre
du peuple : il faut que le peuple français se lève désormais et s'arme
tout entier, soit pour combattre au-dehors, soit pour veiller le
despotisme au-dedans. (Applaudissements universels) ». (Source : Gallica-Bnf, Journal des
Débats de la Société, n°181) Ce même jour, le simple soldat ou le futur
Maréchal d’Empire Jean Lannes s’engage et part rejoindre, le deuxième
bataillon des Volontaires du Gers pour la défense de la frontière
espagnole.
20 et 21 avril : A l’Assemblée, Nicolas de Condorcet remet son rapport
sur l’éducation (Lire des extraits, sur cette même page).
25 avril : A Paris, le criminel Nicolas Jacques Pelletier est le
premier à monter à la guillotine sur la place de Grève (aujourd'hui la place de l’Hôtel-de-Ville).
26 avril : A Strasbourg, Rouget de Lisle, soldat du général Kellermann
achève de composer au petit matin le « Chant de guerre pour l'armée du
Rhin » qui deviendra la « Marseillaise » (chant patriotique et hymne
national). Il est reçu le jour même par le maire de la ville, M.
Dietrich et apprécie cet air et sa composition, et l’invite le soir à la
mairie. Accompagné d’un clavecin, il reçoit un accueil enthousiaste lors de
sa première prestation publique. Le texte est dédié au Maréchal Luckner
et le compositeur est un monarchiste épris de la reine…
27 avril : A Rouen, la municipalité invite ses concitoyens à porter la
cocarde tricolore.
28 avril au 30 avril : Le Maréchal de Rochambeau lance l’offensive et
l’ouverture des hostilités en envahissant les Pays-Bas Autrichiens avec
son armée engagée sur 3 colonnes, avec l’objectif de conquérir Namur
sous la conduite de Lafayette (Belgique). Les premiers combats
concerneront les villes de Quiévrain, de Mons et Tournay en Wallonie, et
se solde par l’absence de prise des cités, engageant des manœuvres de
positions plus que des affrontements. Cela va provoquer la grogne des
soldats à la base ne comprenant pas les ordres de leurs chefs.
29
avril : A Lille, le général Théobald de Dillon auprès de l’armée du
Nord et du Maréchal de Rochambeau et le chef du génie Berthois sont
tués par leurs propres soldats dans la ville. La compagne du général
s’en réchappe en des circonstances dramatiques et elle en sort
meurtrie. Les soldats d’un régiment des dragons un jour avant ont cru à
une compromission avec l’ennemi suite à des manoeuvres incomprises ou
incertaines, pour souligner une grande désorganisation sur une
frontière plus que sensible depuis l’entrée en guerre très récente. Les
militaires rebelles à l’autorité seront condamnés par la Convention et
Lazare Carnot fera attribuer à la veuve rescapée du comte de Dillon une
pension. A l’Assemblée, sont désignés MM. Sonthonax, Polverel et
Ailhaud comme commissaires pour se rendre à Saint-Domingue. La
traversée depuis Bordeaux représentait environ 2 mois de voyage sur les
flots marins. A Avignon les jacobins locaux s’emparent de
l’hôtel-de-Ville pour le rattachement du district aux instances
départementales.
30 avril : Ce jour
sont émis pour 300
millions de livres d'assignats. Au Couvent des Jacobins, l'ancien avocat d'Arras se plaint des
modifications intervenues dans ses déclarations et de la réécriture du
texte de Brissot et de Guadet du 25 avril. « On m'empêche d'établir
les
preuves de ce que j'avais avancé, et après avoir entendu les plus
violentes dénonciations portées contre moi à cette tribune, on étouffe
ma voix. Qui voudra désormais se charger de défendre la cause du
peuple? ». Maximilien Robespierre est rappelé à l'ordre par le
président de séance. « A ce mot, son parti s'irrite, les tribunes
travaillées se mêlent à la question ; on entend ces
apostrophes : M. le président, vous êtes un prévaricateur, un
feuillant. Un feuillant, messieurs, moi un feuillant, répond le
président, tout gonflé de rage! Eh bien, allons aux voix... On va aux
voix, la majorité se déclare contre M. Robespierre ». (Sources : Oeuvres complètes
de Robespierre, tome VIII et Journal général de France, n°125)
V – Le mois de mai 1792
1er et 2 mai : Aux Jacobins la Société modifie son ordre du jour. M.
Guiraut (journaliste et membre) lit le discours du ministre de la
Guerre, de l'Assemblée législative et les pièces sur les événements de
Lille. Louis Legendre protecteur de Marat souligne (futur député de la
Convention et montagnard), que le commandement des armées est attribué
à des nobles. « Robespierre s'élance sur ce texte et démontre que le
ministre est coupable de trahison » Le lendemain, en fin de séance et
après quelques échanges vifs pour obtenir la parole « Je ne
prononce
pas sur les faits qui nous ont été annoncés : mon opinion ne manquerait
pas d'être défigurée par le Patriote français, la Chronique, etc. S'il
faut le dire : non, je ne me fie point aux généraux ; et faisant
quelques exceptions honorables, je dis que presque tous regrettent
l'ancien ordre de choses, les faveurs dont disposent la cour. Je ne me
repose donc que sur le peuple, sur le peuple seul. Mais, je vous prie,
pourquoi saisit-on la moindre occasion de tourner en ridicule et même
de calomnier ceux qui pensent d'une manière différente des partisans de
la guerre? » (Source : Gallica-Bnf, Feuille du jour, n°136 et Discours de
Robespierre).
3 mai : Le journal, l’Ami du peuple est de nouveau interdit, les
généraux sont devenus la cible de Marat depuis sa reparution à la
mi-avril sous sa plume. Aux Jacobins, pendant la séance l’abbé et
instituteur, Jean-Pierre André Danjou, propose de changer de dynastie
et de remplacer Louis XVI par un fils du roi d’Angleterre. Robespierre,
trois jours après dénoncera le curé assermenté (ou jureur) comme
membre des Feuillants et d’avoir à l’origine été de la scission, il
demandera son exclusion.
5 mai : La Législative décrète la création de 31 bataillons de
volontaires.
6 mai : Au Couvent des Jacobins : Robespierre revient sur les discours
modifiés de Guadet et Brissot et dénonce la manœuvre de M. Lanthenas
(futur conventionnel et chef de division auprès du ministère de
l'Intérieur et des cultes), et selon lui, sous les ordres de Jean-Marie
Roland. Tout en précisant qu’il ne partira pas de la société jacobine.
| 8 et 9 mai : En remplacement du ministre de la Guerre, M.
de la Grave
démissionnaire est nommé Joseph Servan de Gerbey, (ci-contre en
portrait) au lendemain de sa
montée en grade comme maréchal de camp (général de brigade), dont le premier ministère
durera à peine cinq semaines et le second deux mois. C’est sur la
proposition de M. Roland que ce militaire de métier est nommé par Louis
XVI, il est à l’origine de plusieurs écrits sur l’armée, dont le Soldat
Citoyen qui lui vaudra un succès d’estime. Il devient le quatrième "girondin" du gouvernement qualifié de « patriote ». (Source : Gallica-Bnf - Le Soldat Citoyen -
paru en 1780) |
|
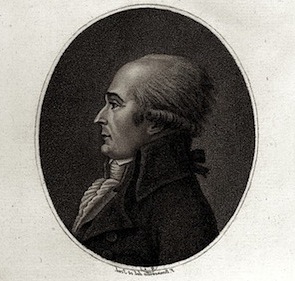 |
10 mai : Aux Jacobins, le Journal de France cite Robespierre en sa
séance extraordinaire (écrit Robertspierre), concernant ses attaques
déformées ou utilisées contre Lafayette, celui-ci demande la parole
dans le tumulte : « Messieurs, la question touche à la chose publique :
il
s'agit bien ici de Lafayette et de moi ! mais je ne puis me taire sur
une lettre écrite par je ne sais quels hommes, lue par je ne sais qui !
(regards de travers au frère Lenoble). Beau discours de Robespierre,
dans lequel il prouve que ceux qui ont signé la lettre tremblaient,
qu'au surplus on n'y voit que trois noms, que ces trois noms sont
Flamands, que Lafayette est un ci, un la, un... enfin un traître aux
jacobins, etc. ». Dans le cadre de la séance ordinaire, l’ancien
avocat
d’Arras repart à la conquête de la parole avant de monter en tribune
voici le résumé narquois de la presse royaliste : « Le fidèle ami
des
sans culottes, Robespierre parle, parle, et puis lèche ses lèvres.
Parle encore pendant une heure, fait la chouette à tous ses hurleurs.
On se chamaille, le président se couvre, se découvre, Robespierre
reparle encore. Contre la motion, ah, ah, oh, oh pas, bravo! Il sort
de la question, il y est, il n'y est pas, à bas mâtin! tels sont les
accompagnements de l'éternel monologue de M. Robespierre. Il y serait
encore, si Danton, avec son tonnerre, n'eût menacé, qu'avant peu, on
tonnerait contre ceux qui attaquent une vertu consacrée par la
révolution, la vertu de Robespierre enfin. »
12 mai : A proximité de Paris, le dramaturge Charles-Simon Favart décède au village de Belleville. Il est
connu pour avoir composé les livrets d’opéras-comiques et des pièces de
théâtre, son nom est associé depuis à l’Opéra Comique de la capitale,
dite Salle Favart consacrée aux répertoires lyriques et son emplacement
est situé en rive droite dans la rue du nom de l’auteur (actuel 2ème
arrondissement).
13 mai : Au couvent des Jacobins, un « patriote Suisse » du nom de
Charvet et résidant au 243, rue Saint-Martin, ce membre de la société
demande la révision des traités avec son pays et se voit applaudi.
Robespierre s’y oppose expliquant que ce n’est pas le moment de se
mettre à dos les citoyens Suisses et précise les impossibilités
légales. Après
son intervention Charvet est interdit de parole.
16
mai : A Paris, il sort de l’imprimerie du
Cercle Social (société fondée par l’Abbé Claude Fauchet et proche des
tendances girondines), un placard ou un imprimé d’une page se nommant La
Sentinelle. Elle sera éditée jusqu’au 21 novembre et 73 numéros
paraîtront (La Sentinelle -
source Gallica-Bnf). Aux Jacobins, en
début de
la séance, Sébastien Lacroix, présente sa brochure « L'intrigue
dévoilée, ou Robespierre vengé des outrages et des calomnies des
ambitieux » (imprimerie de la Vérité). Après, plusieurs lettres sont
lus sur les nouvelles des frontières, puis, le président Lecointre fait
les présentations d’une patriote brabançonne. Elle vient quérir la
société une aide dans la recherche de son époux. Suite à son
intervention Robespierre, lui accorde son appui, disant connaître son
affaire.
17 mai : A New York est signé « l’accord de Buttonwood », il engage
entre diverses agences spéculatives la mise en place de la bourse de
Wall-Street. Robespierre fait paraître le premier numéro de son
Prospectus - Le
défenseur de la Constitution (d’environ
60 feuillets)
par souscription. Il y aura en tout 12 hebdomadaires à partir de cette
date. Et ils seront publiés jusqu’au 20 août. (Source : Gallica-Bnf).
18 mai : Les armées de Russie sans déclaration de guerre préalable franchissent la
frontière polonaise avec les cinq colonnes du Maréchal Kachowsky, la
Prusse rompt son alliance avec la Pologne. S’engage plusieurs mois de
conflits avant la seconde partition de cette nation et la fin du régime
constitutionnel à la « française ».
23 mai : A l'Assemblée, les députés Brissot et Vergniaud dénoncent le «
Comité autrichien » réunit aux Tuileries et marque une première rupture
avec les Feuillants. Brissot s'engage à prouver l’existence du comité,
il demande aussi, un décret d'accusation contre l'ex-ministre
de Montmorin, et l'examen de la conduite de MM. Duport du Tertre et
Bertrand de Molleville, ministres démissionnaires de la justice et de
la marine, et s’attaque à Lafayette, comme son organe de presse le
Patriote Français.
26 mai : A la Législative, le commissaire civil, M. de Mirbeck (avocat nommé le 5/08/1791 jusqu'au 1er avril de cette année) fait un Compte sommaire de l'état actuel de la colonie de St. Domingue. (Source : Bib. Manioc, 46 pages)
Il retrace les événements auxquels, lui et les autres commissaires ont
du faire face, en particulier l'hostilité des colons blancs, qu'il
désigne comme séditieux, sous le nom des Léopardins. C'est-à-dire, les 85 membres de l'assemblée de St. Marc qui étaient partis sur un navire portant le nom de Léopard,
après avoir soudoyé l'équipage, en direction de la France en août 1790,
pour plaider leur cause. Cette assemblée a été dissoute le 12 octobre
de la même année par la chambre des députés. Son rapport fait état des
difficultés rencontrées, pièces à l'appui et Frédéric Mirbeck précise
que « Si l'on eût pris ce parti pour le décret du 15 mai 1791, la colonie entière était sauvée. »
27 mai : Guadeloupe, Georges Henri Victor Collot est nommé gouverneur.
Ancien combattant et officiers aux Etats-Unis pendant la guerre
d’indépendance, il prendra ses fonctions en février 1793. Il capitulera
devant les troupes anglaises qui prendront possession de l’île en avril
1794. A Paris, l’Assemblée décrète la déportation des prêtres
réfractaires ou insermentés : « considérant que les efforts auxquels
se
livrent constamment les ecclésiastiques non sermentés pour renverser la
Constitution ne permettent pas de supposer à ces ecclésiastiques la
volonté de s'unir au pacte social, et que ce serait compromettre le
salut public que de regarder plus longtemps comme membres de la
société, des hommes qui cherchent évidemment à la dissoudre ; (…) après
avoir décrété l'urgence, décrète que tous ceux qui n'ont pas prêté
serment selon la loi du 26 décembre 1790 ou après le 3 septembre 1791,
ou qui se sont rétractés, peuvent être déportés à la demande d'une
assemblée de canton, demande confirmée par le Directoire du
département. Lorsque l'avis du Directoire du district ne sera pas
conforme à la pétition, le commissaire du canton devra vérifier si la
présence de l'ecclésiastique ou des ecclésiastiques dénoncés, nuit à la
tranquillité publique ».
28 mai : A l’Assemblée le député Bazire présente un rapport négatif au
nom du comité de surveillance sur la garde du roi dite
constitutionnelle, notamment sur sa composition pas du tout homogène et
l’exclusion de soldats des gardes nationales, ensuite s’engage des
débats entre feuillant et girondins à savoir qui a en charge la
responsabilité de cette garde prétorienne et s’invectivent. Arrivée de
Bonaparte dans la capitale. Il assistera à la journée du 20 juin et
celle du 10 août prochain comme spectateur des événements.
|
0
NOUVELLES
DES FRONTIÈRES...
« A
Maulde, 25 hommes du premier bataillon de Paris, se défendent
vaillamment contre 300 ou 400 Autrichiens. Au moyen d'un renfort de
cinquante hommes, ils soutiennent encore le feu pendant une bonne
heure. Enfin arrivent 150 soldats du même bataillon, 6o recrues de
Navarre, 25 dragons de Chartres, 25 chasseurs de Hainault, une
compagnie de canonniers et deux pièces de canon. Alors, pour me servir
de l'expression des soldats même, c'était un plaisir de voir les
Autrichiens courir, en montrant les talons. Il paraît qu'on leur a tué
beaucoup de monde.
Un homme digne de foi,
nouvellement arrivé de Givet, atteste que
l'armée de Lafayette brûle de patriotisme et d'ardeur, que les
provisions abondent au camp, qu'aucune des choses nécessaires ne
manque. Il atteste que dans le pays de Liège où il a clé, les habitants
chérissent la révolution Française, et nous appellent tous les jours.
Il assure qu'on a calomnié les Brabançons, quand on a dit qu'ils
étaient mal disposés pour nous. Maintenant il n'y a dans les Pays-Bas
et dans le Pays de Liège que fort peu de troupes ennemies, et avant
quinze jours peut-être elles y seront en grand nombre. Pourquoi donc
attendre qu'elles soient arrivées? Pourquoi ne pas aller avec des
soldats qui ne demandent qu'à les battre, pourquoi ne pas aller à la
victoire, tandis qu'elle est encore facile? Pourquoi ne pas affranchir
des peuples lassés du joug, et qui nous seront des alliés à toute
épreuve?
Quand nous avons déclaré la
guerre, était-ce pour souffrir encore les
insultes de l'ennemi, qu'à présent nous pouvons écraser? était-ce pour
attirer chez nous les fléaux de la guerre, que nous pouvons porter chez
lui? Lafayette, on dit qu'il existe des officiers qui veulent éterniser
la guerre, pour éterniser leur pouvoir, et d'autres qui espèrent
fatiguer l'impatience française par une foule de petits combats sans
fin, et cela, pour nous faire accepter, de lassitude, une honteuse
composition. Lafayette ! Lafayette ! il est temps de vous montrer, si
vous ne voulez pas que des soupçons déjà trop fondés ne deviennent des
certitudes, et que personne, dans l'empire, ne puisse plus douter que
vous aussi vous êtes du Comité Autrichien. »
La Sentinelle
de
l’imprimerie du Cercle Social, numéro 7
|
29 mai : A la Législative sur une proposition de Guadet et après un
discours de Vergniaud la protection constitutionnelle ou garde
rapprochée du roi est supprimée, elle est jugée, comme n’ayant pas dans
ses rangs suffisamment de « soldats patriotes ». Elle représentait une
menace de sédition et de se retrouver sous la conduite ce que l’on
nomme le "Comité Autrichien" depuis quelques jours. Cette garde était
composée de 1.800 soldats dont 600 cavaliers. L’imprimé La Sentinelle revient plusieurs fois à la charge sur le sujet dans ses premiers
numéros.
30 mai : Aux Jacobins, un des ses membre le Maréchal Rochambeau
désavoué par ses soldats suite aux échecs de Tournay et Mons est depuis
démissionnaire. Il vient présenter sa conduite et met la responsabilité
sur l’incompétence des ministres. S’ouvre le débat à la
tribune, défilent Dubois-Crancé, le journaliste Carra et Robespierre.
Un membre tente de minimiser ses erreurs, alors surgit un rejet massif
dans l’audience. En de fin de séance, Rochambeau est radié de la
société. A l'Assemblée, M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères déclare vouloir « faire lecture de trois pièces qui m'annoncent la neutralité de l'Angleterre. C'est d'abord une note remise par M. Chauvelin (ambassadeur à Londres), chargé
des affaires de France, au lord Grenville, ministre du gouvernement
britannique, ensuite la réponse du lord Grenville et enfin la
proclamation du roi d'Angleterre relative et conforme à la demande
portée dans la noté remise par le chargé des affaires de France. On
connaît déjà cette note qui a été insérée dans la Gazette de France. »
V – Le mois de juin 1792
1er juin : Aux Etats-Unis, le Kentucky, devient le quinzième État
ratifiant la constitution. En Ile-et-Vilaine, la garde nationale
investie le château de M. de La Rouërie, lieu considéré comme le centre
de la conspiration bretonne et royaliste. Ils n’y trouvent rien, la
perquisition est un échec.
3 juin : A Paris, une fête et une messe sont données en l'honneur de
l’ancien maire Jacques Guillaume Simoneau tué le 3 mars. Cette
initiative émane des
Feuillants, ils veulent en faire un martyr comme objet de leur
propagande, en réponse aux célébrations triomphales des soldats de
Château-Vieux et aux prises de positions des Jacobins.
3, 4 et 5 juin : A l’Est, l’Armée du Rhin dans le cadre de manœuvres en
territoire ennemi, les troupes vont connaître des lourds problèmes de
discipline à sa base. Des mesures seront prises contre ces refus
d’obéissance en début juillet à la chambre des députés.
7 juin : John-Skey Eustace, francisé en Jean-Skey ou Jean-Skei
est né à New York en
1760, ce colonel étasunien propose ses services à la
Législative, selon Albert Mathiez. Personnage équivoque, il sera dans
la promotion des 21 maréchaux de camp, le 7
septembre. J.S. Eustace combattra en Belgique au sein de l'armée du
Nord, puis prendra le grade de général de brigade de la République
française après certaines réorganisations des armées, lors du conflit
avec la Prusse et l'Autriche.
4 au 8 juin : M. Servan, ministre de la guerre provoque une grave crise
avec le roi, en décidant la mise en œuvre devant l’Assemblée d’un
décret ordonnant la réunion à Paris à ses abords de vingt mille fédérés
des départements pour protéger la capitale (dans un premier temps et à
la date du 14 juillet). Cette décision engage de nouvelles secousses
politiques à l’horizon, et le mois de juin à Paris va connaître ses
premières manifestations populaires et rapports de force entre le Paris
des faubourgs, des quartiers populeux, et les tenants du pouvoir –
"Girondins" inclus. Aux Jacobins, le 4, Robespierre s’y oppose et
préfère
voir ces troupes aux frontières pensant que Paris peut se défendre sans
avoir recours à d’autres forces pour la protection du roi et de
l’Assemblée. Face à un possible danger, il se voit mettre du même coté
que le "Comité Autrichien" dans la presse.
9 juin : A l’Assemblée Législative, il est accordé à Joséphine de
Viefville une pension de 1.500 livres pour la mère des trois enfants de
Téolbald Dillon, tué à Lille le 29 avril.
10 juin : Dans la capitale, 8.000 gardes nationaux parisiens ou
citoyens
actifs protestent contre cette décision de la Législative. La chambre
ne revient pas sur son choix. Le comte Antoine de Rivarol, émigre et
part dans un premier temps pour Bruxelles (Pays-Bas autrichien)
11 juin : Veto du de Louis XVI sur le décret appelant à la réunion de
20.000 fédérés dans la capitale. Le ministre de l’intérieur, M. Roland
impose au roi, par un courrier comminatoire de signer le décret de
déportation des prêtres, en annexe, celui de la mobilisation des
troupes fédérées à Paris pour le 14 juillet.
12 juin : A Avignon, Jean Duprat ("girondin") est élu maire avant que la
ville ne soit réunie à la France. Son frère Benoît fut l’un des meneurs
des massacres d’Avignon en octobre 1791, et Jean est soupçonné d’y avoir
participé et fait un bref mandat de député au sein de la Législative. Louis
XVI renvoie trois ministres dits girondins ou jacobins, à savoir,
Clavière, Servan et Roland, seul échappe au remaniement, quelques
jours, Dumouriez et les ministres légitimistes. Voici ce que le
monarque adresse comme courrier : « Je vous prie, M. le président, de
prévenir l’Assemblée nationale que je viens de changer les ministres de
la guerre, de l’intérieur et des contributions publiques. M. Dumouriez
remplace celui de la guerre, M. de Mourgues celui de l’intérieur. Je
n’ai pas encore remplacé le troisième. M. de Naillac chargé des
affaires à Deux-Ponts succédera à M. Dumouriez. Je veux la
constitution, avec la constitution, je veux l’ordre dans toutes les
parties de l’administration, et mes soins seront toujours chargés à les
maintenir par tous les moyens qui sont en mon pouvoir. » (Source : Gallica-Bnf,L'Ami du Roi, des Français, de l'ordre et surtout de la vérité
du jeudi 14 juin, page 2, n°166)
13 juin : La Législative dit conserver sa confiance dans les ministres
« patriotes » et des parlementaires dénoncent les intrigues de
Dumouriez. Aux Jacobins, Robespierre déclare que : « le seul ministre
que
j'ai loué est M. Servan. Cependant je n'en ai pas moins combattu la
mesure qu'il a proposée. C'est que l'on ne doit ja- mais juger de la
bonté d'utte mesure par le patriotisme de celui qui la propose. Il
s'agissait de faire lever le peuple entier. J'y trouvais des
Inconvénients. Entre autres mesures, je proposais le rappel des
ci-devant gardes françaises, et la formation d'une armée composée de
tous les soldats persécutés et renvoyés pour faits de patriotisme.
N'ayant pas été préparé à la mesure décrétée par l'Assemblée nationale,
j'ai été vivement frappé des inconvénients qu'elle présentait, sans
sentir ses avantages comme ceux qui en étalent les auteurs». A
l’Assemblée, ce même jour est présenté un rapport sur la mendicité par
M. Bernard d’Airy (ou sinon d’Héry), élu de l’Yonne est
présenté et lu
aux députés. Ce rapport bien que soulevant nombres de questions sur la
morale et la relation à la pauvreté est surtout lié aux questions
financières et à la répartition des sommes à établir entre les
départements pour les aides aux « indigents ». En annexe, l’on trouve
quelques éléments chiffrés sur trois département, Paris, la
Seine-et-Oise et les Basses-Pyrénées (de nos jours Atlantiques) : « La
journée de travail a été portée, pour le département de Paris, à 40
sols. Pour le département de Seine-et-Oise, à 20 sols. Pour celui des
Basses-Pyrénées, à 14 sols. Le secours total est supposé de 40
millions, et le prix moyen de la journée de travail pour tout le
royaume, de 17 sols. (…) le département de Paris contient en population
effective, 647.472 individus: en population active, 100.718 ; en
territoire, 24 lieues carrées. Il paye, sur les 300 millions des deux
contributions, 20.729.600 livres. Dans le département de Seine-et-Oise,
la population effective s'élève à 471.612 ; la population active, à
73.372. Son territoire est de 286 lieues carrées ; sa portion
contributive sur les 300 millions, de 7.371.494 livres.
Dans le
département des Basses-Pyrénées, la population individuelle est de
188.389 ; la population active, de 29.305, le territoire de 368 lieues.
La double contribution de ce département est de 1.213.600 livres. »
Ce
sujet revient régulièrement avec l’existence d’un « Comité de secours
publics » ayant commandé l’an passé une enquête, avec comme premier
président de cette instance le docteur et député Jacques René Tenon :
élu de la Seine-et-Oise, dont un hôpital de Paris conserve son nom. M.
Duranthon, le garde de Sceaux ou ministre de la Justice, se voit
attribuer quelques jours les charges des finances par intérim. Il
quittera ses fonctions le 4 juillet et reprendra du service après le 10
août. (Source : Gallica-Bnf - Rapport sur l'organisation générale des secours publics,
et
sur la destruction de la mendicité).
14 juin : Georges Danton propose au roi, que la reine soit répudiée et
de mettre fin à l’influence autrichienne. A la législative vient
à
la barre un citoyen de la ville de Perpignan, il se nomme le « sieur »
Amyot , instituteur, il est accompagné de ses élèves et fait une courte
déclaration en faveur du projet d’éducation de Nicolas Condorcet, que
plusieurs membres de l’Assemblée appuieront :
Législateurs,

« Nos enfants
possèdent dans leurs cœurs le germe des vertus; ils
attendent de vous les moyens de les faire éclore en leur donnant ce
code d'éducation si désiré; les plus avancés de mes élèves apprennent
les droits de l'homme, les plus jeunes délient leurs langues enfantines
en prononçant avec moi les mots sacrés de Constitution, de liberté, de
soumission aux lois ; je grave dans leur mémoire les noms des
fondateurs de notre liberté; ils entendent souvent lire l'extrait de
vos pénibles travaux et ils applaudissent aux noms cités que votre
modestie veut que je taise ; le mot de classe primaire excite leur
émulation, leur vœu est d'être instruits d'après votre plan ; ils
partagent en cela celui de la nation entière. Daignez, sages
législateurs, ordonner le rapport définitif de cet objet si nécessaire
à l'Etat : il en est temps, car il existe dans cette capitale des êtres
de mœurs peut-être plus que suspectes qui instruisent la jeunesse; les
couvents de femmes sont les repaires où l'aristocratie, étalant
l'appareil de ses sophismes trompeurs, séduit et gâte le cœur des
filles de nos concitoyens. Etablissez les bases de l'éducation
nationale, nos enfants apprendront à devenir des hommes plus fermes que
nous dans les principes de la liberté, ils en soutiendront avec plus
d'énergie les colonnes et feront pâlir et trembler les tyrans qui
voudraient renverser votre ouvrage, Leurs âmes élevées au-dessus des
préjugés où nous avons vécu aimeront des corps dont les bras guerriers
porteront des armes protectrices pour leurs représentants et
meurtrières pour ceux qui voudraient s'opposer à leurs décisions
utiles. Prononcez ce décret régénérateur et la France est sauvée, les
instituteurs aux gages des traîtres à leur patrie rentreront dans leur
néant et nos enfants élevés par des amis de la vérité,
n'écouteront plus d'autre voix que celle de la raison. »
Source :
Bib. Stanford, Archives parlementaires
|
15 juin : Dumouriez donne sa démission et il rejoint le commandement
des armées du Nord. Un nouveau cabinet est composé uniquement de ministres
Feuillants. Ils ne laisseront pas grand-chose à la postérité… et le
tourniquet des portefeuilles n’est pas fini.
16 juin : De Maubeuge, Lafayette adresse un courrier menaçant et
enjoignant l’Assemblée (en débat le 28) à prendre des mesures contre
l’indiscipline au sein des troupes et concernant les désordres
provoqués par les clubs, dans son orbite les sociétés et clubs
Jacobins. La Législative décide que l’ancien terrain de la Bastille
restera une esplanade publique et se nommera la Place de
l’égalité,
où devra s’ériger une colonne surplombée par une statue. Une première
pierre sera apposée par le sculpteur Dufoy, mais c’est une fontaine
venant agrémentée la grande place que l’on trouvera pendant quelques
années en ce lieu, elle servira aussi de place d’exécution, très
marginale, environ 70 à 80 décapitations pendant la seconde révolution
(1792-1795).
17 juin : A Paris, la section de la Croix-Rouge envoie une députation
à l'Assemblée pour accuser le roi de trahison. Cette section
deviendra celle du Bonnet Rouge se situant dans l’ancien Xe et actuel
VIIe arrondissement (ou le quartier Saint Thomas d’Aquin), avec 16.000
habitants dont 1.600 citoyens actifs en mesure de payer l’impôt,
1.600 ouvriers et 2.600 pauvres. Pour la Municipalité, le bureau de
police de la capitale fait parvenir à la chambre les déclarations de
plusieurs citoyens affirmant avoir reçu des offres d'argent pour aller
applaudir dans les tribunes les membres du parti Feuillant. La
Législative ordonne son renvoi au Comité de surveillance.
18 juin : La Législative déclare tous les « droits casuels » supprimés
et sans indemnités. Il s’agit de l’abolition des derniers droits
féodaux restant en cours. Et mettant fin au décret du 15 mars 1790 : « Article
premier : La mainmorte personnelle, réelle ou mixte, la
servitude d'origine, la servitude personnelle du possesseur des
héritages tenus en mainmorte réelle, celle de corps et de poursuite,
les droits de taille personnelle, de corvées personnelles, d'échute, de
vide-main, le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre
de vente, donation entre vifs ou testamentaire, et tous les autres
effets de la mainmorte réelle, personnelle ou mixte,qui s'étendaient
sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité ».
(Source :
en français de Wikisource) Aux Jacobins, Lafayette est
l’objet d’un discours sans appel de Robespierre, qui voit dans sa
lettre du 16, « le plus grand des crimes, l'attentat le plus inouï, le
plus épouvantable! Les expressions lui manquent : l'orateur s'enroue ;
(on murmure) l'orateur reprend haleine: il voit Lafayette dire à
l'assemblée nationale : tremblez, car je suis à la tête de 45.000
hommes, et prêts à rentrer en France (frisson général)!... Enfin après
avoir tonné contre le général, il conclut au décret d'accusation,
décret qui doit être appuyé de toute la force nationale : frappez
Lafayette, dit-il, et la nation est sauvée : il a fait fuir le roi ; il
veut encore le faire fuir pour ne jamais revenir : tous les troubles que
vous verrez s'élever dans Paris, seront désormais son ouvrage
; mais s'il est renversé sur le champ, la cause du
peuple triomphe, et la liberté avec lui! (applaudissements féroces). »
19 juin : A l’Assemblée un décret ordonne de brûler tous les titres ou
actes de noblesse.
à suivre...
|
|
|
|
|
|
|
|
Cet espace
d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
Les
articles et textes de Lionel Mesnard sont sous la mention tous droits réservés
Ils ne peuvent faire l'objet d'une reproduction sans
autorisation
Les autres articles ou vidéos sont sous licence
Creative Commons 3.0 FR ou 4.0 (audio)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
|
|
| Adresses et courrier : |
|
|
|
| Courrier
électronique |
lionel.mesnard(AT)free.fr
|
|
|
|
|
|
Archives des vidéos en ligne :
|
| Dailymotion - Pantuana.tv - Youtube |
|
|
|
|
|
|
|