|
|
|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
Sommaire de la page,
1 - Vie politique, organisation nouvelle de la Paris et murs des Fermiers généraux :
I - Les clubs et sociétés populaires
II - Organisation des nouveaux pouvoirs?
III - Les barrières de la colère?
2 et 5 - Chronologie de l'année 1789 du 1er janvier au 14 juillet (en deux parties)
3 - Plaintes des Dames de la Halle, M. Josse
4 - Pétition personnelle d'un électeur parisien
6 - Adresse au Roi de Mirabeau
7 - Le renvoi de M. Necker, L.S. Mercier
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Vie politique, organisation
nouvelle de Paris
- et murs des Fermiers généraux

- Gravure du club des Jacobins dans l'ancien couvent
|
I - Les clubs et sociétés populaires dans Paris
Si les salons ont pu influer, les clubs allaient intervenir plus directement dans
la vie politique : « Après
les journées d'octobre (1789), le club des députés bretons s'est
transporté à Paris avec l'Assemblée. Il siègera dans la bibliothèque du
couvent des jacobins de la rue Saint-Honoré, à deux pas du "Manège" où
l'Assemblée tient ses séances. Il s'intitulera, la société des Amis
de la Constitution.
Il s'ouvre non plus seulement aux députés, mais aux bourgeois aisés qui
y sont admis par cooptation. On y trouve des littérateurs et des
publicistes, des banquiers et des négociants, des nobles et des
prêtres. Le duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, s'y fait admettre
dans l'été de 1790. Le droit d'inscription est de 12 livres et la
cotisation annuelle de 24 livres payables en quatre fois. Dès la fin de
1790 le nombre des membres dépasse le millier. Il correspond avec les
clubs qui se sont fondés dans les principales villes et jusque dans les
bourgs. Il leur délivre des lettres d'affiliation, il leur distribue
ses publications, il leur passe des mots d'ordre, il les imprègne de
son esprit, il groupe ainsi autour de lui toute la partie militante et
éclairée de la bourgeoisie révolutionnaire. Camille Desmoulins, qui en
fait partie, définit assez bien son rôle et son action quand il écrit :
« Non seulement c'est le grand inquisiteur qui épouvante les
aristocrates, c'est encore le grand réquisiteur qui redresse tous les
abus et vient au secours de tous les citoyens. Il semble en effet que
le club exerce le ministère public auprès de l'Assemblée nationale. »
La place des orateurs au sein des diverses assemblées a connu une
importance certaine. Mirabeau, Barnave, Robespierre ou Saint-Just ont eu une
grande capacité à fixer les auditoires et les mener à la force du
verbe. De quoi s'interroger sur la plasticité et sur l’affirmation des
convictions des uns et des autres? Ou de ce qui pouvait représenter une
majorité. Dans les deux assemblées, celle de 1789 et celle de 1792,
l’on vit l’émergence de forces politiques, mais pas de majorité claire
autour d’un ou de partis rassemblés. Comme nous pouvons le connaître de
nos jour (sic), et selon la nature des scrutins. De plus, s’il ne s’agit pas
d’organisations constituées, la vie politique se concentra autour
des clubs, et toute autre forme associative se vit bannir avec la loi Le Chapelier en
juin 1791. Elle toucha notamment les corporations, mais surtout empêcha
la constitution de groupements à caractère civique et social.
Syndicats (1864) et partis
(1902) ne purent se constituer légalement, l’activité clubiste pallia cette absence,
de quoi servir de lien entre les citoyens et les élus. « La
terrible loi Chapelier, qui interdisait aux ouvriers, sous les peines
les plus sévères, de se concerter pour faire hausser les salaires et
punissait la grève comme un attroupement séditieux. Notez que la loi
Chapelier restera en vigueur pendant soixante-quinze ans. Demandez-vous
ce qui arriverait aujourd'hui, si un gouvernement enlevait à la classe
ouvrière le droit de se syndiquer et de se mettre en grève, et mesurez
par là le chemin parcouru ! » (La question sociale, Albert
Mathiez, page 24)
Deux clubs ont marqué le processus révolutionnaire, le plus connu
celui des Jacobins (Société des Amis de la Constitution) se trouvait en
rive droite et les Cordeliers (Société des Amis des droits de l’homme et du citoyen), se
tenait dans un couvent désaffecté en rive gauche et portait le même
nom. Il faut distinguer le club des Jacobins, du jacobinisme, non qui
lui soit totalement étranger, mais ce qui va sous-tendre comme
idéologie est à mettre au crédit des « néo-jacobins » incarnés après
1795 par Bonaparte, entre autres. Les clubs Jacobins, car ils
existèrent dans toute
la France, furent dans la plupart des villes avec leurs correspondants
locaux, ils trouvaient à Paris un siège central et un haut lieu de
débats sur les activités des assemblées.
« De là ces sociétés devinrent l'âme même de la Révolution. Par
l'effet naturel de l'ancienne centralisation, la société mère des
Jacobins rayonna sur tout le territoire. Elle eut sur chaque point,
ville ou village, une succursale obéissante qui répéta au même moment
le mot d'ordre, l'instruction partie du centre. La moindre de ces
sociétés devint l'image parfaite de la société mère de Paris. Il y eut
dans d'elles un petit Danton ou un petit Robespierre, suivant la
différence des époques. Ainsi les idées de la Révolution se répandirent
d'échos en échos par des milliers de bouches. Ces principes, qui
seraient restés lettre morte dans les livres éclairèrent subitement une
nuit de mille ans. Aucune puissance ne pouvait lutter avec ces
sociétés. Elles s'imposèrent aux trois grandes assemblées législatives,
elles venaient à la barre, et c'étaient des ordres qu'elles donnaient.
La pensée sortie du club des Jacobins circulait en quelques jours à
travers toute la France, et revenait à Paris éclater dans la
Législative et la Convention, comme un plébiscite irrévocable. Là fut
le caractère peut-être le plus nouveau de la Révolution. C'est ce qui
projeta ses idées avec la rapidité de l'éclair. Les provinces, si
mornes il y avait à peine deux ans, furent illuminées du feu qui
éclatait à Paris. »
La révolution, tome 1, Edgar Quinet,
pages 114 et 115
En juillet 1791, au sein du club des dits Jacobins, une scission était
organisée par
Lafayette et ses proches, cela amena à la création du club des
Feuillants, qui allait constituer l’aile monarchiste, de moins en moins
libérale, en opposition aux aspirations « républicaines » qui se firent
jour. Ils se rassemblaient à deux pas du « Manège », qui allait tenir
lieu de salle pour les parlementaires en novembre 1789, à
proximité de la résidence royale des
Tuileries et non-loin de l'ancien Palais-Cardinal (datant de
Richelieu), devenu le jardin du Palais Royal. Pareillement les Jacobins
tenaient leur nom du couvent dans
un lieu occupé à l’origine par des religieux, idem pour le couvent et le
club des Feuillants, ils se trouvaient les uns et les autres dans la rue
Saint-Honoré (aujourd’hui le premier arrondissement), qui servit
d’espace d’accueil à ce courant en déroute, l’année suivante.
« Déjà
toute la partie conservatrice des jacobins avait fait scission, le 16
juillet, et avait fondé un nouveau club dans le couvent des Feuillants.
A peu près seuls parmi les députés, Robespierre, Anthoine, Pétion,
Coroller restèrent aux jacobins, mais furent assez heureux pour
maintenir dans leur sillage la plupart des clubs des départements. »
La Rév. fr., tome I, Albert Mathiez, page 176
Il faut aussi préciser que
le général Lafayette se montra sous un jour répressif et bien avant
la dite « Terreur », lui-même aurait pu répondre de quelques crimes,
comme à Paris avec la fusillade du Champ de Mars, le 17 juillet 1791. Cette
répression a été dévastatrice auprès de l’opinion, tout comme la fuite
quelques semaines auparavant des époux royaux à Varenne. Le tout se
cumula avec les refus de Monsieur « Véto » de signer certaines
lois et les représailles contre l’aile minoritaire jacobine. Peu à
peu le climat de tension se retourna aux crédits d’un changement radical de régime.
« Les sections parisiennes siégeaient en permanence. Elles
formaient entre elles un Comité central. Plusieurs admettaient à
délibérer dans leurs assemblées les citoyens passifs, elles les
autorisaient à entrer dans la garde nationale et elles les armaient
avec des piques. Aux Jacobins Robespierre et Anthoine, à l'Assemblée le
trio cordelier prenaient la direction du mouvement populaire. Le rôle
de Robespierre surtout fut considérable. Il harangua les Fédérés aux
Jacobins dès le 11 juillet, il les colérât : « Citoyens, êtes-vous
accourus pour une vaine cérémonie, le renouvellement de la Fédération
du 14 juillet? » Il leur dépeignit la trahison des généraux,
l'impunité de Lafayette : « L'Assemblée nationale existe-t-elle encore
? Elle a été outragée, avilie et ne s'est point vengée ! » Puisque
l'Assemblée se dérobait, c'était aux Fédérés à sauver l'État. Il leur
conseilla de ne pas prêter serment au roi. La provocation était si
flagrante que le ministre de la justice dénonça son discours à
l'accusateur public et demanda contre lui des poursuites. Robespierre,
sans s'intimider, rédigea les pétitions de plus en plus menaçantes que
les Fédérés présentèrent coup sur coup à l'Assemblée. Celle du 17
juillet réclamait la déchéance. Sous son impulsion, les Fédérés
nommaient un directoire secret. »
La Rev. fr. tome I, par Albert Mathiez
page 268
Le siège du club des Jacobins allait représenter un centre nerveux, non
loin du Parlement (il n’existe plus de nos jours). Après Versailles,
ce qui
servit dans un premier temps de cadre d’accueil aux parlementaires de
la première génération, l’ancienne Assemblée nationale se situait en
plein sur la voie de circulation
de l'actuelle rue de Rivoli, et l'édifice a été rasée lors du tracé de la
nouvelle rue sous Napoléon
1er et ses aménagements urbains. Ce qui avait été sous
Louis XV un ancien centre équestre, désigné sous le nom de Manège en raison de sa forme
circulaire, servit de lieu aux débats aux élus. Le bâtiment se trouvait à peu de distance des locaux du
couvent des Jacobins et après les journées du 5 et 6 octobre 1789, c'est-à-dire le lendemain, ce fut aussi le nouveau
lieu de résidence de la famille Capet à quelques centaines de pas, le « Palais Royal » (détruit en mai 1871).
A ne pas confondre aujourd'hui avec les jardins du même nom où exista et préexista
à la Révolution un certain nombre de salons, à distinguer des clubs et sociétés. A quelques encablures du
grand Louvre, jouxtant le Conseil d’État. Cet
ensemble
architectural existe toujours avec son jardin et ses immeubles
l'entourant, a été la propriété
du duc d’Orléans (Philippe Egalité). Et représenta un des lieux de
rencontre du tout Paris : cafés, commerces, théâtres et lieu de
promenade. Cet investissement et ces immeubles de rapport furent très
décriés à la cour, voire jalousés. Cet ensemble commercial a connu un
très grand succès et un attrait certain auprès des Parisiens de toutes
les couches
sociales. Ce fut de là que s’engagèrent les premières saillies de
Camille Desmoulins et appels à la révolte générale en juillet 1789
contre déjà l’invasion étrangère, comme référence aux troupes
Suisses et Allemandes, membres des armées de Louis XVI, en station
autour de la ville et qui circulaient au sein de la Paris.
L’ancien quatrième arrondissement - il y en avait 12 quand ils furent
créés en 1795 - était un quartier hautement politique, où se concentra
une bonne part du devenir de pays, avant et après la destitution du
monarque. Le Palais Royal allait servir d’annexe du Parlement, ce lieu fut désigné
sous
la Convention après la prise des Tuileries en 1792. En partant du 17 au 20 juin
1789, des premiers élus, ceux de la Constituante, la
terminologie la plus fréquemment utilisée pour désigner l’Assemblée est
à distinguer, de ce que nommèrent entre autres Jean Jaurès ou Edgar Quinet - la «
Législative » - allant du 3 septembre 1791 à août 1792. Puis ce que l'on nomma la Convention qui débuta après les élections en septembre 1792.
Dans
le fonctionnement des Assemblées successives et leurs
dénominations : Constituante, Législative puis Convention, comme
aujourd'hui, le public pouvait assister, et le faire un peu plus
bruyamment. Mais l’on remarque dans les débats, l’intervention de
simples citoyens et des questions posées aux députés sur diverses
affaires par l’intermédiaire des pétitions. Des quidams appelés à
témoigner et élus tenus à délibérer ; le droit de pétition allait aussi
fortement influer et être une cause des révoltes éparses, mais
régulières des Parisiens.
L’autre club, celui des Cordeliers
ne fut pas seulement en retrait, il représenta plus, le Paris «
populaire » ou du franc-parler se trouva un premier temps dans une
partie de la ville très modeste, et à proximité du faubourg Saint-Marcel (ou
Saint-Marceau). Un des gros poumons de population, comme Saint-Antoine,
deux faubourgs qui allaient avoir une place importante dans les colères
collectives. Les Cordeliers néanmoins déménagèrent, après avoir connu
des périodes clandestines, le club sur lequel fit main basse Danton
s'intalla toujours en rive gauche, à proximité de la Seine dans
l'actuel 6ème arrondissement de Paris.
« Le parti démocratique (note : comprendre les premiers
républicains avant d’être représentés ou dominés par les jacobins
sociaux) accentue
ses progrès. En octobre 1790 le franc-maçon Nicolas de Bonneville,
directeur de la Bouche de Fer, groupe au cirque du Palais-Royal, une
fois par semaine, les Amis de la Vérité, devant qui l'abbé Fauchet
commente le Contrat social. Les Amis de la Vérité sont cosmopolites.
Ils rêvent d'éteindre les haines entre les nations et entre les
classes. Leurs idées sociales paraissent très hardies aux jacobins
eux-mêmes. A côté des grands clubs, les clubs de quartier apparaissent.
Dans l'été de 1790, l'ingénieur Dufourny, le médecin Saintex,
l'imprimeur Momoro fondent dans l'ancien district des Cordeliers,
devenu la section du Théâtre français, la société des Amis des Droits
de l'homme et du citoyen, qu'on appelle aussi d'un nom plus court le
club des Cordeliers, parce qu'il siège d'abord dans le couvent des
Cordeliers avant d’en être chassé par Bailly et d’émigrer dans la salle
du Musée, rue Dauphine.
Les Amis des Droits de l'homme ne sont pas une
académie politique, mais un groupement de combat, ou Leur but
principal, dit leur charte constitutive, est de dénoncer au tribunal de
l'opinion publique les abus des différents pouvoirs et toute espèce,
d'atteinte aux Droits de l'homme. » Ils se donnent pour les protecteurs
des opprimés, les redresseurs des abus. Leur mission est de surveiller,
de contrôler et d'agir. Sur leurs papiers officiels ils arborent «
l'œil de la surveillance », grand ouvert sur toutes les défaillances
des élus et des fonctionnaires. Ils visitent dans les prisons les
patriotes persécutés, ils entreprennent des enquêtes, ils ouvrent des
souscriptions, ils provoquent des pétitions, des manifestations, au
besoin des émeutes. Par leur cotisation minime, 2 sols par mois, ils se
recrutent dans la petite bourgeoisie et même parmi les citoyens
passifs. C'est ce qui fait leur force. Ils peuvent à l'occasion toucher
et émouvoir les masses. »
La Rév. Fr., tome I, par Albert Mathiez, page
163

illustration des résidents hommes du Val de Grace au XVIIIe siècle
Le couvent des Cordeliers avait été vidé de ses attributs religieux et
ressemblait au dépouillement des habitants, simple avec peu de
mobiliers et ouvert à quatre vents, où se tinrent de nombreuses
discussions des volontés du moment. Le club en tant que tel vit le
jour en avril 1790 :
« La presse ne savait quel conseil donner ; il
n'y avait point encore de ces chefs reconnus qui devaient plus tard
organiser les insurrections. Pris de la fièvre et du délire, Marat
demandait en vain un tribun. Ses fureurs étaient alors sans échos.
Danton, président des Cordeliers, ignorait sa puissance. La Révolution
populaire n'avait pas encore de tête. Ce fut le cri de la famine qui
mit fin aux incertitudes et, comme dans toutes les occasions de ce
genre où l'imagination tient une si grande place, les femmes se
montrèrent longtemps seules, au milieu de l'étonnement et de l'inertie
des hommes
».
La révolution, tome I par Edgar Quinet, page 151
Ce fut de là, du club des Cordeliers que partit un des premiers
appels à destituer le roi, que se formèrent les prémices d’un idéal
égalitaire. Sur la place des femmes, elles furent là toujours présentes
dans les coulisses, ou aux tribunes du public, attentives, occupées ou
invectivant, si besoin allaitant le dernier-né, elles savaient que les
bouches à nourrir étaient nombreuses et que la lâcheté des hommes
n’était pas que légendaire. Elles ont été l’œil, si ce n’est
l’avant-garde, les
hommes toujours pour en tirer de vaines gloires.
« Les Cordeliers ont bientôt derrière eux d'autres clubs de
quartier
qui se multiplient dans l'hiver de 1790 et 1791 sous le nom de sociétés
fraternelles ou de sociétés populaires. La première en date, fondée par
un pauvre maître de pension, Claude Dansard, tenait ses séances dans
une des salles du couvent des Jacobins où siègent déjà les Amis de la
Constitution. Dansard rassemblait à la lueur d'une chandelle qu'il
apportait dans sa poche les artisans, les marchands de légumes, les
manœuvres du quartier et il leur lisait les décrets de la Constituante
qu'il leur expliquait. Marat, toujours clairvoyant, comprit combien ces
clubs à l'usage des petites gens pouvaient rendre de services aux
démocrates. Il poussa de toutes ses forces à leur création. Il y en eut
bientôt dans tous les quartiers de Paris. C'est par eux que se fit
l'éducation politique des masses, par eux que furent levés et
embrigadés les gros bataillons populaires. Leurs fondateurs, Tallien.
Méhée, Latouche, Lebois, Sergent, Concedieu, l’abbé Danjou, étaient
tous Cordeliers. Ils joueront un rôle important sous la Terreur. Pour
l’instant ils appuient de toutes leurs forces la campagne démocratique
contre Lafayette, contre les prêtres réfractaires, et contre la Cour.
Leur idéal emprunté à Jean-Jacques Rousseau est le gouvernement direct. »
Albert Mathiez, La Révolution française, tome I, page 164
PS : De
l'existence de 80 Clubs ou Sociétés populaires en 1790 pour les seuls
Jacobins, ils ont été 800 clubs directement affiliés à la société
parisienne, et aux alentours de 6.000 avec 500.000 membres en 1793 sur le territoire national.
Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet des clubs révolutionnaires,
nous vous conseillons d'écouter le podcast de Paroles d'histoire (durée : 58 minutes) :
Les Jacobins, du mythe à l’histoire
Les invités : Côme Simien, maître de conf. à Paris I et Guillaume
Roubaud-Quashie chercheur associé au centre d’histoire sociale.
Auteurs de Haro sur les Jacobins Essai sur un mythe politique français
(XVIIIe-XXIe siècles), éditions PUF 2025.
|
II - Fonctionnement des pouvoirs, de l’ancien au nouveau ?
L’organisation et la structure du nouveau régime partaient d’abord de
la commune. Elle a été l’unité de base, environ 42.000 municipalités
pour tout le pays. A Paris, le nouveau Maire M. Bailly devait
répondre au fonctionnement de 60 districts, en remplacement des
paroisses. Avant la création des départements, qui réduiront son nombre
à 48, s’y calqueront les sections ou comités révolutionnaires. Nés à
l’origine des États-généraux et de la rédaction des cahiers de
doléances. Paris devint ainsi une commune et un département à la fois,
les districts laissèrent place en premier aux cantons comme
appellation, puis devenaient 12 arrondissements en 1795, puis 20 en
1860 sous Napoléon III.
Un certain nombre de pouvoirs qui étaient dévolus au Lieutenant-général
de Police et au Secrétaire d’état du Roi allait devenir de la
responsabilité de la Ville et du Conseil général, le ravitaillement
entre autres en vivre et surtout en blé. Mais aussi la gestion courante
des hôpitaux, de la police, des prisons, ou tout ce avait un lien avec
le fonctionnement d’une collectivité. L’hôtel-de-ville que l’on nomma
aussi la « Maison Commune » (à partir de l’insurrection de 1792) a été
maintes fois le théâtre de manifestations ou bien d’attroupements
populaires à l’extérieur et en son sein. Sous l'ancien régime, la Mairie
centrale se trouvait quai des orfèvres, à la place de l'actuelle préfecture de
Police de la Paris.
Les journées des 13 et 14
juillet 1789 font de ce lieu central de la vie municipale un espace
d’expression politique de premier plan. Ce fut là que convergèrent les
forces populaires en recherche de fusils, canons, poudres et balles, et de
comment de Flesselles allait accumuler les bourdes et promener les
quémandeurs sur l’existence d’armement disponible dans la ville.
Malgré ses démarches auprès des autorités militaires, l’avis fut de
taire les emplacements provoquant en retour l’attaque des
Invalides le 14, pris d’assaut par 40.000 personnes. C’est en réalité
le fait le plus significatif de la révolte populaire de la journée.
Le
départ précipité de M. Jean-Charles-Pierre Lenoir pour l’étranger dès
après le 14 juillet 1789 et la mort du dernier Prévôt de Paris M. de
Flesselles le même jour, donne une idée des craintes et des haines que
certains fonctionnaires d’état ont pu représenter. M. Lenoir
fut l’avant-dernier responsable en fuite, il fila avec les émigrés de la
première heure, la Lieutenance-générale de Police allait ainsi connaître ses
derniers jours comme administration royale. Dans la cité, ses locaux
furent attaqués et pillés, et ce n’était pas le moindre des emblèmes
des mécanismes de l’absolutisme qui tomba. Cette administration verra
ses immenses pouvoirs transférés aux autorités politiques déjà
évoquées, et aux normes judiciaires et juridiques nouvelles, qui seront
dans l’ensemble assez peu évolutives.
Néanmoins, cette avancée légale
n’a pas été négligeable et conditionna la prise directe des sections
parisiennes sur la vie politique, qui plus est dans le prolongement de
l’activité municipale et départementale, où siégea Robespierre, un
temps au département. Avec la Commune insurrectionnelle d’août 1792,
l’Hôtel-de-ville passait au profit des 48 sections. Il deviendra ainsi un temps le
théâtre de l’activité politique. Si le terme de démocratie directe a
pris toute sa valeur, il faut rester prudent sur son effectivité et sur
le nombre de participants concernant ce système basique et souvent
trompeur. Non point sur le nombre de participants, mais sur les
procédures de vote, pas toujours vraiment démocratiques, comme le vote
par acclamation, voire à main levée sous tension sans recours au vote secret, des tactiques politiques de
noyautages des assemblées, ces mécanismes n'ont pas vraiment changé depuis.
Une chose importante résida en la disparition des charges judiciaires :
juges, avocats, etc., mettant une fin ainsi à l’ancien mille feuille
administratif et juridique de l’ancien régime et à ses privilèges. La
charge était héréditaire ou payante et se limitait à une juridiction le
plus souvent. Donc réservée à une élite sociale, et l’on portait de la
sorte une particule sans avoir à porter des quartiers de noblesse. Dans
la forme, le changement peut sembler radical, sur le fond, c’est un tout
autre problème et le transfert des hôpitaux notamment généraux et des
prisons une préoccupation qui tardera à se mettre en œuvre, de même dans le
cas des lieux carcéraux. L’on allait beaucoup débattre et peu agir, avant
que cela ne tourna aux drames et aux délires "paranoïaques".
Beaucoup de
fantasmes et de préjugés comme les complots ou conjurations des prisons
(au moins deux épisodes) ont été inventés de toutes pièces par la rumeur
publique ou les autorités politiques. Le sort des prisonniers et pas
seulement des embastillés n'allait pas vraiment évolué, les conditions de
vie au sein des geôles avaient peu changé depuis le Moyen Âge.
L’administration pénitentiaire était loin d’être un exemple de vertu,
souvent le petit personnel ressemblait à ceux que l’on enfermait, et comme
partout, chacun jouissait de son petit pouvoir et tentait de le monnayer. Et
ceci, se reproduisait sur une bonne part de la hiérarchie et offrit à
certains de vivre de rentes et trafics de toutes sortes.
A
noter, quelques petites avancées sur les hôpitaux ont débouché sur des
réalisations et furent mises en œuvre à partir de 1793. Les
syphilitiques allaient disposer de leur
hôpital du côté du faubourg Saint-Jacques sur la rive gauche, même si
les traitements médicaux n'avaient guère variés. Fait notable, nombre
de
médecins ont eu un rôle spécifique, quand ce ne fut pas un mandat de
député ou d’élus locaux. La place des sciences et leurs évolutions
seront considérables le siècle suivant. Mais tout était en
préfiguration
depuis au moins 1785 sur la fonction hospitalière. L’on découvre ainsi
quelques figures remarquables comme le docteur Tenon, député la
première année et un petit bonhomme par sa taille. Philippe Pinel qui
fit évoluer la pratique à l’adresse des "fous", insensés, ou aliènés. Notamment
depuis
que Madame Necker découvrit l’état général du système hospitalier et
contribua à certaines améliorations. Diverses
contributions médicales et de longs rapports dans les années 1780
jusqu’en
1791 visèrent à le réformer, et l’ouverture de nouveaux hôpitaux
commença à se préciser.
Un des lieux les plus problématiques fut l’Hôtel-Dieu, le plus vieil
hôpital parisien. Il avait la charge de tout centraliser et de répartir
les malades en fonction de leur état. Il avait quelques années avant la
révolution connu deux incendies et provoqua des rapports sur le
fonctionnement global des hôpitaux destinés à ceux qui n’avaient aucun
moyen de se payer un médecin à domicile et s’il en avait un. L’on
pouvait vous ramasser à même le sol et vous conduire dans des salles
bondées en l’attente d’une guérison improbable, quatre par lits et par
rotation, sur des paillasses infestés de vermine et dans un air vicié.
Il y eut peut-être là aussi quelques raisons de se révolter sur
l’inégalité des sorts?
III - Le mur des Fermiers Généraux ou les barrières de la colère?
« Le mur murant Paris rend Paris murmurant » est un épigramme fait par Beaumarchais qui manifestait le rejet populaire de cette ceinture déjà en 1785.
« Le service de la dette publique absorbe, en 1789, 300 millions
par
an, c'est-à-dire plus de la moitié de toutes les recettes de l'État. La
Compagnie des fermiers généraux, qui perçoit pour le compte du roi le
produit des impôts indirects, aides, gabelle, tabac, timbre, etc.,
compte à sa tête des financiers de premier ordre qui rivalisent de
magnificence avec les nobles les plus huppés. Il circule à travers la
bourgeoisie un énorme courant d'affaires. Les charges d'agents de
change doublaient de prix en une année. Necker a écrit que la France
possédait près de la moitié du numéraire existant en Europe. Les
négociants achètent les terres des nobles endettés. Ils se font bâtir
d'élégants hôtels que décorent les meilleurs artistes. Les fermiers
généraux ont leurs "folies" dans les faubourgs de Paris, comme les
grands seigneurs. »
La Rév. fr., tome I, A. Mathiez, page 23
Porte d'Enfer - restant de la barrière d'octroi - place Denfer-Rochereau (Paris 14ème ar.)
Ce
fut l'architecte Nicolas Ledoux qui fut chargé d'élever les massifs
édifices
qui, ainsi que deux bastilles, elles devaient protéger chaque barrière et
servir de logement aux gabelous (agents du fisc) ; il s'arrangea de façon que ces
constructions pussent au besoin servir pour défendre les entrées de la
Paris. On en peut voir encore quelques échantillons place du Trône
et place Denfert-Rochereau. L'historien et député à la Convention, M.
Dulaure disait à ce propos : « L'architecte
voulant donner des preuves de la fécondité de son imagination, n'en a
souvent prouvé que les écarts. On voyait avec mécontentement et
murmures de fastueux édifices consacrés à une perception oppressive
pour toutes les classes de la société et du commerce ».
Un des
éléments importants et architectural de la ville furent ses
barrières d’octroi, elles expliquent pour bonne part le ressentiment
qui se transforma en colère. Il s'agissait d' « un
mur de pierre, haut de plus de trois mètres, coupé par ces imposants
bâtiments d’octroi, destinés à percevoir les taxes. Ainsi, les
habitants vivant au dehors de la ville sont assujettis à la taille,
alors que les Parisiens, exemptés de cet impôt, paient des droits sur
les marchandises, aussi diverses que les matériaux de construction
(plâtre, bois…), les produits alimentaires et les alcools (vin,
eau-de-vie, cidre, poiré). Ces boissons restent évidemment moins chères
hors barrière, le prix étant en moyenne trois fois moins élevé qu’à
l’intérieur de Paris. » (La Révolution aux barrières de Momcilo Markovic, année 2013, Annales Historique de la Rév. fr. n°372)
La plupart des entrées ou portes ont été incendiées, saccagées ou
en partie détruites. Passage obligé depuis le règne de Louis XV pour
entrer dans la cité, elles furent l’oeuvre d’un des grands architectes
du
siècle, Nicolas Ledoux. Des travaux qui prirent fin en 1790, au début
de la première révolution, certains pans de mur au nord de la ville
n'étaient pas encore achevés, et seules des palissades fait de planches
marquaient les limites. Pour
son organisation propre, les barrières étaient de la responsabilité des
Fermiers
dits Généraux, l’autre nom des murs d’enceinte. Les fermiers généraux
étaient des collecteurs d’impôts, ils se chargeaient des droits
d’entrée
des marchandises, ses collecteurs intervenaient au nom de la Ferme. Ils étaient à Paris les percepteurs de tous les
transports commerciaux, notamment routiers. Ils acheminaient par exemple le
grain ou le vin. Ils prélevaient ainsi une part numéraire ou en nature
et pour la couronne l'assurance des revenus quasi garantis, et
prélevaient pour
eux des bénéfices, qui firent d’eux des partis très convoitables. Ils
agissaient « à ferme », c'est-à-dire, ils assumaient le recouvrement
des impôts indirects et l'exploitation des monopoles fiscaux, et
au final ils reversaient le produit normalement au trésor royal.
Pour augmenter son numéraire
Et raccourcir notre horizon
La Ferme a jugé nécessaire
De mettre Paris en prison.
Vers anonymes
« La suppression de l’octroi fut aussi populaire chez les ouvriers
que l’abolition de la dîmes chez les paysans». (La Question Sociale, A. Mathiez, page 27) Il reste dans la ville
quelques traces comme la Rotonde de la Villette, qui fut en premier une
halle ou un entrepôt à grain. Cette puissance financière a eu de fait
de quoi se faire entendre et défendre ses intérêts. A Paris, ce furent
les fermiers généraux qui poussèrent à ceinturer la ville d'un
mur pour mieux percevoir et éviter les contrebandes, une activité
connue depuis le XVIe siècle en périphérie de la ville. La nouvelle
Assemblée nationale ou Constituante supprima « l'affermage »
en mars 1791
(la 1ère constitution sera approuvée le 3 septembre 1791). La
Convention mettait aux arrêts trente-deux fermiers généraux en novembre
1793 et vingt-huit parmi eux furent guillotinés.
De plus, les barrières ont été aussi un filtre de police, chaque entrée
était surveillée par un prompt renfort de la maréchaussée. Par ailleurs
sous l’ancien régime, chaque arrivée dans les hôtels était par exemple
relevée et transmise aux commissaires des vingt paroisses. Dans le cas
de l’administration des postes, il en allait de noter les échanges de
correspondance, si le régime royaliste n’avait pas d’argent pour
remplir les ventres, elle en trouvait pour espionner ses sujets et
entretenir l’armée la plus puissante d’Europe. Pour clore ce rapide
portrait des administrations royales, les barrières d’octroi
concentrèrent les amertumes populaires et être un des vecteurs du haut
niveau corruption du régime écoulé. Ce que pouvait toucher les employés
des barrières ne pouvaient être suffisant et il entraînait des surcoûts
faisant monter les prix au sein de Paris, d’où l’existence d’un
nombre important de débit de boisson (guinguettes, estaminets,
auberges) hors des enceintes, le vin comme le blé ont leur histoire
particulière en région parisienne et un rôle singulier dans la vie
quotidienne. Ce mécanisme a fini par coûter plus cher qu’il ne
rapportait et avant sa suppression son déficit selon Mathiez était de
plus 100 millions.
« A la mort de Louis XV (1774) le service de la dette exigeait 93
millions,
en 1790 il en exige environ 300 sur un budget de recettes qui dépassait
à peine 500 millions. Mais tout a une fin. Calonne fut obligé d'avouer
au roi qu'il était aux abois. Son dernier emprunt avait été
difficilement couvert. II avait mis en vente de nouveaux offices,
procédé a une refonte des monnaies, augmente les cautionnements,
aliénés des domaines, entoure Paris d’un mur d'octroi, il avait tire
des fermiers généraux 255 millions d'anticipations, c'est-à-dire
d'avances a valoir sur les exercices financiers à venir, il s'apprêtait
a emprunter, sous prétexte de cautionnement, 70 millions encore à la
Caisse d'Escompte, mais tous ces expédients n'empêchaient pas que le
déficit atteignait 101 millions. Par surcroît, on était à la veille
d'une guerre avec la Prusse à propos de la Hollande. Le ministre de la
guerre réclamait des crédits pour défendre les patriotes de ce petit
pays auxquels le roi avait promis main-forte contre les Prussiens.
»
La Rév. fr., tome I, A. Mathiez, page 35
Texte de Lionel Mesnard
|
|
|
|
Chronologie
du 1er janvier au 30 avril 1789

Le Pont Neuf de Paris au XVIIIe siècle
|
Petit rappel : Sur
le plan économique, les
caisses du royaume ont été
vidées en raison de la guerre ; elle perdura de la déclaration du 4
juillet 1776 à Philadelphie, jusqu’en 1783 et la signature d’un traité de
paix (dit de Paris) entre les différentes parties. L’Angleterre comme la France auront
à la veille de la Révolution une dette abyssale à rembourser. En
France, la valse des grands argentiers ou ministres des finances dans
les années 1780 tombaient sur l’impossibilité de réformer ou libéraliser
les finances royales. Le premier poste de dépense était le pain et il
pouvait représenter 90% des achats quotidiens pour un foyer modeste, ou
sinon 50% pour l'achat d'une simple soupe de légumes et un bout de pain
pour un travailleur journalier payé 20 sols (qui équivaut à une livre).
L’objet de Louis XVI fut de trouver de nouveaux impôts, pas de toucher
aux équilibres très complexes de l’ancien régime. Le despotisme éclairé
dont se prévalaient les monarques prussiens, autrichiens, fut très
prisé à Versailles et dans l’entourage royal. Louis XVI navigua
entre les "libéraux" et les "conservateurs", ne sachant sur quel
pied danser pour plaire à tous.
I - Le mois de janvier 1789
Jeudi 1er janvier : Depuis
la fin novembre de
l’année 1788 le temps est
glacial et la Seine s’est mise à geler. La température affiche moins 17
degrés sur le thermomètre, soit moins 21 degrés centigrades ou celsius.
La traversée
entre Calais et Douvres est bloquée, de même le port de Marseille est
sous la glace. Les moulins ne fonctionnent plus. Cela provoque une
pénurie de farine dans toutes les régions. Dans le Dauphiné, se
tiennent les élections des députés. Ces derniers iront siéger pour les
États-générauxi. Ce même jour est publié une Pétition des Femmes du Tiers-état au Roi (sans signataire et le même texte est aussi à la date du 10 janvier aux sein des archives du Calvados) :
« Sire,
Dans un temps où les différents Ordres de l'Etat sont occupés de leurs
intérêts, où chacun cherche à faire valoir ses titres et ses droits ;
où les uns se tourmentent pour rappeler les siècles de la servitude et
de l'anarchie ; où les autres s'efforcent de secouer les derniers
chainons qui les attachent encore à un impérieux reste de féodalité,
les femmes, objets continuels de l'admiration et du mépris des hommes ;
les femmes, dans cette commune agitation, ne pourraient-elles pas aussi
faire entendre leur voix ? »
Source : Gallica-BnF, page 3, 8 feuillets
2 janvier : Publication du Résultat du Conseil d'État du Roi tenu
à Versailles et du Rapport
de M. Necker, ce dernier pose les
principes de la convocation aux États-généraux avec le doublement des
élus du Tiers-état. Louis XVI reçoit les remerciements des six corps de
la ville de Paris pour l'édit du 27 décembre 1788. A Paris ont lieu des
manifestations joyeuses et
des illuminations se déroulent pendant deux jours.
3 janvier : Un arrêt du Conseil du roi suspend les États de Bretagne
durant un mois. Ils étaient ouverts depuis le 30 décembre dernier. Mais
ils ne sont pas acceptés par le Tiers, tant que ses doléances ne seront
pas prises en compte. De son côté, la petite noblesse locale manifeste
et fait entendre ses désaccords avec les grands féodaux.
4 janvier : Charles Maurice de Talleyrand devient évêque d’Autin, et
sera élu au titre du clergé pour les États-généraux (acronyme : E.G.).
A
lui seul,
il traverse nombres d’épisodes des années à venir. Par la
circonstance des dates, il s’agit d’une des grandes figures historiques
et une des intelligences les plus marquantes de son temps. Il
réchappera à tous les régimes allant se succéder. Où il trouvera
presque
toujours sa place, hors un petit exil londonien nécessaire en 1792,
puis aux États-Unis avant de revenir sur le devant de la scène. Son
admirable adaptabilité aux circonstances, sa connaissance des affaires
du pays et de ses secrets d’états, il a été ce que l’on nomme un grand
serviteur de l’État. Il sera une figure du changement dans la
continuité…
5 janvier : Les États de Bretagne sont suspendus jusqu'au 3 février. A Caen, une émeute éclate en raison de l’arrêt du partage
en ce début d’année du « gâteau des rois » aux pauvres. La Normandie
comme le Nord de la France sont les régions les plus prospères du
royaume, tout comme sa démographie.
6 janvier : Les États de Franche-Comté protestent contre la
volonté de doubler le nombre de députés du Tiers aux E.G.
7 janvier : La suspension des États de Bretagne déclenche une
vague de protestation de la noblesse.
8 janvier : Le Tiers-état de
Bretagne se retire à son tour. A Calais, la circulation maritime est arrêtée par le
gel. A Nantes 500 à 600 personnes envahissent la mairie à cause de la
disette, ils dénoncent l'accaparement des grains. La maison du boulager incriminé
est saccagé et l'échevin qui avait accompagné la foule est molesté.
Plus tard, même scène, mais cette fois ce sont 2.000 personnes qui font
irruption dans les locaux municipaux, finalement la municipalité
abaisse le prix du blé. (Source : OpenEdition, Annales hist. de la Rév. fr., Les ouvriers dans les manifestations révolutionnaires à Nantes en 1789-1791, Samuel Guicheteau)
9 janvier : A Paris, le curé de Saint-André-des-Arts suggère une taxe
sur les spectacles et d’augmenter les ateliers de charité : un
système de l’ancien régime qui permettait de donner du travail aux
pauvres et par ailleurs de combattre la mendicité. A l'hôtel-de-ville,
en raison des aumônes collectées se tient une assemblée de charité pour
distribuer une somme de 50.000 livres à partager entre les paroisses de
la ville.
|
10 janvier : Premières élections présidentielles outre-Atlantique, le
processus engagé depuis le 15 janvier 1788 de désignation des grands
électeurs est clos, jusqu’à la désignation en février de George
Washington (ci-contre). Il sera élu deux fois et Adam Smith sera son
vice-président
et le deuxième président de la République fédérale des États-Unis. A
Paris,
l’ambassadeur est Thomas Jefferson depuis 1785. Ce dernier sera présent
jusqu’en novembre et proche du franco-étasunien, Gilbert de Lafayette.
Jefferson sera lui aussi président, le troisième en titre en
1801. L’influence de cette nouvelle République, de 3 millions de
personnes est à la fois réelle et relative, une expérience pour de
nombreux Français qui ont combattu ou soutenu les idées pour
l’indépendance
de cette toute jeune nation aux vastes étendues et voisine de la
Louisiane. Notamment chez les "Girondins", comme Jacques-Pierre
Brissot de « Ouarville » qui usa d’un hameau de la région de la Beauce à consonance
anglo-saxonne pour sa particule, qui devint de Warville. |
|

|
11 janvier : Arrêt du Conseil d'État du Roi, celui-ci favorise des primes à
l'importation des blés et des farines, néanmoins la pénurie perdure et
les convois de grain circulent peu ou pas. Chaque Province puise dans
ses réserves, le commerce et la circulation des marchandises est à mal.
A Caen, le curé d'une paroisse distribue chaque jour de la soupe aux plus pauvres.
12 janvier : Forte agitation, à Besançon, où s'opposent le Parlement
et une partie de la noblesse favorable au Tiers. La population menace
de s’en prendre au Palais. A Montauban la municipalité embauche des
chômeurs pour l’entretien des rues. A Paris, l'on dresse un
procès-verbal d'arrestation au sieur Pierre Lemoine, débardeur, qui, en
état d'ivresse a insulté les commis de la Ferme à la barrière Sainte-Anne. (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Rév. fr., page 271, tome 3)
Du 13 au 18 janvier : Début du dégel, à Londres le cours de la Tamise
déborde et draine énormément d’eau. Le lendemain, même scénario sur le
Rhône, à Lyon, la Seine à Paris et pour la Loire à Tours et
Orléans, le dimanche du 18, l'on recense des inondations ou flots
importants. Dans Paris, le prêtre de Sainte-Marguerite donne
plusieurs milliers de
repas aux indigents.
20 janvier : Le Conseil d'État du roi prend
un
arrêt concernant les États de Bretagne, en la présence de ce
dernier, pour que cesse les troubles et que l'ordre revienne. (Source : Persée.fr)
21 janvier : Décès du fortuné baron Paul Thiry d'Holbach, ancien ami de Diderot, philosophe matérialiste et athéiste
dans son hôtel parisien de la
rue Royale-Saint-Rocheures. D'Holbach n'a jamais publié sous son nom de
son vivant, mais sous des pseudonymes (exemple Mirabaud). En Provence se tient
l’assemblée générale de la
noblesse, il est demandé à ses élus de voter par ordre (au
lieu du vote par tête plus favorable au Tiers). Le comte de Mirabeau est présent à
cette réunion, le même jour se produisent des troubles à Aix (la
sénéchaussée où il se fera désigner
en tant qu’élu du Tiers et non comme aristocrate).
23 janvier : Une des premières secousses de la Révolution se déroulent en
Bretagne. La Bretagne,
comme d’autres régions disposent de sa propre organisation, celle-ci
est féodale sur tout son territoire et ce n’est qu’un exemple dans le
puzzle administratif du pays et de ses relations avec des régions comme
l’Alsace protestante, ou tout simplement pour un habitant du Dauphiné
de ne pouvoir se rendre en Ile de France sans « passe-port » et à des
périodes autorisées. Un autre exemple, les Savoyards sont des étrangers
et soumis à des règles précises.
24
janvier : Lettres de convocation du roi Louis XVI pour les élections
aux États-généraux avec divers règlements, il est stipulé à l'article
premier : « Les
letttres de convocations seront envoyées aux Gouverneurs des
différentes provinces du Royaume, pour les faire parvenir, dans
l'étendue de leurs gouvernements, aux Baillis et Sénéchaussées à qui
elles seront adressées, ou à leurs Lieutenants. » Publication du règlement électoral, le nombre des élus du Tiers-état est
doublé. L’assemblée des trois ordres sera composée de 1.200 élus. Ce
seront les derniers E.G. qui se tiendront à Versailles.
25 janvier : Lancement des E.G de Provence à Aix-en-Provence. Le Tiers
dit non aux débats pour faire entendre ses propres revendications. Résultat des séances des États de Bretagne, convoqués à Rennes ; suivi de la réponse du roi aux députés du Parlement de Bretagne. (Source : Gallica-Bnf, 62 pages)
26 janvier : A Rennes, se déroulent des manifestation des petits métiers ou artisans,
contre la cherté du pain. Ce qui a pour but de pousser la municipalité à baisser le prix
du blé, et grâce à des rassemblements devant le Parlement de Bretagne, les habitants trouvent le soutien de la noblesse locale.
27 janvier : A Rennes, des heurts violents se produisent au
Champ-Montmorin, après la journée organisée par la noblesse : 4 morts
et plus de 30 blessés, cette fois entre aristocrates en armes et
étudiants, venus en nombre. Il en ressort deux tués chez les nobles,
dont un ami d’enfance de Chateaubriand, celui-ci ayant participé aux
heurts et donne récit à un affrontement social avec des jeunes
bourgeois. (cf. à Mémoires d’outre-tombe, Livre V) Cette opposition sociale
grandissante prédominera tout le processus révolutionnaire. De son
côté, la ville-état de Genève fait face à des émeutes sanglantes,
causées par le prix du pain. A Paris, un Cahier de doléances de la
colonie de Saint-Domingue est présenté au roi. Les colons ou "grand
blancs" y exposent leurs revendications autonomistes, et un plan pour
la formation d'assemblées coloniales, provinciales et des comités
permanents, aussi bien dans la colonie, qu'à Paris. Des assemblées
provinciales que les colons imposeront à Saint-Domingue.
28 janvier au 31 janvier : Plus de 2.000 jeunes Nantais se réunissent,
pour aller secourir leurs « frères » de Rennes. Le parlement de
Bretagne veut confier l’enquête sur l’émeute au Parlement de Bordeaux :
colère des avocats, deux membres délégués partent pour Versailles. Le lendemain,
les Nantais s’en vont pour Rennes menés par le graveur François Omnès
et rassemblent d’autres citoyens sur la route. Deux jours après, les
jeunes de Nantes, de Caen et d'Angers parviennent à Rennes. En
réaction, des troupes sont envoyées pour le maintien de l'ordre. A Aix
et en Languedoc, des troubles éclatent, la population se révolte et
elle caillasse un archevêque dans la cité provençale.
Précisions sur janvier : de nombreuses brochures
paraissent, les auteurs :
l’Abbé Sieyès, Honoré-Gabriel de Mirabeau, dit le fils, Camille Desmoulins, Maximilien de
Robespierre, etc… L’hiver a été rude et les prix du blé ont augmenté
fortement durant le mois de janvier, et ils représentent la dépense première
ou principale des foyers modestes. Si les raisons économiques pèsent
pour beaucoup, les raisins de la colère sont aussi liés entre autres à l’absence de
travail et des lois très contraignantes en matière de liberté publique.
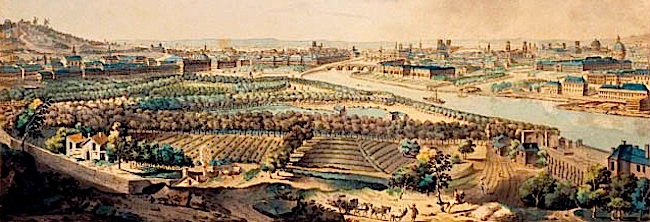
Paris vue des hauteurs de Chaillot au XVIIIe siècle
II - Le mois de février 1789
Dimanche 1er février : A Romans, M. Mounier est
accusé de trahison par le Tiers-état du Dauphiné.
2 février : Mort de M. Louis d'Ormesson, premier président du Parlement
de Paris, il est remplacé par M. Bachaud de Sarron. Il est confirmé que
la Société de la charité maternelle est sous la protection de la reine.
3 février : A Paris, est représenté pour la première fois Le Père Duchesne, ou la Mauvaise Habitude,
comédie en deux actes et en prose sur le théâtre des Grands-Danseurs du
Roi (boulevard du Temple). Nicolas de Condorcet, devenu président de
la Société des amis des Noirs, envoie une Adresse au corps électoral contre l’esclavage des Noirs à tous les bailliages de France :
« La Société des Amis des Noirs
ose donc espérer que la nation regardera la traite et l’esclavage des
noirs comme un des maux dont elle doit décider et préparer la
destruction ; et elle croit pouvoir s’adresser avec confiance aux
citoyens assemblés pour choisir leurs représentants, et leur dénoncer
ces crimes de la force, autorisés par les lois et protégés par les
préjugés. Nous savons qu’il est des injustices qu’un jour ne peut
réparer, qui, liées avec l’intérêt politique ou paraissant l’être, ne
peuvent être détruites qu’avec les précautions nécessaires pour assurer
le bien, et ne point le faire trop acheter ; aussi nous ne vous
demandons point de voter la destruction actuelle de ces maux.
Nous vous conjurons seulement
aujourd’hui de tourner vos regards sur les souffrances de quatre cent
mille hommes, livrés à l’esclavage par la trahison ou la violence,
condamnés, avec leur famille, à des travaux sans espérance comme sans
relâche, exposés à la rigueur arbitraire de leurs maîtres, privés de
tous les droits de la nature et de la société, et réduits à la
condition des animaux domestiques, puisqu’ils n’ont, comme eux, que
l’intérêt pour garant de leur vie et de leur bonheur. (...)
On nous accuse d’être les ennemis des
colons, nous le sommes seulement de l’injustice ; nous ne prétendons
point qu’on attaque leur propriété : mais nous disons qu’un homme ne
peut, à aucun titre, devenir la propriété d’un autre homme ; nous ne
voulons pas détruire leurs richesses, nous voudrions seulement en
épurer la source, et les rendre innocentes et légitimes. Enfin, la voix
que nous élevons aujourd’hui est, en faveur des noirs, aussi celle de
plusieurs d’entre eux qui ont été assez généreux pour s’associer à nos
travaux, et pour concourir à nos vues. »
Source : Wikisource
4 février : Publication des Lettres de Louis XVI pour la convocation
des
États-généraux (datées du 24 janvier) et du Règlement fait par le roi
pour l'exécution des lettres de convocation, fixant le mode d'élection
et les circonscriptions. A Rennes, la diète des jeunes de Bretagne vote
un pacte d’union et de secours mutuel contre la noblesse. Aux États-Unis, Georges Washington est désigné par le collège électoral des grands
électeurs de 10 états sur 13. G. Washington devient le 1er président en
titre. Son premier mandat débutera le 30 avril prochain.
5 février : Aux États de Bretagne, le Tiers refuse de voter l’impôt. Le comte Mirabeau s'adresse :
|
A LA NOBLESSE DE PROVENCE (1)

Portrait de Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749-1791)
«
Qu'ai-je donc fait de si coupable? J'ai désiré que mon ordre fût assez
habile pour donner aujourd'hui ce qui lui sera infailliblement arraché
demain ; j'ai désiré qu'il s'assurât le mérite et la gloire de
provoquer l'Assemblée des trois ordres, que toute la Provence demande à
l'envi... Voilà le crime de l'ennemi de la paix! ou plutôt j'ai cru que
le peuple pouvait avoir raison. Ah! sans doute, un patricien souillé
d'une telle pensée mérite des supplices! Mais je suis bien plus
coupable qu'on ne suppose : car je crois que le peuple qui se plaint a
toujours raison ; que son infatigable patience attend constamment les
derniers excès de l'oppression pour se résoudre à la résistance ; qu'il
ne résiste jamais assez longtemps pour obtenir la réparation de tous
ses griefs ; qu'il ignore trop que, pour se rendre formidable à ses
ennemis, il lui suffirait de rester immobile, et que le plus innocent
comme le plus invincible de tous les pouvoirs est celui de se refuser
ainsi. Je pense ainsi ; punissez l'ennemi de la paix!
Mais vous,
ministres d'un Dieu de paix, qui, institués pour bénir, et non pour
maudire, avez lancé sur moi l'anathème, sans daigner même essayer de me
ramener à d'autres maximes!
Et vous, amis de la
paix, qui dénoncez au peuple, avec la véhémence de la haine, le seul
défenseur qu'il ait trouvé hors de son sein ; qui, pour cimenter la
concorde, remplissez la capitale et la province de placards (affiches)
propres à armer le peuple des campagnes contre celui des villes ; qui,
pour préparer les voies de conciliation, protestez contre le règlement
provisoire de convocation des Etats généraux, parce qu'il donne au
peuple un nombre de députés égal à ceux des deux autres ordres réunis,
et contre tout ce que fera l'Assemblée nationale, si ses décrets
n'assurent pas le triomphe de vos prétentions, l'éternité de vos
privilèges!
Généreux amis de la
paix, j'interpelle ici votre honneur, et je vous somme de déclarer
quelles expressions de mon discours ont attenté au respect dû à
l'autorité royale ou aux droits de la nation? Nobles Provençaux,
l'Europe est attentive, pesez votre réponse! Hommes de Dieu, prenez
garde, Dieu vous écoute!
Que si vous gardez
le silence, si vous vous renfermez dans les vagues déclamations que
vous avez lancées contre moi, souffrez que j'ajoute un mot :
Dans
tous les pays, dans tous les âges, les aristocrates ont implacablement
poursuivi les amis du peuple ; et si, par je ne sais quelle combinaison
de la fortune, il s'en est élevé quelqu'un dans leur sein, c'est
celui-là surtout qu'ils ont frappé, avides qu'ils étaient d'inspirer la
terreur par le choix de la victime. Ainsi périt le dernier des Gracques
de la main des patriciens ; mais, atteint du coup mortel, il lança de
la poussière vers le ciel et de cette poussière naquit Marins, —
Marins, moins grand pour avoir exterminé les Cimbres (peuplade d'Europe
du Nord) que pour avoir abattu dans Rome l'aristocratie de la noblesse!
Mais vous,
communes, écoutez celui qui porte vos applaudissements dans son cœur,
sans en être séduit. L'homme n'est fort que par l'union, il n'est
heureux que par la paix. Soyez fermes, et non pas opiniâtres ;
courageux, et non pas tumultueux ; libres, mais non pas indisciplinés ;
sensibles, mais non pas enthousiastes. Ne vous arrêtez qu'aux
difficultés importantes et soyez alors entièrement inflexibles ; mais
dédaignez les contentions de l'amour-propre, et ne mettez jamais en
balance un homme et la patrie. Surtout hâtez autant qu'il est en vous
l'époque de ces États généraux qu'on vous accuse d'autant plus âprement
de reculer qu'on en redoute davantage les résultats ; de ces Etats
généraux où tant de prétentions seront déjouées, tant de droits
rétablis, tant de maux réparés ; de ces Etats généraux enfin où le
monarque lui-même désire que la France se régénère.
Pour moi, qui dans
ma carrière publique n'ai jamais craint que d'avoir tort, moi qui,
enveloppé de ma conscience et armé de principes, braverais l'univers,
soit que mes travaux et ma voix vous soutiennent dans l'Assemblée
nationale, soit que mes vœux seuls vous y accompagnent, — non, de
vaines clameurs, des protestations injurieuses, des menaces ardentes,
toutes les convulsions, en un mot, des préjugés expirants, ne m'en
imposeront pas ! Et comment s'arrêterait-il aujourd'hui dans sa course
civique, celui qui, le premier d'entre les Français, a professé
hautement ses opinions sur les affaires nationales, dans un temps où
les circonstances étaient bien moins urgentes, et la tâche bien plus
périlleuse? Non, les avantages ne lasseront pas ma constance. J'ai été,
je suis, je serai jusqu'au tombeau l'homme de la Constitution. Malheur
aux ordres privilégiés!
Si c'est là être plutôt l'homme du peuple que celui des ordres
privilégiés, je suis l'homme du peuple, car les privilèges finiront,
mais le peuple est éternel... »
Note :
1.
Mirabeau répond aux attaques de la noblesse qui lui reprochait
amèrement ses discours en faveur des revendications populaires et
l'appelait l'ennemi de la paix.
Source : Gallica-BnF, Joseph Reinach, L'Éloquence française depuis la Révolution
jusqu'à nos jours, pages 1 à 4 - Editeur Delagrave (Paris,1894)
|
6 février : A Genève, le Conseil des Deux-Cents adopte les articles
proposés par le peuple : rappel des exilés, renvoi des régiments
étrangers.
7 février : A Versailles, l'ordre est conféré par le roi pour la
rédaction des cahiers de
doléances. Pour
les élus du Tiers, la circonscription « fiscale » est représentée
par la sénéchaussée ou le baillage. La rédaction des cahiers de doléances s'est déroulée à l’échelle des paroisses au sein
de
139 évêchés à l’échelle du pays. Si il a été retrouvé des demandes
assez
souvent communes de la part des citoyens, c’est aussi en raison de
modèles qui ont pu circuler. Un village était à peu près l'égal d'une
paroisse, il en
ressortit plus de 40.000 communes participantes. Une paroisse dans Paris représentait l’équivalent d’un quartier ou plus avant 1789 (voir le plan Juinié). Les votes s'organiseront au sein de 60 districts, puis 48 districts ou sections Parisiennes au sein de ce qui sera en 1790 le département de la Seine ou de Paris. Le Parlement
de Paris entend les frères Leleu, minotiers (marchands de farine) à
Corbeil, accusés d’augmenter le prix des grains par les boulangers de
Paris.
8 février : La noblesse de Provence exclue le comte Honoré de Mirabeau, qui ne possède pas
de fief.
9 février : Martinique, il est voté une Adresse au Roi : « L'Assemblée
Coloniale de la Martinique, informée de la faveur que vous venez de
faire à votre royaume, en lui accordant des États-généraux, supplie
bien humblement votre Majesté de la faire participer à ce bienfait. » et demande ainsi à avoir des députés aux E.G. (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 92) A Paris, il est lu à l'Assemblée de la Société des Amis des Noirs, le Mémoire sur les noirs de l'Amérique Septentrionale
de J.P. Brissot de Warville. Depuis Londres est publié par l'ancien
Contrôleur général des finances, Charles Alexandre de Calonne
(1783-1787) une Letttre adressée au roi. (Sources : Gallica - Bnf)
10 février : Le Parlement de Paris condamne l'Histoire secrète de la
Cour de Berlin de Mirabeau, fils et comte, à ne pas confondre avec son frère ou père. Tous les trois seront membres de l'Assemblée nationale.
11 février : Le comte de Mirabeau fait publier À la Nation Provençale. « Ai-je
le droit de voter parmi les Possédants-fiefs de Provence? A-t-on celui
de m'en exclure? Cette question en elle-même est bien frivole, et, si
j'ose le dire, peu digne de m'occuper. Ce n'est point la qualité de
Possédant-fief qui me donne le droit d'être utile à mon pays.
Provençal, homme, citoyen tels sont mes titres, je n'en réclame point
d'autres. » (Source : disponible sur Google-livres, 53 pages)
12 février : Lettre de M. Bergasse sur les États-généraux,
celui-ci est négociant et futur député à la Constituante, et c'est un
"monarchien" proche de M. Mounier. Le sieur Nicolas Bergasse
abandonnera ses fonctions en septembre (Source : consultable sur Google livres).
13 février : Le président du parlement de Grenoble signale à Jacques Necker que
les paysans refusent de payer les rentes seigneuriales depuis le début
du mois de février. Au Parlement (de Paris) réquisitoire de l'avocat général Séguier contre
les écrits du Tiers-état de Bretagne (La Sentinelle du peuple
de
Volney) et d'autres brochures. En Haute Normandie, de ce jour au 12
juillet l'on dénombrera 23 révoltes. Et l'on remarque ce mois-ci sur
les routes des personnes très amaigries, affamées et transies de froid.
14 février : Début de l'envoi des lettres de convocation pour les pays
d'État (jusqu'au 19 mars). A Rennes le Tiers vote l’impôt à la demande
de MM. Villedeuil et Necker.
15 février : Dans le baillage de Tinchebray en Normandie les E.G. sont
annoncés dans les villages par le Lieutenant-général via la promugation
d'une ordonnance.
16 février : Les villageois de Saint-Veran dénoncent la politique
d’union du Tiers et de la noblesse aux États du Dauphiné.
17 février : Dans le Journal de Provence du jour, l'on découvre un article sur les Centenaires :
« Marie-Marguerite
le Preux, veuve du sieur le Prince, peintre à Rouen, y est morte le 18
Janvier, âgée de cent deux ans, deux mois et dix-huit jours. Elle
n’avait cessé d’aller tous les jours à la messe, que depuis qu’un rhume
négligé, qui s’est enfin tourné en fluxion de poitrine, l’en empêchait.
On ne lui connut en sa vie qu'une maladie grave dont elle guérit en peu
de temps, quoiqu’elle eût déjà quatre-vingt-deux ans. Vive, active et
laborieuse, elle a toujours vaqué, elle-même, aux soins de fa maison ;
et, l’année dernier encorde, par amour pour les pauvres, elle entreprit
la tâche pénible de faire en leur faveur, dans l’église de St-Maclou,
sa paroisse, une quête, ou son éminence Monseigneur le Cardinal de la
Rochefoucault se fit un plaisir de la conduire. Madame le Prince aimait
tellement le café, qu’elle en prenait non-seulement le matin, et après
son dîner, mais encore en se couchant. Dans une assemblée tenue le mois
dernier dans le comté de Haddinton en Angleterre, pour voter des
adresses de remerciement à M. Pitt, celui que le vœu général appelait à
la présider était âgé de 106 ans. »
18 février : L'on
apprend le décès Me Anne Sophie Gourgaud, dite Mademoiselle Dugazon,
actrice et sociétaire du théâtre Français.
19 février : Le chevalier James Rutledge, journaliste, auteur et pamphlétaire français d'origine irlandaise, a présenté au Roi, ce jour, un Mémoire pour la communauté des maîtres boulangers de la ville et faubourgs de Paris de 16 pages.
20 février : A Paris est représentée pour la première fois une
comédie en 5 actes et et en vers de M. Collin d'Harleville au théâtre
Français (Comédie française), et sera joué à Versailles, devant les
époux royaux, le 26 mars suivant.
21 février : A Paris, l’abbé Jean-Félix Duperey est roué en place de Grève
(aujourd'hui place de l’hôtel-de-ville) pour assassinat. A la demande de
l’archevêque de Paris, le Parlement autorise la consommation d’œufs
pendant le carême. Coup d'état royal en Suède, il est procédé à l'arrestation de sénateurs
et de membres de l'ordre équestre.
22 février : Depuis Paris, M. Florimond de Mercy-Argenteau, ministre
(ou ambassadeur) pour l'Autriche en France écrit au prince Antoine de
Kaunitz, diplomate autrichien et lui relate que M. Guignard de Saint-Priest lui « a bien recommandé de rendre témoignage de ses sentiments de reconnaissance et d'attachement aux principes de l'alliance (avec le royaume français).
La composition actuelle du Conseil de Versailles lui donne de grandes
facilités à y faire valoir ses opinions. J'ai surmonté les préjugés de
la Reine contre ce nouveau ministre. Elle le traite maintenant très
bien ; si M. de Montmorin était déplacé, il est plus que probable que
M. de Saint- Priest lui succéderait, et ce serait à tous égards le
choix qui nous conviendrait le mieux ; mais il n'y a encore rien qui
puisse indiquer l'époque d'un pareil changement ; en attendant, je
crois être en assez bonne mesure vis-à-vis du ministre actuel, et je
tâcherai de me ménager le même avantage auprès de celui qui, un jour ou
l'autre, pourrait lui succéder. » (Source
: Google-livres, Correspondance secrète du comte Mercy-Argenteau avec
l'empereur Joseph II et le Prince de Kaunitz, page 225, Paris 1891)
 illustration de la promenade du Boeuf Gras
illustration de la promenade du Boeuf Gras
22, 23 et 24 février : Ce sont les 3 jours
dit gras, dont le mardi gras, ce qui donne lieu à Paris à de grandes
mascarades, ce sont des journées festives et de carnaval, avec des
manifestations comme le boeuf gras, une tradition héritée du Moyen Âge :
« Les
masques ont été nombreux l'on a vu par centaines des Pierrots, des
polichinelles, des arlequins, des turcs. Les jours gras durent trois
jours et, soit que les pauvres gens aient voulu oublier, soit que la
gaité soldée ait fini par les gagner aussi jamais la population n'avait
paru aussi joyeuse, parcourant les rues du Pont Neuf à la Bastille en
passant par les rues Saint Honoré et Saint Antoine. Le bal masqué de
l'Opéra a été très brillant et les bacchantes, les sorciers, les
pêcheuses en courte robes de satin étaient tellement nombreuses qu’on
n'a pu danser, mais on a beaucoup ri, on s'est beaucoup pressé et on a
soupé très tard dans tous les restaurants demeurés ouverts. Le bœuf
gras a été promené à travers Paris portant un enfant déguisé en amour.
Le cortège des boucliers déguisés en romains de fantaisie est allé
suivant l'usage rendre visite au Parlement et comme les magistrats se
faisaient attendre, un farceur de la basoche se met à dire : - Puisque
le Parlement ne vient pas au bœuf c’est le bœuf qui ira au Parlement.
Et on pique la bête qui gravit lentement le grand escalier du Palais de
Justice au milieu des rires et des applaudissements de la foule. Un
président de Chambre arrive enfin, il remplace le Premier Président
malade, reçoit l'hommage des boucher et le bœuf redescend l'escalier,
puis le cortège continue sa promenade. »
Source : Gallica-Bnf, Le Peuple, Le carnaval de 1789, page de une, 1911
25 février : Mercredi dit des Cendres, dans tout le royaume débute le Carême (fait de jeûnes et pénitences chez les catholiques) pour 40 jours ou jusqu'à Pâques. Un arrêt du conseil du roi interdit les délibérations hors
des assemblées paroissiales ou des corps de métiers. A Granville, les
rentiers du Tiers désignent leurs délégués aux assemblées secondaires.
26 février : Chaque semaine depuis le 17 février 1788 se rassemble la Société des Amis des Noirs, ce même jour sous la présidence de M. de Condorcet. "L'anti Sade", Nicolas Rétif de la Bretonne publie Le Plus fort des pamphlets : l'ordre des paysans aux États-généraux. (Source : Gallica-Bnf, 80 pages)
27 février : Le Parlement de Paris déclare et prend
pour arrêté que, sans vouloir arrêter le zèle des magistrats qui se
rendent aux assemblées des bailliages, il importe que le cours de la
justice ne soit interrompu dans aucun des bureaux de la cour.
28 février : Se tiennent les élections à Lyon des 36 électeurs des maîtres marchands et
ouvriers en étoffes précieuses. Les 36 sont des ouvriers.
Note sur Février :
Rédaction des cahiers de
doléances, soit environ
60.000 manuscrits ont été rédigés dans le royaume. Il pouvait aussi
s’agir de groupes « corporatifs » ou sociaux. L’on retrouve par exemple
les cahiers des comédiens du théâtre Français (la Comédie
française), les Dames de la Halle, etc. Les archives
départementales permettent de découvrir en ligne le contenu de ces
manuscrits, ou sur le site de la Bibliothèque nationale de France (B.n.F), ou des Archives nationales. Il
est important de noter que le roi n’a jamais été remis en cause, mais ses
pouvoirs devaient être limités, est ce qui représenta la préoccupation générale.
L’objet n’était pas dans l’esprit des rédacteurs pour un renversement de
la royauté, tout se fit au cri assez unanime de « Vive le roi! » tout
au long de l’année et plus encore. Il en allait d’unifier un corps légal
très éclaté, de faire nation commune, là chaque ensemble social redonna
souffle et voix à un pays qui ne pouvait se résumer à Paris.
| Dans la perspective des États-généraux,
Guillaume de
Lamoignon de Malesherbes (1721-1794, en portrait ci-contre). Il sera un
des futurs avocats de Louis XVI. Il vient de rédiger un manuscrit
sur la
liberté de la presse (par un ministre d'État), en six questions. Il est considéré comme l'ami des philosophes et a subi sous Louis XV un
exil à résidence suite à une lettre de cachet. Malesherbes préconisait
que seule la justice puisse décider en cas de litiges, comme la
diffamation (les libelles), « à l'exemple de l'Angleterre et d'autres pays ! (...) La
Nature ne produit pas souvent des Montesquieu et des J.J. Rousseau, et
il est rare que des familles opprimées aient, comme celle des Calas, le
bonheur de trouver un Voltaire pour défenseur. » (source Gallica-Bnf - manuscrit original de février 1789) |
|
 |
III - Le mois de mars 1789
En ce début de mois, les assemblées électorales des bailliages et
des sénéchaussées commencent à se réunir, et les cahiers de
doléances sont rédigés.
Dimanche 1er mars : Dans le Dauphiné, les
habitants de Saint-Vallier
(Drôme), souhaitent que les pauvres exclus des élections puissent tenir
un cahier séparé.
2 mars : L'on publie un règlement fait par le roi,
pour fixer le nombre de députés, que la sénéchaussée d'Angoumois doit
envoyer aux prochains États-généraux. Et il en sera ainsi pour
toutes les régions au sein des bailliages, sénéchaussées et généralités du royaume. (Source : Archive.org, 2 pages)
3 mars : A Londres, à la chambre haute a été
abordée la question de la santé du roi George III et l'examen, le 20 et
21/02, d'un bill de régence, finalement le chancelier de l'échiquier de
la couronne, M. William Pitt dit le jeune a déclaré : « J'ai
la vive satisfaction d'annoncer à la Chambre que l'état de la santé du
Roi s'est tellement amélioré, qu'il reste peu de doute sur son prochain
rétablissement, et qu'il y a lieu de se flatter que, sous très-peu
de temps, Sa Majesté pourra reprendre elle-même l'exercice du pouvoir
exécutif. Je félicite la Chambre sur la probabilité de ce grand
événement, et je suis convaincu que tous les nobles Lords qui
m'entendent participent de l' événement à la satisfaction générale, à
la satisfaction générale, et éprouvent envers le ciel les mêmes
sentiments de reconnaissance qui m'animent en cet instant. La motion de
l'ajournement a été accueillie unanimement. » (Source : Retronews-Bnf, La Gazette du jour)
4 mars : Aux États-Unis, se réunit pour la première fois le Congrès à New York (la capitale).
5 mars : C'est le retour triomphal du comte de Mirabeau à Aix, sa terre future
d’élection...
6 mars : Le Parlement de Paris prohibe la diffusion des
publications sur les événements en Bretagne.
Samedi 7 mars : Le Mercure de France à l'origine le Mercure Galant
est un hebdomadaire, il est composé d'environ une centaine de pages et
vendu par abonnement. Si l'on peut le définir, c'est un journal
généraliste, où l'on découvre sa table des matières en deuxième page. L'on retrouve comme rédacteur, M. Jacques Mallet du Pan, connu pour ses positions contre-révolutionnaires. Ce fut l'un des plus vieux périodiques français et d'une longévité exceptionnelle (de 1672 son premier numéro, il perdura jusqu'en
1965), et,
il a été la propriété de l'éditeur ou patron de presse, M.
Charles-Joseph Panckoucke pendant la Révolution. Dans le numéro du
jour, ce dernier fait part du trentième tirage de l'Encyclopédie et sa mise en vente, avec ce qui a pu changer depuis 1782 et la première édition. (Source : Retronews-Bnf, page 28)
8 mars : A Vrigny en région normande, et comme dans de
très nombreuses communes ou paroisses, la rédaction des cahiers
de doléances est en œuvre un peu partout dans le royaume et il faut
prendre en considération les situations locales, comme la colère des
habitants contre le seigneur local, le marquis de Vrigny : « A
propos de landes et bruyères que le seigneur voulait faire enclore, à
propos de l'étang, dont il ne laissait pas écouler les eaux nécessaires
aux moulins d'aval, il y avait eu d'autres démêlés irritants. Il est demandé la protection au Roi
« contre le seigneur Marquis de Vrigny qui, depuis environ vingt-cinq
années qu'il a succédé au père le plus respectable et le plus
populaire, ne cesse d'opprimer et persécuter les malheureux paroissiens
dont il aurait dû se montrer l'appui et le soutien. » (Source Gallica-Bnf, Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome XXXIII, page 133)
9 mars : République de Venise, Ludovico Manin devient
Doge. Il sera le dernier doge de la république vénitienne, qui cessera
de même, et son dignitaire Manin abdiquera à l'arrivée des troupes de
Bonaparte en 1797.
10 mars : En région normande, est rédigé le Cahier Général des plaintes, doléances, remontrances, Moyen et Avis des communes du bailliage secondaire de Nonencourt et d'Ezy, découvrir le manuscrit original et intégral en ligne. (Source : Archives départementales de l'Eure)
11 et 12 mars : A Reims (Champagne), la faim pousse les ouvriers du
textile à piller les greniers à blé.
13 mars : La
noblesse de Toulouse rédige une protestation contre la constitution des États du Languedoc. Elle se plaint de la prépondérance attribuée aux
évêques par l'antique usage. Elle demande pour le clergé une
représentation plus équitable, pour la noblesse et le Tiers la
reconnaissance de leurs justes droits. « Car,
dit-elle, les droits du clergé et du Tiers entrent, comme les nôtres,
dans le plan de la restauration. Et pourquoi séparer notre cause de la
leur? » (...) A Versailles, on travaille activement aux
préparatifs de la salle des États. Sept semaines à peine nous séparent
de la date de convocation. Le roi va lui-même inspecter les travaux. On
sait que cette salle était située au palais même, dans la salle des Menus. Mais les États ne s'y tiennent que pour la séance solennelle
d'ouverture. A Paris, au théâtre de Monsieur, première représentation du Fabuliste, ouvrage bien accueilli, et où l'acteur principal, Chevalier, obtient tous les suffrages. « On joue en même temps la Serva padrona, de Pergolèse.
Cet opéra-bouffe plaît infiniment, bien que les amateurs regrettent
l'ancienne manière du maître, plus limpide et plus simple. On trouve à
sa musique nouvelle un abus de complications et même un excès dans les
mouvements dramatiques. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, du 13 mars 1889, n°1846, page de une)
14 mars : A Manosque en Provence, l’évêque est lapidé par la foule l’accusant d’accaparement.
A Lyon, dans l'église des Cordeliers se tient la réunion des trois
ordres pour désigner les huit députés, dont quatre pour le Tiers. Cinq
cent électeurs se réunissent de bonne heure sous la présidence de M.
Laurent Basset, lieutenant général de la sénéchaussée. M. Lemontey (avocat) a la charge de la rédaction du cahier des doléances. (Source : Google-livres, Jean Baptiste Monfalcon, Histoire de la ville de Lyon, Volume 2, page 875)
15 mars : La municipalité de Saint-Vallier (Drôme) organise une réunion
de protestation contre l’éventuelle indemnisation des biens des
possesseurs nobles. Il est créé une liaison maritime postale entre
Bordeaux et les États-Unis. A Saint-Domingue, François Raimond, et son
frère Julien demandent aux colons ou "grands blancs" de Saint-Domingue,
l'égalité citoyenne des "gens de couleur libres" et de disposer d'une représentation aux États-généraux. Ce qui leur sera refusé.
16 mars : L’archevêque d’Embrun demande, au nom du clergé et de la
noblesse, que l’élection des députés du Dauphiné soit annulée. Est
publié le règlement électoral pour la Bretagne. En Normandie, se
tiennent les élections aux États-généraux, 1.200 personnes se réunissent dans une
église de Caen pour discuter. L'idée est lancée de la création d'un journal Le Patriote François , il devait paraitre en avril. Seul un premier numéro depuis
Versailles sous la forme d'une lettre paraitra le 6 mai, et il faudra
attendre le 28 juillet pour que la parution devienne régulière ; son
rédacteur en chef est Jacques-Pierre Brissot. (Source : Gallica-Bnf)
17 mars : Dauphiné, le Parlement de Grenoble décide que les officiers
municipaux doivent aider à la circulation des grains.
|
18 mars : A Marseille, Mirabeau est fêté, l’on danse jusque devant chez
lui. A Caen, l’évêque de Bayeux (et son équipage) quitte l’assemblée du
clergé, le règlement électoral du 24 janvier lui semble pour le
haut clergé défavorable.
19 mars : En Picardie, François-Noël Babeuf, fonctionnaire, participe aux
E.G., il est l'auteur d'articles pour le bailliage de Roye. Il va
proposer : la fin des fiefs et du droit d'aînesse,
le rachat des censives, des limitations à l'autorité paternelle, la
création d'une éducation nationale, de nouvelles règles fiscales, etc.
20 mars : Honoré-Gabriel de Mirabeau est accompagné en musique jusqu’à Aix…
|
 |
21 mars : Un arrêt du Conseil d'État, est rendu « sur
la requête du sieur Toussaint Langlois, teinturier à Paris, pour être
déchargé des condamnations prononcées contre lui par un jugement du
Bureau des finances, du 14 mars, qui l'avait déclaré complice de la
fraude commise par le sieur Le Moine, marchand de vins, locataire de
caves dépendantes d'une maison appartenant au dit sieur Langlois, rue
de Château-Landon, près et hors la barrière du faubourg Saint-Martin,
lequel avait fait pratiquer une communication souterraine pour
introduire clandestinement des liquides. » (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la R.F., page 271, tome 3) En soirée, l'on joue Le Pessimiste ou l'Homme mécontent de tout. Une comédie en un acte et en vers de M. Pigault-Lebrun est représentée pour la première fois sur le théâtre du Palais-Royal. (Source : Gallica-Bnf, 33 pages)
23-24 mars : Agitation dans toute la Provence, à Marseille et à Toulon
éclatent de violentes émeutes de la faim et des pillages se produisent.
A Toulon, les femmes des ouvriers de l'Arsenal se soulèvent durant deux
jours avant d'obtenir satisfaction sur le prix du pain. Le 23, pendant
que les délégués du Tiers se réunissent à l'hôtel-de-Ville pour
désigner leurs députés et boucler les cahiers de doléances, la mairie
est envahie principalement par des femmes, épouses des ouvriers de
l'Arsenal, dont les salaires n'ont pas été payés depuis 2 mois, et se
plaignent de l'augmentation du pain. Cela ouvre à la mise en place d'une milice
bourgeoise.
25 mars : Les émeutes à Aix débouchent sur la création d’une garde ou
milice bourgeoise. Gilbert Du Mottier de La Fayette (qui deviendra selon ses vœux Lafayette) est élu député de la noblesse de Riom, avec 198 voix. (Source : Assemblée nationale, aller en haut de la page sur la droite et cliquer sur biographie)
26 mars : A Aups (Var), des paysans révoltés tuent un noble.
27 mars : Est élu député de la sénéchaussée de Saumur, Clément,
Balthazar Mesnard, curé-prieur d'Aubigné-sur-Layon, pour le clergé aux États-généraux de Versailles. Il prêtera le serment constitutionnel le
27 décembre 1790, et restera très effacé au sein de l'Assemblée
nationale.
28 mars : Il est publié le règlement pour les élections de Paris et de sa
prévôté. Disette et misère; les révoltes agraires éclatent un peu
partout, jusqu'en mai, et des troubles graves sont signalés dans de
nombreuses villes : Reims, Nancy, Besançon, Avignon, etc.
29 mars : « M. le
comte de Montmorin, ministre des affaires étrangères, présente à Sa
Majesté MM, le comte de Chatons et le marquis de Bombelles, qui
viennent la remercier de leur récente promotion au grade d'ambassadeur.
» (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, le 329 mars 1889, page de une, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF)
30 mars : « La noblesse du bailliage de Blois déclare que « le bonheur n'est pas réservé à un petit nombre d'hommes, mais qu'il appartient à tous » et rajoutent deux conditions : « Sûreté des personnes, sûreté des propriétés
». Et ils demandent la suppression de tous les impôts frappant la
personne, taille, corvée, capitation, et en demandent le remplacement
par un impôt unique en argent, frappant proportionnellement les revenus
de chacun. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, le 30 mars 1889, page de une, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF)
31 mars : « L'émeute
suit son cours à Besançon. La multitude se concentre au faubourg
Battant, elle passe le pont et continue les perquisitions chez les
magistrats soupçonnés d'accaparement. La maison du président Talbert
est mise à sac sans qu'on y trouve un grain de blé. Chez le conseiller
Bouclans, on trouve du blé en abondance, mais il provient de ses
terres. On en distribue une partie, on gaspille l'autre; car les
insurgés de la famine ont coutume de donner au ruisseau ou à la rivière
les vivres qu'ils dérobent. Le conseiller Bourgon s'est caché ; on met
le feu à sa maison il s'en échappe à grand-peine sous un déguisement.
Enfin, vers le soir, quand les pillages sont achevés, la troupe
parcourt la ville avec un effroyable vacarme de tambours et de
trompettes. Quant à la foule, elle assiste à cette promenade militaire
avec une joie qui se traduit par des acclamations enthousiastes au
débonnaire commandant militaire, M. de Langeron. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, le 31 mars 1889, page de une, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF)
N.B. : Des mois de mars à mai, éclatent des révoltes agraires en
Provence, en Cambrésis et en Picardie.
 Vue du château et de la ville de Versailles
Vue du château et de la ville de Versailles
IV - Le mois d’avril 1789
Mercredi 1er Avril : A Rennes, le Tiers-état
commence à élire ses députés et se méfie des anoblis. Le Chapelier est
exclu.
2
avril : Le comte de Mirabeau est élu par le Tiers-état d'Aix. L'ancien
contrôleur des finances de 1783 à 1787, Charles-Alexandre de Calonne
retourne en
Angleterre, après avoir essayé de se faire élire à Bailleul.
3 avril : A Paris, il est dressé un procès-verbal d'arrestation et il est mené un interrogatoire, par le commissaire Guyot, « du nommé Louis Lecourt, regrattier de fruits (vendeur au détail), trouvé porteur, par les commis des Fermes à la barrière de l'École Militaire, de cinq vessies remplies d'eau-de-vie, » et s'étant « blessé légèrement à coups de couteau ».
Rapport de M. de Maissemy, directeur général de la librairie (en
charge de la censure), à l'effet de réprimer les écarts des
journalistes qui se permettent dans leurs critiques des personnalités
blessantes, avec projet de circulaire journalistes et aux censeurs
royaux à ce sujet. (Sources : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la R.F., page 271, tome 3 et page 313, tome 1)
4 avril : Depuis l'Auvergne, le marquis Gilbert Du Mottier de La
Fayette part pour rejoindre Versailles et habiter l'hôtel
particulier de la famille de Noailles. Il lui faudra 7 jours pour
arriver à destination.
5 avril : En région bretonne, la commune et ville d'Antrain de la sénéchaussée de Fougères rédige son Cahier de doléances, fait des plaintes et remontrances « pour les États-généraux relativement à la province de Bretagne et à leur terrain, dont un autant sera remis à leurs députés.
Article 1 : Les
députés demanderont qu'à l'avenir les représentants du Tiers-état
soient aux États de la province de Bretagne comme aux États-généraux en
nombre égal à celui des deux ordres de l'Eglise et de la noblesse
réunis, lesquels choisiront respectivement leur représentant, et que
les voies soient comptées par tête et non par ordre. (...)
Article 4 : Que dorénavant tous les impôts qui concerneront la
province, et qui seront consentis par les trois ordres tels qu'ils
soient, tant réels que personnels seront supportés d'une manière égale
et proportionnelle par les trois ordres, et chaqu e genre d'imposition
sera porté sur un même rôle pour tous les ordres ; que la répartition
de chaque impôt sera faite par les généraux de paroisse seulement et
non par aucuns commissaires, les généraux des paroisses étant censés
mieux connaître les revenus et facultés de leurs habitants que des
commissaires étrangers. »
Source : Gallica-Bnf, 16 pages
6 avril : Depuis Londres est publié la Seconde lettre adressée au Roi
de l'ancien contrôleur des finances M. de Calonne, qui se termine par
ses propos à l'adresse du monarque et sur le futur à venir :
« Défendez- vous contre toute espèce d'engouement. Surtout respectez le Trône ; vous n'avez pas assez de caractère pour être Républicain ;
et le premier pas que vous feriez vers cette liberté sauvage, vous
enfoncerait dans la servitude : tâchez donc de ne pas courir après un
bien chimérique. La Royauté n'est pas toujours un vice dans un
Gouvernement, elle est au contraire un bienfait chez une Nation, dès
qu'elle a perdu ces idées primitives de simplicité et d'égalité
qu'avaient autrefois les Hommes, et qu'elle est incapable de les
reprendre. L'inégale distribution des rangs, des titres, des richesses,
des fortunes, des dignités, accréditées en France, nous défend d'y
penser comme en Suisse. Et si les Français cessaient d'avoir une Maison
privilégiée qui occupât la première place dans la Société, soyez
persuadés que l'État déchiré par les divisions, les haines, l'ambition,
la rivalité, les intrigues, et les factions de quelques Hommes
puissants, aurait bientôt plusieurs despotes. »
Source : disponible sur Google-livres, page 41
7 avril : Porte ottomane, annonce du décès du sultan Abdulhamit Ier, auquel lui
succède son neveu Sélim III, qui devient empereur des Turcs.
8 avril : A Saint-Etienne, l’hôtel-de-ville est envahi par la
population et elle exige la vérification des poids et mesures des
boulangers, tous ont faussé leurs instruments sous le contrôle des juges
locaux.
9 avril : Le "Jeudi saint" trouve sa place dans le calendrier des
Catholiques plusieurs jours avant les fêtes religieuses de Pâques et de
la fin du Carême (40 jours).
A cette occasion, « à
Versailles et dans toute la France, la journée entière est consacrée
aux offices. La philosophie a envahi les salons et les académies, mais
elle n'a pas encore modifié les coutumes elle n'a fait aucun tort aux
paroisses. Les cérémonies royales du jeudi saint sont touchantes et
méritent d'être rapportées. Elies se passent dans la chapelle du
château. L'évêque de Sarlat donne l'absoute, l'abbé de la Boissière,
vicaire général de Valence, prononce un sermon sur l'humilité. Faisant
allusion au lavement des pieds, il dit que la religion chrétienne est
la seule qui fasse courber le front des rois devant les pauvres. Avant
la messe, le roi lave les pieds de douze pauvres. Un dîner leur est
servi, et Sa Majesté fait l'office de maître d'hôtel. (...) Ensuite,
le roi et la reine, accompagnés de Mme la comtesse d'Artois, de Mme
Adélaïde, de Mme Victoire, de Mme Elisabeth, se rendent à la chapelle
du château, où la grand-messe est célébrée par l'abbé de Ganderatz et
chantée par la musique du roi. Le sermon de la Cène est prêché par
l'abbé de Boulogne. La reine a procédé, de son côté, aux mêmes
cérémonies. Elle a lavé les pieds de douze pauvres femmes et les a
servies à table, accompagnées de toutes princesses de la famille
royale. Mgr le comte d'Artois va faire à Notre-Dame de Versailles la
communion publique, tandis que le roi remet à son grand-aumônier,
l'évêque de Metz, la barrette cardinalice que le pape vient de lui
envoyer. L'évêque de Metz prend le nom de cardinal de Montmorency. »
Source : Gallica-Bnf, Le Matin du 9/04/1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, en page de une
10 avril : Selon la Société linnéenne du Nord, «
La fin de l’hiver et l’approche des beaux jours sont annoncés par les
oiseaux. L’alouette, qui chante vers le 20 février, ne s’est fait
entendre que le 10 avril 1789. (sic) » (Source : Gallica-Bnf, tome XI, page 62, Amiens-1904)
11 avril : Normandie, éclate une émeute de la faim à Dunkerque. A
Saint-Cloud, l'inventeur et horloger Jean-André Lepaute décède.
12
avril : Dimanche de Pâques, dans tout le royaume des offices religieux
sont tenus dans les paroisses, le roi et des dignitaires du régime se
sont rendus aux vêpres à Versailles. A Paris, à six heures du soir, il
est joué au cirque du jardin du Palais-Royal des compositions de Haydn.
13 avril : Bretagne, à Rennes, Michel Gérard est considéré comme le seul député ou figure paysanne
du Tiers élu, mais pas le seul désigné comme Laboureur, c'est en raison de son franc-parler qu'on en fit un personnage mythique et même plus tardivement un journal. Être "Laboureur" ne consistait pas à labourer les champs, mais à possèder des terres et plus.
14 et 15 avril : En Île-de-France, à Montlhéry et ses alentours depuis
le 6, le prix du blé provoque des fortes tensions avec la population,
et l'on a déployé des forces pour le marché du jour. Vers 10 heures du
matin arrivent un grand nombre de paysans. Les prix sont hauts, de 36 à
40 livres le setier de blé, et les quantités ne sont pas suffisantes
(seulement 24 muids de blé). S'ensuit que les sept brigades de la maréchaussée se trouvent tenues à distance par la foule en colère.
Les esprits s'échauffent, et il est imposé aux marchands une diminution
du prix. Puis les 8.000 personnes se ruent sur les grains exposés à la
vente, et ils obtiennent des prix presque pour moitié moins chers et en
pillent une partie sans payer. Ce qui provoque la stupeur et l'effroi
d'un fonctionnaire local. Le jour suivant, des évènements comparables à ceux du 14 avril ont lieu sur
le marché de Chevreuse, les vendeurs de blé sont obligés de baisser
leurs prix.
15 avril : Lettre de M. de Maissemy, Lieutenant général de la librairie
(censeur du roi), dans laquelle il propose l'interdiction de la feuille
périodique intitulée : le Patriote français ou Journal libre, impartial et national, par une société de citoyens, qu'annonce sans permission aucune M. Brissot de Warville, arrivé « au dernier degré́ de l'audace enhardie par l'impunité », avec lettre-circulaire aux inspecteurs de la librairie des provinces. (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la R.F., page page 314, tome 1)
16 avril : Sont enregistrées par le Parlement, les Lettres patentes et la déclaration du Roi concernant les désordre en Provence. (Source : Bib. d'Aix, Les méjanes, 1 page)
17 avril : Dans le Dauphiné, il est demandé aux curés de lire une
déclaration demandant à la population de respecter la propriété et la
tranquillité publique.
18 avril : Assemblée improvisée du Parlement de Paris, certains membres
tentent des « remontrances » au roi concernant la convocation des E.G.
19 avril : En Bretagne, la noblesse et le clergé assemblés à
Saint-Brieuc, veulent s’en tenir aux formes juridiques anciennes.
20
avril : Est convoquée l'assemblée générale des trois ordres de
l'Artois. Il sera procédé à plusieurs désignations d'élus, puis
à la rédaction des cahiers de doléances. La région voisine, la Flandre
achève son processus électoral et envoie 33 représentants des trois
ordres pour les E.G. à Versailles, le scrutin a été plurinominal
à bulletin secret et pour être élu, il fallait obtenir la majorité des
votes. (Source : OpenEdition, Vers les États-généraux)
21 avril : Premières assemblées du Tiers parisien, par districts, pour
le choix des électeurs, des précautions importantes sont prises pour le
maintien de l'ordre.
22 avril : Suites aux événements du 14 et 15 avril à Montlhéry et au
marché de Chevreuse, l'intendant de la Généralité essaie des mesures
pour apaiser les esprits. Dans une lettre, il ordonne de « transporter
sur le champ, chez tous ceux de votre arrondissement, à l'effet de
visiter les granges, greniers, ou resserres, constater aussi
précisément que possible la quantité de bled qui y est renfermé, (…)
vous les sommerez de ma part de fournir le marché auxquelles ils ont
continué de porter et vous prendrez leur soumission de le faire. Vous
veillerez, je vous prie, avec le plus grand soin à ce qu'ils se
présentent exactement sur le carreau avec une quantité convenable de
grain, (...), je vous recommande le plus grand zèle dans l'exécution de
ces mesures dont vous sentez toute l'importance ». (Source : Archives départementales de l'Essonne).
23-24 avril : A Caen, une émeute de la faim éclate et elle est conduite par les
femmes, puis réprimée par la garnison et la milice bourgeoise.
25 avril : A Versailles, les 20 députés de Paris font leur entrée aux
États-généraux. Les conférences de conciliation prennent fin sans
résultats. Louis-Pierre Dufourny de Villiers fait publié les Cahiers du quatrième ordre, celui des pauvres Journaliers, des Infirmes, des Indigents :
«
La force des anciens usages n'a pas permis de faire pour cette
convocation tout ce qu'on fera peut-être pour l'une des suivantes. Il a
paru nécessaire de distinguer encore les Membres de la Nation, par
Ordres et le nombre de ces Ordres a été selon l'usage limité à trois
mais est-il nécessaire de distribuer la Nation par Ordres? et ces
trois Ordres renferment-ils exactement toute la Nation? Peut-être
cette distribution sera-t-elle abolie il faut l'espérer ; et si elle
ne l'est pas il faut faire un quatrième Ordre ; il faut, enfin, que,
dans l'un et l'autre cas la portion de la Nation qui est appelée par
son droit naturel & qui cependant n'est pas convoquée soit
représentée. » (Source : Gallica-Bnf)
26 avril : Maximilien Robespierre est élu lors des États-généraux de l'Artois, il reste trois élus du Tiers à désigner.

- Entreprise Réveillon - émeute et répression au sein du faubourg Saint-Antoine
27-28 avril : A Paris, émeutes contre Réveillon, patron d’une
manufacture de papiers peints employant 300 ouvriers au sein du
faubourg Saint-Antoine à Paris, il veut baisser les salaires, quand
le prix des denrées augmentent et le blé en particulier circule mal
dans la pays. Cette révolte ouvrière fait 300 morts suite à une
intervention de l’armée et plusieurs centaines de blessés. « A
Paris,
le 27 avril, la grande fabrique de papiers peints Réveillon est pillée
au cours d'une sanglante émeute. Le mouvement n'est pas seulement
dirigé contre les accapareurs de denrées alimentaires, contre le vieux
système d'impôts, contre les octrois, contre la féodalité, mais contre
tous ceux qui exploitent le populaire et qui vivent de sa substance. Il
est en rapport étroit avec I'agitation politique. A Nantes, la foule
assiège l’Hôtel-de-Ville au cri de Vive la Liberté! A Agde, elle
réclame le droit de nommer les consuls. Dans bien des cas, I'agitation
coïncide avec l’ouverture des opérations électorales. » (La Révolution Française,
tome I,
A. Mathiez)
29 avril : En Picardie éclate une révolte de la faim à Amiens.
30 avril : A Versailles, c'est la création du Club breton, (le futur
club des Jacobins) duquel participent notamment MM. Le Chapelier,
Lanjuinais, Defermon, Coroller, Kervélégan, Mounier et Robespierre. A
Marseille, des habitants s’emparent de trois places fortes et tuent un
officier. A Paris, deux émeutiers de la manufacture Réveillon sont
pendus
place de Grève. A New York, George Washington prête serment, et engage son premier mandat de président.
à suivre...
|
|
|
Cahier des plaintes des Dames
de la Halle et des marchés, &c.
|
Légende : Vue des Porcherons, proche de Paris
|
|
Le texte ci-après, rédigé au mois d’avril 1789, est
une synthèse des demandes des Dames de la Halle pour les États-généraux et de leurs
convocations. C'est l'expression des marchandes de poisson (et des marchés), les
« poissardes » qui ont tenu une place particulière dans la grogne
populaire de l’année, celle de tous les changements (?) et au plus près des conditions
des femmes de la toute petite bourgeoisie de Paris et de leurs difficultés journalières.
Ce
texte a été adapté en un langage plus contemporain, pour les mots qui
n’ont
plus d’usages, il a été apporté des précisions utiles pour la
compréhension.
Mais pas pour tous, certains idiomes restent plus ou moins usités et
facilement
compréhensibles. Difficile de cacher la verdeur du langage, quoi que,
certaines
formes ne manquent pas de vocabulaires à leur arc, et des expressions
qui ont un
charme propre, révélateur d’un quotidien animé et de quoi observer les
chalands, leurs comportements
avec attention. Mis dans une forme plus actuelle, il s'agit du langage
populaire courant au sein de la ville, il a été conservé la
formulation originale du rédacteur, un homme, qui a repris cette
déclinaison linguistique
assez particulière où le « je et le nous » se confondent, et
peuvent
faire une troisième personne du pluriel (J'avons, Je savons, etc...).
Sinon
son contenu est d’un vif
intérêt, rares sont les textes pouvant traduire les colères populaires,
ou en
être une émanation directe. Il y est question du vin, du pain, de la
misère ambiante, de l’octroi au passage des barrières ceinturant la ville, de la
police et ses triste-à-pattes, des
hôpitaux et ses conditions infâmes, des taxes prélevées par les procureurs
fiscaux, comme des remarques sur les gens de la « haute » ou du clergé,
très critiqués ; seuls, le roi et M. Necker trouvent grâce à leurs yeux, avec ces
Messieurs des États-généraux,
quoi que… et elles précisent leurs déceptions
devant les reculs du Parlement. Soit une ribambelle de personnages, de
réalités
à l’exemple des gourgandines, ou « filles de mauvaise vie »
qui
donnent à cet écrit toutes ses "saveurs" et épreuves à protéger les
« jeunesses ».
Les « filles de joie » dont les occasionnelles ont pu
représenter un
quart des femmes de Paris, c’est-à-dire entre 60 et 80.000 prostituées
régulières ou occasionnelles en estimation haute, des travaux récents
sur le genre sont de l'ordre de 10 à 15.000 "femmes publiques" pour la
seule ville de Paris ; et donnent le là de la misère ambiante, des
vicissitudes et
« corruptions » nombreuses de l’ancien régime.
Note de Lionel Mesnard
|
Des plaintes & doléances des Dames de la Halle
& des marchés de Paris

Les dames de la Halle haranguent le roi (A : le roi - B : les dames - C : la doyenne)
Rédigé au grand salon des Porcherons, le premier
dimanche de mai,
pour être présenté à Messieurs les États-Généraux.
NOS CHERS MESSIEURS,
Je ne savons que depuis quelques
jour, que je pouvons vous faire à savoir notre façon de penser sur les affaires
en question. C’est M. Josse (ou Joffe) écrivain à la pointe Saint-Eustache qui
nous a appris ça. Les libraires & autres marchands d’esprit qui nous
fournissent (en payant s’entend) du papier pour empaqueter le beurre nous ont
envoyé une charretée de livres écrits en blanc touchant ce qui a rapport aux
états généraux & mille autres gaudrioles semblablement égales. J'ont voulu
savoir ce que contenait toute cette écriture, pour afin de nous instruire de
quoi y retourne & nous mettre même de connaître la matière de la dispute.
J'avons envoyé cherché M. Josse à cet effet, c'est un garçon d'esprit, il fait
nos comptes ; il écrit nos lettres, nos mémoires tout courant ; c'est lui qui
nous dresse la plainte que j’avons l’honneur de vous faire & vous porter.
Il nous a donc fait la triaille (le tri) de cette fourmilière de livres, &
nous a débrouillé dans toute cette écriture que la robinaille (le monde
judiciaire), la finance, les calotins (ecclésiastiques) & les talons rouges
(noblesse) voulaient en manière de persévérance faire toujours endêver les
pauvres gens qu'ils appellent par dérision, le tiers-état & de leur mettre
comme de coutume, le pied sur le col. Mais j'avons aussi appris que notre
bourgeois de Versailles n'entend pas ça. M. Josse nous a dit, en lisant qu'il a
permis a tout le monde de se plaindre, & de lui faire à savoir, ou bien à
vous, nos chers Messiers, toutes les rubriques par lesquelles on bouscule tant
le pauvre monde. C’est tout justement pour en venir à bout, que j'allons vous
décharger notre rate, sans craindre ni mouchards, ni lieutenant de police, ni
commissaire, encore moins les triste-à-pattes (police parisienne). Où y a de la
gêne n'y a point de plaisir.
J'allons tout d'abord pour
commencer, dégueuler contre la ferme & les fermiers généraux ; car
aussi en vérité, être obligés de payer une pauvre bouteille de vin douze sous,
tandis que sans cette engeance je pourrions l'avoir pour encore moins de six
sous, ça nous met en indignation : encore s'il y avait de la justice dans
leur perception des droits de barrières, mais non, une sacrée bouteille de
misérable vin d'Argenteuil baptisé, & frelaté de mille histoires pardessus
le marché, paie aussi cher qu'une bouteille de leur bon vin de Beaume (du
Rhône) : en conscience c’est-il juste çà? Qu'ils payent eux les
autres richards six sous par bouteille de vin de Bourgogne, de Malaga, de Champagne,
à la bonne heure, ils en ont le moyen, & ce serait bien fait, mais que le
pauvre monde soit grugé comme ça en buvant de la ripopée (mélange de vins), ça
n'est pas pardonnable ; & je nous récrions contre cette injustice criante.
N'est-il pas bien en devant de ne pouvoir se mettre sur la conscience un pauvre
poisson de rogomme (liqueur) sans débourser quatre sous, & que je ne
puisons en lamper à moins, sans aller courir la ̃piétantaine (faire une
promenade) au-delà des barrières, & ce qui est bien plus fichant, planter-là
nos affaires ! Il faut cependant en flûter (boire) quelques demi-setiers
par-ci par-là, & quand je sommes à la belle étoile exposées au froid dans
la halle & les marchés faut-il pas se ravigoter le cœur, & s’échauffer
en avalant la goutte de cette affaire ? cependant pas moins, si on se
trouve le dimanche aux Porcherons (quartier de la ville de Paris), à Vaugirard, à
Gentilly, on est tenté d'en faire une petite provision pour la semaine ; eh
bien, si on a le malheur d'en entrer tant seulement une topette (petite
bouteille) dans sa poche, ces furets de commis, qui ne demandent que plaies
& boues, la sentent à travers vos habits cette canaille des fermiers
généraux, vous farfouillent par indécence, ils veulent fourrer leurs mains
partout, aussi ils attrapent souvent de bonnes tornioles (coups) dont ils ne se
vantent pas, mais avec tout ça, s'ils découvrent la marchandise, vous êtes
encoffré, & faut payer une forte amende. Aussi quand on est le dimanche
dans tous ces endroits-là, faut s'en mettre dans le ventre pour huit jours, au
risque de se faire mal ou ne pas s'en mêler. Je ne finirions pas, si je
voulions vous mettre dans cette plainte toutes leurs mangeries. Pas moins je ne
pouvons nous taire d’un autre droit que le grand diable d'enfer leur a chié ;
ils l’appellent comme ça le Pied fourché
avec cette invention : ils sont sur la viande comme pour le vin. C’est
bienheureux quand le boucher nous la donne pour dix sols la livre, & des
gens savants nous ont dit, que sans ce sacré droit, je ne la payerions pas cinq
sous. C’est-il pas dépitant des choses aussi noires ? Et faut-il pas avoir
les entrailles d'une âme damnée pour traiter des chrétiens comme ça ? Et
le beurre, les œufs, le poison salé, &c. &c. Je vous le répétons nos
chers Messieurs faudrait que toutes ces victuailles, qui sont pour le monde du
tiers-état ne payassions rien, ou tout au moins peu de chose & bien saler
celles qui sont pour les autres du haut parage. A présent, c’est tout au
contraire ; je payons tous les droits rubis sur l'ongle ; on ne nous fait pas
grâce d'un liard, tandis que les richards trouvent le moyen de ne rien payer
par leurs exemptions, leurs privilèges & encore les grandes facilités
qu'ils ont pour entrer tout ce qu'ils veulent en contrebande & dont ils ne
manquent pas de se bien servir. Faut-il avouer que tout ça fait dresser les
cheveux sur la tête. Il était encore bien nécessaire de reculer les barrières
jusqu'au diable, & de faire entrer les Porcherons dans Paris ! &
tout ça pour afin de nous faire, faire plus de chemin les dimanches &
fêtes, & nous faire user plus de souliers. Ils ne savent que s'imaginer
pour nous gruger ; si vous les laissiez faire, bientôt poseraient des
régiments de gardes aux barrières pour nous empêcher de sortir ; ils seraient
couvrir tout Paris comme l'hôtel Soissons, de peur que je ne passions
par-dessus les murailles. Ah Messieurs les états généraux, vous devriez bien
faire couper le col à toutes ces horreurs & abattre les murs qui sont tout
à l'entour, qui rendent Paris comme Clamart. Qu'ils nous font rire avec leurs
murailles ! ça vous a dépensé un argent qui fait trembler pour bâtir un
mur qu'on ferait dégringoler à coups de pommes cuites. Et tous leurs beaux
châteaux de pierre qu'ils y ont mis à chaque pas, pour loger des je ne sais qui !
Ne vaudrait-il pas mieux en faire des hôpitaux? Mais non, ces sacrés
chiens de fermiers généraux, ces nouveaux parvenus, cette crapule d'hier,
voulaient toujours nous faire porter le collier de force. Ils ont trouvé le
moyen, eux, de s'enrichir d'avoir des hôtels d'une façade à perte de vue, une
vingtaine de chevaliers grimpants pour le moins aussi insolents que leurs
maîtres, autant de femmes qu'ils entretiennent pour les autres, car il y a gros
qu'ils n'y mettent pas le pouce, & je ne pouvons obtenir qu'on nous fasse
une halle commode, couverte & à l'abri du froid de la saison ! Dame,
c'est que je sommes du tiers-état, nous que je sommes des malheureux faits pour
travailler pour avoir de la peine & je sommes regardés moins que des zéros
en chiffre. C'est à force de voleries qu'ils en ont conté au roi, ce pauvre
cher homme avait besoin de noyaux, & il a pris ceux que lui ont offert les
fermiers généraux pour avoir la permission de faire ce vilain mur. II voulait
tant seulement leur donner un petit dédommagement, mais il n'entendait pas
qu'ils amassent & s'enrichissent en faisant mourir les pauvres gens de faim
& de soif. Et puis on nous a dit comme ça, qu'il a été aussi trompé par le
contrôleur des finances d'alors, qui avait reçu une grosse somme de ces
sangsues publiques, pour afin de les soutenir. Je connaissons son bon coeur,
j'avons des preuves qu'il nous aime, & je l'aimons bien aussi. Je savons
tout comme vous que le roi ne peut pas vivre de l'air du temps, qu'il lui faut
des espèces pour son ménage & entretenir de pied en cap tout un royaume de
soldats, je savons encore qu'il a été pillé que combien a été gaspillé par les
Calonne, les Brienne, les &c. &c. Aussi je consentons à lui donner de
l'argent selon nos moyens ; mais il faut aussi que les richards lui en donnent
selon les leur, il n'est pas de la justice que les pauvres payent tout &
les autres rien, vous en conviendrez, vous qui êtes la crème des braves gens de
tout le royaume. Et puis mettez des impôts sur les carrosses les cabriolets sur
le trop grand nombre de Valetaille sur les jardins anglais & un autre tas
de fariboles qui font mal au cœur, & vous trouverez l'ingrédient d'avoir
autant d'argent que celui de la ferme, ou bien de faire diminuer le nombre des
éclabousseurs, des écraseurs, & des écrasés. On sera obligé de payer quand
on voudra avoir des jasmins, ou de les renvoyer dans leur village pour trimer
la galère ; les jardins anglais paieront, ou bien on y plantera des gros
choux pommés & d'autres légumes.
La prêtaille, nos chers
messieurs, ne mérite pas moins que vous lui rogniez les ongles. Oh pour le
coup, c’est bien là que vous trouverez de la besogne, & j'ont bien peur
qu'avec toute votre faïence, vous ne puissiez pas en venir à bout. Je savons
bien que vous y ferez de votre mieux, mais y a trop affaire, faudrait trop les
taper, & les messeigneurs ont les bras trop longs. J'allons cependant vous
défiler notre chapelet à leur égard ; je vous prévenons par avance de ne
pas scandaliser vos oreilles des bonnes vérités qui pourront nous échapper dans
la fureur de notre emportement. Je sommes d'aussi bonnes chrétiennes que le
pape de Rome, je savons respecter notre mère la sainte église, mais je ne
pouvons voir tout ce qui se passe sous nos yeux, ni tant seulement penser au
libertinage, à la gourmandise, à l'avarice, à l’orgueil de ces gens d'église
sans nous transporter d'indignation. Je sommes de franches poissardes
(marchandes de poisson) & j'allons vous décoiffer tout ce qui nous viendra
à la bouche : Je vous le demandons, nos bons messieurs pourquoi t’est-ce
que les évêques ont des cent mille des vingt mille livres de rente ? ce
n'est-il pas pour distribuer aux pauvres après qu'ils ont pris leur nécessaire
là dessus ? Ils en font bien un autre usage, eux, vous le savez aussi bien
que nous & j'espérons que vous y mettrez bon ordre. Ils achètent de beaux
carrosses, des beaux habits encore bien souvent ils les prennent à crédit, à ne
jamais payer. Ils engraissent un tas de valetaille qui ne finit plus. Quand
j'allons porter quelque chose dans leurs grands hôtels, la tête nous en tourne
tant j'y voyons de monde. Ils ont une table mille fois plus friande que celle
du roi, je le savons bien s'il y a un beau & bon morceau sur la place,
dame, faut voir, coûte qui coûte, c'est toujours le maître d'hôtel d'un de ces
monseigneur qui l'emporte. Ils entretiennent des filles d'opéra qu'ils couvrent
de joyaux & à qui ils donnent des petites maisons ; si je voulions
personnaliser, je pourrions vous en désigner plus de cinquante aux alentours de
Paris, & je pourrions vous nommer telles actrices des Français, des
Italiens, & des Boulevards qui ont ruiné plus de violets qu'elles n'ont
faits de rôles. Ils jouent un jeu d'enfer, & cette passion est si engrainée
chez eux qu'ils joueront, comme on dit, le cul dans l'eau. Ce n'est pas tout,
ils ont une séquelle (kyrielle) de parents qu’il faut faire subsister, des
oncles, des tantes, des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, & puis
encore d'autres neveux & d'autres nièces que leurs frères ou leurs sœurs
n'ont jamais faits, il faut nourrir tout ça pour voir toute cette graine. Tant
y a qu'avec leurs cent mille livres de rente, ils ne donnent pas cent liards
aux pauvres dans l'année, ils en verraient crever de misère & de faim à
leurs portes, qu'ils ne leurs feraient pas porter un verre d'eau, encore bien
souvent ils mourront banqueroutiers, & faut que leurs héritiers abandonnent
leur succession. Je ne pouvons aussi nous taire de leur orgueil, ils sont plus
fiers que les marguilliers (laïc chargé de l’entretien du lieu de culte) de
parole quand ils sont dans leur banc ; ils méprisent le petit monde, ils
se le regardent tant seulement pas & le traitent de canaille, ils croient,
Dieu nous le pardonne, qu'ils sont d'une autre pâte que nous. Faut voir quand
ils nous donnent la confirmation, on dirait qu'ils ont peur de prendre la gale.
Sarpedié (exclamation), c'est par trop fort aussi ; & si j'osions, je vous
les confirmerions de la bonne manière je vous leurs appliquerions une emplâtre
qui n'aurait pas besoin de bandage. Je ne vous parlerons pas des gros abbés,
des chanoines, c'est tout comme, & le proverbe est bien vrai qui dit comme
ça : tel maître, tel valet : ils sont comme qui dirait les singes des
évêques selon leurs moyens. Pour ces petits abbés farauds (vaniteux), à la frisure
à la monte-au-ciel & à badine que je voyons passer si souvent dans la place
Maubert, ils nous font tant seulement rire, je ne pouvons digérer qu'ils
fassent quelque chose de bon, ça va vous porter son écu chez la gueule, ou bien
chercher à débaucher quelque honnête fille, & puis voilà tout. Vous devriez
bien nos chers messieurs nous débarrasser de cette vermine, en les claquemurant
dans leurs séminaires, jusqu’à ce qu'ils fussent curés ou vicaires. Il ne
devrait pas y avoir d'autres prêtres que ceux-là, & faudrait bien les
choisir ; comme aussi, pour afin de les empêcher de penser à cocufier les
maris, & à débaucher les filles de leurs paroissiens, je croyons qu'il ne
serait pas mal de leur permettre d'avoir une femme, & des enfants légitimes
par mariage. Car enfin, faut être juste, ils sont de chair & d'os comme
nous, & on ne leur coupe rien quand on les fait prêtres. Faudrait donc,
sauf meilleur avis, retrancher plus des trois quarts des revenus des évêques,
dont ils font un mauvais usage ; en donner une petite partie aux curés
& aux vicaires, d'une autre partie faire des maisons de charité d'éducation
pour la pauvre jeunesse, de retraite pour les bons vieillards & les
attaqués d'infirmités, & donner le reste au roi pour les besoins de son
royaume. Il faut pourtant dire la vérité, à tout seigneur tout honneur.
Monseigneur notre archevêque de Paris est assez bon vivant, tout comme son
premier garçon monsieur de Senès ; aussi quand je vous les rencontrons dans
leur voiture, je vous leurs baillons (présenter) une révérence qui, parlant par
respect, sent la civilité d'un quart de lieue à la ronde. Je voudrions bien
savoir, par exemple, s'il commande aux curés, de se faire payer pour la moindre
bagatelle de sacrement ; ils trouvent de quoi tondre sur un œuf.
Arrive-t-on, en ce monde? Ils vous font payer plus cher l'eau du baptême
que si c'était du bon vin. Lorsqu'on en part, il faut payer le voyage, sans
quoi vous vous en iriez dans l'autre monde comme des péteux, on vous
emballerait dans un sac comme un paquet de linge sale, point de chemise de
bois, point de chandelle, un petit crucifix de bois & à peine vous
régaleraient-ils, en courant, d'un misérable de profundis. Lorsqu'on veut se prendre par le mariage, encore de
l'argent, autrement il a faudrait faire un mariage à la détrempe (médiocre)
& des enfants bâtards. Pour le bon Dieu, ils vous en rognent la moitié, si
on ne met pas la pièce sous le chandelier. Ils sont si chiches de messe, que si
l’on veut en faire dire une à la bonne sainte Geneviève, ils vous fichent de
côté tout le profit d'une journée. Enfin de tout pour finir, ils vous font
donner de l'argent pour aller au ciel, comme pour aller chez Nicolai. Je
n'aimons pas non plus que ces abbés fassent le catéchisme à nos filles ; ils
leurs apprennent toujours la malice, ils ne cherchent qu'à les déniaiser &
nous les renvoyons souvent avec un pucelage de moins.
J’avons encore messieurs, à vous
faire savoir que l'Hôtel-Dieu n’étant pas fait peur les chiens, les gens
nécessiteux comme nous sommes quelquefois obligés d'y aller pour nous faire
guérir des maladies. Eh bien pour une colique on vous flanque dans un lit à
quatre, un qui a la gale, l'autre mourant, l'autre mort, & on se met comme
ça toutes ces maladies dans l’âme. Ce n'est que quand on est à l’agonie, qu'il
vient un chevalier de la lancette & une autre tête à perruque (personne
incapable de penser), pour drogailler votre mal malgré vents & marée. Je ne
sommes pas endurantes, il arrive parfois que la cuisson du mal nous fait lâcher
un f…., faut voir alors la soeur du pot s'enfuir, & vous laisser-là comme
une âme damnée. La bonne pièce ! elle n'a pas quelquefois autant de peur
de la chose avec un carabin (médecin) ou un aumônier. Si on pouvait encore se
plaindre au bureau, mais les administrateurs ne pensent la plupart qu'à eux,
& qu'à pêcher en eau trouble. C'est encore bien pis aux Incurables, &
aux Petites-Maisons, les administrateurs de ces endroits-là sont des gros
seigneurs, qui ne veulent pas se ravaler (se rabaisser) jusqu'à écouter les
pauvres gens, ils laissent ce soin-là à leurs valets, & il faut graisser la
patte à ceux-ci pour avoir une place dans ces maisons. Tout ça, messieurs, ne
crie-t-il pas vengeance? Et le dépôt de Saint-Denis, je voulons vous en
dire un petit mot en passant ; ça fait horreur. Je convenons qu'il est bien de
renfermer les mauvais sujets & les feignants, qui font métier de la
gueuserie, mais aussi ne faut pas que les bons pâtissent pour les méchants,
& c’est pourtant ce qui arrive. Les mouchards n'y cherchent pas tant de
façon ; pour gagner leur sacrée pièce de trois livres, ils prennent tout ce
qu'ils rencontrent bons & mauvais sujets, sains & malades, jeunes &
vieux, & qui plus est les petits enfants. Ils entassent tout ça pêle-mêle
ensemblement. Ceux qui se portent bien, y deviennent malades, ceux qui n'ont
qu'une maladie y en prennent dix ; aussi ils y mourront drus comme mouches.
Mais ces pauvres petits enfants ! ah ça nous fend le coeur quand j’y
pensons. Ils arrivent dans cette chienne de maison purs d'âme & de corps,
ni plus ni moins que des petits anges ! eh bien ils y apprennent toutes
sortes de malices ils y contractent tous les vices les plus infâmes avec les
mauvais sujets, & ils attrapent toute espèce de vilaines maladies avec les
malades, en telle sorte que quand ils en sortent, ils ont le cœur, l’âme &
le sang tout gâtés & corrompus.
Parlons maintenant du pain qu'il
faut manger à quinze fois. Je pensions tout d'abord que c’était parce que les
mitrons renchérissent d'eux-mêmes pour empocher, & qu'à regard de ça ils
avaient graissé la patte à la police, mais y a gros qu’ils en sont innocents
& que la famine ne vient pas de la grêle, ni du roi encore, bien moins de
M. Necker. Ils avaient pourtant l’impertinence d'en accuser ce pauvre cher
homme, qu'est notre bon ange gardien & notre sauveur, il aime le
tiers-état, lui, je ne croyions pas qu'avec celui-là il y ait quelque anguille
sous roche, quoique ça, je disons, ne faut jurer : faudrait être pis que
forcer pour deviner ce que ces grands ministres ont dans l'âme. Je savons bien
toujours d'où vient la cherté du pain, & puisque nous voilà en train, faut
une bonne fois nous décharger le cœur ; ce faut pas tant de beurre pour
faire un quartron (mesure ou dose). C’est vous messieurs les chatte-mités (hypocrites)
de parlement, & vous calotins qui tous voyant votre dernier soupir, joué de
votre reste en accompagnant le bled (les céréales), pour afin de nous faire
révolter contre notre bon maître, & par après lui en revendre en lui
disant, que tant qu'il aurait pour bras droit M. de Necker, il y aurait du
tintamarre (bruit). Mais vous avez eu beau faire, ça n'a pas pu prendre &
j'aimons encore mieux mourir de faim & de soif, que de nous révolter contre
notre bon roi. Il est bien vrai en cas de ça qu'il y a eu tout plein de bruit
(rumeur) au faubourg Saint-Antoine ; mais je pouvons bien dire en bonne
conscience, que ce n'était pas une véritable révolte, en tant qu'il n'y était
pas question de pain, ni de vin, ni du roi. Vous savez bien, messieurs les
états généraux, que c'étaient des gens qui avaient été payés, qui six francs,
qui douze francs pour faire du mal, & par après causer une véritable
révolte, mais ils ont eu un pied de nez, personne n'a bougé que ceux qui
avaient reçu de l'argent. Ce n'est pas pour des prunes, qu'on a mis en cage cet
abbé qui porte un si beau nom, qui est gueux comme un rat d'église, &
pourtant a semé bien des noyaux. Ces chiens d'abbés, ils se fourrent
partout ! Mais chut…, j'espérons que vous prendrez connaissance de toute
cette manigance-là, & que vous les punirez tous, comme ils le méritent,
pour avoir été la cause de la mort de tant de pauvre monde. Quant à l’égard de
ça, faut avouer suffit qu'il y a bien de la faute de la police ; huit jours
avant que tout ce tapage éclate, ils en avaient connaissance & ils auraient
bien pu empêcher tant de tuerie. Ils méritent bien que vous leur donniez l’or
les doigts pour cette négligence-là, & pour tout plein d'autres choses dont
je vous parleront par après, si j'y pensons. Qu’est-ce qui aurait cru, par exemple
que ce poison de parlement, qui semblait prendre notre avantage, il y a un an,
ne le faisait pas tout de bon? ah, messieurs les bons apôtres, vous
faisiez la patte de velours, pour nous mieux écorcher, & monter vous mêmes
sur des échasses ; mais je savons aujourd'hui le fin mot de votre pensée,
& les états généraux rabattront votre caquet de plus d'un cran. Vous en
avez la foire, mes enfants, & y a gros que vous en serez les dindons. Quand
on ne pisse pas clair, le médecin fait peur. Que j'étions bêtes de prendre
votre parti & de vous exposer pour vos beaux yeux aux baïonnettes des
triste-à-pattes ! aussi aujourd'hui qu'on vous casse, qu'on vous rompe,
qu'on pende tous vos chiens de procureurs, nous nous en fichons comme de ça.
Puisque nous touchons cette
corde, il faut, messieurs les états généraux, que je vous découvrions le pot au
rose. Si vous avez bonne souvenance, vous devez vous souvenir de l'année passée
quand on faisait faire amende honorable au guet, qu'on faisait des cendres de
leurs casemates, qu'on était prête dans la place Dauphine comme des harengs,
& qu'on se tuait comme des mouches, & bien c'était la robinaille qui
envoyait la valetaille sans faire semblant de rien pour débaucher nos maris
& nos enfants, pour afin de mettre le feu aux étoupes (mèches). Le
lendemain, ils rendent pour la frime un arrêt en papier affiché contre les
attroupements, là où ils-nous gueulaient qu'ils voulaient notre bien ; Mais je
voyons clair à présent, & ils ne nous en compteront plus je savons que dans
tout ça, ils ne pensent qu'à eux, & se fichent de nous comme de Colin
tampon. Leur opiniâtreté à rencontre des volontés du roi n'était que pour leur
intérêts. Ils faisaient le diable à quatre pour des édits qui attaquent leur
pouvoir, leurs privilèges, ou qui les exposaient à payer quelque impôt, mais
pour les autres qui pouvaient leur faire du profit, en faisant tout plein de
mal au pauvre, tiers-état du peuple, ils ne soufflent pas le mot, & le
laissaient bien vite passer. Témoin l'exportation du bled qu'ils ont permis
d'eux-mêmes, pour afin de le faire renchérir & par ainsi mieux vendre celui
dont leurs greniers regorgent, quand la famine serait venue. Sarpedié, si
avions su cette hypocrite, comme je vous les aurions soutenus de la bonne
manière. De combien de malheurs n'ont-ils pas été la cause, avec le froid de
l'hiver qu'il a fait, combien de pauvres mères de famille, qui n'avaient que la
misère à mettre sous la dent, ont été obligées de mettre tout au Mont-de-Piété
& même de vendre leurs propres filles, pour afin d'acheter un pain de
quatre livres, & quelques falourdes (fagots de bois) pour se réchauffer. Et
voilà, la raison pourquoi on voit tant de gourgandines (filles légères) au coin
des rues ; si la plupart avaient du pain ; elles ne se mettraient pas à
faire ce vilain métier, & puis quand elles en ont une fois tâté et les s'y
acoquinant par après deviennent des catins au litron ; elles empoisonnent nos
garçons & donnent des exemples critiques à nos filles. Je vous le
demandons, nos chers messieurs, que voulez vous que pense une petite jeunesse
en les voyant raccrocher, & leur entendant dire les termes du métier ?
ça leur trotte dans la tête, & à force de penser à ce que ça peut être, une
jeunesse y met tout justement le doigt dessus, elle en joue d'un air, &
puis elle augmente bientôt le nombre de ces dévergondées. Encore s'il était
possible de pouvoir les retirer du vice malgré leurs dents, mais non elles sont
retenues par la police, elles sont protégées par les commissaires & les
mouchards, avec qui elles partagent le profit du commerce, le moyen d'en venir
à bout. Je voudrions bien, Messieurs les états généraux, que vous fassiez une
bonne défense à ces vierges de contrebande de se planter comme des bornes sur
les portes des allées dans les rues ou à pour afin de faire monter les
passants. Vous devriez bien surtout faire empaler les sacrées vieilles
marchandes de chair humaine, qui viennent nous enlever nos filles à notre barbe
& presque sous notre cotte (jupe paysanne), sans que ç'a y paraisse. Je n'ignorons
pas que vous n'aurez pas les bras assez longs pour empêcher qu'on ne déniche
les pucelages, & qu'on n'en fige métier & marchandise ; que les
grandes dames de noblesse, les marquises, les baronnes s'en donneront toujours
malgré vous & malgré vos dents. Je savons aussi qu'il faut de ce gibier-là
pour les financiers, les abbés & mille autres parrains, si je ne vous
demandons pas l'impossible ; ôtez tant seulement les abus & les
mauvais exemples ; empêchez qu'on ne tire le monde dans les rues, qu'on ne
raccroche dans les promenades publiques, pour afin que les jeunesses ne le
voyant pas sous leurs yeux. Mais de quoi est-ce que j'allons nous aviser de
parler des promenades publiques ? ça ne nous regarde pas, je ne sommes pas
de ces beaux endroits-là, & ne faut pas se méconnaître. Si je voulons le
dimanche chanter le mauvais air de la halle, & respirer tant soit peu le
frais, je ne pouvons pas même entrer dans le jardin du roi, parce que je
n'avons pas de grands chapiaux (chapeaux) enharnachés de plumes & de rubans,
parce que je n'avons pas de robe et de mantelet (manteau), parce que je sentons
le poisson. Eh sacré chiens, si j'étions entretenues comme beaucoup de celles
qui y entrent ; j'aurions, aussi bien qu'elles de tous ces affiquets
(ornements), mais je pouvons aller la crête levée ; toutes nos hardes nous
appartiennent, tandis que la plupart de ceux qui vont y faire la belle jambe
ont loué les leurs ou n'ont pas de chemine à leur derrière. J'aimons mieux
encore sentir le poisson, que le mercure, & j’ons plus d'honneur dans le
bout de nos ongles qu'eux autres dans tout leur sacré crâne de personne.
Je voulions vous lâcher quelques
mots sur les procureurs (fiscaux), ces catins nous ont déroutées ; mais à
tout bon compte revenir, & j'allons vous en entretenir sur le moment. On
dit comme ça, Procureurs voleurs. Je ne savons pas si le proverbe ment, mais
combien ne voyons-je pas de petits clériots (clercs) qui n'ont pas cinq sols
vaillant acheter une boutique de procureur à crédit & puis au bout de moins
de six ans être riches comme des Crésus? Faut donc qu'ils volent les
pauvres nigaudes qui se servent à eux ou que leur commerce soit furieusement
bon. Je savons bien qu'avec un procès de six liards, ils en se font tout de
fuite un de cent écus qu'ils embrouillent & obscurcissent l'affaire la plus
simple & la plus claire, & qu'ils ont l'intrigue de la faire traîner
plus de vingt ans pendant qu'en bonne conscience ils auraient pu la faire finir
en moins de vingt jours. Je savons aussi qu'ils ne sont pas gauches pour ruiner
les débiteur & les créanciers ; j'avons souvent vu des gros
banqueroutiers laisser presque de quoi payer toutes leurs dettes, les
procureurs savent toujours mettre le nez dans ces bonnes affaires ; ils
font des écritures que ça ne fini plus : si bien que quand ça vient pour
compter, ils ont tout & les créanciers n'ont plus rien, c'est encore
bienheureux s'ils ne leurs font pas payer des frais. J’avons encore
connaissance de la manière que sont faites leurs écritures ; ça fait
rire ! Avec un mot ils font une ligne ; ils barbouillent un main de
papier marqué, & s'ils avaient bien voulu il ne leur en aurait pas fallu
une feuille. Et bien quoi que ça, je ne pouvons comprendre, comment il est
possible qu'ils puissent faire tant vite une si grande fortune ; ça nous
(dé)passe. Je vous prions, Messieurs les états généraux, de tirer tout ça au
clair, d'empêcher tous ces artifices, & encore tous ceux que je ne
connaissons pas. Je vous faisons pareillement une semblable prière touchant les
huissiers, les sergents & les commissaires, les mouchards & toute leur
séquelle en bonne vérité, je croyons qu'ils s'entendent tous comme larrons en
foire.
Je savons, nos chers Messieurs,
qu'il y a de bien braves gens parmi les nobles de qualité ; j'en
connaissons qui valent plus que leur pesant d'or, eux aussi je leur portons
respect, ni plus ni moins qu'à nos père & mère. Mais, quoi que, je ne
voulions pas les nommer, pour afin de ne pas désigner ceux qui sont tout au
rebours, ça ne doit pas nous empêcher de faire notre plainte contre ceux-ci.
Qui se sent morveux se mouche. Par ainsi, en conséquence, j’entendons vous
signifier ces nobles de qualité qui tant les fendants, qu'il semblait que tout
le royaume de France n'était pas assez grand pour eux. Ça s’est mis dans la cervelle
que tous les bons morceaux leur reviennent, comme si on les avait tout exprès
mâchés pour eux, mais je sommes chrétiens comme eux autres, faits de chair
& d'os ; & si je n’avons pas tant d'aisance, j'avons du coeur & du
sentiment dans notre manière de voir, & je pouvons dire plus de charité,
qu’eux autres pour notre prochain quoi que je soyons pauvres, ou gueux comme
ils disent. Tiens, il est bien forcé d'être riche, quand on l'a trouvé tout
gagné, qu'on ne paie rien au roi qu'on a les meilleurs emplois, sans les avoir
méritées, quand on acheté toujours & qu'on ne paie jamais qu'on vit &
s'entretient aux dépens des pauvres marchands & artisans. J'avons toutes
connu un duc qui est mort il y a aux environs de trente ans ; quand il est
parti pour aller faire sa révérence au père éternel, il devait vingt mille
francs à son cordonnier seulement. Il n'y a pas jusqu'à leur gibier qu'ils
nourrissent avec le bien des autres ! Aussi ces pauvres gens de la
campagne qui nous apportent des légumes à la halle quand je leur
demandons : « Un tel ou une telle (comme ça se rencontre) pourquoi
vos choux sont-« ils rongés à faire peur »? Ils nous répondent que
c’est une fourmilière de lièvres qui dévorent tout jusqu'à la moelle des os.
Si, je leur conseillons de leur tordre le col : « C’est bon à dire,
disent-ils, je ne sommes pas si hasardeux, pour payer une forte amende ou aller
en galère. Notre seigneur n'entend pas raillerie sur ça ; il aimerait mieux
qu'on couche avec Madame, qu'un lièvre enjoué. Ce n'est pas la fin de l'histoire,
une vingtaine de chiens de chasse qui vont toute la vie arpenter les champs,
& s'y flairer au cul, puis après les laquais, puis encore les
gardes-chasse, puis ensuite un tas d'autres bêtes de même espèce, ravagent
tout, détruisent la moisson, la vendange, s'emparent de tout le beau fruit,
dont je pourrions faire de bel & bon argent, & sont si bien que quand
je sommes à la récolte, après avoir payé la taille, le taillon, la capitation,
le vingtième, la dîme, &c. &c. à peine nous reste-t-il la paille pour
vivre ». Oh par exemple Messieurs les états généraux, ça mérite bien de
faire rasoir, & vous devez, en conscience de Dieu vous mettre dans la tête
qu'un gâteau bien partagé ne fait mal à personne. Et que dirons-nous de cette
noblesse à six liards le litron, qui s'est décrassée avec une savonnette à
vilain ? Elle nous la baille belle avec sa hauteur, c'est quasiment aussi
fier qu'un commissaire, & se croit plus que monseigneur le comte d'Artois.
Dites donc nos gentilshommes manqués votre noblesse de rebut est à son
extrême-onction, & pourra faire le saut périlleux, quoique vous soyez venus
l'autre jour dans les églises pour afin de caponner les états généraux du
tiers-état : nos petits choux, il fallait mettre les pouces plutôt ;
mais aujourd’hui je vous en ratifions. A chien brûlé eau tiède fait peur. On
n'a pas été assez nitouche pour donner dans le panneau de votre parolis.
J'aurions encore une grande
litanie de plaintes à vous faire par rapport à la milice, par rapport aux
racoleurs qui engueulent nos enfants sur le quai de la ferraille pour les
engager dans un régiment. Je pourrions vous demander pourquoi on ne pend que
les petits voleurs, pourquoi on tranche la tête a la noblesse de qualité &
on casse les os au tiers-état quand il sont assassins ? pourquoi il nous
faut payer des dispenses au pape de Rome pour épouser un parent ? s'il y a
du mal à coucher avec un oncle, un neveu, un cousin, le grand diable d'enfer ne
nous ferait pas entendre que l'argent peut l'ôter. Pourquoi ci ? pourquoi
ça ? Mais comme à toutes choses faut une fin, j'allons d'abord finir, en
vous priant de dire à ceux des prêtres & des nobles, qui veulent juger les
affaires par bande & non pas par tête, que si je délibérions par bras, ils
seraient bien attrapés, & qu'en cas de ça je n'en aurions pas le démenti.
Si vous venez à bout, Messieurs
les états généraux de nous faire compter pour quelque chose dans ce monde, je
prierons le bon Dieu pour vous ; j'irons faire les neuf tours de la châsse
de la bonne Sainte Geneviève, à l'intention que vos femmes puissent s'en passer
pendant toute votre absence, & ne vous en plantent pas dans votre pays,
pendant que vous êtes attroupés à Versailles ; je brûlerons encore une
bonne chandelle à Notre-Dame de Consolation ; pour afin qu'elle sache le
miracle que vous soyez toujours gaillards auprès de ces pauvres chères femmes.
|
|
Source : Gallica-Bnf -
Cahier des plaintes & doléances des dames de la Halle & des marchés de
Paris, rédigé au grand salon des Porcherons, le premier dimanche de mai, pour être
présenté à messieurs les États-généraux (édité en1789) - Identifiant :
ark:/12148/bpt6k47803q
|
|
|
|
|
PÉTITION
PARTICULIÈRE
D'UN HABITANT DU DISTRICT DE SAINT-MARCEL

Mr Aclocque, marchand brasseur, électeur
du district
|
Pour réunir au
Cahier du Tiers État de la Ville de Paris
Article premier. — Aucune proposition ne sera reçue dans aucune
assemblée par acclamation, mais il sera donné au moins un jour pour en
délibérer et elle ne sera admise ou rejetée que par la voie du scrutin,
afin que le suffrage soit libre.
« Art. 2. — Eu égard aux circonstances actuelles de la cherté et de la
disette du blé, les États généraux s'occuperont avant tout d'assurer la
subsistance des peuples, en leur procurant l'abondance de toutes les
denrées de première nécessité et ne permettront, dans aucun cas,
l'exportation des grains qu'autant que toutes les provinces en seront
approvisionnées au moins pour deux ans.
« Art. 3. — Sa Majesté sera suppliée de rendre l'Assemblée des États
généraux aussi durable que les assemblées des provinces dont elle est
le centre, et de constituer cette assemblée de manière que le tiers des
Députés soit renouvelé chaque année, sans qu'aucun d'eux ne puisse y
reparaître qu'au bout de trois ans.
« Art. 4 — Sera pareillement suppliée d'établir dans Paris, à l'instar
des assemblées de province, une assemblée de la Ville, composée des
Députés de chaque quartier, et des assemblées de quartier également
permanentes, à l'instar de celles des bailliages, parce que cette
capitale du royaume, avec ses quartiers, n'est pas moins considérable
qu'une province avec ses districts ; il souhaite, d'ailleurs, qu'il n'y
ait à l'avenir qu'un seul Ordre de citoyens dans Paris, puisqu'il n'y a
qu'un intérêt commun avec tous ses habitants et que tel est le vœu même
de la Noblesse, dans ses assemblées à Paris, du 20 de ce mois.
« Art. 5. — Le quartier de Saint Marcel demande, avec les autres
assemblées des communes du royaume, la liberté individuelle des
Français, la liberté de ta presse, le secret des lettres, la réforme de
la justice civile et criminelle, la suppression de la vénalité des
charges, qui empêche les gens de mérite pauvres de parvenir aux emplois
et dignités, l'abolition de l'esclavage des noirs aux colonies, de la
servitude mainmortable des serfs du mont Jura; l'abolition de la
taille, celle de la corvée, de la milice, de la gabelle, des
capitaineries et de tous les autres fléaux des campagnes parce qu'il
est possible de subvenir, par des impositions plus équitables, aux
divers besoins de l'État qui ont nécessité ces servitudes sous le
régime féodal; et supplie Sa Majesté, par l'amour paternel qu'elle
porte à ses peuples, de commencer l'ouverture des États généraux par un
acte de bienfaisance qui doit attirer sur elle les bénédictions du
ciel, en délivrant des galères les infortunés qui ont été les victimes
de ces lois désastreuses.
« Art. 6. — Il demande également l'abolition des péages des rivières,
de la presse des matelots que l’on enlève en temps de guerre,
l'abolition de toutes les entraves du commerce ; celle, par exemple, du
second droit que payent les nourrisseurs de bestiaux, lors de la vente
de leurs vaches, quoi qu'ils en aient acquitté les entrées aux
barrières ; celle encore des droits de gros et droits d'entrées perçus
sur les bières de cette capitale, à leur arrivée dans les villes de
province, quoique les brasseurs de Paris aient déjà payé le double des
droits que payent ceux de province; celle enfin des droits excessifs
dont sont charges les amidonniers, ce qui les fait recourir à des ruses
pernicieuses pour le commerce : en effet, il est prouvé qu'ils
consomment annuellement, pour leur fabrication, un tiers de grains de
plus qu'il ne leur en faudrait pour rendre le même produit d'amidon ; et
qu'il n'y ait à l'avenir qu'un même poids, mesure et aunage dans tout
le royaume.
« Art. 7. — Que la dette nationale soit reconnue et acquittée par une
imposition générale, également supportée par les citoyens de tous les
Ordres.
« Art. 8. — Qu'il soit fait une Constitution nouvelle et établi une
éducation nationale qui y soit conforme, afin que les enfants
apprennent à devenir des citoyens.
« Art. 9. — Les maux publics étant réparés, les États généraux sont
priés de s'arrêter sur ceux qui affectent en particulier ledit
faubourg, et qui ont la plus grande influence sur la capitale du
royaume; il demande qu'on arrête l'exécution du projet de détourner les
eaux de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins, ce qui réduirait à la
mendicité au moins trente mille habitants qui n'ont d'autre existence
que leurs manufactures, moulins et usines sur cette rivière, sur
laquelle d'ailleurs ils ont une propriété légale par des arrêts du
conseil de la plus respectable antiquité.
« Art. 10. — Que le droit de la marque des cuirs soit supprimé, comme
étant, de toutes les impositions fiscales, une de celles qui ont
engendré le plus de crimes et de délits secrets, en dépravant à la fois
les mœurs des fabricants par l'attrait de la fraude et celles des
commis du fisc, en les excitant à faire aux redevables des procès
insidieux et ruineux sur le moindre prétexte. C'est au seul droit
de la marque des cuirs qu'il faut attribuer l'extinction de la moitié
des tanneries du royaume, laquelle n'a commencé qu'à l'époque de
l'établissement de ce droit, qui a fait dégénérer à un tel point la
bonne et ancienne fabrication de nos cuirs, que les Anglais se sont
enrichis de notre ruine en fournissant les nations voisines qui, jadis,
s'approvisionnaient en France.
« Art. 11. — Que les ports aux blés soient régis et inspectés par des
marchands choisis par les assemblées de quartier demandées ci-dessus,
pour obvier aux grands abus qui s'y commettent, et qu'il y ait des
officiers préposés pour le mesurage des grains, comme il y en a dans
les chantiers pour le cordage des bois.
« Art. 12. — Si les États n'avisent point à la suppression des
barrières, qu'au moins les entrées des vins des environs de Paris et
autres de pareille qualité ne soient pas taxés comme ceux de Bourgogne,
Bordeaux et autres ; que chaque vin soit imposé à proportion de son
prix, afin que le pauvre ne paye pas au Roi des droits aussi grands
pour sa consommation que le riche.
Art. 13. — Que tous les privilèges de l'Hôtel soient supprimés, par le
tort qu'ils font à l'État et aux commerçants, dont ils partagent le
bénéfice sans supporter le même poids de capitation.
« Art. l4. — Que le quartier Saint-Marcel soit déchargé de l'impôt mis
sur les maisons pour le logement des soldats, ainsi que de l'impôt
qu'une partie de ce quartier paye pour le logement des ouvriers des
Gobelins.
« Art. 15 et dernier. — Que l’on applique les revenus et les fonds de
quelques abbayes au soulagement des pauvres du faubourg Saint-Marcel,
qui n'ont d'autres secours que la charité des habitants de ce quartier,
les moins fortunés de Paris, et celle de leurs pasteurs, dont les cures
sont très modiques, et que ces secours soient distribués par les
assemblées permanentes de quartier dont il a fait la pétition ; au
reste, il souhaite que ces secours et cet ordre, qu'il désire pour
lui-même, s'étendent a toutes parties de la capitale et du royaume qui
ont les mêmes besoins.
« Signé :
Aclocque, marchand brasseur, un des électeurs du district. »
|
Source : Gallica-Bnf, Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (Pour lire l'original, cliquez ici).
Les assemblées primaires et les cahiers primitifs – Texte recueillie et
annoté par Charles-Louis Chassin, Éd. scientifique - Publié par C.
Noblet (1888-1889)
|
|
|
- Chronologie
du 1er mai au 14 juillet

- Jardins et gallerie du Palais-Royal au XVIIIe siècle
|
V - Le mois de mai 1789
Vendredi 1er mai : A Paris, le fabriquant de papier
peint M. Réveillon demande à être mis sous protection à la Bastille.
2 mai : A Versailles, présentation des députés des États-généraux au roi.
En Normandie, à Saint-Lô, les habitants sillonnent et réquisitionnent
les campagnes pour leurs besoins en grain.
2 au 5 mai : Honoré-Gabriel de Mirabeau édite un journal nommé États-généraux (manuscrit) ce périodique démarre le 5 mai et prend fin en février 1790. Son autre publication le Courrier de
Provence
a commencé le 2 mai et sera l’objet d’une censure, idem, pour le
journal de J.P. Brissot, qui sort à la même période. Toute publication
étant
soumise à une autorisation préalable auprès du Libraire du roi, en
charge de la censure. La question de la liberté de la presse est
présente au sein des cahiers de doléances, comme nombres de sujets
relatifs aux libertés. (Cf. Lettres du comte Mirabeau à ses
commettants, publiées du 10 mai au 25 juillet 1789, puis sous le titre
du Courrier de Provence, jusqu'en 1791).
Dimanche 3 mai : Pétition de cent cinquante mille ouvriers et artisans de Paris, adressée à M. Bailly, secrétaire du tiers état assemblé à l'archevêché. (Gallica-Bnf, 5 pages)
4
mai : Dans le nord de la ville de Paris, une quinzaine de personnes tentent
de passer en force des marchandises, mais ils se heurtent à la brigade
de Saint-Denis et sont arrêtés et transferés à la prison de la Force. A
Versailles, l'on procède à une procession des États-généraux.
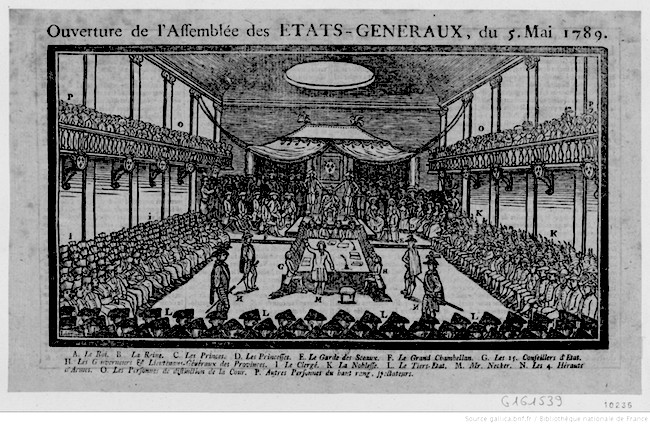 Légende : A. Le Roi B. La Reine C. Les princes D. Les princesses E. Le Garde des Sceaux
Légende : A. Le Roi B. La Reine C. Les princes D. Les princesses E. Le Garde des Sceaux
F. Le grand Chambellan G. Les 15 conseillers d'État. - Gravure de Jean-Michel Moreau
5 mai : Camille
Desmoulins qui a tenté se faire élire sans réussite et a assisté à la
cérémonie solennelle du 4 mai, écrit à son père et l'informe de
ce qui se passe à Versailles : « Ce fut hier pour moi un des beaux jours de ma vie.
Il aurait fallu être un bien mauvais citoyen pour ne pas prendre part à
la fête de ce jour sacré. Je crois que quand je ne serais venu de Guise
à Paris que pour voir cette procession des trois ordres, et l'ouverture
de nos états généraux, je n'aurais pas regret de ce pèlerinage. Je
n'ai eu qu'un chagrin, ça été de ne pas vous voir parmi nos députés. Un
de mes camarades a été plus heureux que moi ; c'est de Robespierre,
député d'Arras. Il a eu le bon esprit de plaider dans sa province. » (Source : Consultable sur Google-livres, Correspondance inédite de Camille Desmoulins, pages 1 et 2, Paris-1836) Le numéro 1 de la Gazette nationale, ou le Moniteur universel paraît à cette date sur 4 pages, sa périodicité est à ses débuts hebdomadaire, puis au fil du temps la Gazette nationale
deviendra un quotidien. Fondé par Charles Joseph Panckoucke, directeur de
publication, qui est un grand patron de presse pour son époque, à la tête de pluseurs publications. Ce journal deviendra au
moment du Consulat (1799) un organe officiel de l'État et le restera
jusqu'en 1868. A Versailles, c'est l'ouverture des États-généraux à
l'hôtel
des
Menus Plaisirs, les députés des trois ordres assistent au discours du roi, du garde des sceaux M. Barentin, et de
M. Necker, directeur général des finances, qui déclare ce même jour,
(suivi après par le discours du roi, que vous trouverez dans l'encadré ci-dessous) :
«
Messieurs, lorsqu'on est appelé à se présenter et à se faire entendre
au milieu d'une Assemblée si auguste et si imposante, une timide
émotion, une juste défiance de ses forces sont les premiers sentiments
qu'on éprouve, et l'on ne peut être rassuré qu'en se livrant à l'espoir
d'obtenir un peu d'indulgence et de mériter au moins l'intérêt que l'on
ne saurait refuser à des intentions sans reproche ; peut-être encore
a-t-on besoin d'être soutenu par la grandeur de la circonstance et par
l'ascendant d'un sujet qui, en attirant toutes nos pensées, en
s'emparant de nous en entier, ne nous laisse pas le temps de nous
replier sur nous-mêmes, et ne nous permet pas d'examiner s'il y a
quelque proportion entre notre tâche et nos facultés. (...)
Il ne faut donc pas qu'un manquement de foi vienne souiller les
prémices de la restauration de la France ; il ne faut pas que les
délibérations de la plus auguste des Assemblées soient marquées à
d'autres empreintes que celles de la justice et de la plus parfaite
raison. Voilà le sceau perpétuel des empires : tout peut y changer, tout peut y essuyer des révolutions ; mais tant que les hommes viendront se rallier autour de ces grands principes, il n'y aura jamais rien de perdu.
Ce sera un jour, Messieurs, un grand monument du caractère moral de Sa
Majesté, que cette protection accordée aux créanciers de l'État, que
cette longue et constante fidélité ; car en y renonçant, le Roi
n'aurait eu besoin d'aucun secours extraordinaire, et il n'aurait pas
été soumis aux diverses conséquences qui en sont résultées. C'est là
peut-être un des premiers conseils que les aveugles amis de l'autorité,
que les Machiavels modernes n'auraient pas manqué de lui donner. (...)
Le déficit, selon le compte de 1788, était de 160.827.492 livres. »
Et les
colonies d'outre-mer y sont exclues de toute représentation.
L'ouverture des États-généraux se fait en présence des
députés du
clergé, de la noblesse et du tiers-état. La cérémonie débute avec la
présentation à Louis XVI des
députés : ils sont 1.139 députés présents ainsi répartis :
291 du Clergé dont 208 curés, 47 évêques, 35 abbés ; 270 de la Noblesse ; 578
du Tiers-état dont 200 avocats parmi 400 hommes de loi ou juristes.
 Discours d’ouverture du roi Discours d’ouverture du roi
« Messieurs,
Ce
jour que mon cœur attendait depuis longtemps est enfin arrivé, et je me
vois entouré des représentants de la Nation à laquelle je me fais
gloire de commander.
Un long intervalle s’était écoulé depuis les dernières tenues des états
généraux ; et quoique la convocation de ces assemblées parût être
tombée en désuétude, je n’ai pas balancé à rétablir un usage dont le
royaume peut tirer une nouvelle force, et qui peut ouvrir à la Nation une nouvelle source de bonheur.
La dette de l’État, déjà immense à mon avènement au trône, s’est encore
accrue sous mon règne : une guerre dispendieuse, mais honorable, en a
été la cause ; l’augmentation des impôts en a été la suite nécessaire,
et a rendu plus sensible leur inégale répartition.
Une inquiétude générale, un désir exagéré d’innovations, se sont emparés des esprits, et finiraient par égarer totalement les opinions, si on ne se hâtait de les fixer par une réunion d’avis sages et modérés.
C’est dans cette confiance, Messieurs, que je vous ai rassemblés, et je
vois avec sensibilité qu’elle a déjà été justifiée par les dispositions
que les deux premiers Ordres ont montrées à renoncer à leurs privilèges
pécuniaires. L’espérance que j’ai conçue de voir tous les Ordres réunis
de sentiments concourir avec moi au bien général de l’État, ne sera
point trompée.
J’ai
ordonné dans les dépenses des retranchements considérables ; vous me
présenterez encore à cet égard des idées que je recevrai avec
empressement : mais malgré la ressource que peut offrir l’économie la
plus sévère, je crains, Messieurs, de ne pouvoir pas soulager mes
sujets aussi promptement que je le désirais.
Je ferai mettre sous vos
yeux la situation exacte des finances ; et quand vous l’aurez examinée,
je suis assuré d’avance que vous me proposerez les moyens les plus
efficaces pour y établir un ordre permanent, et affermir le crédit
public. Ce grand et salutaire ouvrage qui assurera le bonheur du
royaume au-dedans, et sa considération au-dehors, vous occupera
essentiellement.
Les esprits sont dans
l’agitation ; mais une assemblée des représentants de la Nation
n’écoutera sans doute que les conseils de la sagesse et de la prudence.
Vous aurez jugé vous-mêmes, Messieurs, qu’on s’en est écarté dans
plusieurs occasions récentes ; mais l’esprit dominant de vos
délibérations répondra aux véritables sentiments d’une Nation
généreuse, et dont l’amour pour ses Rois a fait le caractère distinctif
: j’éloignerai tout autre souvenir.
Je
connais l’autorité et la puissance d’un Roi juste au milieu d’un peuple
fidèle et attaché de tout temps aux principes de la Monarchie : ils ont
fait la gloire et l’éclat de la France ; je dois en être le soutien, et
je le serai constamment. Mais tout ce qu’on peut attendre du plus
tendre intérêt au bonheur public, tout ce qu’on peut demander à un
Souverain, le premier ami de ses peuples, vous pouvez, vous devez
l’espérer de mes sentiments.
Puisse, Messieurs, un heureux accord régner dans cette assemblée, et cette époque devenir à jamais mémorable pour le bonheur et la prospérité du royaume ! C’est le souhait de mon cœur, c’est le plus ardent de mes vœux, c’est enfin le prix que j’attends de la droiture de mes intentions et de mon amour pour mes peuples.
Mon Garde des Sceaux va
vous expliquer plus amplement mes intentions ; et j’ai ordonné au
Directeur général des finances de vous en exposer l’état ».
|
6 mai : Versailles, les députés de la noblesse et du clergé siègent
dans des salles respectives. Le Tiers reste dans la salle affectée aux
E.G. au sein de l'hôtel des Menus-Plaisirs, les délégués présents
proposent une vérification des pouvoirs et refusent de se constituer. Les
députés du Tiers se donnent en leur sein le nom de « Communes », et l'on dénombre 663 élus pour le troisième ordre sur 1.177 élus des trois ordres selon l'historien Guillaume Mazeau. Un
arrêt du Conseil d'État fait « défenses
à tous imprimeurs, libraires ou autres d'imprimer, publier et
distribuer aucun prospectus, journal ou autre feuille périodique sans
la permission du Roi. » (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la R.F., page page 314, tome 1)
7 mai : A
Versailles, au sein des élus du clergé, des curés décident d'avoir des commissaires amovibles pour échanger avec les autres ordres. Un arrêt du Conseil d'État interdit les écrits de M. Mirabeau
sur
les États-généraux, dont deux numéros paraissent les 6 et le 7.
8 mai : A Versailles, les électeurs du Tiers-état de Paris sont contre
les arrêts précédents et réclament la liberté de la presse.
Dimanche 10 mai : Le Cahier des citoyens nobles de la ville de Paris
est publié (une trentaine de feuillets). Ce texte plutôt novateur est
signé par le duc de la Rochetoucauld, Huguet de Semonville, le marquis
de Condorcet, le marquis de Lusignem, M. De Laclos, le comte de
Rochechouart, M. Ferran, le comte d'Espinchal, le marquis de
Montesquiou Fezensac, M. NicolaÏ en tant que premier président de la
Chambre des Comptes, M. Du Port, le comte de Riccé, et MM. Stanislas
comte de Clermont-Tonnerre comme président, puis Duval d'Esprémesnil,
comme premier secrétaire. (Source : Gallica-Bnf)
11 mai : La chambre ou assemblée de la noblesse se déclare constituée.
12 mai : A Versailles, il est tenu un service religieux à la mémoire de
Louis XV y assistent des députés des trois ordres. Les pouvoirs de la Noblesse sont vérifiés. A Paris, les
électeurs du Tiers commencent les élections du premier corps électoral,
Jean-Sylvain Bailly (futur maire en juillet) est élu dans son district.
13 et 15 mai : A Versailles, le comte d'Artois élu de la noblesse
reçoit
l'ordre du roi de ne pas être présent comme député aux E.G. Le
surlendemain, une lettre du comte d'Artois est lue devant les députés
des États-généraux, où il annonce renoncer à cette fonction,
après avoir chaudement remercié le baillage qui l'avait élu.
16 mai : L'ancien Garde des sceaux, Chrétien-François de Lamoignon décède dans son château de Basville à Saint-Chéron en Île de France.
17 mai : Louis XVI nomme Marie-Joseph Vien premier peintre du Roi. Il
entrera au Panthéon sous Napoléon en1809 lors de funérailles
nationales. Et semble être depuis le seul artiste présent sous son dôme.
18 mai : A Versailles, première intervention de Robespierre. Ce même
jour décède l'ancien garde des sceaux Lamoignon. (Lire l’année 1788)
19 mai : Une circulaire de M. de Maissemy invite les journalistes à
n'insérer aucun article concernant les États-généraux sans
communication et approbation préalables. Les journaux « autorisés » peuvent rendre compte des E.G. en se
limitant à des comptes-rendus, sans aucun commentaire. A Paris, les
élections sont terminées. Le clergé renonce à toute exemption fiscale.
20 mai : Le Clergé abandonne ses privilèges fiscaux.
19
au 22 mai : Aux abords de Paris, à la barrière de Clichy se produisent des
manifestations, la population ne veux plus payer les taxes de l'octroi.
Aux revenus fixés dans le rapport du 5 mai sur les finances, les
recettes de la Ferme générale sont de 4 millions de livres en 1788, pour les entrées de Paris incluses avec le tabac à la rubrique supplément.
22 mai : L’aristocratie accepte le principe de l'égalité devant
l'impôt. Dans le Nord à Armentières éclate une émeute de la faim,
réprimée par le prince de Bourbon-Condé.
23 : Versailles, Nicolas Ledoux, architecte des barrières d'octroi est révoqué
par M. Necker. La noblesse abandonne ses privilèges fiscaux.
24 mai : A noter, l'arrivée à Paris de Francisco de Miranda après son tour d'Europe.
23-25 mai : A Versailles, au bout de trois jours, la seconde conférence de conciliation et de vérification des pouvoirs reste sans suites entre les commissaires des trois ordres.
26 mai: Les articles de la Gazette de Leyde (Nouvelles extraordinaire de divers endroits) fait par Etienne Luzac sont dénoncés par la
noblesse, il s'agit d'une vieille publication imprimée aux Pays-Bas et qui date l'année 1677.
27 mai : Agitation à Paris et à Versailles, au moins 2.000 personnes se
mêlent aux élus du Tiers. De son côté, le bas du clergé, s'opposent aux
évêques, et se déclarent prêts à rejoindre les élus de la bourgeoisie.
Pour les élus de l’aristocratie, M. d'Eprémesnil devant l’ordre rappelle le
sort de Charles 1er d'Angleterre (décapité en janvier 1649).
28 mai : Lettre du Roi, il demande la reprise des conférences devant
des commissaires royaux. La noblesse déclare que la délibération par
ordre est « constitutive de la monarchie ». Aux élus du Tiers, les
députés bretons demandent que la chambre se constitue sur le champ et
soit déclarée « essentiellement nationale ».
29 mai : Après de longs débats, les trois ordres acceptent la reprise
des conférences et ils votent en faveur d'une adresse de Mirabeau au roi.
30
mai : La troisième réunion de conciliation entre les trois ordres
échoue. Il en sera de même les 3 et 4 juin en présence des commissaires
de Louis XVI.
31 mai : Dimanche de Pentecôte.
VI - Le mois de juin 1789
Lundi 1er juin : Michel-François d'Ailly,
député du bailliage de Chaumont-en-Vexin, est élu doyen des « Communes » ou des élus du Tiers-état.
2 juin : A Paris, La comédie lyrique en deux actes et en vers, Les Prétendus de Jean Baptiste Moyne dit Lemoyne, est jouée pour la première fois à l'Académie royale de musique.
3
juin : M. Bailly succède à M. d’Ailly
démissionnaire. Lors de la conférence de conciliation, la noblesse
refuse le terme de « Communes », et ne signe pas le procès-verbal.
Louis XVI accorde à Francisco Miranda un faux passe-port signé M. de
Meiroff.
4 juin : Mort du dauphin à Meudon, âgé de sept ans,
Louis-Joseph-François-Xavier était
né à Versailles le 22/10/1781. Le duc de Normandie Louis-Charles, né le
27/03/1785 devient à son tour Dauphin du royaume. A Versailles, M. Necker
propose une nouvelle « ouverture de conciliation » entre les ordres. A
Versailles, à la conférence des commissaires des trois ordres, en
présence des commissaires du roi, M. Necker propose un projet d'accord
: chaque ordre est appelé à vérifier les pouvoirs de ses membres ; en
cas de contestation, il sera procédé à un examen commun par les
commissaires des trois ordres qui en réfèreront à leurs commettants ;
en l'absence de compromis le roi pourrait décider.
5 juin : A Versailles, lors des E.G., le comte de Mirabeau, après avoir
constaté certaines inerties et en même temps, en remerciant
chaleureusement le monarque d'avoir convoqué les E.G., il conclue sa
réponse au roi par : « M.
d'Esprémenil renouvella ses réclamations sur le mot Communes, et se
réserva d'en parler en temps et lieu. Dieu veuille qu'il s'en acquitte
bientôt ! car, de jour en jour, les infractions se multiplient ; et, si
l'on n'y prend garde, dans très-peu de temps, le mot Tiers-état ne se
trouvera plus que dans les arrêtés de la Noblesse et leJournal de Paris. » (Source : Neuvième lettre à ses commettants de Mirabeau, page 23, consultable sur google livres) A l'assemblée des Communes, l'un des commissaires
fait son rapport sur la conférence du 4. M. Bailly qui préside, propose de
repousser de 24 heures le débat sur le projet de conciliation proposé
par les ministres. Les opinions se partagent. Finalement, il est décidé sans grande opposition « que la discussion sur le projet
présenté par les ministres, aurait lieu après la clôture du
procès-verbal des conférences, c'est-à-dire lorsqu'elles auraient pris
fin ».
6 juin : La noblesse accepte un plan de conciliation, mais des
amendements rendent le texte sans effet. Une députation du Clergé
invite le Tiers à délibérer sur les « besoins pressants du peuple ». Le
Tiers y voit une manœuvre, et invite le Clergé à se réunir à lui, pour
se constituer en chambre nationale.
7 juin : Il est rédigé un projet provisoire de règlement des « Communes » vers une assemblée unique.
8 juin : Au chateau de Meudon, des délégations des trois ordres s'y rendent pour un dernier hommage au Dauphin, et s'incliner devant sa dépouille. Son frère cadet Louis-Charles lui succèdera.
9 juin : A Versailles, lors de la dernière conférence de conciliation, la noblesse refuse de
signer.
10 juin : Les Communes ou élus du Tiers acceptent la motion de Sieyès de se constituer
en « assemblée active », d'appeler une dernière fois la noblesse et le
clergé à les rejoindre, et de commencer la vérification des pouvoirs.
11 juin : Le jour de la « Fête-Dieu », des députés des trois ordres
assistent à la procession.
12 juin : Une délégation des élus du Tiers se rend auprès des deux autres ordres. La
séance des députés attire une grande affluence. La Chambre de la noblesse nomme
son président, le duc de Luxembourg, celui-ci s'adresse au roi le suppliant de
« conserver l'ancienne constitution du royaume
». Lettre de Mme de Gouges, demandant à M. de Maissemy (libraire du
roi) une entrevue pour l'intéresser à la fondation de son journal. Ce
courrier restera sans suite. Nénmoins à l'occasion des E.G., elle rédige et publie un 4 pages, Mes voeux sont remplis, ou le don patriotique dédié aux États-généraux. (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la R.F., page page 315, tome 1)
13 juin : Funérailles du dauphin Louis-Joseph, les trois ordres suivent
l’enterrement. Le roi reçoit la délibération du 10. Trois
ecclésiastiques se joignent aux élus du Tiers.
14
juin : Six autres députés du clergé se joignent au Tiers, et les élus
de la Noblesse et du Clergé ne se rassemblent pas. Sur l'île du Timor, les habitants voient débarquer les rescapés du navire le H.M.S. Bounty de la Royal Navy.
Les marins de l'équipage s'étaient révoltés contre leur capitaine
William Blythe (abandonné seul dans une chaloupe). La mutinerie se
déroula fin avril, en voguant dans le Pacifique sud.
15 juin : A Versailles, les élus du Tiers s’interrogent sur le titre de leur
constitution: « représentants de la nation, connus et vérifiés », ou
« Assemblée du peuple français », ou « Assemblée de la plus grande partie
de la nation
»? L'abbé Sieyès fait remarquer qu'elle est le fruit des représentants
d'au moins les quatre-vingt-seize centièmes de la nation. Il propose
que l'Assemblée s'intitule « Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française. » Sa motion donne lieu à un important échange lors de plusieurs séances jusqu'à la décision du 17/06.
16 juin : Dans sa réponse à l'adresse du Tiers, envoyée depuis Marly
(actuel département des Yvelines), le roi désapprouve l'expression de « classes privilégiées »
pour désigner les deux premiers ordres, et demande la confiance. 4.000
personnes emplissent la salle dès 7 heures du matin. Plus de 20 prêtres tiennent encore séance. M. Legrand propose le nom d'« Assemblée nationale » ; 83 opposants empêchent la résolution.
17 juin : Les députés du Tiers-état, qui se voient refuser le vote par
tête (1 vote par député) au nom du vote par ordre, se proclament «
Assemblée nationale ». Mirabeau et d’autres élus vont complètement
changer la donne en faisant attention à ne pas sortir du cadre légal, la
peur d’une scission avec la noblesse et le clergé leur semble une
erreur à ne pas commettre. Leur objet est d’y inclure, la Nation dans
son ensemble ou sa majorité. Cet âpre débat donne un débat vif entre
les partisans d’une ligne légitimiste et souverainiste, entre Mirabeau
et Sieyès. Après un ajournement de nuit avant de laisser place à un
vote, il y a surtout des concessions de Mirabeau, permettant à la
motion de Sieyès d’être approuvée par une très confortable majorité de
491 pour et 90 contre. « Ce serment est prêté par 600 membres
environnés de 4.000 spectateurs, excite la plus grande émotion et forme
une cérémonie auguste et imposante ». (Le Moniteur - 17 juin 1789) Impôts : «
L’Assemblée nationale, considérant (…) qu’en effet, les contributions,
telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n’ayant pas
été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent
nulles dans leur création, extension ou prorogation. »
|
L’Assemblée nationale est née. Il en sort un casse-tête juridique,
mandat impératif ou mandat libre pour les élus? Le mandat impératif
aurait pu tout bloquer et devenant élu de la nation, la nature des
mandats n’étant plus dans la stricte observation des cahiers de doléances.
Ils deviennent des élus dans un ensemble commun effaçant toute forme de
disparité sociale (en apparence), et aussi les coupant de leurs bases,
ce à quoi ils devaient à l’origine s’en tenir sans accord préalable, ou
établi dans le mandat. Un coup de canif dans le contrat, donnant du
poids aux députés du Tiers, qui n’ont pas dit leur dernier mot. Du
moins, selon les souhaits de Sieyès et une volonté d’en découdre avec
l’aristocratie. Celle-ci est vue comme un agent de l’étranger et un
désir affiché de les voir partir.
|
18 juin : A Versailles, il n'y a pas de réunion, la séance est reportée en raison de la procession du Saint-Sacrement.
19 juin : Fondation
du journal Le Point du Jour, ou résultat de ce qui s'est passé la veille à l'Assemblée Nationale (consultable sur google livres) de Bertrand Barère de Vieuzac (avocat et
député du Tiers pour les États de Bigorre), qui est paru de
ce jour jusqu'au 1er octobre 1791. Ce périodique rendait compte des
discussions de l'Assemblée et ne paraIssait qu'en fonction des débats.

Serment du jeu de Paume avec au milieu et sur la table M. Bailly la main lévee pour le serment
20 juin : Serment du Jeu de Paume (tableau ci-dessus de Jacques-Louis David), les élus du Tiers jurent de ne pas
se séparer sans donner une constitution à la France. Puis dans les
jours suivants, le clergé puis la noblesse acceptent l’idée d’égalité
devant l’impôt. Au conseil du roi, Necker propose alors le vote par
tête, deux chambres, le veto absolu. Les députés du Tiers trouvent
la salle fermée, et gardée par les troupes, sur ordre du roi envoyé de
Marly en prévision d'une séance royale le 22. Sous la pluie, ils
gagnent le Jeu de Paume. Le serment est « de ne pas se séparer jusqu'à
l'affermissement de la constitution
»,
voté à l'unanimité, moins une
voix. L'Assemblée nationale admet dans ses rangs 9 députés non élus de
Saint-Domingue, à leur tête le marquis de Gouy d'Arsy. La députation
sera réduite à 6 membres, le 4 juillet. A ce sujet Louis XVI avait
refusé de convoquer les pays ou comptoirs de l'empire colonial pour les
E.G.
21 juin : Rejet du plan de M. Necker au Conseil du roi, ce dernier
annonce
à un groupe d’aristocrates qu'il gardera toute son autorité. Le député
Sieyès à l'Assemblée déclare au sujet des citoyens passifs, qui selon
lui ne peuvent devenir actifs, c'est-à-dire les femmes, les enfants,
les pauvres et les étrangers, celles et « ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent point influer sur la chose publique ».
22 juin : La séance royale est renvoyée au lendemain. L'Assemblée
nationale se réunit dans l'église Saint-Louis de Versailles, où se
joint la majorité du clergé, soit, 150 membres et 2 autres de la noblesse se joignent au tiers-état.
23 juin : Le roi fait ordonner aux élus de se disperser, il se voit
opposer de nouveau un refus d’obtempérer des députés. Au cours de la
séance, sur proposition de Mirabeau, les « Communes » se déclarent
inviolables.
24 juin : Le carrosse de l'archevêque de Paris est caillassé. A
Versailles, des cris se manifestent pour protester contre les gardes
armés, qui interdisent à la foule l'entrée de la salle des Menus Plaisirs. Surgit une
motion
de Mounier, il demande au roi d'éloigner les troupes et il précise que
l'Assemblée des élus de la nation doit avoir leur propre police, et si
le roi ne fait rien ou persiste, l'Assemblée changera de lieu.
25 juin : Une députation calme les curieux voulant forcer l'entrée de
la salle. 47 représentants de la noblesse ce jour s’unissent aux élus
du Tiers. Une assemblée unique va ainsi se créer avec les élus du Tiers
et des membres du clergé, ils deviennent majoritaires. Toutefois
l’assemblée des 1.200 députés sera conservée, ils seront ramenés au
nombre de 745 au sein de la Législative, plus tardivement en septembre 1791. La
minorité de la noblesse est menée par le duc d'Orléans, et ils
sont reçus sous les acclamations. A Paris, on tire des fusées dans les
jardins du Palais-Royal.
26 juin : Les évêques d'Orange et d'Autun (Talleyrand), trois curés,
puis l'archevêque de Paris rejoignent eux aussi l'Assemblée. L’ordre
est donné à six régiments de se mettre en mouvement.
27 juin : Le roi fini par céder, il engage le clergé et la noblesse à se réunir avec les élus du tiers
(réunion des 3 ordres). Les nobles font leur entrée à 5
heures du soir, dans un silence glacial. A Paris se soulève une
allégresse et des, « Vive le roi, vive Necker », « vive M. de
Montmorin ! » A Versailles, un grand nombre de députés et la foule se
rendent sous les fenêtres du roi, Louis XVI se présente au balcon avec la
reine. Suivront des illuminations pendant trois nuits.
Dimanche 28 juin : La foule parisienne fraternise avec la troupe.
29 juin : Différents échanges administratifs de courrier sur le blé
font part de la difficulté d'approvisionner la ville de Paris en grain.
30
juin : Du côté de l'Assemblée à Versailles, il est fait état de
nombreuses protestations de députés
nobles contre tout ce qui s'est fait sans leur concours. Le premier
président des séances parlementaires de la Constituante est M. Bailly.
Les adresses
de félicitations commencent à arriver des provinces. A Paris, le petit
peuple
force la prison de l’abbaye Saint-Germain et délivre des
gardes-françaises détenus pour indiscipline. Et ils sont invités,
alimentés et logés, au-dessus du café de Foy aux jardins du
Palais-Royal, propriété privée du duc d'Orléans. Pendant plusieurs
jours, ils seront une attraction pour le tout
Paris aisé et populaire. Les jardins rassemblent chaque jour
plusieurs
milliers de personnes, et toutes classes ou castes confondues.
VII - Le mois de juillet 1789
|
Mercredi
1er juillet :
De nouveaux régiments prennent position autour
de Paris, sous les ordres du maréchal de Broglie, nommé ce même jour
commandant en chef de l'armée avec des pouvoirs étendus, et le roi fait
appel à un régiment suisse présent à Metz. Vingt jeunes gens
parisiens viennent demander à l'Assemblée la grâce des
gardes-françaises et s'ensuit une
députation de l'Assemblée au roi pour implorer sa clémence. M. Moreau
de Saint-Méry, colon martiniquais, devient devient le président de l’Assemblée générale des Électeurs parisiens.
A noter que l'Assemblée nationale avait réuni préalablement, le
prévôt des marchands, les échevins, les délégués du Roi et les
électeurs, et leur demanda de se constituer en un Comité des Electeurs
ou Comité de l'Hôtel-de-Ville, siégeant en permanence et très largement
dominé par les Electeurs. Et cette assemblée des Electeurs sera
acceptée et reconnue par Louis XVI.
Petits métiers de Paris - ci-contre un porteur d'eau
|
|
 |
2 juillet : Lecture à l'Assemblée de la lettre de grâce du roi. A Lyon, la célébration d'un Te deum
provoque la
colère chez les habitants, en raison des nouvelles qui parviennent de
la ville de Paris, face aux demandes des E.G non reconnues par la prévôté
royaliste lyonnaise, ceux-ci s'attaquent en retour aux
barrières d'octroi de la ville (pillages et destructions diverses).
L'émeute
populaire durera jusqu'au 5 juillet, quatre jours après la municipalité
prend une ordonnance contre les brigands qui se sont attaqués aux
barrières. Et la révolte sera réprimée avec force jusqu'au 14
juillet par l'armement d'une milice bourgeoise dite des Muscadins et l'envoi d'un régiment des Dragons caserné à la Croix-Rousse, ainsi que le régiment suisse de Sonnenberg.
3 juillet : A Versailles, le duc d'Orléans refuse la présidence de l'Assemblée,
l'archevêque de Vienne, Lefranc de Pompignan, le remplace. La noblesse
se réunit encore à part, pour demander la conservation des droits
constitutionnels de la monarchie.
4 juillet : Jean-Georges Lefranc de Pompignan, archevêque et comte de
Vienne est désigné président de la Constituante jusqu'au 12.
L'Assemblée, après de longs débats, décide que
Saint-Domingue aura 6 députés. En Bretagne à Fougères, les ouvriers
cloutiers et tisserands se révoltent contre les propriétaires fonciers
vendant leur blé hors de la ville. Dans la ville de Paris le marquis de Sade
est transféré de la prison de la Bastille à l'asile de Charenton. Et Olympe de Gouges rédige une Lettre au duc d'Orléans : « Plusieurs
personnes sont étonnées que je n’ai point obtenu encore le privilège du
Journal du peuple ; ce journal , vous le savez Monseigneur, ne peut que
calmer son effervescence et le porter vers le bien, et cependant il ne
m’est pas encore accordé, on m’engage, on me presse de le demander aux
États-généraux. »
5 juillet : Antoine-Joseph Gorsas lance un périodique d'environ 16 feuillets par jour : Le courrier de Versailles à Paris et de Paris à Versailles (fin du titre le 17 octobre 1789, qui deviendra à partir d'août 1790 Le courrier de Paris dans les 83 départements).
6 juillet : En Bretagne, les artisans et compagnons de Vitré accusent
la
municipalité de favoriser la hausse des prix du blé. Arrivée du prince
de Lambesc, Charles Eugène de Lorraine, avec ses troupes privées du
Royal-allemand au chateau de la Muette, près de Paris.
7 juillet : A Lyon, un Savoyard est condamné à mort pour avoir incendié
la barrière de Perrache.
8 juillet : A Paris, l'après-midi des troupes du prince de Lambesc
mettent fin à des échaffourés près de la barrière de Montmartre avec la
population et protègent les employés de la Ferme. A Versailles, à
l'Assemblée sous la présidence de l'évêque de Vienne, M. de Pompignan,
après quelques interventions, le Comte de Mirabeau s'empare de la parole
et dit :
« Avant
de vous occuper de l'objet souverainement important que je vais vous
soumettre, je dois rétracter le mot de propositions, que j'ai hasardé
l'autre jour, relativement à une négociation américaine pour les
subsistances. Je suis porteur d'une lettre de M. Jefferson, où il
déclare qu'il n'a point fait de propositions à ce sujet, et même que,
sur la réquisition du directeur général des finances, il prévint, il y
a plusieurs mois, les Américains que la France ferait un excellent
marché pour les grains et les farines. Il n'en est pas moins vrai que
les intentions du gouvernement ont été très-mai suivies par la faute
des sous-ordres, et qu'une profonde ignorance et le défaut de concert
dans la distribution des primes ont privé la France des denrées
américaines. Une multitude de faits du même genre qui sont parvenus à
ma connaissance jetteront un grand jour soit sur le commerce des
grains, soit sur la théorie de ce commerce, et démontreront toujours
mieux combien l'Assemblée nationale doit se garder d'aucune déclaration
législative à ce sujet, tant que cette grande question n'est pas
profondément instruite. Ces faits et leurs conséquences seront l'objet
d'un travail que je vous demanderai incessamment la permission de vous
présenter. »
M. de Mirabeau dépose sur le bureau la lettre de M. Jefferson. Et il
reprend la parole jusqu'à la fin des débat du jour et demande le renvoi des troupes dans la ville de Paris et se fait
ovationner par l'hémicycle, soutenu par M. de Lafayette,
9 juillet : L’Assemblée nationale sise à Versailles est réunie en raison de la crise financière, elle se déclare assemblée Constituante.
Le comte de Mirabeau présente une motion pour que soit fait une Adresse au roi
(à lire après la chronologie), lue aux députés, qui à la fin
l'ovationnent. Mirabeau veut faire entendre les fortes inquiétudes de
la chambre, à savoir, les troupes autour de Paris et de Versailles,
depuis le 26 juin, et pour lui demander un renvoi rapide de ses
soldats. La motion est adoptée à l'unanimité, moins quatre voix. Puis, M. Mounier fait part du travail du comité sur les travaux et leur répartition entre trente
bureaux qui élaboreront la constitution. Près de Paris, à peu de distance de la barrière de Montmartre durant la nuit, suite à une inspection menée chez un particulier, se déroule un accrochage entre les commis de la Ferme et la population appelée en soutien. Les employés des Fermiers Généraux sont obligés de fuir.
10 juillet : A Versailles, le roi reçoit la députation lui portant
l'adresse de
Mirabeau, il déclare ne vouloir que le maintien de l'ordre, et propose
à l'Assemblée son transfert à Noyon ou à Soissons. A l'Assemblée, le
comité de constitution soutient l'idée d'une déclaration des Droits
pour précéder la Constitution (effectif le 26 août). A Argenteuil, décède le marquis Victor de Mirabeau, le
père. A Paris dans la soirée, «
vers 21 heures, à la barrière Papillon, des pierres, lancées d’un
immeuble, s’abattirent sur les employés alors que ceux-ci fouillaient
un individu soupçonné de transporter des vessies d’eau-de-vie. Les
commis s’abritèrent précipitamment dans leur bureau. Le même soir vers
23 heures, à la barrière Saint-Georges et des Trois-Frères, les
employés placèrent deux roulettes d’observation (des guérites) rue
Saint-Lazare, près de la rue La Rochefoucauld, ayant constaté depuis
plusieurs nuits que des marchandises étaient introduites en fraude dans
la ville. Une dizaine d’individus s’approcha d’une des roulettes ; ils
s’adressèrent calmement au sous-brigadier, lui indiquant que, dans
moins de 24 heures, elles n’y seraient plus. » (La Révolution aux barrières, M. Markovic, Annales Hist. de la Rév.Fr., n°312)
Samedi 11 juillet : Depuis Versailles, Louis XVI renvoie M. Necker et fait rappeler la troupe, s'ensuivent des
troubles dans la ville de Paris, « à
10 heures, la barrière Saint-Martin connut les premiers véritables
soubresauts. Un scénario analogue à ce qui s’était produit la veille à
la barrière Papillon ébranla les employés dont le bureau échappa de peu
à un incendie. À l’annonce de l’arrestation d’un homme qui transportait
des vessies d’eau-de-vie, les employés virent s’abattre sur leur bureau
une troupe de plusieurs centaines d’individus, armés de pioches, de
pelles, de grosses pierres et de pavés. Les premiers « vive le
Tiers-état » se font entendre, relayés par des avertissements à
l’encontre des employés que la population menaçait de brûler. Des
hommes et des femmes pénétrèrent dans le bureau, vidèrent les armoires,
foulant aux pieds les effets des commis, brisèrent les vitres et
commencèrent à casser les cloisons à coups de massues. Ils
envisageaient de mettre le feu au bureau mais un détachement de
gardes-françaises arriva sur les lieux, ce qui dissuada les émeutiers
de continuer leur besogne. » (La Révolution aux barrières, M. Markovic, Annales Hist. de la Rév.Fr., n°312) Après l'envoi d'une délégation de l'Assemblée auprès du roi, il est
déclaré par l'intermédiaire de son garde des sceaux en son nom, que : « Personne
n'ignore les désordres et les scènes scandaleuses qui se sont passées,
et se sont renouvelées à Paris et à Versailles, sous mes yeux et sous
ceux des États-généraux ; il est nécessaire que je fasse usage des
moyens qui sont en ma puissance pour remettre et maintenir l'ordre dans
la capitale et dans les environs. C'est un de mes principaux devoirs de
veiller à la sûreté publique : ce sont ces motifs qui m'ont engagé à
faire un rassemblement de troupes autour de Paris. Vous pouvez assurer
l'Assemblée des États-généraux qu'elles ne sont destinées qu'à
réprimer, ou plutôt à prévenir de nouveaux désordres. (...) Si
pourtant la présence nécessaire des troupes dans les environs de Paris
causait encore de l'ombrage, je me porterais, sur la demande des États-généraux, à les transférer à Noyon ou à Soissons ; et alors je me
rendrais moi-même à Compiègne, pour maintenir la communication qui doit
avoir lieu entre l'Assemblée et moi. » Suite au départ du ministre, un nouveau
ministère est dirigé par M. de Breteuil. Devant la Constituante, le citoyen Lafayette présente un projet reprenant l'idée de la veille du comité de constitution et déclare que : « Quoique
mes pouvoirs m'ôtent la faculté de voter encore parmi vous, je crois
cependant devoir vous offrir le tribut de mes pensées. (...) Le
mérite d'une déclaration des droits consiste dans la vérité et la
précision ; elle doit dire ce que tout le monde sait, ce que tout le
monde sent. C'est cette idée, Messieurs, qui seule a pu m'engager à
tracer une esquisse que j'ai l'honneur de vous présenter. » (Lire son projet ci-dessous) En Normandie, à Rouen éclate une émeute de la faim
déclenchée par les ouvriers du textile.
|
M. le marquis
de Lafayette
fait lecture
du projet qui suit :
Ci-contre : gravure d'Edme Quenedey
|
|
|
« La nature a fait les
hommes libres et égaux ; les distinctions nécessaires à l'ordre social
ne sont fondées.que sur l'utilité générale. Tout homme naît avec des droits inaliénables et
imprescriptibles ; telles sont la liberté de toutés ses opinions, le
soin de son honneur et de sa vie ; le droit de propriété, la
disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses
facultés ; la communication de ses pensées par tous les moyens
possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression.
L'exercice des droits naturels n'a de bornes que
celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.
Nul homme ne peut être soumis qu'à des lois consenties par lui ou ses
représentants, antérieurement promulguées et légalement appliquées. Le
principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul
individu ne peut avoir une autorité qui n'en émane expressément.
Tout gouvernement a pour unique but le bien commun.
Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
soient distincts et définis, et que leur organisation assure la
représentation libre des citoyens, la responsabilité des agents et
l'impartialité des juges.
Les lois doivent être claires, précises, uniformes
pour tous les citoyens. Les subsides doivent être librement consentis
et proportionnellement répartis. Et comme l'introduction des abus et le
droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout
établissement humain, il doit être possible à la nation d'avoir, dans
certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont le seul
objet soit d'examiner et corriger, s'il est nécessaire, letf vices de
la constitution. »
Source : Bib. de Stanford - Archives Parlementaires, tome VIII, page 219
|
Dimanche 12 et lundi 13 juillet : En Bourgogne, l'on fait état d'un soulèvement à Autun contre la hausse du
prix des céréales. A Paris, c'est l'édition en préparation ou daté à ce jour, du premier numéro de l'hebdomadaire des Révolutions de Paris
(jusqu'au 17 juillet et incluant un récit de la prise de la Bastille)
de Louis-Marie Prudhomme, qui selon Camille Desmoulins reçut un grand
succès dès sa première vente (parution sans discontinuité jusqu'en
avril 1794). Pareillement, il faut noter la parution du Journal politique-national
de M. l'abbé de Sabatier de Castres (qui prendra pour pseudonyme le nom
de M. Salomon, avec pour contibuteur Antoine de Rivarol. Le périodique
cessera ses activités en 1790). (Sources : Gallica-Bnf) Des troubles éclatent aux jardins du Palais-Royal et
suivie d'une charge du Royal-Allemand dans la nuit, les émeutes se
propagent et les
portes de Paris sont attaquées. Quarante des cinquante enceintes ou
entrées de la ville seront incendiées par la fureur populaire, qui
va se déchaîner dans la cité durant ces deux journées. « À
la barrière de Clichy, le 12, en milieu d’après-midi, les commis
assistent aux mêmes scènes qui voient les barrières saccagées par une
masse importante d’individus toujours armés d’instruments contondants
et tranchants. Ce sont ainsi les barrières de la partie septentrionale
qui subissent les premiers assauts. Des scènes identiques se répètent
les jours suivants aux quatre points cardinaux de la capitale. Les
barrières sont pillées, saccagées, détruites. Quelquefois, un deuxième
assaut s’avère nécessaire où après avoir, dans un premier temps,
dévasté les bâtiments, ces derniers sont ensuite incendiés quelques
heures plus tard ou le lendemain, lorsqu’il n’y a plus de menaces
d’intervention des troupes. » (Les barrières de la Révolution, M. Markovic, Annales Hist. de la Rév. Fr., n°312) Les
barrières d’octrois étaient l’équivalent d’un péage, elles vont être
sans activités autres que celles de la police jusqu’en 1798. Il ne sera exercer
qu’un contrôle sur les entrées
et les sorties des voyageurs ou résidents. Les barrières ou
l’équivalent de portes imposantes ceinturaient la ville et en
permettaient l’accès, elles furent construites à l’origine sur un
plan
délimitant l’espace de la de la ville de Paris fait par l’architecte Nicolas
Ledoux, qui nomma cet ensemble architectural : Les Propylées de Paris. Les élus des districts prennent place au sein de l’Hôtel de
Ville et commencent à tenir siège. Pour indication, jusqu’alors les
locaux de la Mairie (centrale) se trouvait en lieu et place du fameux Quai des Orfèvres...
Le 13, à l'Assemblée nationale qui se tient à la salle des Menus
Plaisirs à Versailles (jusqu'en octobre), Gilbert de Lafayette est élu
vice-président de la Constituante.
 Scène d'émeute du 12 juillet - la charge de Lambesc aux Tuileries - Dessin de Prieur
Scène d'émeute du 12 juillet - la charge de Lambesc aux Tuileries - Dessin de Prieur
Mardi 14 juillet : Île de France, il n’est pas possible de faire état d’une scène précise,
mais de plusieurs qui vont rassembler plusieurs dizaines de milliers de
citoyens en colère et désireux d’avoir des armes. Des délégations citoyennes vont se voir
depuis le 13 juillet promenéés par les manœuvres du prévôt M. Jacques de Flesselles
depuis l’Hôtel de Ville. Celui-ci tente de retarder ou de calmer les
ardeurs collectives. Avec l'attaque des Invalides, ce sont 40 à 50.000 parisiens
qui s’emparent des lieux et rudoient quelques anciens militaires. Les
scènes tournent au pillage, au final des canons sont saisis et au moins
28.000 fusils, mais sans la poudre. Pour la prise de la Bastille,
seul un petit millier d’assaillants seront reconnus comme des héros
ayant fait tomber le symbole. Ils gagneront une reconnaissance pour avoir
été présents sur les lieux et assisteront à la Fête de la fédération
en grande pompe l’année suivante. De l'autre côté de la Manche, le roi d'Angleterre Georges
III prend ce jour un bain de mer.

à suivre...
|
|
|
ADRESSE AU ROI
du Comte Honoré-Gabriel de Mirabeau
Lue à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1789
*
Ci-contre : Statue de Jean-Marie Pigalle,
Mirabeau à la tribune (Musée Carnavalet)
|
|
 |
Sire, vous avez invité l'Assemblée nationale à vous témoigner sa confiance : c'était aller au-devant du plus cher de ses vœux.
Nous venons déposer dans le sein de Votre Majesté les plus vives alarmes.
Si nous en étions l'objet, si nous avions la faiblesse de craindre pour
nous-mêmes, votre bonté daignerait encore nous rassurer, et même, en
nous blâmant d'avoir douté de vos intentions, vous accueilleriez nos
inquiétudes ; vous en dissiperiez la cause ; vous ne laisseriez point
d'incertitude sur la position de l'Assemblée nationale.
Mais, Sire, nous n'implorons point votre protection ; ce serait
offenser votre justice : nous avons conçu des craintes ; et, nous
l'osons dire, elles tiennent au patriotisme le plus pur, à l'intérêt de
nos commettants, à la tranquillité publique, au bonheur du monarque
chéri, qui, en nous aplanissant la route de la félicité, mérite bien
d'y marcher lui-même sans obstacle.
Les mouvements de votre cœur, Sire, voilà le vrai salut des Français.
Lorsque des troupes s'avancent de toutes parts, que des camps se
forment autour de nous, que la capitale est investie, nous nous
demandons avec étonnement : le Roi s'est-il méfié de la fidélité de ses
peuples? S'il avait pu en douter, n'aurait-il pas versé dans notre cœur
ses chagrins paternels? Que veut dire cet appareil menaçant? Où sont
les ennemis de l'État et du Roi qu'il faut subjuguer? Où sont les
rebelles, les ligueurs qu'il faut réduire? Une voix unanime répond dans
la capitale et dans l'étendue du royaume ; Nous chérissons notre Roi ;
nous bénissons le ciel du don qu'il nous a fait dans son amour.
Sire, la religion de Votre Majesté ne peut être surprise que sous le prétexte du bien public.
Si ceux qui ont
donné ces conseils à notre Roi, avaient assez de confiance dans leurs
principes pour les exposer devant nous, ce moment amènerait le plus
beau triomphe de la vérité.
L'État n'a rien à redouter que des mauvais principes qui osent assiéger
le trône même, et ne respectent pas la conscience du plus pur, du plus
vertueux des princes. Et comment s'y prend-on, Sire, pour vous faire
douter de rattachement et de l'amour de vos sujets? Avez-vous prodigué
leur sang? Etes-vous cruel, implacable? Avez-vous abusé de la justice?
Le peuple vous impute-t-il ses malheurs? vous nomme-t-il dans ses
calamités ? Ont-ils pu vous dire que le peuple est impatient de votre
joug, qu'il est las du sceptre des Bourbons? Non, non, ils ne l'ont pas
fait : la calomnie du moins n'est pas absurde ; elle cherche un peu de
vraisemblance pour colorer ses noirceurs.
Votre Majesté a vu récemment tout ce qu'elle peut pour son peuple , la
subordination s'est rétablie dans la capitale agitée ; les prisonniers
mis en liberté par la multitude, d'eux-mêmes ont repris leurs fers ; et
l'ordre public, qui peut-être aurait coûté des torrents de sang si l'on
eût employé la force, un seul mot de votre bouche l'a rétabli. Mais ce
mot était un mot de paix, il était l'expression de votre cœur, et vos
sujets se font gloire de n'y résister jamais. Qu'il est beau d'exercer
cet empire! C'est celui de Louis IX, de Louis XII, d'Henri IV. C'est le
seul qui soit digne de vous.
Nous vous
tromperions, Sire, si nous n'ajoutions pas, forcés par les
circonstances : cet empire est le seul qu'il soit aujourd'hui possible
en France d'exercer. La France ne souffrira pas qu'on abuse le meilleur
des Rois et qu'on l'é-carte, par des vues sinistres, du noble plan
qu'il a lui-même tracé. Vous nous avez appelés pour fixer, de concert
avec vous, la constitution, pour opérer la régénération du royaume :
l'Assemblée nationale vient vous déclarer solennellement que vos vœux
seront accomplis, que-vos promesses ne seront point vaines, que les
pièges, les difficultés, les terreurs ne retarderont point sa marche,
n'intimiderons point son courage.
Où donc est le danger des troupes, affecteront de dire nos ennemis?...
Que veulent leurs plaintes, puisqu'ils sont inaccessibles au
découragement?
Le danger, Sire, est pressant, est universel, est au delà de tous les calculs de la prudence humaine.
Le danger est pour
le peuple des provinces. Une fois alarmé sur notre liberté, nous ne
connaissons plus de frein qui puisse le retenir. La distance seule
grossit tout, exagère tout, double les inquiétudes, les aigrit, les
envenime.
Le danger est pour la capitale. De quel œil le peuple, au sein de
l'indigence et tourmenté des angoisses les plus cruelles, se verra-t-il
disputer les restes de sa subsistance par une foule de soldats
menaçants? La présence des troupes échauffera, ameutera, produira une
fermentation universelle ; et le premier acte de violence, exercé sous
prétexte de police, peut commencer une suite horrible de malheurs.
Le danger est pour les troupes. Des soldats français, approchés du
centre des discussions, participant aux passions comme aux intérêts du
peuple, peuvent oublier qu'un engagement les a faits soldats, pour se
souvenir que la nature les fît hommes.
Le danger, Sire, menace les travaux qui sont notre premier devoir, et
qui n'auront un plein succès, une véritable permanence, qu'autant que
les peuples les regarderont comme entièrement libres. Il est d'ailleurs
une contagion dans les mouvements passionnés. Nous ne sommes que des
hommes : la défiance de nous-mêmes, la crainte de paraître faibles,
peuvent entraîner au delà du but ; nous serons obsédés d'ailleurs de
conseils violents et démesurés; et la raison calme, la tranquille
sagesse, ne rendent pas leurs oracles au milieu du tumulte, des
désordres et des scènes factieuses.
Le danger, Sire, est plus terrible encore ; et jugez de son étendue par
les alarmes qui nous amènent devant vous. De grandes révolutions ont eu
des causes bien moins éclatantes ; plus d'une entreprise fatale aux
nations s'est annoncée d'une manière moins sinistre et moins formidable.
Ne croyez pas ceux
qui vous parlent légèrement de la nation, et qui ne savent que vous la
représenter, selon leurs vues, tantôt insolente, rebelle, séditieuse,
tantôt soumise, docile au joug, prompte à courber la tête pour le
recevoir. Ces deux tableaux sont également infidèles.
Toujours prêts à vous obéir, Sire, parce que vous commandez au nom des
lois, notre fidélité est sans bornes, comme sans atteintes.
Prêts à résister à tous les commandements arbitraires de ceux qui
abusent de votre nom, parce qu'ils sont ennemis des lois ; notre
fidélité même nous ordonne cette résistance, et nous nous honorerons
toujours de mériter les reproches que notre fermeté nous attire.
Sire, nous vous en
conjurons au nom de la patrie, au nom de votre bonheur et de votre
gloire ; renvoyez vos soldats aux postes d'où vos conseillers les ont
tirés ; renvoyez cette artillerie destinée à couvrir vos frontières ;
renvoyez, surtout, les troupes étrangères, ces alliés de la nation, que
nous payons pour défendre et non pour troubler nos foyers : Votre
Majesté n'en a pas besoin. Eh! pourquoi un Roi, adoré de 25 millions de
Français, ferait-il accourir à grands frais autour du trône quelques
milliers d'étrangers? Sire, au milieu de vos enfants ; soyez gardé par
leur amour : les députés de la nation sont appelés à consacrer avec
vous les droits éminents de la royauté sur la base immuable de la
liberté du peuple. Mais ; lorsqu'ils remplissent leur devoir,
lorsqu'ils cèdent à leur raison, à leurs sentiments, les
exposeriez-vous au soupçon de n'avoir cédé qu'à la crainte? Ah!
l'autorité que tous les cœurs vous défèrent est la seule pure, la seule
inébranlable; elle est le juste retour de vos bienfaits, et l'immortel
apanage des princes dont vous serez le modèle.
O n demande que l'adresse soit incessamment présentée au Roi par une députation de vingt-quatre membres. En
conséquence, M. le président nomme pour composer la députation : pour
le clergé, MM. l'archevêque de Vienne, l'évêque de Chartres, les abbés
Joubert, Chatizel, Grégoire et Yvernault ; pour la noblesse, MM. le duc
de la Rochefoucauld, le marquis de Crécy, le vicomte deToulongeon, le
marquis de Blacons, le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre; pour les
communes, MM. le comte de Mirabeau, Corroler, Kegnault de Saint-Jean
d'Angély, Robespierre, Marquis, Barrière de Vieuzac, de Séze, Delaunay,
Pétion de Villeneuve, Buzot, de Kervélégan et Tronchet.
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS
& POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES
Sous la direction de M. J. MAVIDAL et MM. E. LAURENT ET E. CLAVEL
TOME VIII - Du 5 MAI 1789 au 15 SEPTEMBRE 1789 - pages 211 à 213
|
|
|
|
|
|
Le renvoi de M. Necker
(11 juillet 1789)
Louis-Sébastien Mercier (ci-contre en gravure)
|
 |
|
«
Le livre des grands événements par les petites causes n'est pas encore
seulement commencé, et c'est parce que je l'ai longtemps médité, que je
ne vais pas chercher bien loin ce qui a engendré un fait
quelconque,lorsque le jour d'hier est quelquefois son véritable
générateur. Les ordres privilégiés qui avaient bien voulu par
condescendance n'employer que la mauvaise foi, la ruse et quelques
petites menées pour répandre dans les provinces la division, la disette
et même la famine, et opérer la dissolution de l'Assemblée nationale,
voyant qu'elle se familiarisait jusqu'à vouloir établir les droits de
l'homme, résolurent d'associer le plaisir de la vengeance avec
l'orgueil de l'empire, d'en imposer tout à la fois à la capitale et de
braver l'armée entière.
Ils traitèrent de bourgeois six cents pauvres députés presque écrasés
sous le poids de la calamité nationale, et tout étonnés que le tiers
état ne fût point disposé
à endurer les humiliations qu'on lui avait
fait tant de fois essuyer dans les assemblées des règnes antérieurs,
ils décrétèrent dans leur comité secret que le ministre des finances
serait chassé avec éclat, qu'on se rendrait maître de Paris et de cette
bourgeoisie assemblée ; que s'il s'y trouvait des mutins, ils seraient
dispersés, n'importe comment ; enfin que les mots d'États-généraux,
d'Assemblée nationale seraient désormais effacés de tous les
dictionnaires français. Vingt-cinq à trente mille hommes à cheval et à
pied eurent ordre de se rendre aux environs de Paris et de Versailles ;
mais était-on bien sûr des militaires qui raisonnaient le commandement
et qui s'indignaient qu'on ne voulût faire d'eux que des instruments de
servitude?
Il fut dit qu'on ferait une répétition de cette sanglante tragédie. On
souleva les ouvriers d'une manufacture au faubourg de Saint-Antoine, on
y fit mettre le feu afin d'avoir occasion de faire marcher les
gardes-françaises et les gardes suisses contre les prétendus révoltés,
et de paraître protéger les propriétés et les maisons contre les
incendiaires. La répétition se fit à merveille: on fit feu, on en
blessa autant qu'on en voulut, et l'incendie des barrières fut aussi
ordonné pour servir de prétexte à la formidable introduction des
troupes. Cependant les grands enfants étaient si appliqués à tromper,
qu'ils ne s'aperçurent pas qu'ils se trompaient eux-mêmes. Ils n'eurent
pas la patience, dans toute cette belle entreprise, d'attendre
l'arrivée de toutes les troupes. Ils précipitèrent le renvoi de M.
Necker le samedi au soir du 11 juillet. Il eut ordre de sortir du
royaume sous vingt-quatre heures et à petit bruit. C'était donner le
signal de la banqueroute, et à la suite de la séance royale et de la
cour plénière, c'était rallier tous les esprits à l'insurrection.
L'armée des agioteurs se rassembla au Palais Royal ;
l'on vit un homme monter sur une table, animé de cette audace du
moment, de cette audace qui fait tout, tirer deux pistolets de ses
poches, haranguer le peuple, lui crier : « Notre ruine est prononcée ;
voyez ce qui se passe aux Champs Élysées; les troupes s'emparent de
tout l'espace qui se trouve entre l'Étoile de Chaillot et les
Tuileries, elles s'y rangent en bataille; nous avons assez délibéré ,
dé libérons par bras,nous sommes les plus nombreux et nous serons les
plus forts : armons-nous ; que tous nos citoyens s'arment, partons! » Et
ils sortirent en foule. Il avait détaché un rameau de l'arbre qui
l'ombrageait ; ce rameau se transforma en une cocarde verte ; chaque
boutonnière d'habit eut un ruban vert. C'était la couleur de
l'espérance. Mais bientôt on fit la réflexion que les couleurs d'Artois
étaient vertes ; on prit les couleurs des armes de la ville de Paris :
de là la cocarde tricolore, qui fera le tour du monde à raison des
obstacles qu'on lui opposera.
On sonne le tocsin, on dépouille les boutiques des armuriers et des
fournisseurs, on cherche partout des armes, on établit des ateliers, on
organise des districts. Le marteau résonne, étend ou courbe le fer ;
tous les instruments de cuisine sont emmanchés ; une foule innombrable
se porte aux Invalides, y prend tous les fusils, et, au grand
étonnement des militaires, ne commet point de désordre ; on traversa
des caves pleines de vins sans y toucher : on ne voulait que des armes,
on traînait les canons du plus gros calibre, et ils marchèrent comme
par enchantement. Des canonniers experts auraient demandé deux jours
pour opérer ce qui fut fait en trois heures.
|
Tandis que M. Necker (ci-contre) s'éloignait tranquillement dans sa chaise de
poste, son renvoi avait décidé le plus grand soulèvement et le plus
rapide dont l'histoire fasse mention. Quelle nuit du lundi au mardi!
Des patrouilles qui se succédaient et se croisaient de quinze en quinze
pas! une multitude agitée par la crainte, l'incertitude et
l'indignation! un murmure vague accompagné de coups qu'on frappait sans
objet déterminé sur les portes et les boutiques! ce son triste,
monotone et continu de toutes les cloches d'une immense capitale! ce
tocsin au milieu des ténèbres semblait appeler la colère et la
vengeance d'un grand peuple pour briser un trône.... Quelle nuit!... et
vous tous, princes, ministres et administrateurs des empires, qui
n'avez pas entendu ce tocsin, attendez-vous à l'entendre sonner au
premier attentat contre la liberté. |
|
|
Hé! ce tocsin de la capitale se fit entendre d'un bout de l'empire à
l'autre. Une puissance invisible frappait partout sur cette terre
d'oppression,et partout l'on voyait sortir de son sein des hommes tout
armés. Et à quoi tenait ce grand mouvement ? Le dirai-je? A une
divinité qu'on appelle la peur! La cour avait épouvanté la capitale par
un appareil de guerre : il en naquit cette journée mémorable, qui fut
toute grande, toute sublime et la plus majestueuse dont parlera
l'histoire ».
tome I, chapitre XII, édité par Poulet-Malassis (Paris 1862).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cet espace d'expression citoyen
n'appartient à aucune organisation politique, ou entreprise
commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
Les
articles et textes de Lionel Mesnard sont sous la mention tous droits réservés
Ils ne peuvent faire l'objet d'une reproduction sans
autorisation
Les autres articles ou vidéos sont sous licence
Creative Commons 3.0 et 4.0 (audio)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.fr
|
|
| Adresses et courrier : |
|
|
|
| Courrier
électronique |
lionel.mesnard(AT)free.fr
|
|
|
|
|
|
Archives des vidéos en ligne :
|
| Dailymotion - Pantuana.tv - Youtube |
|
|
|
|
|
|
|