|
|
|
Cliquez ci-dessus pour revenir à la page d'accueil
|
|
|
Sommaire du
bloc-notes n°2 - année 2016,
1 - Que se passe-t-il au Venezuela? & La mort heureuse de Bolivar, par Rafael Marron-Gonzalez.
2- 145 années après : Réhabilitation des Communards par l'Assemblée nationale (1871-2016)
3 - Bolivar et Miranda & petites affaires diplomatiques franco-vénézuéliennes ? (1897)
4 - Simon Bolivar à Paris, par Louis Guilaine (1912)
5 - «L’épée de Bolivar»
ou Mélenchon ce «grand malade» qui voudrait nous gouverner?
6 - Ti-Sarko s’en va et Monsieur Nobody triomphe, par Jacky Dahomay
|
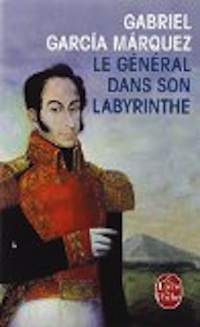 |
|
|
|
- Que se passe-t-il au Venezuela?

Nicolas Maduro et l'épée de Bolivar ?
|
Le 19 décembre de
ce mois, un avion en provenance de Suède est arrivé à l’aéroport de
Maïqueta près de Caracas chargé des nouveaux billets tout frais
imprimés de 500 bolivars, la monnaie nationale. A grand renfort médiatique,
la chute vertigineuse des cours du Bolivar «fort» se voit imputée d’un
complot tout azimut, la Colombie et Washington dans l’orbite de la
pagaille et soulevant le danger de «l’anarchie» suggéré par le pouvoir
en place. D’ici le 2 janvier 2017 et après de vifs incidents et
des pillages dans certaines villes du pays, des nouvelles coupures
viendront remplacer les anciennes et peut-être mettre un arrêt à
l’histoire la plus rocambolesque du régime de Nicolas Maduro? Le moins
poilant de cette histoire fait qu’un petit vent de révolte pèse et
risque de renvoyer cette nation à ses vieux démons de guerre civile.
En 1989 se déroula ce que l’on nomme le «Caracaso» et qui a fini sous
les balles du régime de Carlos Andres Perez alias CAP et ayant fait
plusieurs milliers de victimes. Les décisions du FMI avaient imposé une
ligne ultralibérale ayant conduit les plus pauvres à s’en prendre aux
commerces, des scènes de pillage se déroulèrent dans tout le pays.
Fidel Castro joignit à cette occasion sa "solidarité" à son collègue
pour ses hauts faits répressifs (1). Pour complément à l’époque, 70 à
80% des habitants vivaient sous les seuils de pauvreté et avec cette
particularité de « l’extrême pauvreté » définissant un bon quart de la
population, ou vivant avec moins d’un dollar par jour. Il s’agissait
d’un gouvernement qualifié de social-démocrate, une sorte de ventre mou
électoral centriste qui donnait à l’époque un bipartisme flou entre le
parti Action Démocratique de CAP à la présidence, membre de la deuxième
internationale et le COPEI, les chrétiens-démocrates qui soutinrent, au
passage au Chili, le coup d’état en 1973. Il va comme une évidence, que
l’arrivée du président Chavez va balayer assez facilement ce qui était
alors la quatrième république. Pour autant les résistances ne vont pas
désarmer, et les querelles continuer à pourrir toute évolution sociale
ou d’espérer un débat démocratique moins clivant ou azimuté et plus en
cours avec le développement du siècle et se libérant de sa mono
productivité énergétique, le pétrole et le gaz (1ère et 8ème réserves
mondiales du monde).
De nombreuses raisons m’avaient poussé à ne plus vraiment suivre cette
nation, à tous les égards bien opaque ou se déclinant sur le mode
binaire, du pour ou du contre. Ce qui ne laisse pas vraiment place à
une analyse des situations, l’on peut-être amené à ne plus vouloir
traiter, si tout n’est qu’objet de propagandes. Pour le plus de clarté
possible, pour trouver des apports sortant de la caricature de l’adversaire
ou de l’ennemi de circonstance, les positions non tranchées, ou non
empreinte d’une vérité quelconque, mais cherchant à comprendre ce qui
se passe là-bas sont rares (2), voire inexistantes. Il faudrait parler d’un
blocage de l’information et tamisé selon les entendements, se dégage
aussi une troisième catégorie visant à rapporter mais sans se mouiller…
ou se contenter d’une info aseptisée.
Lire que Théodoro Petkoff - journaliste et pamphlétaire - est une clef pour saisir les
chaos locaux, tout cela vu au trombinoscope d’une prétendue gauche
ayant émargé à droite au sein de la démocratie chrétienne locale avant
1998 peut faire sourire. Ce n’est pas parce que vous avez porté un
temps la révolution aux nues, que x. années après, petits
accommodements obligent, vous n’avez pas fait votre petit sillon
ailleurs. Mais bon, les énormités viennent de chaque part et se référer
au MUD ou au PSUV, c’est se faire écho du problème vénézuélien sans
mode d’emploi. La crédibilité des uns et des autres équivaut à répéter
ce que veulent entendre l’opposition ou l’opposition, ne sachant plus
vraiment où se situent les responsabilités politiques et
décisionnelles. Entre le martyre des uns et le complot permanent des
autres, il faut avoir sous la main son paquet de mouchoirs en papier
(difficile à trouver ou cher en l’état), dans cette Novela politique,
les plus humbles donc la majorité paie depuis toujours la casse de ses
«élites».
Le Venezuela n’est pas une nation où tout serait simple, c’est
d’expérience que j’ai pu découvrir, bien antérieurement à la crise des
liquidités et des produits de premières nécessités (huile, riz, lait,
farine, …), ces crises sont apparues depuis la disparition d’Hugo Chavez
en 2013, et ce que peut vouloir dire le mot corrompre. Déjà, rien n’a
changé en ce domaine depuis la fin du siècle dernier, la corruption
place le Venezuela dans les 10 pays les plus touchés de la planète. Nous sommes
face à des pratiques touchant tous les échelons de la société, mais
entre le petit commerce de contrebande pour survivre et ce qui relève
d’un fonctionnement mafieux ou organisé, il faut pouvoir distinguer les
mécanismes corrupteurs étranglant l’économie vénézuélienne depuis
longtemps.
Comme tout objet de trafic, ils sont souvent plusieurs, et quand une
partie de l’économie passe par ce type de chemin, l’état n’est plus en
mesure d’y faire face et ceci des deux côtés de la frontière. Une
limite faisant avec la Colombie plus de 2000 kilomètres dans des zones
plutôt reculées ou urbanisées selon les axes routiers, hors des postes frontières et
grandes voies de communication pouvant mener de l’autre rive; c’est
aussi des sentiers, et de tous les départements frontaliers que passe l’équivalent de 100.000 barils par jour de pétrole par exemple, de la
station-service vénézuélienne au marché colombien. Le prix au détail à la pompe
bien qu’ayant connu une augmentation reste bien en dessous des prix
pratiqués chez le voisin. C’est un petit marché commun des trafics en
tout genre, et englobant, celui à gros rendement des Narcos. De plus, les
produits qui devraient être au sein des magasins vénézuéliens sont
vendus à des prix six à sept fois plus haut par les détaillants
colombiens liés aux fluctuations des contrebandes. Sinon et au titre
des fantaisies, le pétrole dérouté du Venezuela serait meilleur… (Vidéo en VO de RTVE Espagne sur le trafic).
Je me souviens bien que Nicolas Maduro voulait s’attaquer à la
corruption dès son arrivée, et aussi il faut souligner, que la chute des
cours des hydrocarbures ayant plongé met cette nation dépendante à la
merci des marchés. Les derniers ajustements de l’OPEP dont le Venezuela
est membre depuis CAP, encore lui et pour cause, il est à l’origine de
la création l’entreprise nationale PDVSA, et si la mémoire ne fait
défaut, c’est sous son premier mandat vers 1973 ou un peu avant que le
pays sera membre du cercle des grands producteurs mondiaux. Bref, si
Maduro est en responsabilité depuis trois ans, si à la fois, il a
hérité du problème, les mesures prises ont engagé des mécanismes
bureaucratiques si contraignants qu’ils semblent paralyser toute forme
d’activité ou d’entendement. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer,
et à suivre cette histoire de billets de 100 bolivars, ne valant plus
que 15 cents et s’entassant en Colombie et en Europe (Suisse, Allemane,
Espagne,…) pour faire tomber une économie déjà malade. Cela ne peut que
provoquer de sérieux doutes. De là à établir un lien de cause à effet,
il y a de quoi se moquer des démonstrations de la Télévision nationale
VTV (3) à monter en image des masses sous la forme graphique et de
montages de photos pas nettes de billets. Sur ce que l’on nomme en l’état
de la monnaie de singe.
Passé d’un baril à 100 dollars à près de trente, être au centre d’une
des régions les plus corrompues du monde, et comme à l’image du changement des billets dévalués par de nouvelles coupures,
l’impréparation a été totale, et ce qui devait prendre 72 heures aux
guichets des banques a été retardé. Et un tel mécanisme demande une
préparation impeccable, ce qui fut et reste loin d’être le cas.
L’anarchie gouvernementale se suffit à elle-même, et au sein des
classes dirigeantes, la preuve de l’incompétence généralisée n’est pas
une nouvelle. Au lieu, sur un sujet sensible comme la corruption, de
faire appel à une aide internationale. qui vaudrait tout aussi bien
pour la Colombie que le Venezuela, la persistance à tous les coûts et
les goûts d’une fin de régime. Une décomposition politique tout aussi
féroce que dans l’après «Grande Colombie». Avec la mort de Bolivar et
de ce qui suivit comme terrain ouvert aux guerres civiles et divisons
nationales, les vieilles passes d’arme ne se sont jamais totalement
éteintes.
Quand je suis revenu la dernière fois à Caracas à la fin de l’année 2006, j’avais
compris que le projet bolivarien tournerait sur lui-même, et ne croyant
pas au sauveur suprême, beaucoup d’espoir était parti en fumée sur une
amélioration sociale et politique graduelle comme l’envisageait Chavez.
A l’époque, déjà la désinformation dominait, mais il semblait encore
possible de garder une distance critique. Les années qui ont suivi ont
fini par refroidir tous mes élans et mes critiques évidemment hors des
chapelles et conventions habituelles, j’ai cherché ailleurs. Puis
faut-il en vivre ou se construire ses propres forces et en cet aspect
l’histoire, n’a de rocambolesque, que l’attitude d’un héritier, n’étant
qu’une gentille marionnette agitant le nom de son prédécesseur pour
s’assurer une légitimité populaire, qu’il n’aura jamais. La
militarisation du régime est indéniable, ou son contraire; à se
demander, si seul un ancien militaire pouvait tenir en respect sa
propre armée? Ce type de schéma débouche sur une nouvelle pantalonnade
et ce pays que j’ai quitté si joyeux et vif est à nouveau pris en
tenaille par ses bourgeoisies dégénérées.
Billet de Lionel Mesnard, le 20 décembre 2016
Notes :
1 - Message de Fidel Castro Ruiz à Carlos Andrés Pérez en février 1989. "Le président cubain Fidel Castro manifeste sa solidarité avec le premier mandataire vénézuélien".

Source : Indymedia Venezuela (décembre 2016)
3 - Regarder les émissions de Mario Silva "la Hojilla" de Venezolana de Television (VTV) sur Youtube, décembre 2016.
|
|
La mort heureuse de Bolivar
au Venezuela

Par Rafael Marrón-González, 16 Décembre 2016 |
A une heure de l’après-midi du 17 décembre 1830, le commandant général
du Magdalena, depuis le quartier général de Santa Marta, par
l’intermédiaire du bureau n°55, notifie au préfet du département la
mort de Bolivar : « Son Excellence. Monsieur Bolivar a payé
aujourd’hui à la nature le tribut précieux de son importante vie, et la
Colombie vient de perdre pour toujours son libérateur… à notre Père… à
son meilleur et plus illustre Citoyen. Avec une profonde douleur de mon
cœur, je dois être le porteur d’une si mauvaise nouvelle, accompagnée à
Votre Excellence de la copie certifiée des derniers bulletins de
l’état-major depuis hier sur les neuf heures jusqu’à une heure de
l’après-midi à laquelle expira S.E. Que dieu vous garde V.S.»
Ordre général pour le 17 décembre 1830
Article 2 : En ce milieu de journée, la Colombie vient de perdre pour
toujours son Libérateur et Père. Si grand et magnanime a été la vie du
génie de notre indépendance, sa mort fut celle d’un véritable Héros.
Quelle souffrance ! Quelle constance ! Quelle tranquillité d’esprit !
Un espace immense s’est déjà interposé entre la Colombie et son
Libérateur, et rien ne pourra calmer la dure peine des Colombiens…
L’armée, cette partie précieuse du peuple que tant de jours de gloire,
il rendit à la Patrie, vous ne verrez plus en avant de leurs drapeaux
l’homme illustre qui par le chemin de l'honneur et de la victoire l'a
amené au temple de l'immortalité. Soldats : un adieu éternel nous a été
transmis par notre Libérateur, notre Général, et séparé d’entre-nous,
nous a adressé les mots suivants :
«Colombiens! Vous avez été témoin de mes efforts pour faire pousser la
liberté où avant la tyrannie régnait. J’ai travaillé avec désintérêt,
abandonnant ma fortune et même ma tranquillité. Je me suis séparé du
commandement quand j’ai été persuadé que vous vous méfiez de ma
générosité. Mes ennemis ont abusé de votre crédulité et piétinés ce à
quoi de plus sacré je tenais, ma réputation et mon amour de la liberté.
Je suis une victime de mes persécuteurs, qui m’ont conduit à la porte
de la tombe. Je leur pardonne. Après avoir disparu d'au milieu de vous,
mon affection me dit que je dois manifester de mes derniers souhaits.
Je n'aspire pas à une autre gloire qu'à la consolidation de la
Colombie. Tous vous devez travailler pour le bien inestimable de
l'union : les peuples en obéissant à l'actuel gouvernement pour être
libéré de l'anarchie; les ministres du culte dirigeant leurs prières au
ciel; et les militaires employant leur épée pour défendre les garanties
sociales. Colombiens! Mes derniers voeux sont pour le bonheur de la
patrie. Si ma mort contribue pour que cessent les partis et si l'union
est consolidée, je descendrai tranquille dans ma sépulture.»
« Ce précepte, cette loi prononcée sur la sépulture par le
fondateur de la Colombie restera pour l’armée une règle inviolable, et
malheur à celui qui désobéit à un si sain commandement. L’ombre du
Libérateur le cherchera de toute part et ne pourra supporter les
remords qui l’accompagneront».
Proclamation d’Ignacio de Luque, commandant des armées de Carthagène.
« Soldats! Le soleil de la Colombie est mort! Ses rayons bienfaiteurs
ont déjà cessé d'enfanter cette terre disgraciée! IL est mort, LE PÈRE
de la PATRIE, l’éclat de BOLIVAR, et cent ans de chagrin ne sont pas
suffisants à lui démontrer toute notre gratitude, tout notre amour,
toute notre reconnaissance! Soldats! Vous savez ce qui a perdu la
Colombie chez son Libérateur : un père amoureux : un soldat fidèle : un
magistrat savant; le meilleur protecteur de l'humanité. Soldats! Notre
LIBÉRATEUR ayant toujours confiance en votre patriotisme, en vos
vertus, et l’affection que vous lui avez juré, je vous fait une
supplique que vous trouverez consignée dans sa dernière volonté. Il
n'est pas possible de vous en détacher : honorer sa mort, puisque à la
fois vous remplissez ce devoir sacré, la patrie tirera mille biens de
votre soumission. Je vous le prie, et je serai le premier à m'accrocher
aveuglement à la dernière disposition du bienfaiteur de la Colombie».
Juan Francisco de Martin, préfet du Magdalena annonce le décès de Bolívar
« Peuples du Magdalena ! Pénétré d'une douleur la
plus extrême, je remplis aujourd'hui le triste devoir. LE PÈRE de LA
PATRIE déjà n'existe plus… Les calamités publiques, et l'horrible
ingratitude de ses ennemis l’ont conduit au tombeau le courant du 17, à
une heure de l'après-midi. Il est mort victime de sa consécration à la
Patrie. Une fin prématurée a été le prix de ses sacrifices héroïques;
et les larmes de ses amis fidèles et le repentir tardif de ses ennemis
libres, ils ne pourront pas reprendre la vie à laquelle tant de fois,
il a donné à la Colombie. La stèle recouvrant ses vénérables restes le
sépareront pour toujours de nous. Aux instants où l’appel national lui
donnait raison, l’appelant comme l’unique espérance de la Patrie, la
mort nous l’a enlevé, et le ciel a déjà reçu un bienfaiteur d’un monde.
Citoyens! LE LIBÉRATEUR vous a consacré jusqu’aux derniers instants de
sa précieuse existence. Ecoutez sa voix, et respectons dans un saint
recueillement ses derniers souhaits; ces voeux qui doivent être une loi
sacrée pour nous, et nous rendraient malheureux si nous parvenions à la
violer : la ruine nationale serait résultat le plus infaillible, et la
Colombie terminerait son existence avec celle de son illustre
fondateur. Citoyens! LE LIBÉRATEUR, nous a laissé pour toujours, il
nous a chargé, de marcher unis et jurons sur sa tombe être fidèle : de
tous travailler pour le bien inestimable de l'union, et que nous
obéissions à l'actuel Gouvernement pour nous nous affranchissions de
l'anarchie. Correspondons, donc, à sa demande, marchons unis, et jurons
sur sa tombe d'être fidèle à ses souhaits, ses derniers voeux qui lui
ont été inspirés pour le bonheur de la patrie. Ainsi nous honorerons sa
mémoire et nous répondrons à une dette immense de reconnaissance.
Carthagène, le 21 Décembre 1830».
Mais au Venezuela sa mort a été un soulagement
Au Venezuela, à l’annonce, de la nouvelle de la mort de Bolivar, le
triste gouverneur de Maracaibo, Juan Antonio Gómez écrit à Páez : «
Bolivar, le génie du mal, la torche de la discorde ou, mieux dirai-je,
l'oppresseur de sa patrie, a déjà cessé d'exister et de promouvoir les
maux qui revenaient toujours sur ses concitoyens. Je me félicite avec
vous d'une si plausible nouvelle». Un vil éclat d'euphorie, qui n'est
d’autre que le soupir du soulagement de la lâcheté.
Un an après en Colombie
Le 21 février 1831, « dans l’église paroissiale
de la Ville de Medellin, capitale du département d’Antioqua, dans
l’accomplissement des ordres du Gouvernement Suprême de la République
», il a été commémoré le premier an du décès de Bolivar, et l’Oraison
funèbre fut prêchée par M. Antonio Maria Gutiérrez, secrétaire de son
Excellence l’évêque du diocèse d’Antioqua, Fray Mariano Gárnica. De sa
longue intervention, nous avons extrait : « Quelle douleur, mesdames et
messieurs ! Depuis que n’existe plus le fondateur de trois nations,
l’homme à qui nous appelions. Avec enthousiasme et tendresse, notre
Libérateur, notre Père, l’ami le plus constant et généreux de
l’humanité. Il nous manque le Héros des héros anciens et modernes de la
Liberté, l’ennemi implacable des despotes, le bastion inexpugnable de
l’indépendance, le protecteur le plus déterminé de la morale et de la
religion. Il avait disparu du nombre des vivants, et le savant consommé
sans ostentation, l'homme politique profond artifices, l'homme
religieux sans hypocrisie, le mortel le plus protégé du ciel. En une
parole le chef suscité entre la miséricorde du Seigneur, comme en
d'autres temps, Simón fils de Matatías, pour sauver ses frères du plus
abominable esclavage, et pour éloigner du continent américain les
déprédations et la mort, et les violences et toutes les calamités de la
guerre. (…) Soutenez alors, Seigneur, l'oeuvre de vos propres mains.
Faites que dans la tombe de notre Libérateur, nous ensevelissions
toutes nos dissensions, et que par la suite il n'existe entre les
Colombiens, sinon une profession de foi religieuse et politique; une
seule une opinion pour la liberté, et pour l'indépendance; un seul un
coeur et une seule une âme : Ceci était Seigneur les voeux de notre
chef et ce sera l'objet de ses supplications dans votre obéissance
divine : écoutez-le, Seigneur, et en nous donnant la paix et la
tranquillité, accordez à l'âme de votre serviteur un repos éternel».
Une année après au Venezuela
Profond, désolant, ingrat, vil : Silence!
Deux années après au Venezuela
Juan Vicente Gonzalez rédige : « Deux ans qu’il dort en paix notre
Libérateur. Pas une voix l’a accompagné ; ni même une seule fois un
souvenir. Si facilement oublié le coeur de l’homme (…) Donne-moi,
Bolivar, un rayon de feu qui t’animait, et moi j’accompagnerai ta
solitude avec de doux chants comme ton nom, glorieux comme tes faits.
Chaque an, moi je porterai une gerbe à ton tombeau, d’autres seront
plus belles, mais les miennes auront scintillé là-bas quelques temps….
solitaires comme ta sépulture.
Trois années après au Venezuela
De retour Juan Vicente Gonzalez à inciter avec sa tristesse
l’indifférence officielle et civile de la patrie de Bolivar : « J’ai
assisté à la chambre des représentants pour voir ce que faisaient les
législateurs de ma patrie avec le héros auquel j’ai cru, et mon âme
émue qui jusque maintenant n’a pas laissé d’impression funeste. J’ai vu
choisir les couleurs plus noires pour le dépeindre, dépecer sur ses
tempes le laurier de la victoire, lancer un voile d'oubli sur ses
exploits et couvrir ses éminentes gloires d'un nuage d'injures. De ma
vie je ne pourrais oublier ce spectacle».
Et ainsi pour 50 ans
A Santa Marta demeura la sépulture de Bolivar durant 12 années,
jusqu’au 21 novembre 1842 quand le gouvernement du général Páez l’a
fait ramené au Venezuela accomplissant sa volonté, déjà calmée par la
haine de la médiocrité, dont les expressions resteront des anecdotes de
la bassesse, mais pour le faire replonger de nouveau dans l’oubli
jusqu’en 1876, année de sa translation au Panthéon et que commença son
extravaguant culte. C'était son fervent désir de revenir à sa Patrie,
dont une fois il a dit : « Le sort du Venezuela ne peut pas m’être
indifférent, ni de même après la mort ». « Mon cher Venezuela que
j'aime au-dessus toutes choses ». Mais qui l'a enseveli dans l'oubli
pendant cinquante ans, jusqu'à ce que Guzmán Blanco l'ait récupéré,
pour justifier son personnalisme à travers son nom, ce qui le dériva en
un "culte à Bolivar" jusqu'à ce que la main de Chávez se convertisse en
adjectif politique équivalent au socialisme. De là-bas qu'Andrés Eloy
Blanco disait que Bolivar était océanique, son nom servant à tout.
Une précision utile
Dans le monde entier, sans changement horaire est commémorée la mort de
Bolivar à une heure précise de l’après-midi de chaque 17 décembre, sauf
au Venezuela où l’ignorance, s’inspirant de la rigueur du documentaire
historique, a promu la superstitieuse «une heure et sept minutes»
marquant l’horloge de Santa-Marta. Comme si le cadran s’était arrêté de
pair avec le cœur de Bolivar, quand ce fut Mariano Montilla, qui
arracha le pendulier les sept minutes de stupeur passées : «Le Libérateur est mort, tu ne marcheras plus».
|
|
|
|
145 années après,
Réhabilitation des communards

Par les Ami-e-s de la Commune
|
L’Assemblée
nationale a voté la proposition de résolution n° 907, rendant justice
aux victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.
En avril 2013, Patrick Bloche, député de Paris, avait déposé une
proposition de résolution tendant à « rendre justice aux victimes de la
répression de la Commune de Paris de 1871. Cette résolution venait en
débat le 29 novembre 2016, lors de la 2e séance publique. Pendant près
de deux heures, l’Assemblée a débattu de la Commune de Paris, de son
œuvre, de sa portée et de la nécessité de lui rendre justice.
Patrick Bloche, en introduction de son rapport, rappelle que « la
présence des députés dans l’hémicycle a pour but d’effectuer un acte
solennel pour la République et notre Nation ». « La résolution proposée
comporte, en effet, une charge symbolique toute particulière en raison
de son objet. Il s’agit, pour notre Assemblée, de proclamer la
réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris sur
le fondement, bien sûr, des faits établis par les historiens »
précise-t-il.
Patrick Bloche rappelle la « Semaine sanglante », les jugements
prononcés de manière expéditive et les exécutions sommaires. Le bilan
demeure imprécis ; il varie de 10.000 à 20.000 morts. Puis après
l’écrasement de la Commune par les armes, l’internement de 43.522
communards et la présentation d’hommes, de femmes, d’enfants devant 24
conseils de guerre. 9780 communards ont été condamnés à des peines très
lourdes. Comme le dira Louise Michel, quelques années après son retour
du bagne de Nouvelle-Calédonie : « du côté de la Commune, les victimes furent sans nom et sans nombre ».
L’amnistie partielle, le 3 mars 1879, puis l’amnistie générale, le 11
juillet 1880, ont seulement permis de libérer les communards encore en
vie, mais en coulant une chape de plomb sur cette répression et en
rejetant tous les autres dans l’oubli. Le temps est donc venu de
réhabiliter toutes les victimes. (...)
Les groupes Les Républicains et l’Union des démocrates et indépendants,
les non-inscrits n’ont pas voté cette résolution. Les groupes
Socialiste, écologistes et républicains, Gauche démocrate et
républicaine (communistes et apparentés) et Radical, républicain et
démocrate (radicaux de gauche) ont voté la résolution, qui a donc été
adoptée par l’Assemblée nationale.
145 années après, la représentation nationale a donc effacé l’infamie
qui pesait depuis 1871 sur les femmes et les hommes de la Commune de
Paris.
|
Proposition de résolution pour rendre justice
aux victimes de la répression
de la Commune de Paris de 1871
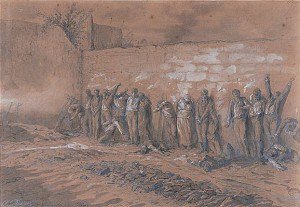
Intervention du député Patrick Bloche à l'Assemblée nationale,
le 29 novembre 2016
Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Mes chers collègues,
L’histoire peut faire son œuvre
sans que justice soit rendue à ses victimes. C’est la raison pour
laquelle nous sommes, aujourd’hui, présents dans cet hémicycle afin
d’effectuer ensemble un acte solennel pour la République et notre
Nation. La résolution, qui vous est proposée comporte, en effet, une
charge symbolique toute particulière en raison même de son objet. Il
s’agit, pour notre Assemblée, de proclamer la réhabilitation des
victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871 sur le
fondement, bien sûr, des faits établis par les historiens.
Le temps est désormais venu pour la République, de rendre honneur et
dignité à ces milliers de femmes et d’hommes qui furent, parce qu’ils
étaient des «Communards», victimes d’une répression impitoyable. Tel
est l’objet de cette proposition de résolution qui répond tout autant à
un « devoir d’histoire », pour reprendre la belle et juste formule de
l’historien Antoine PROST, qu’à un « devoir de justice ».
Les faits sont connus. Les historiens ont œuvré et de nombreux travaux
ont ainsi été publiés sur la Commune de Paris et sa terrible fin qui se
déroula en deux périodes.
Ce fut d’abord la «Semaine sanglante», celle des jugements prononcés de
manière expéditive et celle des exécutions sommaires. Elle débuta le 21
mai 1871 avec l’entrée des troupes versaillaises dans la Capitale et
s’acheva le 28 mai avec la chute de la dernière barricade de la rue de
la Fontaine-au-Roi, défendue notamment par Jean-Baptiste CLEMENT,
l’auteur du « Temps des cerises ». Son bilan demeure imprécis tant elle
fut féroce, mais il y eut, selon les estimations, entre 10 000 et 20
000 morts. L’incertitude même pesant sur ce nombre, montre la brutalité
et le caractère aveugle de la répression. Les témoins mentionnent les
nombreuses exécutions frappant, par exemple, ceux dont les mains
semblaient porter des traces de poudre suggérant l’emploi récent
d’armes à feu.
Ce fut ensuite, après l’écrasement de la Commune par les armes,
l’internement de 43.522 Communards et la présentation de 34.952 hommes,
819 femmes et 538 enfants devant 24 Conseils de guerre qui siégèrent
pendant plus de quatre ans et qui condamnèrent 9.780 Communards à des
peines souvent très lourdes. A la mort des victimes de la première
période, s’ajouta donc l’infamie attachée à ces condamnations.
Tel est le bilan connu de cette répression dont le but était de
réaliser, selon les propres termes prononcés par Adolphe THIERS, à
l’Assemblée nationale le 22 mai 1871, une «expiation complète» de la
Commune de Paris.
Louise MICHEL, qui fut condamnée à la déportation en
Nouvelle-Calédonie, écrira, quelques années après son retour en France
le 9 novembre 1880, que «du côté de la Commune, les victimes furent
sans nom et sans nombre».
Cent quarante-cinq ans après, ce terrible constat demeure
puisqu’effectivement, le nombre exact des victimes de cette répression
reste inconnu et que nombre d’entre elles seront toujours anonymes.
Pour cette raison, mais aussi parce qu’une justice d’exception aussi «
expéditive » qu’ « expiatoire » se déchaîna sans limites, le temps est
enfin venu de rendre justice à toutes les victimes.
J’ai bien dit : toutes les victimes. Car l’amnistie partielle,
intervenue le 3 mars 1879, et l’amnistie générale, intervenue le 11
juillet 1880, ont seulement permis de libérer de leurs chaînes les
ex-Communards encore en vie, coulant par la même une chape de plomb sur
cette répression. La question, qui s’est posée, était donc aussi celle
du moyen juridique nous permettant de rendre justice à toutes ces
victimes.
Pourquoi, en effet, avoir privilégié la proposition de résolution
prévue par l’article 34-1 de notre Constitution? Plusieurs instruments
juridiques pouvaient, à priori, répondre à cette interrogation.
Trois d’entre eux ont été rapidement écartés parce qu’à l’évidence, ils
ne pouvaient pas répondre à l’objectif fixé, à savoir la réhabilitation
collective des victimes de la répression de la Commune de Paris.
Il s’agit de l’amnistie, de la grâce et de la réhabilitation
judiciaire. Ne pouvant bénéficier ou profiter utilement qu’aux
personnes vivantes, ces dispositions ne constituaient pas une solution
pertinente. A cela s’ajoutaient, pour chacune d’entre elles, d’autres
raisons ou incompatibilités.
Ainsi, la grâce ne peut être accordée, selon l’écriture actuelle de l’article 17 de la Constitution, qu’«à titre individuel»,
ce qui exclut une action collective. De plus, elle ne peut rétablir les
personnes dans leur honneur puisqu’elle n’efface pas leur peine. Enfin,
elle ne s’applique qu’à des jugements dûment prononcés, ce qui ne fut,
en général, pas le cas durant la Semaine sanglante.
Quant à l’amnistie, elle est une mesure prise par la voie législative dans un contexte particulier. Certes, elle «efface les condamnations prononcées»
comme le stipule l’article 133-9 du code pénal, mais elle présenterait
l’inconvénient majeur de se heurter aux lois d’amnistie intervenues en
1879 et 1880.
Alors, pourquoi pas la réhabilitation judiciaire puisqu’elle a pour
effet d’effacer les peines prononcées. Non plus, car outre le fait
qu’elle est destinée à des personnes vivantes, elle est soit légale,
auquel cas elle opère de plein droit, soit judiciaire, ce qui nécessite
une décision de la chambre de l’instruction.
Et, pour quelle raison ne pas faire le choix de la requête en révision
qui permet de solliciter le réexamen d’une affaire passée en force de
chose jugée ? Parce qu’il s’agit, à l’instar de la grâce, d’une
procédure individuelle.
Enfin, pourquoi ne pas déposer une proposition de loi dite «mémorielle»
? Parce que, chers collègues, la mission d’information de notre
Assemblée sur les questions mémorielles a clairement mis en évidence
les dangers et les risques d’une loi dont l’objet serait historique.
Son rapport du 18 novembre 2008 est solidement argumenté et reprenait
les fortes réserves émises par les historiens.
A contrario, ces derniers, dont Pierre NORA, Marc FERRO et Jean FAVIER,
tout comme le constitutionnaliste Pierre AVRIL, avaient indiqué que la
résolution pouvait constituer un instrument, à la fois pertinent et
utile, à l’Assemblée nationale pour s’exprimer sur un événement
historique. C’est donc ce choix qui s’imposait et que le groupe
socialiste, écologiste et républicain a fait.
Il s’agit donc, ici et maintenant, de débattre puis d’adopter cette
proposition de résolution visant à ce que l’Assemblée nationale :
– Estime qu’il est temps de prendre en compte les
travaux historiques ayant établi les faits dans la répression de la
Commune de Paris de 1871 ;
– Juge nécessaire que soient mieux connues et diffusées les valeurs
républicaines portées par les acteurs de la Commune de Paris de 1871 ;
– Souhaite que la République rende honneur et dignité à ces femmes et
ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix d’exécutions
sommaires et de condamnations iniques ;
– Proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.
Avant de conclure, Monsieur le Ministre, Chers Collègues, il ne me
semble pas inutile de revenir à l’Histoire et de rappeler les «causes»
de la Commune de Paris afin que le sens de notre vote n’échappe à
personne.
Sa cause immédiate, c’est la guerre et le désastre de Sedan qui
provoqua l’insurrection du 4 septembre 1870. Des Parisiens envahirent
le Palais-Bourbon et, sur la suggestion de députés républicains, tel
Léon GAMBETTA, proclamèrent la République à l’Hôtel de Ville de Paris.
Sa cause immédiate, c’est aussi le refus de la capitulation. Paris
n’acceptait pas l’armistice signé le 28 janvier 1871 par le
Gouvernement de défense nationale et que Georges ARNOLD, le fondateur
de la Garde nationale, qualifia de «paix honteuse et hideuse».
Mais la «cause», la grande «cause» de la Commune de Paris, c’était, au
fond, la défense de la République. Paris, en effet, se méfiait de
l’Assemblée élue le 8 février 1871. Elle avait bien désigné Adolphe
THIERS «Chef du gouvernement exécutif de la République française», mais
hésitait, en réalité, sur la nature du régime à instaurer.
Alors, lorsque le 10 mars 1871, l’Assemblée, se replia à Versailles, la
confiance fut rompue et le drame s’annonçait déjà. A Paris, on réclama
l’élection d’une municipalité, puis d’une «Commune» comme sous la
«Grande Révolution».
Le 26 mars 1871, après l’acte fondateur du 18 mars, la Commune de Paris
était, enfin, élue. Elle ne vivra que 73 jours. Mais, 73 jours, qui
contribuèrent fortement, comme le dit l’historien Jacques ROUGERIE, à
«l’acquiescement progressif des Français à la République».
Le moment est donc venu que nous rendions honneur et dignité à ces
milliers de femmes et d’hommes qui n’eurent que le tort, outre le fait
d’être le peuple industrieux de Paris, de croire en la possibilité de
bâtir une République sociale dont le fondement même était notre belle
devise républicaine : liberté, égalité, fraternité .
Alors oui, chers collègues, montrons, avec Victor HUGO, que «ce qui fait la nuit en nous peut laisser en nous les étoiles»
et proclamons, en adoptant cette proposition de résolution, la
réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de
1871 afin que celles-ci illuminent, comme elles y ont droit, le ciel de
notre République ! Car, je l’affirme à cette tribune avec Eugène
POTTIER, « Non, la Commune n’est pas morte ! »
|
L’Assemblée nationale, le 29 novembre 2016.
Vu l’article 34-1 de la Constitution, - Vu la loi du 3 mars 1879 sur l’amnistie partielle,
- Vu la loi du 11 juillet 1880 relative à l’amnistie des individus
condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de
1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, - Vu
l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que les lois
d’amnistie partielle de 1879 et d’amnistie totale de 1880 n’ont pas
permis de réhabiliter l’ensemble des victimes de la répression de la
Commune de Paris de 1871 ;
1. Estime qu’il est temps de
prendre en compte les travaux historiques ayant établi les faits dans
la répression de la Commune de Paris de 1871 ;
2. Juge nécessaire que soient
mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les
acteurs de la Commune de Paris de 1871 ;
3. Souhaite que la République
rende honneur et dignité à ces femmes et ces hommes qui ont combattu
pour la liberté au prix d’exécutions sommaires et de condamnations
iniques ;
4. Proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.
Délibéré en séance publique, à Paris
Le Président, signé par Claude BARTOLONE
|
Sources : Les Amis de la Commune de Paris de 1871.
Le blog de Patrrick Bloche et le site de l'Assemblée Nationale
|
|
|
|
- Bolivar et Miranda,
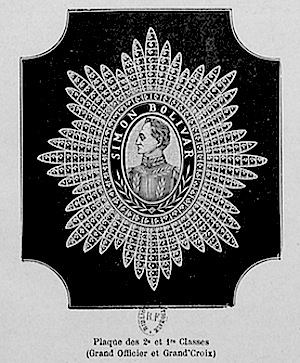
- et petites affaires diplomatiques
-
entre la France et le Venezuela ?
|
Au demeurant voilà un ouvrage qui aurait pu ne pas retenir mon
attention, et c’est avec une petite surprise, que j’ai découvert
certaines informations tenant à nos deux illustres personnages. Rien de
très fondamental, mais complémentaire à ce que j’ai pu déjà rédiger, et
ainsi apporter un éclairage rapide et simple avec des documents
touchant à la période des dictateurs ou caudillos vénézuéliens au XIX°
siècle. Sur le regard très complaisant avec cette nation en prise avec
la guerre civile et des régimes pas vraiment démocratiques repeint aux
couleurs républicaines pour les circonstances. Toute comparaison
n’étant pas totalement fortuite…
Ce sont deux textes courts, extrait d’un ouvrage collectif, le premier
fait écho aux deux acteurs les plus connus du processus de libération
du Venezuela colonial. Le second écrit est une brève biographie de
Miranda Ils sont extraits d’un livre de la fin du dix-neuvième siècle
et il est fait référence au président et dictateur Joaquim
Crespo-Torres à la presque fin de son second et dernier mandat avant de
décéder en 1898 (1). A un an près, 1897 étant la date où parue cette
publication traitant principalement des décorations à l’ordre Simon
Bolivar, sujet accessoire qui se limitera à la reproduction de la
médaille de première et deuxième classe (en image ci dessus).
Un ouvrage très diplomatique et nourrit par quelques militaires
français. Des récits plutôt conservateurs ou dans l’esprit de la
troisième république et ses relations oubliées avec le Venezuela. Si le
premier texte est plutôt illustratif, il n’est pas dénué d’intérêt sur
la présence de Bolivar en France et la nature de ses études. Le texte
suivant est assez fidèle à la réalité historique et donne des
précisions importantes quant au rôle de Miranda
au sein de la Révolution française. Tout en soulignant le décalage du
temps et d’éléments, dont l’auteur ne pouvaient pas disposer, comme
l’emplacement en Espagne de la tombe, qui est resté longtemps inconnu.
NB : Pour mieux situer les noms cités et
donner des précisions utiles des notes de transcriptions sont insérées
à même les textes avec l’acronyme : Ndt. La récupération de ce genre
d’ouvrage fait appel à des corrections et certaines modifications orthographiques plus contemporaines.
Notes de Lionel Mesnard, le 4 décembre 2016
|
- Deux Héros
 Par Léon Gautier (historien de la littérature) et G. Muller.
Par Léon Gautier (historien de la littérature) et G. Muller.
Miranda et Bolivar sont les deux plus grandes figures de la démocratie
sud-américaine ; le précurseur Miranda, à qui la République
Vénézuélienne vient de rendre un solennel hommage de respect et
d'admiration, vit son œuvre continuée et accomplie par Bolivar. Leur
nom résume une belle épopée et symbolise une époque où les splendeurs
de la victoire eurent pour couronnement l'émancipation des peuples du
Nouveau Monde, issus de la fière et impérissable "race" latine.
Frère d'armes et volontaire de Washington, ami du général Lafayette,
général et soldat de la République française, sous la Convention,
Miranda a pris part aux mémorables événements de son temps:
l'indépendance Nord américaine, la Révolution française, l'Indépendance
de l'Amérique latine. Trahi, comptant sur la foi jurée et la loyauté
chevaleresque, il succombe, il est fait prisonnier par les royalistes.
Jeté dans un cachot, conduit à la prison de la Carraca, près Cadix, il
meurt en captivité, le 14 Juillet 1816.
Cet homme héroïque, austère, né noble et très riche se sacrifia pour le triomphe de ses idées; il mourut pauvre et martyr. «Miranda, vainqueur ou vaincu, paraîtra toujours grand comme un des plus fervents apôtres de la liberté dans les deux, mondes.» (Arístides Rojas - 1889. Ndt. -
auteur et historien vénézuélien et spécialiste de Miranda). Mais son
œuvre ne resta pas inachevée : le Libérateur Bolivar la continua et
l'acheva. - Peu d'auréoles brilleront d'un éclat plus glorieux dans le
Panthéon de l'humanité. - Ce n'est pas un aveuglant météore qui «brille et disparaît, le Libérateur a fait œuvre éternelle.» (Amiral Révoillère 1849)
Leur idéal fut complet, grand, sublime, bien digne de l'humanité et de
la civilisation! Leur tombe est entourée aujourd'hui de l'auréole de
l'immortalité. Elevé en France, ayant l'ait ses études à Paris, vers
I800, où il suivait les cours de l'Ecole Normale et de l'Ecole
Polytechnique, Bolivar aimait beaucoup les Français. L'un d'eux, le
savant Boussingault (1802-I887) fut très lié d'amitié avec lui, durant
un séjour prolongé au Venezuela, vers 1822, il fut, croit-on, l'un de
ses conseillers.
«Simon Bolivar, a dit Boussingault dans ses mémoires (Ndt - chimiste et botaniste) ; était
un petit homme au-dessous de la moyenne, portant une tête un peu
disproportionnée à sa taille, mais très énergique, un regard vif, yeux
bruns, cheveux noirs, teint bistré, bras longs, membres grêles, une
grande vivacité dans les mouvements. - Il était expansif, bienveillant
avec ses inférieurs, généreux à l'excès, vivant d’une manière très
simple, sobre». «Patriote vénézuélien, Bolivar a pour objectif la
délivrance de son pays natal, mais guidé par un génie politique égal à
son génie militaire, il considérait avec raison toutes les possessions
espagnoles comme solidaires». (Ndt - Par l’Amiral Paul Emile, Marie
Réveillère, militaire de carrière, il a laissé des ouvrages faisant
référence à ses voyages autour du monde et à ses fonctions
d’officier de marine).
Sous l'un et l'autre aspect, Bolivar ne peut être confondu, en effet,
avec d'autres grands hommes qui, quoique leur carrière ait laissé plus
d'éclat dans l'histoire de leur époque, n'ont agi peut-être que dans
l'intérêt de leur pouvoir personnel ou pour l'agrandissement d'une
nation au détriment d’autres nations. - Si l'histoire est la
résurrection des hommes et des peuples, aucune n'est plus glorieuse que
celle du Libérateur !
«Son nom, idole de l'Amérique, traverse les mers sur les ailes de la
Renommée immortelle, pour être l'éloignement de l'Europe, qui
l'acclame, le salue aussi comme un homme extraordinaire». (Hector
Varela, 1883 – Ndt – auteur argentin) Plusieurs statues ont été érigées
au Venezuela et en Colombie en l'honneur de Simon Bolivar. D'autres
villes ont suivi cet exemple.
Il y a quelques années, la ville de Paris, sur la demande d'un
américain, le Dr H. Antich, a rendu hommage à sa mémoire, grâce à
l'appui de Victor Hugo et de M. de Heredia, ancien ministre, ancien
président du Conseil municipal de Paris, le nom de Bolivar fut donné a
l'une des rues populaires de la Métropole. (Ndt – dans le dix-neuvième
arrondissement)
Sur l'Arc-de-Triomphe de l’Etoile, parmi les noms qui ornent la voûte
du Monument, il y a inscrit le nom d'un Vénézuélien, d'un enfant de
Caracas : Miranda! Et Bolivar et Miranda n'ont pas eu encore leur
statue érigée dans la ville Lumière! Washington y a la sienne. (Ndt. Si
depuis, il existe deux statues de Bolivar et une de Miranda dans la
capitale. Et il existait un petit buste de Bolivar à la station de
métro du même nom).
Le gouvernement actuel du Venezuela, dont le chef illustre et
président, le général Crespo, a donné tant de preuves de patriotisme à
ses concitoyens et d'amitié à la France, s'est souvenu du patriotisme
glorieux légué par Miranda à son pays, alors qu'il combattit pour la
cause libérale, sous le drapeau tricolore de la France républicaine.
Aussi vient-il de fêter dignement les gloires de ce héros et martyr.
Puissions-nous reconnaître bientôt, par l’érection
de leur statue, que des hommes comme Bolivar et Miranda serviront
toujours de trait d'union fraternel entre la Démocratie française et la
Démocratie sud-américaine.
|
- Courte biographie de Miranda
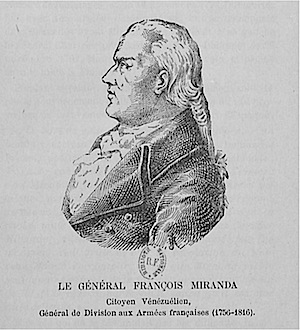
Par Etienne-Philippe Piraud, (Ancien magistrat, Avocat-Avoué).
Miranda, François, Antoine, Gabriel naquit le 9 juillet 1756,
C'est à tort que certains historiens, notamment Thiers et Lamartine, le
font naître au Pérou et d'autres à Maastricht (Hollande), car c'est à,
Caracas, aujourd'hui la capitale du Venezuela, qu'il vit le jour. Après
avoir fait ses études à l'Université de Caracas, il partit à l'âge de
17 ans (Ndt. - à 21 ans) pour l'Espagne dont le roi, qui tenait en
haute estime sa famille, lui confia le commandement d'une compagnie;
là, il fit venir de France des professeurs de mathématiques et de génie
militaire afin de compléter son instruction; il fit ses premières armes
dans la campagne d'Alger et à la défense de Melilla (Ndt - au Maroc) où
il combattit vaillamment.
Lors de l'insurrection des colonies anglaises d'Amérique contre
l’Angleterre, Miranda sollicita en vain l'honneur d'aller servir la
cause de l'Indépendance; mais bientôt la France et l'Espagne ayant pris
parti pour les Américains, il put enfin partir avec le corps
expéditionnaire comme aide de camp du général en chef; ses relations
avec les principaux chefs de l'Insurrection américains développèrent en
lui cet immense amour de la libellé qui fut toujours le mobile de
toutes ses actions, et c'est alors qu'il conçut le sublime projet
d'affranchir son pays du joug espagnol.
Mais, auparavant, Miranda voulut observer de près les institutions des
peuples; inquiété par le gouvernement espagnol, qui voyait d'un mauvais
œil ses allures et fit même brûler, un jour, au nom de la sainte
Inquisition, sa bibliothèque uniquement composée d'ouvrages
révolutionnaires, il donna sa démission d'officier et parcourut alors
successivement l'Angleterre, la Prusse, la Saxe, l'Autriche, l'Italie,
la Grèce, l'Asie mineure, la Turquie et enfin la Russie. Présenté à
Catherine II par le prince Potemkine, son premier ministre, dont il
avait su conquérir l'amitié, celle-ci, frappée par son immense savoir
et sa connaissance approfondie des hommes et des choses, lui proposa un
emploi à son choix. Miranda refusa cette offre flatteuse voulant,
disait-il, se consacrer tout entier à l'unique but de sa vie :
l'affranchissement de sa patrie; mais comme l'Espagne le faisait
réclamer par son ministre, Catherine II, pour le mettre à l'abri, lui
décerna le titre de colonel.
En 1790, il revint à Londres après avoir parcouru la Suède et la
Norvège, le Danemark, les villes hanséatiques, la Suisse et la France;
il faillit même entraîner Pitt dans une insurrection de l'Amérique
espagnole.Ce mouvement en faveur de son pays, que Miranda n'avait pu
faire éclater en Angleterre, il crut pouvoir le provoquer en France,
qui était alors en pleine révolution.
Convaincu que, de la Révolution Française, naîtrait enfin l’ère de la
liberté pour l'Amérique du Sud, il revient à Paris, se lie avec Pétion,
Brissot et les Girondins et embrasse avec enthousiasme leurs idées;
désireux de s'acquérir des droits à la reconnaissance de la nation
française, afin de rattacher plus tard à sa cause, il accepte du
service et part en qualité de maréchal de camp rejoindre Dumouriez
chargé d'arrêter l'invasion des armées prussiennes et autrichiennes;
malheureusement, Dumouriez se fit battre au défilé des Argonnes.
Miranda, qui avait su rallier sa division, prit alors le commandement
et montra les plus brillantes qualités dans cette fameuse retraite où
il sauva l'armée française ; et trois jours après, celle-ci répara ses
désastres par l'éclatante victoire de Valmy.
Nommé lieutenant général à la suite de ces exploits, il fait la
campagne de Belgique, est au premier rang à la victoire de Jemmapes,
et, le 14 novembre 1792, Dumouriez fait avec son armée victorieuse son entée triomphale dans Bruxelles ayant Miranda à sa droite
et à sa gauche le général Chartres (plus tard le roi Louis-Philippe);
le 26 novembre 1792, Miranda s'empare d'Anvers et pacifie ensuite toute
la Flandre.
Pendant ce temps, Miranda avait été vivement sollicité par le
gouvernement d'aller dans l'Amérique du sud provoquer un mouvement
insurrectionnel contre l’Espagne.
« Le sort de cette dernière révolution dépend d'un homme, écrivait le 28 novembre 1792 à Dumouriez Brissot, président du Comité de défense nationale : Vous
le connaissez, vous l’estimez, vous l'aimez : c'est Miranda; son nom
lui vaudra une armée et ses talents, son courage, son génie, tout nous
répond du succès. Les ministres sont tous d'accord sur ce choix, mais
ils craignent que vous refusiez de céder Miranda; je leur ai dit: vous
ne connaissez pas Dumouriez....; il brûle de voir la révolution du
Nouveau Monde s'accomplir, il sait que Miranda est le seul homme
capable de le faire et quoiqu'il ait besoin de lui, il le cédera parce
qu’il saura qu'il est plus utile ailleurs. »
Miranda qui ne se dissimulait pas les difficultés insurmontables que
rencontrait, pour l'heure, ce projet grandiose, il refusa cette mission
et le poste de gouverneur général de Saint-Domingue.
Dès la fin de 1792, Brissot et Pétion auraient voulu remplacer Dumouriez par Miranda comme général en chef. « Dumouriez
ne peut nous convenir, écrivait Brissot au Ministre de la guerre, je me
suis toujours méfié de lui, Miranda est le général de la chose, il
entend le pouvoir révolutionnaire, il est plein d'esprit et de
connaissances.» Mais Miranda était étranger et presque inconnu en France et ce projet fut abandonné plus tard. Cependant,
il fut désigné pour remplacer Monge au Ministère de la marine, mais
Dumouriez fit rapporter cette décision en déclarant que si on lui
enlevait Miranda, il ne pouvait se charger des opérations à lui
confiées.
Le 5 Janvier 1793, Miranda est nommé commandant en chef de l'armée de
Belgique; il prend part à la campagne de Hollande et sur ses sages
observations le Conseil exécutif rejette le projet de Dumouriez
d'envahir la Zélande; en six jours, Miranda marche sur Maeseyck, s'en
empare, prend Stewenswerdt et le fort Saint-Michel, bat les Prussiens à
Roermond et les force à repasser le Rhin.
Mais ces succès ne devaient pas être de longue durée, grâce à
l'imprévoyance de Dumouriez; Miranda reçoit de ce dernier l'ordre de
bombarder Maastricht et, le 21 février 1793, n'ayant que 25 bouches à
feu et l5.000 hommes, il commence l'investissement de cette place
forte, avec une méthode des mieux conçues qui lui vaut les éloges du
ministre de la guerre Bournonville. «Le plan de vos opérations que j'ai examiné avec beaucoup d'attention, lui écrit celui-ci, m'a paru très sage, et bien concerté».
Déjà il ne désespère plus du succès, déjà il a fait les sommations,
lorsque malheureusement, Lanoue est impuissant à contenir en avant
d'Aix-la-Chapelle un corps d'armée autrichien, fort de 40.000 hommes,
qui se portail au secours de Maastricht; l'armée française
d'observation est forcée, elle bat on retraite et cet échec oblige
Miranda à lever le siège de Maastricht. Dans cette retraite, Miranda,
avec son habileté ordinaire, accomplit des prodiges; il parvient
hardiment à se réunir à Valence, opère avec ordre sa retraite sur Liège
et occupe les hauteurs de Louvain d'où il couvre la Belgique, en
attendant des secours de France.
C'est alors que Dumouriez, désespéré de l'insuccès de plans conçus à la
légère et aigri contre la Convention nationale dont il n'a plus la
confiance, revient de Hollande prendre le commandement en chef; il
cherche à faire partager à l'armée ses ressentiments contre la
Convention; seul, parmi ses généraux, Miranda résiste el lui fait de
sévères remontrances; dès lors Dumouriez a juré de le perdre; il cesse
de le consulter sur ses opérations, faute impardonnable; au lieu de
rouvrir seulement Louvain, situé dans une forte position, en attendant
des renforts de France, Dumouriez avance jusqu'à Nerwinde, et, le 18
mars 1793, à onze heures du matin, il donne l’ordre de livrer bataille.
Les troupes françaises sont débordées et mises en déroute et Miranda
est encore chargé de couvrir la retraite de l'armée à Pellemberg;
pendant qu'il s'acquittait valeureusement de cette tâche délicate,
Dumouriez, déjà traître à la Patrie, rejetait sur Miranda sa honteuse
défaite et le dénonçait à la Convention nationale.
Traduit le 8 avril 1793 devant le tribunal révolutionnaire, Miranda se
lava des accusations portées contre lui par Dumouriez et fut, le I0 mai
1793, acquitté à l'unanimité, après une brillante plaidoirie de
Chauveau-Lagarde, son défenseur; quinze jours plus tard, ses amis les
Girondins perdaient le pouvoir et il les rejoignait en prison; élargi
environ deux ans après, le Directoire lui offrit le commandement d'une
armée; il répondit qu'il avait combattu de bon cœur pour la liberté,
mais qu'il ne voulait pas se battre pour faire des conquêtes.
Injustement arrêté, le 6 Frimaire an IV (27 novembre 1795), et expulsé
de France, il rentra quelque temps après à Paris et y vécut en sécurité
jusqu'à la Révolution (Ndt - ou le coup d’état) du l8 Fructidor an V (4
septembre 1797), d’où il fut inscrit sur la liste des déportés et même
sur celle des émigrés. Miranda passa en Angleterre et ne revint en
France qu'en 1804 (Ndt. – Non, il va continuer à effectuer des allers
et venues entre les deux rives de la manche). Bonaparte, premier
consul, alors omnipotent, refusa de comprendre parmi les généraux de
l’armée française, Miranda dont le caractère indépendant ne lui
plaisait pas. Arrêté lors du complot de la machine infernale (Ndt -
Conjuration et attentat royaliste de décembre 1800), son innocence fut
reconnue et il se retira alors définitivement à Londres.
Déjà, en 1796, Miranda avait entamé des négociations avec l'Angleterre
en vue d'un soulèvement des colonies espagnoles d'Amérique, mais elles
avaient échoué par suite du refus des Etats-Unis de se joindre à cette
opération de crainte de s'aliéner l'Espagne. En 1801, Miranda reprit
ses projets que la paix d'Amiens fit mettre de côté; en 1804, la guerre
ayant éclaté avec l'Espagne, il rappela à Pitt ses promesses
d'autrefois (Ndt. - Premier ministre britannique, dit le jeune): les
négociations furent menées rapidement et tout était prêt, lorsque
l'espoir du triomphe de la troisième coalition contre la France
républicaine ajourna encore la question de l'émancipation de l'Amérique
espagnole.
Las de se voir ainsi joué par l'Angleterre qui préférait faire ses
conquêtes pour son propre compte, Miranda, sur les conseils d'émigrés
vénézuéliens, résolut tardivement de tenter un coup de main sur son
pays natal, l'Espagne et la France étant alors en démêlés; le moment
d'agir lui parut favorable; privé des secours qu'il espérait des
Etats-Unis et de l'Angleterre, il tenta en vain de débarquer à Coro;
une seconde fois, il ne fut pas plus heureux et ne réussit qu'à sauver
sa tête mise à prix; il rentra alors en Angleterre (Ndt. - après
plusieurs mois de séjour de repli à Trinidad ou Trinité et Tobago).
Survinrent les événements de la péninsule de Charles-Quint; Napoléon
avait assis son frère Joseph sur le trône. L'abdication du roi Charles
IV en faveur de son fils Ferdinand. L'occupation prolongée de l'Espagne
et la captivité de son roi avaient porté une grave atteinte au prestige
de la métropole dans ses colonies abandonnées à leurs propres
ressources, obligées de s'administrer et de se défendre elles-mêmes,
souvent en dissentiment avec la junte centrale, l'idée d'indépendance
devait bientôt germer parmi elles. C'est ainsi qu'en 1810 la junte
vénézuélienne bannit le capitaine général et les membres de l'Audience
et nomme un pouvoir exécutif de trois membres qui gouvernera le
Venezuela au nom de Ferdinand VII prisonnier.
C’était l'indépendance de fait; il fallait la maintenir, Simon Bolivar
vint alors à Londres, avec une députation, solliciter l'appui de
l'Angleterre; ses démarches échouèrent. Miranda, pendant ce temps
s'était lié avec lui et avait réussi à lui inculquer ses idées
républicaines. Le 10 décembre, Miranda, qu'avait précédé Bolivar,
débarquait sur le sol natal; unis dans un même but : le triomphe de la
liberté, ils commencèrent par créer des sociétés patriotiques, à
l'instar de celles de la Révolution française et ils firent de si
nombreux prosélytes que Miranda, qui avait été élu député et nommé
lieutenant général, put voir enfin, le 5 juillet 1811, le Congrès de
Caracas déclarer le Venezuela libre et constitué en République.
Un gouvernement fut modelé sur celui des Etats-Unis, mais avec un
patriciat et un exécutif plus fort. Un manifeste fut adressé à toutes
les nations et Luis Delpech (Ndt - Commerçant français et agent de
Napoléon 1er) fut chargé d'établir des relations entre le nouveau
gouvernement et l'Angleterre. Enfin, le 14 juillet 1811, le drapeau national créé par Miranda fut arboré à Caracas.
Trois provinces tenant pour l'Espagne, la guerre civile éclata bientôt;
une première armée de la République fut complètement anéantie. Miranda
prit alors le commandement et parvint à s'emparer de Valencia (13 août
1811). Mais bientôt les royalistes reprennent l'avantage et Santa-Cruz
est incendiée par eux. Cependant, les Républicains se maintenaient dans
leurs positions, lorsque le 26 mars 1812, un tremblement de terre (à lire sur Libres Amériques)
sema la mort et la ruine, surtout dans les régions du Venezuela
occupées par eux; les esprits encore imbus de superstition y virent le
doigt de Dieu. La cause de l'indépendance semblait perdue.
En vain le Congrès investit Miranda de tous les pouvoirs; en vain
celui-ci prit le titre de généralissime et proclama à Maracay la loi
martiale; en vain il chercha par l'exemple à ranimer le courage de ses
troupes que décimaient la désertion, les fatigues et la famine;
Puerto-Cabello, le dernier rempart de l'indépendance, défendue par
Bolivar, se rendit aux Espagnols, grâce à la trahison de Venoni qui
leur livra le fort de San Felipe et Miranda apprit cette triste
nouvelle, au moment même où il célébrait, avec son armée, le premier
anniversaire de la proclamation de la République vénézuélienne.
(Ndt - Les faits ne sont pas exacts et cela semble être un beau
compromis avec la réalité entre les deux personnages. L’attitude de
Bolivar fut plus que désinvolte concernant la protection du fort de
Puerto-Cabello sous sa responsabilité, et la livraison de Miranda aux
troupes ennemies fut très confuse).
La lutte n'était plus possible et le héros de Pichincha et de Ayacucho
(Ndt. – les batailles se sont déroulées en 1823 et 1824) capitulait le
25 juillet 1812 à Maracay. La République du Venezuela disparaissait
momentanément du rang des nations.
Fait prisonnier à la Guaira par les Espagnols, le 30 juillet 1812 au
moment où, avec Simon Bolivar, il s'embarquait pour l'Angleterre,
incarcéré à la prison de Puerto-Cabello, puis au fort du Morro de
Puerto Rico, il fut enfin emmené en Espagne et enfermé dans la célèbre
prison de l'arsenal de la Carraca, près Cadix. Une fin terrible
l’attendait et c'est dans un immonde cachot, après avoir vu échouer,
par la trahison d'un faux ami, ses projets d'évasion, que devait mourir
cet homme, de génie qui avait si noblement combattu pour la liberté.
Vaincu par la fièvre et les souffrances les plus atroces, Miranda
rendit le dernier soupir, à l'âge de 60 ans, le 14 juillet 1816. Ainsi
mourut cet apôtre et martyr de l'Indépendance du Venezuela qui, par ses
hautes qualités, sa connaissance approfondie de l'art militaire et son
profond amour de la liberté, étonna ses contemporains.
Les Vénézuéliens n'ont pas oublié le précurseur de leur indépendance et
mus par un pieux souvenir à sa mémoire, ils ont, depuis la Constituante
de Cucuta (12 juillet 1814), conservé comme drapeau national celui
qu'il avait conçu et fait adopter par le congrès de 1811. Ses cendres
n'ont pu être retrouvées, mais sur la proposition et par décret de
l'éminent général Joaquin Crespo, président de la République du
Venezuela, en date du 22 Janvier 1895, contresigné par les ministres
Ezéquiel Rojas, Fabricio Conde, Guerra, Lulowsky, David Léon, Luis
Ezpelusin et Tosta Garcia, un cénotaphe, digne de la mémoire de
Miranda, lui a été élevé dans une chapelle du Panthéon national, à
Caracas.
L'inauguration de ce monument a eu lieu, le 5 juillet 1896, au milieu de réjouissances sans précédents. Le
souvenir de Miranda est également conservé en France; son nom est
inscrit sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile, à Paris, parmi les gloires
militaires de la Révolution et son effigie figure dans la galerie des
portraits du musée de Versailles.
Nous ne saurions mieux terminer cette biographie de Miranda que par ces passages de Michelet :
« Cet homme héroïque, austère, né noble et très riche sacrifia,
de sa jeunesse, son repos et sa fortune au triomphe d'une idée :
l'affranchissement de l'Amérique espagnole. Il n'y a pas d'exemple
d'une vie si complètement dévouée, systématisée tout entière au profit
d'une idée, sans qu'un seul moment fut donné jamais à l'intérêt, à
l'égoïsme.... Personne n'avait plus d'esprit, personne n'était plus
instruit. Quant au courage, s'il n'avait pas la brillante initiative de
nos militaires français, il eut au plus haut degré la fermeté
castillane et cette noble qualité était fondée sur une autre bien
glorieuse : la force et la profondeur de sa foi révolutionnaire. »
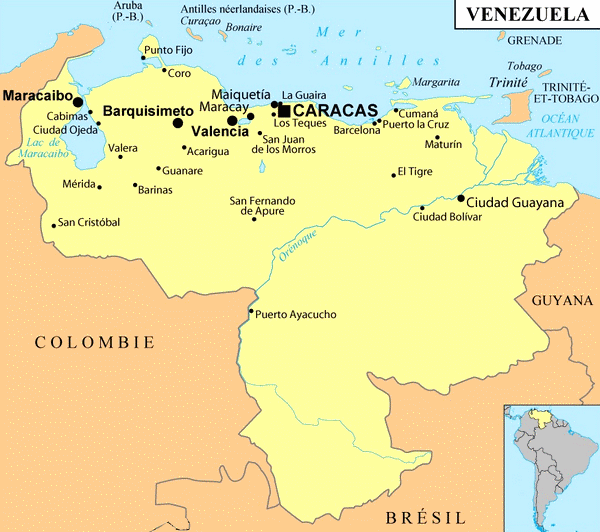
Note et source d'origine :
(1) L’Annuaire illustré pour 1897. Notice sur l'ordre américain du buste du libérateur des Etats-Unis du Venezuela. Source textes et illustrations Gallica-BNF.
|
|
|
|
- Simon Bolivar à Paris
-
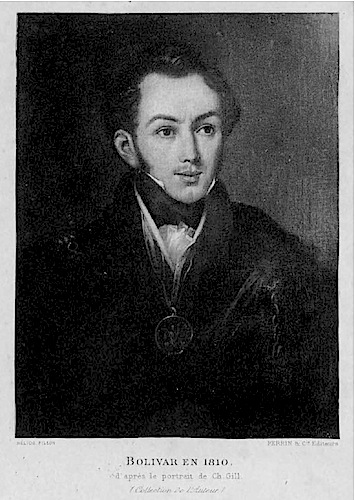
- Bolivar en 1810
Par Louis Guilaine, pour le journal, Le Temps (1912)
|
«Si je ne
me souvenais que Paris existe et si je n'avais l'espoir d'y retourner
un jour, je serais capable de ne plus vouloir vivre» Simon Bolivar
Voici un article glané sur le passage et séjour de Bolivar à Paris,
lors de son deuxième voyage en Europe. Ce n’est pas le seul texte
existant à ce sujet, et fait appel à un historiographe de Simon
Bolivar, M. Mancini, auteur d’un livre sur Bolivar que vous pouvez
consulter à partir de cet article au sein des notes de ou sur l’auteur
! Le Libérateur du Nouveau Monde avait préalablement séjourné en
Espagne et en France jusqu’en 1801, et
c’est à cette occasion qu’il rencontra sa première et seule épouse :
Maria Teresa del Toro y Alayza, fille du Marquis del Toro. Celle-ci va
décéder rapidement après son mariage au Venezuela et le très impulsif
Bolivar vouloir noyer son chagrin au sein des salons parisiens, où il
fut plus que remarqué. Ce sont les parents de Flora Tristan
qui l’aideront à passer certaines passes difficiles, et la petite fille
garda un souvenir impérissable de ces moments partagés et suivra depuis
la France son épopée.
Nous sommes loin encore de cet étrange apparenté que l’on a voulu lui
conférer d’être un équivalent de Napoléon Bonaparte, c’est possiblement
là une projection le résumant à ses conquêtes et inévitablement un
regard proprement autocentré ou bien un parallèle faussé, car impropre.
Cependant les descriptions, les aventures de ce dernier et ses traits
romantiques à la René (Chateaubriand) peuvent se confondre dans
cette inclinaison mélancolique avec la légèreté parisienne, de ce récit
synthétique, d’un ton très classique, voire très franco-français. Cet
art de sombrer dans tous les premiers clichés venus à l’égard des
Amériques, et toujours un brun condescendant et avide de détails d'un
intérêt mineur, pour ne pas dire ridicule.
Cependant il est cité quelques personnages clefs de la relation
franco-vénézuélienne et plus, notamment avec le Baron von Humboldt et
son coéquipier Aimé Bonpland botaniste. Ils parcoururent les premiers
certains coins du Venezuela jusqu’alors non exploré et A. Humboldt,
enseignant de géographie en France produire une des plus belles sommes de son temps
sur l’Amérique méridionale. Et sous le coup d’un contre-temps où ils
devaient à l’origine se rendre en Afrique, mais ne purent s’embarquer
faute de se voir prisonniers ou tués lors de leurs aventures
scientifiques et surtout maritimes.
Toutefois, revenons sur le tout jeune Simon Bolivar, orphelin de ses
deux parents à l’âge de neuf ans. Ses crises existentielles prenaient
des formes incontrôlables, jusqu’à fuguer et refuser toute autorité
adulte en dehors de sa nounou noire Hipolita. A Paris, dans ses
changements abruptes, il va passer du festif à l’étude et toujours avec
le même investissement. Seules deux personnes durant son enfance
arrivèrent à le stabiliser émotionnellement, dont Simon Rodriguez -
qu’il retrouvait en Europe moins d’une dizaine d’années après avoir été
son éducateur au sens plein. On peut parler d’un père spirituel et si
le rapide portrait du journaliste Louis Guilaine sur Simon Rodriguez
alias Samuel Robinson est en parti erroné, celui-ci l’a fortement
inspiré au-delà de son rousseauisme à mener le combat des
indépendances. Celui que l’on désigne comme le «maestro de Bolivar»
reste encore une figure très effacée de l’histoire et son initiateur
aux secrets et à la connaissance.
Hors du cadre de ses frasques et dépenses parisiennes, ce fut aussi
l’occasion de son initiation au sein d’une loge maçonnique
sud-américaine qui a connu ses premières bases dans la capitale et dont le
fondateur était Francisco de Miranda.
Je ne puis l’affirmer à coup sûr, mais je présume son initiation dans
les anciennes carrières des Buttes-Chaumont. Mais point d’emballement,
la relation de Bolivar aux loges fut distante lors de son exercice du
pouvoir à partir des années 1820, ce qui a été la cause de divisions
politiques, en ce domaine, rien n’est simple (lire les notes sur Jules Mancini). Tandis qu’à Paris à la
même époque l’on portait un chapeau nommé le Bolivar pour signaler ses
opinions. Ne serait-ce que pour montrer le rapport un peu frivole en
comparaison à la dimension historique et intellectuelle du personnage,
donc à relativiser, mais comme un symbole, ou soutien à une lutte
républicaine inédite ou difficilement comparable dans sa nature.
L’influence de la France est indéniable, mais il faut rester prudent.
Il n’y a aucun doute, après l’indépendance des Etats-Unis, le choc
retentissant de la Révolution française sera source à peser et en
premier dans une traduction en espagnol de la déclaration des Droits de
l’Homme et du citoyen (Par Narino, de la Nouvelle Grenade ancien nom
de la Colombie) qui prendra date outre-atlantique. Mais, et ce n’est
pas un bémol, Bolivar et d’autres vont croire en tirer un enseignement.
Sauf à rappeler que si la gouverne des Bourbon de France n’eut rien à
envier à sa branche espagnole, au titre des influences, c’était un beau
calque sur la nature de certaines lois répressives, et institutions aux
plus pauvres. Sans parler du poids de l’Inquisition abolie avec les
indépendances des colonies hispano-américaines le temps court de la
Grande Colombie, éphémère.
Bolivar, bien qu’un peu rebelle face à l’enseignement scolaire et aussi
un grand vadrouilleur des rues de Caracas dans sa prime jeunesse. Il
avait déjà lors de son premier séjour fait une pause et s’était formé
l’esprit à de nouvelles sources de connaissances, après avoir vécu
quelques périodes somptueuses. A noter que c’était l’homme le plus
fortuné du Venezuela et qu’il va profiter des éclats d’un héritage et
d’un capital qui lui permit d’épouser ses rêves. Le terme riche est
peut-être même insuffisant au regard de ce qu’il posséda… Une
particularité de cet homme dans ses correspondances : être le plus
synthétique et court possible. Et comme le pose en préambule l’auteur
de l’article reflétant assez peu au final son introduction sur la
démocratie en terres américaines, le sujet est bel et bien toujours
d’actualité… et assez lointain de nos paillardises journalistiques.
Note de présentation de Lionel Mesnard, du 30 avril 2016
|
- Simon Bolivar à Paris,
 Station de métro à Paris dédié à Bolivar - Paris XIX° arrondissement
Station de métro à Paris dédié à Bolivar - Paris XIX° arrondissement
Journal, le Temps, mardi 11 juin 1912 (*)
« Les études et les
travaux sur les origines des démocraties sud-américaines sont de plus
en plus à l'ordre du jour. Un de nos jeunes et distingués diplomates,
M. Mancini, s'est laissé tenter à son tour par l'épopée du Libertador
Simon Bolivar (1783-1830), non moins glorieuse ni moins passionnante
que celle dès conquistadors, et publie un important volume sur Bolivar
et l'émancipation des colonies espagnoles (1). Ce livre, d'un réel
intérêt historique, littéraire et documentaire, contribue à jeter plus
de lumière sur une période de l'histoire du Nouveau Monde restée assez
obscure, et à mettre plus en valeur qu'il ne l'a été jusqu'ici le rôle,
à la vérité très considérable, que la France a joué dans l'émancipation
sud-américaine.
M. Mancini (**) a reconstitué avec un
vif relief la personne et le caractère de Bolivar et s'est attaché à
faire ressortir l’inspiration vraiment française de son oeuvre
libératrice. Dans des pages aussi vivantes et palpitantes qu'un roman,
il nous montre le jeune patricien de Caracas, veuf à vingt ans d'une
épouse qu'il aimait éperdument, venu en Europe pour s’étourdir et
s'oublier et trouvant dans une Française, Fanny de Trobriand, sa
cousine par alliance, fille d'une soeur de M. d'Aristeguieta dont
Bolivar avait hérité son majorat, et mariée à M. Dervieu du Villars, de
beaucoup plus âgé qu'elle, la confidente, l'inspiratrice des nobles
aspirations qui sommeillaient en lui.
Mme du Villars, qui était alors
âgée de vingt-huit ans, témoignait à son cousin une vive affection.
Bolivar était à cette époque un jeune romantique qui traversait la vie
«hautain, tourmenté, désabusé en apparence, affichant un mal
inguérissable, jouant les « René » que Chateaubriand mettait alors à la
mode». (Ndr - C’est-à-dire jouant son propre rôle, René est un des
prénoms de l’auteur romantique).
Fanny s'institua sa conseillère,
sa directrice. Une correspondance suivie s'établit entre Bolivar et sa
cousine, qu'il appelait Thérèse. (Ndt - Son épouse décédé de même) Son
style se ressent manifestement de l'air du siècle, des pâmoisons, des
soupirs et des regards au ciel dont Saint-Preux et Julie embarrassaient
leur écriture.
Bolivar connaissait depuis
longtemps l'état de sa fortune. La lettre qu'il avait envoyée à Caracas
pour avertir son oncle don Pedro de son futur mariage fait allusion au
«majorat important» qu'il risquerait de perdre, si «conformément aux
volontés au légataire», il ne venait s'établir à Caracas, et les
précautions qu'il avait prises, d'accord avec son frère, avant de
quitter pour la seconde fois le Venezuela, afin que ses revenus lui
fussent régulièrement assurés, ne laissent aucun doute sur sa
prévoyance. C'est donc pur romantisme que ces lettres à «Thérèse», mais
elles n'en restent que plus caractéristiques de l'état d'âme du
disciple de Rodriguez et du lecteur passionné de Jean-Jacques :
« Le présent n'existe pas
pour moi c'est un vide absolu d’où ne peut naître un seul désir capable
de laisser de trace en ma mémoire. Ah Thérèse, ce sera là le désert de
ma vie… À peine un caprice m'effleure-t-il, je m'efforce de le
satisfaire, mais ce qui me semblait désirable me devient odieux
aussitôt que je m'en suis emparé. De nouveaux changements que le hasard
imposerait à ma vie me satisferaient-ils? Je l'ignore, mais si ces
revirements se dérobent, je retomberai sans doute dans l'abattement
dont m'a tiré mon précepteur en m'annonçant mes quatre millions. »
Ce précepteur, c'est Simon
Rodriguez, une puissante caricature de Jean-Jacques, qui avait fait de
Simon Bolivar son «Emile». Simon Rodriguez, qui fut le compagnon de
jeunesse et l'éducateur du Libertador, était un type curieux qu'on
aurait cru emprunté à quelque galerie des philosophes français du
dix-huitième siècle. Après s'être à quatorze ans querellé de telle
sorte avec son frère aîné qu'il abandonna le nom paternel pour n'avoir
rien de commun avec lui et prit le nom de sa mère, il s'était fait
mousse (Ndt - Non il fut typographe et s'installa aux Usa plus
tardivement). Il était parti pour l'Europe, avait vu en France la
Révolution, puis était revenu se marier au Venezuela (Ndt - faux), et
plein d'admiration pour le calendrier révolutionnaire, il avait donné à
ses enfants des noms de légumes ( Ndt - rire).
Devenu, pédagogue (Ndt - vrai),
compromis dans les complots des patriotes vénézuéliens contre la
domination espagnole, mais relâché faute de preuves, il avait dû
quitter le pays et son élève et reprendre le chemin de l'Europe en
changeant encore une fois d'état civil. Il s'appela dès lors don Samuel
Robinson. Simon Bolivar l'avait retrouvé à Vienne préparateur du
laboratoire de chimie d'un seigneur autrichien. L’ancien précepteur
avait tenté alors d'éveiller les grandes et nobles passions chez son
«Emile» (2), mais l'heure n'était pas encore venue ou devait se révéler
le, futur libérateur, à, en juger par la vie qu'il mène :
À Vienne, puis à Londres, à
Madrid, à Lisbonne, il mène un train de prince, perd au jeu cent mille
livres en une soirée, prodigue l'or «à la seule apparence des plaisirs». «Je n'aspirais pas aux richesses - écrit-il à Fanny
au sortir de si belles équipées, elles se sont offertes à moi sans que
je les aie souhaitées. N'étant pas préparé à résister à leur séduction,
je m'y abandonne entièrement.»
A Paris, il s'ennuie, écrit-il
encore, mais il faut croire cependant qu'il ne s'y ennuyait pas autant
qu'il le prétendait. Un de ses familiers relate que plus tard le
Libertador, au milieu des graves soucis de la lutte, prenait grand
plaisir à conter ses fredaines de Paris et à dénombrer les beautés
qu'il avait aimées en France, à citer les calembours de Brunet, à
chanter les couplets en vogue. C'est alors qu'il faisait au général
Mosquera cette confidence «Si je ne me souvenais que
Paris existe et si je n'avais l'espoir d'y retourner un jour, je serais
capable de ne plus vouloir vivre.»
Bolivar avait dû certainement rencontrer peu de cruelles si l'on en juge par ce portrait très joliment tracé par M. Mancini :
Bolivar était alors un cavalier
de noble et belle prestance. On pouvait malaisément, où il se trouvait,
figer les yeux sur une autre physionomie que la sienne. Le magnétisme
irrésistible qui plus tard rendra soumis en sa présence ses ennemis,
même les plus résolus, émanait déjà de toute sa personne. Sous les
paupières un peu lourdes, ornées de longs cils noirs, autant
d'étincelles que de sourires échappaient au feu sombre de ses
prunelles.
Il avait le teint mat et chaudement doré, le front haut et serré vers les tempes, les joues maigres, le nez long, droit,
correctement courbé, aux ailes accusées et fines, la bouche d'un dessin
ferme, relevée délicatement à la commissure des lèvres modérément
colorées et saillantes la lèvre supérieure notablement allongée
s'ombrait d'une moustache naissante le menton était bas, carré et
quelque peu cossu. Des favoris châtains contrastant avec une chevelure
brune, qui tombait sur le cou en boucles frisottantes, suivaient
l'ovale très long du visage.
De taille moyenne, le buste
étroit, les jambes grandes, svelte et bien découplé cependant, il
affectait la plus élégante recherche de mise et de manières. Mais la
vivacité de son geste, l'agitation de sa démarche, sa voix aiguë et sonore
semblaient mal adaptées au cadre restreint d'une chambre. On imaginait
mieux Bolivar dans un vaste décor de paysage et de soleil.
Son nouvel historiographe nous
le montre dans le salon de Mme du Villars, qui rivalisait dans le Paris
si brillant du Consulat et des premières années de l'Empire, avec celui
des Ségur, de Mme de Talleyrand, de Mme d'Houdetot. Il y vit toutes les
«reines du jour», Mme Récamier et Mme de Staël, et les hommes
politiques les plus célèbres, des généraux couverts de gloire, le
prince Eugène, des savants, Talma, etc.
Impulsif, raisonneur et disert,
Bolivar tenait dans cette compagnie une place qu'on n'eût pas attendue
de sa jeunesse et de sa qualité d'étranger. Il querellait le prince
Eugène qui s'était avisé de courtiser cette même Thérèse avec laquelle
correspondait si éloquemment le disciple de Rodriguez. Il apportait
dans ce milieu raffiné une note d'exotisme un peu brusque dont la
hardiesse spirituelle intéressait et s'imposait à tous.
Incertain de sa destinée, il
continuait toutefois, à défaut d'autres fièvres, à chercher dans lés
plaisirs l'indispensable aliment de son âme. Le libertinage, la passion
du jeu l'absorbèrent. Les galeries de bois du Palais Royal
retentissaient de ses folies. Les supplications de Thérèse finirent
cependant par émouvoir ce déplorable cousin. Il perdit une somme
considérable, et Rodriguez, venu tout exprès de Vienne, le morigéna
d'importance. On était à la fin de novembre. Bolivar quitta la rue
Vivienne (l’hôtel des Voyageurs, s'y trouve une plaque rappelant son
passage) pour une résidence plus calme, rue de Lancry (Paris – X°
arrondissement, lieu non identifié). Il s'assagit, revint à ses livres.
C'est, alors qu'il se lia avec
Humboldt auquel Mme du Villars l'avait présenté quelque temps
auparavant. C'est à ce contact entre l'esprit prophétique du savant
baron, qui revenait de son grand voyage de l’Amérique du sud dont il
prédisait déjà les immenses destinées, et l'âme ardente du jeune
Américain que se révélèrent la vocation et la haute mission de Bolivar.
Le futur Libertador avait trouvé sa voie.
«La tête pleine alors des vapeurs de l'amour»,
comme il l'a dit lui-même, il assista au sacre de Napoléon. Le
spectacle inouï de cette apothéose, qui lui sembla le terme ultime, de
l'ambition d'un homme, l'exalta et décida de son destin :
« Bien que je fusse loin d'imaginer qu'une telle fortune dût m'échoir un jour, dira-t-il plus tard, j'évoquai malgré moi l'esclavage de ma patrie et l'auréole dont pourrait resplendir son affranchissement».
Peu après, Bolivar partait pour
l'Italie avec Simon Rodriguez, et à Rome, dans un transport sublime,
sur le mont Sacré, il fait à son fidèle précepteur ce serment :
Ah! mon ami par tous ces
immenses souvenirs, par ma patrie et mon honneur, je jure de ne donner
de repos ce bras qu'il n'ait délivré l'Amérique du joug de ses tyrans!
Bolivar a tenu parole. Il va,
par ses victoires de Carabobo, de Boyaca, de Pichincha, etc. affranchir
le Venezuela, la Colombie, l'Equateur, la Bolivie, le Pérou, où il
donnera la main à San-Martin, libérateur de l'Argentine et du Chili. M. Mancini est vraiment un historien éloquent et merveilleusement documenté de cette épopée.
Note de l’auteur et compléments (*) et (2) :
(*) Ses noms et prénoms de baptême : Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios.
(1) Jules Mancini : Bolivar et l'émancipation des colonies espagnoles, des origines à 1815.
A la Librairie académique Perrin et Cie, ouvrage publié de 620 pages à
Paris en 1912. Source : Bibliothèque Manioc - Pointe-à-Pitre
(**) Jules Mancini comme il est précisé dans l’article a été un jeune
représentant diplomatique et l’auteur d’un seul livre en raison d’un
décès prématuré. Il existe peu d’information à son sujet, hors cet
article élogieux du journal le Temps de 1912. Cet ouvrage est à lire
avec distance et critique, les propos et les références sont plutôt
réactionnaires (Guizot, Taine, Gobineau entre autres) et l’analyse des
populations en « races » portent toutes les traces d’une pensée raciste
sur un ordre politique de même. C’est en quelque sorte le regard d’un
colonisateur, cette race bien particulière d’assassin, de gens sans
vertu. Nous avons là une défense et illustration de l’ordre colonial
consigné par un diplomate et son analyse historique révélatrice de son
époque. Il reste cependant à lire pour les plus courageux, parce qu’il
donne accès aussi à des éléments biographiques sur Bolivar qui ne sont
pas à négliger, mais qui peuvent être faux ou infondés aussi. Pour
exemple, l’initiation de Bolivar trouve plusieurs dates et deux lieux
possibles entre 1803 et 1808 entre Cadix et Paris, pour ce qui est le
seul secret existant de la maçonnerie. Comment se déroule le rite
initiatique? De fait on ne peut que supputer, présumer à la limite de
la fiction.
(2) Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762, source UQAC : Emile ou de l’éducation
|
|
|
|
|
« L’épée de Bolivar »
ou Mélenchon ce « grand malade »
qui voudrait nous gouverner ? |
Maison
où fut exposé le corps de Bolivar en 1830 avant son enterrement –
source BNF
Photographie de Joseph de Brettes en
1892 depuis Santa Marta (Colombie)
« En 1827, début du déclin de son pouvoir, il parvint à réunir un
congrès à Panama, dont le but officiel fut d'établir un nouveau Code
international démocratique. Des délégués viennent de Colombie, du
Brésil, de La Plata, de Bolivie, de Mexico, du Guatemala, etc. Son
intention réelle était de transformer toute l'Amérique du Sud en une
république fédérative soumise à sa dictature. Tandis qu'il lâchait
ainsi la bride à son rêve d'attacher la moitié du monde à son nom, le
pouvoir réel échappait rapidement à son emprise ». De Karl Marx
publié
en 1858 et traduit de l'Allemand par Louis Janover.
J’ai tenté pas une fois, mais plusieurs de mettre de l’eau dans mon
vin, j’ai cru que le député européen arriverait à prendre de la
distance avec ses vieux démons, ce sont exactement les mêmes bourdes ou
contradictions qui refont surfaces en 2016, comme en 2012. Il faut
absolument regarder la vidéo de ce dernier à Paris le 26 novembre,
attention, c’est pathétique (1). En onze minutes, c’est la nausée
assurée, et une honte certaine pour la mémoire des oppressés. Un
traitement médico-psychologique pourrait-il s’avérer nécessaire?
Tout comme les grands agités, il vaut mieux éviter de les contredire,
surtout que la meute des fanatiques est hystérisée par les personnage
délirants, soyez prudents ! Malheur à celui qui viendrait contredire le
«lider minimo»! J’assume la part narquoise, parce que la référence à
cette brute épaisse et cruelle que fut Castro Fidel n’est pas une
surprise (lire le post-scriptum). Faute de représenter un mouvement
émancipateur et constructif pour la gauche française, les vieux
oripeaux stalinistes servent encore de matrice à des allumé-e-s.
Comme les petits télégraphistes de Poutine, c’est vraiment trop dans sa
version reptilienne. Monsieur Mélenchon, il serait temps de plier bagage
et prendre votre retraite de sénateur et des leçons de comédiens pour
les feuilletons à l’eau de rose. A ce rythme, il n’y a nulle raison de
suivre un agent suicidaire ou ventilateur des pires thèses régressives
et nationalistes, mais à s’en prémunir.
Le fait de se référer à l’épée de Bolivar a quelque chose de cocasse,
et où se trouve une partie des causes de l’enlisement des républiques
des Amériques espagnoles au XIX° siècle. Le caudillisme après 1830 ou
ce qui fut la fin de la Grande Colombie a été l’horizon pesant de
l’après Bolivar. C’est-à-dire jusqu’en 1936 au Venezuela, ce que l’on
désigne après comme la période de transition vers la démocratie. Qui ne
prendra forme qu’à la fin des années 1950 avec Romulus Betancourt. Avec
toujours à sa tête des militaires, la société civile passant pour bonne
part à la trappe, l’armée vénézuélienne est un état dans l’état depuis
toujours. Pour précision, celui que l’on nomme le Libérateur (El
libertador) est à la source d’idéologies contradictoires. La question
est plus de savoir : quel courant sur l’échiquier politique n’a-t-il
pas nourrit?
En fait de l’extrême droite jusqu’à ses opposés ou oppositions
politiques, ils se réclament tous de cette «épée» bolivarienne, des
juntes sanguinaires aux révolutionnaires maoïstes et pro-cubains. Elle
a servi plus à répandre du sang qu’à étendre la démocratie. Et
probablement n’ayant rien à voir avec ce qu’a pu penser ou écrire
Bolivar, le mythe est une donnée à la peau dure. Sauf à souligner,
qu’un des tenants de la libération des peuples Latino-américains du
joug castillan est décédé au nord de la Colombie (département de Santa
Marta). En exil de ses nations émergentes, nées d’une lutte sans merci
contre l’occupant ou l’empire colonial le plus violent de toute
l’histoire de l’humanité. Surtout à avoir pour constat d’avoir «labouré
la mer» ou les fonds marins, à la fin de ses jours. Pour les amateurs
de
littérature, lire absolument Gabriel Garcia Marquez et son Général dans
le labyrinthe. (2)
Mort d’épuisement après avoir libéré de Caracas à Guayaquil les
populations opprimées. Deux ans avant sa mort, la vie de Bolivar sera
attentée à Bogota en 1828, et sauvée de justesse par sa compagne
Manuela Saenz, sa «libératrice». Le tout avec un parfum de trahison
et pour le savoureux de la chose possiblement en raison de luttes
intestines entre des loges franc-maçonnes sud-américaines. Des Libéraux
aux Conservateurs (de la gauche à la droite) tous se réclament du même
homme et vont en Colombie se faire la guerre pendant des décennies
jusqu’aux années 1960. Vous comprendrez que le fil de cette épée peut
nourrir toutes les erreurs et monstruosités commises au nom des causes
les plus obscurantistes.
Il y a encore peu Mélenchon avait flingué la gauche et incarnait tout
le «peuple». Ce rétropédalage dans la semoule en se réclamant comme
le bras armé de la gauche, n’est pas celle d’un individu sain d’esprit,
selon mon entendement. Je n’ai rien contre l’homme en tant que tel, et
si l’annonce du décès de Castro me laisse froid ou de glace, j’ai
simplement du mal à compatir pour un meurtrier et dictateur, et je
tenais à manifester que non seulement, je ne regrette pas d’avoir
rapidement fui le troupeau des «insoumis», mais qu’en aucun cas, je
ne voterai pour lui et ses partisans.
Comme acte de décès, merci néanmoins pour cette révélation à Jean-Luc
Mélenchon, je le laisse avec ses moulins à vent. Nous n’avons pas
besoin d’un Don Quichotte du marxisme léninisme, ou d’un Jean-Luc
Bonaparte, la main dans le manteau et presque le menton à la David (le
peintre) : regarder à la fin de l’enregistrement, ceci dénote toute la
misère de la philosophie des temps actuels. Je vous invite par ailleurs
à la lecture de Marx sur Bolivar y Ponte! (3). La critique est d’un
usage difficile, et ma seule épée est ma plume et j’ai vraiment autre
chose à faire que mirer la décomposition intellectuelle d’un socialisme
de petits et grands bourgeois. «Inventons ou nous errerons» est la
seule maxime à retenir d’un proche de Simon Bolivar.
Dans toutes ses spéculations ou délires, les avatars de la pensée
magique en plein débat pour les présidentielles ne font pas vraiment un
programme. Il y a vraiment de quoi se tenir à distance de cette
tragédie comédie aux airs incantatoires. Oui, Jean Luc : vous
êtes le
plus grand et le plus beau du monde intergalactique et on vous aime…
D’accord, mais de mort lente comme chantait Brassens pour les idées !
En attendant au Venezuela ce sont à nouveau les plus faibles qui
trinquent et face à des accapareurs de pouvoir furieux de chaque part,
il est impossible d’arbitrer dans la folie. Ici nous connaissons des
problèmes de surproductions alimentaires, là-bas on manque de tout. Et
le président Maduro danse la Salsa et joue le pousse disque dans son
studio radio à lui tout seul, comment ne pas exprimer un gros malaise.
Les enfants de la compagne de Maduro sont incarcérés pour trafic de
drogue de cocaïne à New York, tout le portrait des labourages
contemporains et qui n’ont rien de politiques. Mais se comptent en des
milliards partis en fumée dans le budget des pétroles nationaux
(PDVSA), on ne
sait dans quelles poches ou paradis fiscal? Mais pas au service de la
lutte contre la pauvreté reprenant le cours de la hausse depuis 2013,
le pays jonglant pendant ces temps derniers avec 700% d’inflation. Tout
est de la faute des autres, c’est bien connu, le grand méchant empire
étasunien est derrière, il complote, tout s’explique aux idiots utiles
du système capitaliste et à l’entretien de ses phénomènes parasitaires!
Où se trouve le soutien internationaliste? à ce sujet beaucoup de
blabla et pas d’actes concrets et sortant du morbide de la chose.
A ce stade de connaissance plutôt faible de ce que peut représenter le
spectre des grandes gloires latino-américaines, et l’ignorance assez
généralisée sur les Amériques ibériques et son histoire passée me
pousse à retourner à mon labeur. Je vais aller cultiver mes petites
différences…
A bientôt qui sait !
Billet de Lionel
Mesnard le 28-11-2016
Ps : L’analyse portée par Raphaël Enthoven est très juste et suffit à
elle seule pour poser le cadre des contradictions posées… A
écouter ou
télécharger en Mp3 ! : «N'en
déplaise à Jean-Luc Mélenchon, les crimes de Fidel Castro ne sont pas
un point de détail de l'histoire». (Source Europe 1 du 28-11-2016)
Notes :
(1) Intervention de J-L Mélenchon le 26-11-2016 sur Youtube, lire les
commentaires, c’est édifiant: Cliquez
ici !
(2) Lire une brève critique du roman historique de Garcia Marquez, Le
Général et son Labyrinthe: Cliquez
ici !
(3) pour la référence à Bolivar y Ponte de Karl Marx (1858) : Cliquez ici !
Pour les hispanophones, il existe une version en espagnol en ligne
: Cliquez ici !
  Dernière maison de Simon Bolivar et son jardin à Santa Marta – source Gallica-BNF
Dernière maison de Simon Bolivar et son jardin à Santa Marta – source Gallica-BNF
Photographies de Joseph de Brettes.
|
|
|
|
|
Ti-Sarko s’en va
et Monsieur Nobody triomphe
|
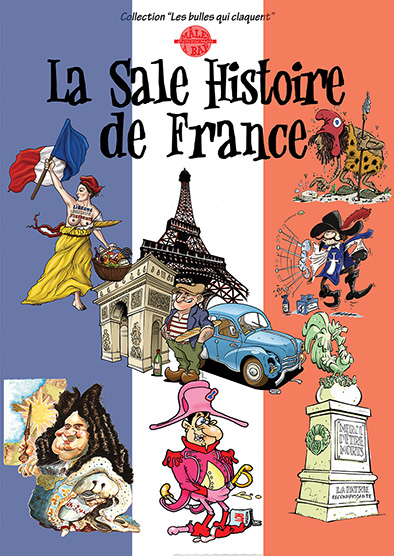 Par Jacky Dahomay, le 28 novembre 2016 (*)
Par Jacky Dahomay, le 28 novembre 2016 (*)
A peine avions-nous voulu, il y a une semaine, inscrire Ti-Sarko dans
l’histoire en faisant de lui un personnage d’une sorte de conte
créole, qu’il se retrouve aujourd’hui brutalement éjecté de l’histoire.
Nous nous sommes trompés. Mea culpa donc. Nous avions oublié que
l’histoire traîne toujours derrière elle ses poubelles et qu’elle
aime de temps en temps se faire une beauté même à coup de
karcher. Les Africains peuvent bien rigoler.
Ti-Sarko doit maintenant s’éclipser, abandonnant comme il
le dit ses « passions publiques » pour ses « passions privées ». Il
emprunte désormais, non pas les voies publiques, mais les chemins
détournés, ce qu’en créole on nomme les Chimin chyen,
(chemin des chiens), chemins de traverse en quelque sorte mais qui ne
sont pas tout à fait ce que les Allemands nomment Holzwege
(chemins qui rentrent dans le bois mais qui s’y perdent). Titre
d’ailleurs d’un livre de Heidegger qui est traduit en français sous
le titre de Chemins qui ne mènent nulle part. (Le bruit
court que pour son départ, Fillon – sur les conseils clandestins de
Macron - aurait décidé de lui offrir ce livre du
philosophe allemand, mais nous n’avons pas pu vérifier une telle
information).
Notre pauvre héros quitte donc le pouvoir et s’en va seul, vers un
nouveau destin. Comme dirait Hésiode, il marche mais il marche
vers rien car les dieux ont caché ce qui fait vivre les hommes. Sur les
chemins poussiéreux, il pense au récit de la Genèse et se demande si
lui aussi n’est pas que poussière car au fond il sait bien que
toujours, demain, la terre reste à la terre. Y aurait-il une dimension
tragique dans la passion de Ti-Sarko ?
En tout cas, il n’emprunte ni une bicyclette, comme le fit une ministre
démissionnaire, ni une moto comme pourrait le faire un président normal
à son départ ni non plus un cheval comme le ferait un nouveau
président sans nom imitant, le héros du western de Tony Valerii, My
name is nobody. Il s’en va seul, à pieds, comme Œdipe aveugle quittant
Thèbes ou Saint-Paul sur les chemins de Damas. Peut-il encore
avoir une illumination? Sans doute, mais on ne peut croire qu’elle
puisse être de nature politique. Toutefois, on ne sait jamais.
Nous serions très attristés de devoir écrire un jour : « le
retour de Ti-Sarko ». Peut-être, par les temps qui courent, une
illumination religieuse ?
Nous voyons mal Ti-Sarko en moine ou en Saint-Nicolas ! Disons plutôt
une illumination dans ses «passions privées» mais là, il faudrait une
autre écoute que la nôtre. En attendant, le Nicolas
aux passions tristes, dans une solitude terrible et une nuit
aveuglante, rêvant d’aspirateur sinon de karcher et pensant à son
ancien collaborateur, creuse son sillon pour aller...vers où ?
Vers son Ithaque bien sûr, dans cette France par lui dangereusement
brunie, en direction de son lieu privé où l’attendent un bruit de
casseroles et l’odeur des frites et où l’espère, sur le parvis
de sa demeure, Carla sa frétillante Pénélope. Et là il
apprendra que s’il y a des allers à Ithaque, les retours d’Ithaque sont
toujours difficiles. Il n’y a que des Fillon à savoir creuser les
sillons d’un tel espoir, quitte à emprunter les chimin chyen. Ti-Sarko
n’ira donc plus jamais à l’Elysée. Mais un autre palais peut l’attendre.
Nous disons donc adieu à Ti-Sarko mais subitement un doute nous
assaille. Avons-nous vraiment bien pensé la « passion de Nicolas » ?
Celle-ci n’aurait-elle pas un sens historique ? Ne serait-ce que dans
une négativité à la mode hégélienne : la ruse de la raison c’est
quand celle-ci utilise les passions des hommes pour arriver à ses fins.
Et si Ti-Sarko avait accompli une œuvre, même basse? Serions-nous
bien allés aux faits ? N’aurions-nous pas eu une vision trop
politicienne de la politique? Car comme l’écrit Régis Debray dans son
livre Allons aux faits (Gallimard) : « La
politique nous cache le politique comme les joies de
la baignade le cycle des marées ».
Les forceurs d’histoire dit-il aussi, sont toujours
un peu zinzins. Mais, ici, on pourrait nous faire cette remarque
:
Arrêtez ! Qu’aurait donc forcé Ti-Nicolas? Vous n’allez tout de
même pas le remettre dans l’histoire d’où on vient de le chasser
!
Eh bien oui, un peu ! Car nous prenons au sérieux ce que dit notre ami
Régis : « Le plafond de possibilité des inventions politiques est plus
bas que ce qu’on aime à penser, afin de jouer de son mieux sur les
variations de l’invariant (…) C’est le jeu de la politique précisément,
que de déployer tout l’éventail des traitements possibles de
l’invariant »
- Poursuivez plutôt votre ti-conte antillais sur Sarkozy et cessez
d’être obscur avec vos références à Debray. C’est quoi cette histoire
d’invariant?
« On m’a appelé l’obscur et mes propos étaient de mer ». Nous ne
savons pas pourquoi nous viennent à l’esprit ces paroles de Saint-John
Perse, poète d’origine guadeloupéenne et que Pétain déchut
de sa nationalité française. C’est que nous parlons
d’Outre-mer et les divers récits identitaires proposés de la
Mère-patrie nous interpellent. Nous préférons la pêche en mer aux joies
de la baignade.
Nous sommes plus observateurs des mouvements des marées d’autant plus
que, sous nos latitudes, ils sont de faible amplitude. Ainsi,
nous sommes très attentifs aux permanences, sans doute à ce que Debray
nomme des « invariants ». Cet écrivain nous a appris que le religieux
subsiste en France pays pourtant dit le plus athée. Ce que sans doute
Emmanuel Todd désigne par le terme de catholicisme zombie, dont
du reste selon lui Hollande serait issu.
Pour donner un exemple, le roman national enseigné à l’école a-t-il
vraiment varié de Jules Ferry à François Fillon en passant par Sarkozy
? Notons que des « Gaulois » de Ti-Sarko à la refonte des manuels
scolaires voulue par Fillon, il y a bien une évolution dans la
permanence, mais en pire. C’est d’une part une falsification
de l’histoire de France et d’autre part un récit qui exclut les
citoyens issus de la «diversité».
Il faut bien noter qu’avec M. Nobody, le logiciel permanent ou «
invariant » d’une droite française très réactionnaire s’affirme sans
complexes. M. Nobody est vraiment un personnage dangereux.
- C’est qui ce Monsieur Nobody et quel rôle joue
Ti-Sarko dans l’histoire?
Vous ne suivez pas l’actualité ? Nobody est le nom que donne Ti-Sarko à
son ancien collaborateur, François Fillon. On nomme ce
dernier tantôt le Collaborateur, tantôt M. Nobody. Monsieur personne.
Reste à savoir pourquoi l’ancien président de la république nomme
ainsi son ancien ministre. Il y a peut-être là une vérité énoncée
par Ti-Sarko. Quelle peut-elle être ?
Sans doute Sarko a-t-il pensé au film de science- fiction de Jaco Van
Dormael. C’est l’histoire d’un enfant qui hésite sur les quais d’une
gare à suivre ou son père ou sa mère. « Ou bien, ou bien » titre d’un
livre Kierkegaard, fondateur de l’existentialisme. Son choix
déterminera la suite de son existence. Doit-on en conclure que Fillon
aurait connu ce choix, entre un père (lequel? De Gaulle?) ou une mère
(laquelle: la mère patrie vue par la droite?), bref, entre
républicanisme et nationalisme ?
S’il a mis du temps à hésiter (on ne le sait pas) ce qui est sûr c’est
que Fillon a fait le choix définitif de la
droite antirépublicaine. Le dilemme existentiel l’a conduit à ce que
Sartre, parlant de Flaubert, nomme le « choix fondamental ». Le
choix d’une droite ultra-conservatrice fait par le prétendant à la
présidence de la république est donc bien « fondamental » et il est
d’autant plus dangereux que le personnage a l’air très serein tout en
ayant l’air de rien. On pourrait même se demander, contrairement à
Sartre pour qui chez tout homme l’existence précède l’essence, si Sarko
ne voulait pas signifier que chez M. Nobody, l’essence
précéderait l’existence !
Mais il se pourrait que Ti-Sarko ait pensé aussi au western de
Valérii, Mon nom est personne, mais la chose est plus difficile à
expliquer. La personne est masque et on pense au film de Bergman. Quel
lien entre l’intimité profonde de Fillon et sa personnalité sociale ?
Nul ne le sait. Dans le film de Valérii, le héros veut vaincre
seul la horde sauvage. Pour la droite actuelle, celle-ci n’est
pas seulement l’« immigré » mais aussi la masse des pauvres qui
s’amplifie. Tout cela est confus et nous proposons une autre
explication.
Personne, Nobody, ninguna, Pon moun en créole (Fillon sé on moun ki pon
moun). On peut décliner le mot dans toutes les langues. Autrement dit,
on aurait affaire là un « sans nom », une personne vide. Etrange ! On a
eu un président agité, ensuite un président normal et maintenant on
pourrait avoir un président vide ? Quel est donc le destin de
cette république française?
Dans ce que Marcel Gauchet nomme la quête de
l’Un, aurait-elle un problème avec l’incarnation du pouvoir et
cela depuis l’Ancien régime? (Lire la transcription de la
conférence de Marcel Gauchet «Qui sont les acteurs de l’histoire?»
17ème rendez-vous de l’histoire de Blois, 2014)
Souffre-t-elle à ce sujet d’une sorte de ce que Marc Richir dans Du
sublime en politique appelle un « malencontre symbolique » et qui
aurait aussi taraudé Robespierre sous la Terreur? Le populisme n’est-il
pas en réalité une sorte de «malencontre symbolique» ce que ne verrait
pas Chantal Mouffe?
En vérité, Fillon cherche à occuper la place de ce qu’on
appelle depuis Lacan, un signifiant vide. Mais quel rapport au
politique?
Il faut revenir à Ernesto Laclau, sans doute celui
qui a écrit le livre le plus profond sur le populisme d’autant plus
qu’on met derrière ce dernier terme tout et n’importe quoi. Pour le
philosophe argentin, il y a populisme quand une série de demandes
populaires se fédèrent en un désir d’identité collective.
Pour cela, il faut bien sûr, un autre, posé comme ennemi, mais
aussi un fondement du lien social qui est selon lui de nature
libidinale. Or, l’identité collective est toujours une construction,
une identité imaginée en quelque sorte, et cela fait penser à la
mère-toute de Lacan qui bien sûr n’existe pas, tout comme d’ailleurs la
femme-toute de Don Juan. Mais cet impossible a besoin d’un objet pour
le représenter et qui le désignerait en quelque sorte. Autre façon de
donner matière à l’absence. Pour Laclau, le parti ou le leader joue
le rôle de signifiant vide dans la logique populiste.
Fillon joue le rôle de signifiant vide pour le peuple de droite.
Ti-Sarko essayait de récupérer les voix du FN. Mais il a développé une
république de la luxure avec maints territoires perdus.
Mister Nobody lui a fait front sur les conservateurs chrétiens. Mais
il fait plus : pour la droite populiste du FN, il peut
représenter le signifiant vide car les machos d’extrême droite ont du
mal à prendre Mme Le Pen pour l’objet identifiant et Philippot n’a pas
la personne ou le masque pour cela. Fillon, oui et il y a là comme un
mystère d’incarnation, ce que la presse n’a pas vu venir. Ainsi donc,
Nobody peut-être celui qui opère une synthèse de toutes les
droites. Sarkozy en a rêvé, Fillon a réussi. Le premier a
voulu faire du Trump mais il n’a pas compris que
chaque droite a son histoire. Celle des USA s’appuie surtout sur
un protestantisme. Celle de France sur un catholicisme.
Sarkozy est ainsi éliminé. Qu’il aille donc au diable ou au bon
dieu !
- Et vous voulez tout de même le faire rentrer dans
l’histoire par on ne sait quelle petite porte.
Oui, car il a joué un rôle historique. Lequel ?
Celui d’éliminer totalement de la droite française un certain
républicanisme issu du gaullisme. Il a mené une lutte farouche
ces dix dernières années contre tous ceux qui pouvaient se réclamer du
gaullisme et il a parfaitement réussi. Quand il était ministre de
Chirac il s’opposait à notre proposition faite au HCI de
distinguer entre intégration républicaine et assimilation car en tant
qu’Antillais nous ne voulions pas entendre parler d’assimilation
culturelle. Devenu président, il créa le ministère de
l’intégration qu’il confia au sinistre Hortefeux. Nous démissionnâmes
donc du HCI suivi en cela par Edouard Glissant.
Ti-Sarko avait compris que c’est par la question de
l’identité qu’il pouvait éliminer une droite républicaine issue
du gaullisme car celle-ci n’a jamais été au clair sur la question de
l’identité. Qui reste-t-il aujourd’hui? De Villepin? La tâche
historique de Ti-Sarko est terminée, il l’a parfaitement accomplie.
Son ancien collaborateur l’a soutenu dans cette
besogne, de façon silencieuse comme s’il était sans nom. Aujourd’hui,
il ramasse la mise ! Il n’y a presque plus personne dans la
droite française à se réclamer du programme du Conseil National
de la Résistance. Le patronat applaudit. Les ultra-libéraux
triomphent
Mais comprendre ce triomphe de la droite en France nécessite de faire
un retour à l’histoire. En vérité cette droite française fut sans
doute la plus puissante d’Europe depuis le XIX° siècle avec ses
écrivains et ses nombreux théoriciens ayant même influencé les
nationalistes allemands. Les éléments permanents de son logiciel?
Son anti-républicanisme, depuis la Révolution française. Son racisme et
sa xénophobie permanente. Son appui sur un catholicisme conservateur.
(70% des catholiques sont antirépublicains au début du XX° siècle). Son
enracinement dans une bourgeoisie provinciale et sur la
paysannerie, ce dernier point ayant marqué Marx dans Le 18 brumaire de
Louis Bonaparte.
Enfin, une forte culture impériale nationaliste justifiant tous les
colonialismes. Et cela donna Vichy et après l’OAS. Elle a su accepter
la démocratie à partir de Maurras mais pas la république. C’est
le logiciel ou l’invariant de cette droite qui triomphe sous une
masque nouveau (compte tenu du néolibéralisme) avec M. Nobody.
Debray nous dirait sans doute qu’il faut remonter encore plus loin,
d’avant même la Révolution. Le connaissant, il risque de
nous renvoyer à Constantin le Grand qui semble le fasciner.
Arrêtons-nous simplement à Louis XIV. Peut-on trouver dès cette époque
les éléments d’un même logiciel?
Avec Colbert c’est l’époque du mercantilisme et on est très loin
du néolibéralisme à moins de penser ce dernier comme une forme de
néomercantilisme. Louis XIV c’est d’abord le rejet d’un premier
républicanisme, celui de la « monarchie républicaine » qui caractérise
en quelque sorte Henry IV. C’est aussi le renouement
avec une politique impériale d’une très grande intensité.
Ensuite, c’est une nouvelle gouvernementalité qui
refuse toute limitation extérieure.
Le Parlement voit son rôle réduit, le Roi soleil gouverne avec
ses ordonnances ou ses Codes, le Chancelier est remplacé par un
superintendant des Finances (Colbert), l’Etat se veut un
Etat administratif et non un Etat de justice. Le Code Noir introduit
une nouvelle biopolitique: on produit une « subjectivité nègre », le
nègre est un humain dégradé ou inférieur, le blanc du même coup
un humain supérieur. Il y a bien là une matrice qui produira des
éléments invariants: le racisme et la xénophobie, la culture impériale,
la tentation de soumettre la justice ou les procureurs au pouvoir
de l’Etat.
Cela ne vous rappelle rien? Jules Ferry le tonkinois bien
sûr, lui qui déclarait à l’Assemblée qu’il est devoir des races
supérieures d’éduquer les races inférieures. Bien, mais qui déclare
aujourd’hui que les Africains ne sont pas entrés dans l’histoire? Qui
veut gouverner par ordonnances et mieux assujettir les procureurs au
pouvoir de l’Etat. De telles questions restent posées.
Ti-Sarko s’en va et M. Nobody triomphe à droite. Nous quittons le conte
pour la tragédie. Nobody n’est pas un vrai populiste car il ne prend
pas en compte les demandes populaires qu’il réduit à des demandes
identitaires. Malgré tout, il affaiblit le FN. En cas de crise
très grave, les éléments d’un néofascisme sont là si Nobody et ses
partisans parviennent à faire front avec ceux de Marine Le Pen.
L’époque est très inquiétante et l’histoire risque de s’accélérer
dangereusement. Mais le mérite de Nobody, dans sa volonté de faire
passer à tout prix ses mesures ultra-libérales, est de remettre la
lutte de classes à l’ordre du jour.
- Et la gauche dans tout cela ? Et Mélenchon ?
Vous voulez à tout prix nous plonger dans
la dépression? Mais vous n’aurez pas notre
désespérance. Nous continuons à réfléchir sur ce que nous appelons «le
moment mélenchonien» Quant au reste, il appartient à la gauche de se
dé-zombifier et d’établir une nouvelle hégémonie. Si Nobody
devient président, l’Outre-Mer va en souffrir. Mais qu’il soit d’ores
et déjà clair que si les luttes sociales vont s’intensifier
avec l’accroissement du chômage et de la pauvreté qui s’ensuivrait,
qu’au plan culturel, il sera hors de question que les enseignants
chez nous appliquent le programme d’histoire, insultant pour nos
mémoires, que pourrait nous concocter ce Monsieur Personne.
Les vrais républicains de gauche devraient penser le lien social dans
un autre registre que celui de Laclau et de Mouffe, non pas dans le
libidinal mais dans la raison des Lumières même si
celles-ci ont produit quelque part des ombres qu’il faut toujours
détecter. Ils doivent abandonner l’obsession identitaire de l’Un,
l’identité racine unique et méditer sur ce que nos écrivains comme
Glissant et Chamoiseau nomment la créolité.
Et si, avec la France, nous n’avons pas fini de nous aimer, c’est
que nous croyons que la France, comme elle l’a fait dans le
passé, sait être grande quand elle abandonne ses tares, quand à
partir d’une lucidité sur elle-même, elle sait prendre le chemin
de la libération en entraînant d’autres peuples derrière elle. C’est le
pays dont le système social est le plus en contradiction
avec le néolibéralisme. Nobody l’a compris. Ou ça passe, ou ça
casse. La France de gauche peut-elle relever le défi en
entraînant dans la lutte d’autres peuples d’Europe?
Durant l’Occupation, les meilleurs de nos parents, dans tout
l’Outre-mer, ont su faire dissidence et rejoindre le
général De Gaulle. N’oublions pas le Gouverneur général Félix Eboué.
Vous n’aurez pas notre désespérance pour une raison bien plus
simple : c’est que depuis près de quatre siècles, dans nos îles
d’Outre-mer où nos ancêtres ont, dans la danse, tenté de repenser le
lien entre la terre et le ciel, nous savons comment la patrie peut être
amère, nous avons toujours cherché à donner matière à l’absence
et, surtout, nous avons appris à humer « l’odeur des mers
silencieuses » pour reprendre cette belle formule de
Nietzsche.
(*) "Né le 13 mars 1946 à Pointe à Pitre, Jacky Dahomay est philosophe,
professeur de la chaire supérieure au Lycée de Bainbridge, Guadeloupe.
A publié de nombreux articles dans des revues diverses aussi bien
concernant la philosophie morale et politique que portant sur les
fondements anthropologico-politique des sociétés caribéennes issues de
l'esclavage".
|
|
|
| Cet espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation politique, ou
entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que rédacteur.
|
|
|
|