- Chronologie
du 15 juillet jusqu'à la fin de l'année 1789

Louis XVI sort de l'Assemblée nationale à Versailles, le 15 juillet - estampe de J.F. Janinet
|
Suite du mois de juillet...
Mercredi 15 juillet : A
Versailles,
au sein du château à huit heures du matin, le duc François
de Larochefoucauld-Liancourt annonce à Louis XVI au saut du lit,
que la veille, les
Parisiens ont pris la Bastille. Au sein du compte-rendu des débats, il est expliqué que « l'Assemblée
nationale, trop profondément affectée et trop vivement inquiète sur les
malheurs publics, pour arrêter ses pensées sur d'autres objets, n'a pas
pu suivre le plan ordinaire de ses délibérations et au lieu de
commencer, comme les autres jours, par la lecture des adresses, on a mis
en délibération quel parti il y avait actuellement à prendre pour
rétablir la tranquillité dans Paris. Plusieurs membres de l'Assemblée
ont fait différentes propositions. Quelques-uns ont présenté des
projets d'adresse au Roi. » Honoré de Mirabeau propose comme adresse : « Sire,
Henri IV, lorsqu'il assiégeait Paris, faisait passer secrètement les
blés à la capitale ; et aujourd'hui, en temps de paix, on veut réduire
cette même ville aux horreurs de la famine sous le nom de Louis XVI. » Le roi se rend à l'Assemblée à midi, lui déclare sa
confiance et annonce l'éloignement des troupes. Il est raccompagné dans
l'enthousiasme général. Au début de l'après-midi, une députation de 60
députés se rend à I‘Hôtel-de-Ville de Paris, pour annoncer la démarche
du roi. Dans la capitale, c'est une « Révolution municipale », M. Bailly devient le nouveau et
premier Maire de Paris effectif depuis Etienne Marcel.
La désignation du maire serait le fruit d'une acclamation générale des
citoyens présents ce jour à l'hôtel-de-ville, avec la députation de l'Assemblée constituante. De même, M. de Lafayette prend
la tête de la milice parisienne comme commandant-général. Un Te Deum d'action de grâce est joué à la cathédrale Notre-Dame. Au Havre,
la population s’empare de la tour François 1er.
16 juillet : Heurt à l'Assemblée, entre le comte de Mirabeau dit le fils et M. Mounier, à propos d'un
projet d'adresse du premier pour demander au monarque le renvoi des
ministres. Le roi fait annoncer le rappel de Necker, renvoie les troupes à leurs casernes, et son intention
d'aller à Paris. Il est fait une déclaration de la noblesse et du clergé, ils renoncent
aux mandats impératifs et au vote par ordre. L'assemblée des électeurs
décide la démolition de la Bastille. S'ensuit la formation de comités permanents et
de milices dans de nombreuses villes de province. A Paris, M. Bailly éccrit à M. Moreau de Saint-Méry : « On m'a dit que l'élection si flatteuse pour moi (celle du 15 juillet) doit être confirmée par une véritable élection : cela me paraît naturel. »
Ce qui n'aura aucune suite, quant à sa désignation. En même temps, le
nouvel édile de la capitale va présenter à l'Assemblée nationale sa
nomination...

Hôtel-de-Ville, arrivée du roi le 17 juillet 1789

| 17
juillet : A Paris, le colon de la Martinique Moreau de Saint-Méry, devenu
président de l'Assemblée des Electeurs de la ville et M. Bailly, nouveau
maire de la capitale accueillent Louis XVI et l'haranguent. Puis le roi est accueilli à l'intérieur de l’Hôtel de Ville de Paris, il reçoit des mains de Lafayette une cocarde tricolore.
Le roi, au cours de sa réception, fait savoir lors de
conversations particulières, à Bailly d'abord, puis à Lafayette, qu'il
confirme leur nomination. Dans le lot d'une centaine de personnes de
l'Assemblée nationale se trouve Maximilien Robespierre venu dans le cortège avec le roi depuis
Versailles, et qui en profite pour faire une visite guidée : « J'ai vu la Bastille, j'y ai été conduit par un détachement de la brave milice bourgeoise qui l'avait prise ». |
Suite du 17 juillet : Les grands du
royaume fuient la France, comme Condé,
le comte d'Artois, ce dernier part pour Turin en Italie, commence ainsi les débuts de
l'émigration. Deux villes notoires accueilleront les
contre-révolutionnaires : Coblence (ou Coblentz) et Mayence en
Allemagne. A Saint-Germain-en-Laye, il éclate une émotion populaire,
le meunier Sauvage est accusé d'accaparement
et décapité. A Rouen s’installe une nouvelle municipalité.
18 juillet : Ile de France, il éclate une émeute à Poissy, le fermier Thomassin est sauvé de
justesse. L'Assemblée décide d'envoyer une députation sur place. A Paris, Lafayette s'adresse directement aux soixante districts, il écrit qu'il se doit d' « observer que le général des milices parisiennes
a été nommé par une acclamation, bien flatteuse sans doute, mais qui
n'a pas le caractère légal de la volonté des citoyens, d'où doit émaner
tout pouvoir. Je désire, Messieurs, que mes concitoyens se choisissent régulièrement un chef. » (Source : Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution,. Introduction, page XV ; Sigismond Lacroix, Paris 1894)
Dimanche
19 juillet : A Nantes, le
château des ducs de Bretagne, ou la "Bastille nantaise" est prise
d'assaut par plusieurs centaines de
révolutionnaires, et le commandant de cette place forte ne fait aucune
résistance, on ne déplore aucune victime ; dès le lendemain est élu un
nouveau maire, M. Christophe-Clair Kervégan. A Paris, éclate une émeute
dans le quartier
Saint-Germain, deux députés sont pris à partie. Dans la capitale et
jusqu'au 23/08, 57 des 60 districts parisiens formalisent la
désignation du maire du Paris et du général-commandant de la milice.
20
juillet : Débuts de la Grande Peur (jusqu'au 6 août) avec des révoltes dans toute la
Franche-Comté, les paysans s’attaquent aux châteaux et brûlent les
actes
seigneuriaux, s'ensuit la constitution de municipalités et de Gardes
nationales
dans toute la France, et l'extension de la «
révolution municipale », plus l'expansion des milices bourgeoises. En Normandie, la garnison de Caen est chassée par la
foule, et à Rouen, deux métiers de tissage britannique sont
détruits. A l'Assemblée, la motion de
Lally-Tolendal proposant une proclamation pour appeler le Peuple à
l'ordre et au respect des lois reçoit une vive opposition de MM. Buzot,
Mirabeau et
Robespierre : « Il
faut aimer la paix, mais aussi il faut aimer la liberté. Avant tout,
analysons la motion de M. de Lally. Elle présente d'abord une
disposition contre ceux qui ont défendu la liberté. Mais y a-t-il rien
de plus légitime que de se soulever contre une conjuration horrible
formée pour perdre la nation? L'émeute a été occasionnée à Poissy sous
prétexte d'accaparement ; la Bretagne est en paix, les provinces sont
tranquilles, la proclamation y répandrait l'alarme et ferait perdre la
confiance. Ne faisons rien avec précipitation : qui nous a dit que les
ennemis de l'Etat seront encore dégoûtés de l'intrigue? ». (Source : Archives Parlementaires - Bib. Stanford) M. Lally-Tolendal « a été fortement attaqué par MM. Robespierre, Buzot (député d'Evreux) et Gleizen (député de Rennes). » (Source : Mercure de France du 27/07)
21
juillet : De graves émeutes éclatent à Strasbourg, quand est appris la
prise de la Bastille, l'hôtel-de-ville est mis à sac et de nombreux
documents administratifs sont détruits. Et de même à Lille, le
commandant est
lapidé, les maisons saccagées. A Cherbourg, devant l’émeute le maire
doit quitter la ville. A Versailles, le député Sieyès à l'Assemblée déclare au sujet des
citoyens passifs, qui selon lui ne peuvent devenir actifs, c'est-à-dire
les femmes, les enfants, les pauvres et les étrangers, « ceux qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent point influer sur la chose publique ». Reprise des spectacles à Paris, il y est joué la Partie de chasse d'Henri IV, qui est une comédie en 3 actes et en prose, du défunt M. Charles Collé.
22 juillet : Cette journée est considérée comme un prélude à la Grande Peur. (Cahiers de L'Institut d'Histoire de la Rév. française) A Paris, Louis Bertier de Savigny, Intendant de la Ville (préalablement
arrêté à Compiègne), et son beau-père M. Joseph François
Foullon sont exécutés devant l'Hôtel-de-Ville par la foule. Et il est
procédé à l'arrestation du commandant militaire de la région
francilienne, Pierre-Victor de Bezenval, près de la capitale, il
échappe à un lynchage et il est conduit en prison. En
Normandie, à Falaise, le marquis de Ségrie renonce à
ses droits féodaux devant l'ire et par crainte d’une émeute ; à Ballon,
en pays Normand, le lieutenant du Mans et le seigneur du village
sont
assassinés par des paysans.
|
23 juillet : La
proclamation proposée par M. Lally-Tolendal (ci-contre) le 20/07 est enfin adoptée,
avec des amendements. Des députés, des électeurs du Tiers demandent à
l'Assemblée la création d'un tribunal pour les crimes de lèse-nation.
Le marquis de Lafayette veut donner sa démission de commandant-général de la
milice, les
districts parisiens lui demandent de rester. |
|
 |
24 juillet : Arrêt de l'assemblée générale des Electeurs de la Commune
: toute publication doit porter le nom de l'auteur ou de l'imprimeur,
les colporteurs d'écrits non signés seront emprisonnés. M. de Beaumarchais
fait don de 12.000 livres pour les pauvres du faubourg Saint-Antoine.
25
juillet : A l'Hôtel-de-Ville, il se tient la première réunion de
l'assemblée provisoire des Représentants de la Commune de Paris, élue
le 24, soit 120 membres, ou 2 élus par district.
26
juillet : En Bourgogne, dans le Mâconnais se produit une révolte
paysanne. Le député et abbé Maury est arrêté à Péronne (bailliage de Picardie). Le lendemain, l’Assemblée
demande sa libération. Celui-ci en tant qu'élu du Tiers s'opposera à
l'émancipation politique des Juifs au sein de la Constituante, en 1789 et 1790, et
il sera nommé évêque en 1792 par Rome.
27 juillet : A l'Assemblée M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre déclare : « La
nation a voulu être libre, et c'est vous qu'elle a chargés de son
affranchissent! Le génie de la France a précipité, pour ainsi dire, la
marche de l'esprit public ; il a accumulé pour vous, en peu d'heures,
l'expérience que l'on pouvait à peine attendre de plusieurs siècles.
Vous pouvez, Messieurs, donner une constitution à la France ; le Roi et
le peuple la demandent ; l'un et l'autre l'ont méritée. » Et il est procédé au Résultat du dépouillement des cahiers.
|
Art. 1er. Le gouvernement français est un gouvernement monarchique.
Art. 2. La personne du Roi est inviolable et sacrée.
Art. 3. Sa couronne est héréditaire de mâle en mâle.
Art. 4. Le Roi est dépositaire du pouvoir exécutif.
Art. 5. Les agents de l'autorité sont responsables.
Art. 6. La sanction royale est nécessaire pour la promulgation des lois.
Art. 7. La nation fait la loi avec la sanction royale.
Art. 8. Le consentement national est nécessaire à l'emprunt et à l'impôt.
Art. 9. L'impôt ne peut être accordé que d'une tenue d'Etats généraux à l'autre.
Art.,10. La propriété sera sacrée.
Art. 11. La liberté individuelle sera sacrée.
Questions sur lesquelles l'universalité des cahiers ne s'est point expliquée d'une manière uniforme.
Art. 1er. Le Roi a-t-il le pouvoir législatif, limité par les lois constitutionnelles du royaume?
Art. 2. Le Roi peut-il faire seul des lois provisoires de police et
d'administration, dans l'intervalle des tenues des États généraux?
Art. 3. Ces lois seront-elles soumises à l'enregistrement libre des cours souveraines?
Art. 4. Les Etats généraux ne peuvent-ils être dissous par eux-mêmes ?
Art. 5. Le Roi peut-il seul convoquer, proroger et dissoudre les Etats généraux?
Art. 6. En cas de dissolution, le Roi est-il obligé de faire sur-le-champ une nouvelle convocation.
Art. 7. Les Etats généraux seront-ils permanents ou périodiques?
Art. 8. S'ils sont périodiques, y aura-t-il, ou n'y aura-t-il pas une commission intermédiaire?
Art. 9. Les deux premiers ordres seront-ils réunis dans une même Chambre?
Art. 10. Les deux Chambres seront-elles formées sans distinction d'ordre?
Art. 11. Les membres de l'ordre du clergé seront-ils répartis dans les deux autres ordres?
Art. 12. La représentation du clergé, de la noblesse et des communes sera-t-elle dans la proportion d'une, deux et trois?
Art. 13. Sera-t-il établi un troisième ordre, sous le titre d'ordre des campagnes?
Art. 14. Les personnes possédant charges emplois ou places à la cour, peuvent-elles être députées aux Etats généraux?
Art. 15. Les deux tiers des voix seront-ils nécessaires pour former une résolution?
Art. 16. Les impôts ayant pour objet la liquidation de la dette nationale, seront-ils perçus jusqu'à son entière extinction?
Art. 17. Les lettres de cachet seront-elles abolies ou modifiées?
Art. 18. La liberté de la presse sera-t-elle indéfinie ou modifiée?
Ps : suivent les premiers débats sur la constitution et un projet de déclaration des droits de l'homme en société de M. Target. Présenté au comité de constitution.
|
28 juillet : A Versailles, à la Constituante un député de
Franche-comté fait le récit des atrocités perpétuées par un
aristocrate, M. de Mémay, conseiller au Parlement de Besançon. Celui-ci
a piégé un grand nombre de citoyen en proposant un festin, et avec la
complicité de ses domestiques, par la suite, il les a poussé dans un
piège mortel en employant des explosifs et il a occasionné la mort de
plusieurs personnes et des blessés. Il est depuis en fuite. Une
information parue dans Le Patriote François, de Jacques-Pierre Brissot, dans le n°1, ce jour, composé de 4 pages. Et il fait état de la liberté de la presse « enfin rendue » dans son premier numéro autorisé. Ses premières tentatives datent de mars-avril et mai. (Source : BNF-Gallica)
29 juillet : En Alsace, dans le Sundgau, les paysans
attaquent les châteaux, puis les populations juives. A Paris, encore un retour de Necker et le dernier : il entre dans l'Assemblée
portée par l’enthousiasme, et il est décidé que tous les votes se
feront à la majorité simple. Aussi la chambre des députés autorise le droit de pétition à titre individuel
et le texte signé par son auteur, car ne pouvant être fait à titre
collectif. Il est décidé d'un réglement à l'usage de l'Asssemblée
nationale.
Chapitre premier, Du président et des secrétaires :
1° Il y aura un président et six secrétaires.
2° Le président ne pourra être
nommé que pour quinze jours ; il ne sera point continué, mais il sera
éligible de nouveau dans une autre quinzaine.
3° Le président sera nommé au scrutin, en la forme suivante. Etc.
30 juillet : Dans la capitale, M. Necker est reçu à l'hôtel-de-ville par l'assemblée
des Electeurs et par l’assemblée des 120 représentants, il obtient la
libération de M. Bézenval et un arrêté d'amnistie générale. Réactions très
vives des districts, surtout celui de l'Oratoire, et provoque
l’effervescence, l'assemblée des Electeurs reporte son arrêté.
31 juillet : L'Assemblée approuve l'arrêté des Électeurs revenant sur
l'amnistie. Robespierre, lui demande la punition des crimes, comme un «
droit de la Nation » et il déclare : « Je
réclame dans toute leur rigueur les principes qui doivent soumettre les
hommes suspects à la nation à des jugements exemplaires. Voulez-vous
calmer le peuple? parlez-lui le langage de la justice et de la raison.
Qu'il soit sûr que ses ennemis n'échapperont pas à la vengeance des
lois, et les sentiments de justice succéderont à ceux de la haine. » Et selon le compte-rendu : MM.
Bouche et Pétion de Villeneuve professent les mêmes principes et les
mêmes sentiments. Tous regardent le projet d'arrêté de M. Target comme
suffisant.
VIII - Le mois d’août 1789
Samedi 1er août : Il paraît un nouveau périodique se nommant L'Observateur
(de 4 à 8 pages si avec un supplément, et édité environ tous les 2
jours), Ses rédacteurs sont le journaliste Gabriel Feydel et l'écrivain
Choderlos de Laclos, ils sont proches de MM. Bailly et Lafayette et le
ton du journal est plutôt à la satire (130 numéros jusqu'au 12 octobre
1790). A la Constituante, sous la présidence du duc de Liancourt, le compte-rendu précise que « l'on
annonce des députations des représentants de la commune de Paris, des
villes d'Orléans, de Sens et de Dieppe. Quelques membres sont des
représentations contre l'abus de l'admission des députations, qui
faisaient perdre à l'Assemblée un temps précieux qu'elle devait aux
travaux de la constitution. » M. Pétion de Villeneuve « s'élève contre » et à son tour Mirabeau, va dans le même sens et conclue : « Quant
à la proposition de ne plus admettre les députations des provinces,
j'espère qu'elle ne peut pas même être mise en question. Nous n'avons
pas plus le droit que le désir de refuser les avis, les consultations,
les communications de nos commettants ; et s'il pouvait s'élever dans
notre sein de telles prétentions, l'opinion publique les aurait bientôt
mises à leur place ». M. Regnault garde le silence, et sa motion n'a aucun succès. Puis l'on discute à l'Assemblée à savoir, si la
déclaration des droits précèdera-t-elle la constitution? Une
députation des électeurs signale l'extrême fermentation de Paris et
demande l'institution rapide d'un tribunal pour juger des crimes contre
la Nation. Grave émeute à Lyon, la milice bourgeoise de cette ville
fait une expédition « pleine de succès » contre les « brigands » des
environs. A Valenciennes, deux paysans pendant les émeutes sont pendus.

2 août : Dans la nuit du 2 au 3, à Saint-Denis, le lieutenant-maire de
la ville est massacré par la foule, pendant une distribution de pain
aux pauvres. (Gravure de J.F. Janinet, ci-dessus)
3
août : En début des débats de la Constituante, le duc de
Liancourt annonce que le vote de samedi a élu pour président des
séances M. Thouret, qui prend sa place, fait une courte intervention,
puis
démissionne, et M. de Liancourt est invité par l'Assemblée à
reprendre ses fonctions en attendant une prochaine élection. Pétion de
Villeneuve propose une nouvelle distribution de la parole en deux
listes pour les textes proposés, avec les intervenants qui sont pour et
ceux qui sont contre, pour éviter ainsi des échanges à ne plus en finir
ou se répétant. Puis les débats s’engagent sur les troubles des
campagnes. Pour y remédier, M. Salomon, au nom du comité des rapports,
propose que l'Assemblée nationale, « informée
que le paiement des rentes, dîmes, impôts, cens, redevances
seigneuriales, est obstinément refusé, déclare« qu'aucune raison ne
peut légitimer les suspensions des paiements d'impôts et de
tout autre redevance, jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur
ces différents droits ». Certains députés disent que
l'Assemblée n'a pas de preuves légales des désordres. M.
Desmeuniers, député du Tiers-état de Paris, remarque « que les faits n'étant point constatés, il ne convient pas à l’Assemblée de faire une déclaration sur des objets douteux ». En toute fin des échanges, le projet de déclaration est renvoyé au comité de rédaction.
|
|
La nuit du 4 août 1789 et fin des féodalités !
 Légende : Nuit du 4 août 1789 ou le délire patriotique
Légende : Nuit du 4 août 1789 ou le délire patriotique
Ci-après
il s'agit d'un récit du 4 au 5 août 1789 d'Adrien Duquesnoy, avocat
lorrain, député du
Tiers à la Constituante à Versailles, élu de mai 1789 à septembre 1791.
Puis il deviendra maire de la ville de Nancy jusqu'en 1792. Ses écrits
sont extraits de son Journal, qu’il a tenu au jour le jour une partie
de son mandat.
La nuit du 4 août est un des événements majeurs de
l'année 1789, ce regard de l'intérieur mérite attention, mais ce
n'est que le point de vue d'un député se qualifiant de révolutionnaire, mais monarchiste. Toutefois, il existe peu de
témoignages
pris dans le vif, en dehors de la presse
présente. Cependant en raison des horaires tardifs, les habitants de
Versailles devaient dormir poings fermés... pourtant quelle effervescence dans la salle des Menus-Plaisirs !
La séance d'hier matin (le 4 août, à l'Assemblée constituante commença
à 9 heures sous la présidence de la Rochefoucauld-Liancourt) s'est
ouverte par la lecture de quelques adresses et du procès-verbal des
séances précédentes, puis on a repris la discussion sur la question de
savoir s'il y aurait ou non une déclaration des droits de l'homme. Je
n'analyserai pas les divers discours qui ont été tenus ; presque tous
rentrent dans le même sens, ont le même objet.
Buste de M. Adrien Duquesnoy par Houdon ci-contre
|
|
 |
L'Assemblée, fatiguée de cette multitude de harangues, demandait à
aller aux voix, lorsque M. Camus a proposé d'ajouter aux mots
déclaration des droits ceux de déclaration des devoirs. Cela a donné
lieu à de nouvelles discussions ; on lui a observé avec raison qu'il
n'y a pas de droits sans devoirs, que des droits supposent le respect
pour les droits d'autrui.
On ajoutait que la déclaration des droits de l'homme fixait ses droits,
la constitution et la législation ses devoirs, etc., etc. Toutes ces
observations ont été inutiles, il a opiniâtrement voulu qu'on délibérât
sur cet amendement. II a été rejeté, mais cet entêtement a occasionné
une perte immense de temps, et l’on a remarqué avec peine que M. Camus
soutenait avec une espèce d'acharnement une proposition à laquelle le
clergé semblait mettre un haut prix. On a délibéré alors s'il y aurait
ou non une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et
l'affirmation a été arrêtée presque unanimement. On va voir dans quelle
forme elle sera rédigée.
La discussion avait été interrompue par l'arrivée d'une lettre du Roi dont voici la copie :
« Je
crois, Messieurs, répondre aux sentiments de confiance qui doivent
régner entre-nous en vous faisant part directement de la manière dont
je viens de remplir les places vacantes dans mon ministère. Je donne
les sceaux à M. l'archevêque de Bordeaux, la feuille des bénéfices à M.
l'archevêque de Vienne, le département de la guerre à M. de la Tour du
Pin-Paulin, et j'appelle dans mon Conseil M. le maréchal de Beauvau.
Les choix que je fais dans votre Assemblée même vous annoncent le désir
que j'ai d'entretenir avec elle la plus constante et la plus amicale
harmonie. »
Signé : « Louis. »
« A Monsieur le Président, Je vous envoie, Monsieur, une note que,
comme président, vous lirez de ma part à l'Assemblée nationale. »
A mesure que le président lisait la lettre, les noms étaient
successivement applaudis ; la lettre l'a été beaucoup elle-même quand
on l'a unie, et certes avec raison. Nous avons donc un ministère
populaire, un ministère nommé par la voix du peuple ; jamais cela
n'était arrivé.
Le bon archevêque de Vienne est plein d'années et de vertus, c'est un
homme bon, simple, c'est un ancien prélat ; l'archevêque de Bordeaux
est l'ami de M. Necker depuis quinze ans. Il est un des créateurs des
administrations provinciales, il est un des auteurs de la révolution
actuelle, et personne, peut-être, n'y a plus contribué que lui,
puisqu'il a entraîné les curés pour se réunir aux communes.
Le comte de la Tour du Pin-Paulin est parfaitement étranger à toutes
les intrigues ; il est étranger à ce pays-ci, il est agréable à
l'armée, il est âgé, il a bien fait la guerre. Le maréchal de Beauvau
est l'homme le plus vertueux de la cour, il est ami de M. Necker.
Quelles espérances que les travaux de l'Assemblée nationale seront
secondés par le Roi ! La nation sera libre, sans doute, mais elle le
sera plus tôt encore que si un ministère pervers était venu retarder,
contrecarrer ses opérations.
Il m'est impossible de m’occuper d'autre chose que de la séance du soir
(nuit du 4 août). Qu'on se rappelle qu'elle avait pour objet la lecture
de l'arrêté qui avait été voté la veille pour tâcher de calmer les
provinces. Dès qu'il a été lu, le vicomte de Noailles s'est levé et a
dit que le seul motif des peuples pour dévaster les châteaux est le
fardeau onéreux des rentes et prestations seigneuriales, reste odieux
de féodalité ; il a insisté pour qu'on les déclarât rachetables, il a,
été applaudi avec transport.
Le duc d'Aiguillon a appuyé cette motion et y a donné de nouveaux
motifs ; puis le duc du Châtelet a déclamé avec violence contre les
abus de la féodalité, on l'a applaudi à plusieurs reprises ; plusieurs,
nobles ont exigé qu'on en fit une déclaration expresse.
L’évêque de Nancy s’est levé et a appuyé pour lui personnellement la
motion de MM. De Noailles, d'Aiguillon et du Châtelet ; il a invité
tout le clergé à faire de même, en observant que le produit du rachat
des rentes ne devait pas tourner au profit îles titulaires actuels des
bénéfices, mais être placé pour faire un capital appartenant au
bénéfice.
L'évêque de Chartres, l'archevêque d'Aix ont successivement appuyé
cette opinion, puis tout le clergé s'est levé, puis toute la noblesse.
L'évêque de Chartres a déclaré qu'il renonçait aux droits de chasse,
tout le clergé, toute la noblesse, l'ont suivi ; puis M. de
Saint-Fargeau a demandé que non seulement que tous les privilèges
pécuniaires fussent abolis pour l'avenir, mais que tous les privilégiés
fussent imposés, à dater du 1er janvier de cette année 1789, dans la
même forme et sur les mêmes rôles que les autres individus ; puis on a
voté la suppression des colombiers et garennes, puis les curés ont
offert la suppression du casuel. Les banalités, l'admission à toutes
les places : c'était un délire, une ivresse.
Le marquis de Blacons a demandé l'abandon des privilèges de toutes les
provinces ; la Bretagne a donné l'exemple ; les barons de Languedoc ont
renoncé à leurs droits de baronnie ; l'Artois, la Bourgogne, la
Lorraine, etc., etc. Puis l'archevêque de Paris a proposé un Te Deum
dans la chapelle du Roi, le duc de Liancourt une médaille pour
perpétuer cet événement éternellement mémorable, et, sur la motion du
comte de Lally, Louis XVI a été proclamé « restaurateur de la liberté
française ».
Jamais, sans doute, aucun peuple n'a offert un tel spectacle ; c'était
à qui offrirait, donnerait, remettrait aux pieds de la nation :
- moi, je suis baron de Languedoc, j'abandonne mes privilèges ;
- moi, je suis membre des états d'Artois, j'offre aussi mon hommage ;
- moi, je suis magistrat, je vote pour la justice gratuite ;
- moi, j'ai deux bénéfices, je vote contre la pluralité des bénéfices.
Plus de privilèges des villes ; Paris, Bordeaux, Marseille, y
renoncent. Grande et mémorable nuit! On pleurait, on s'embrassait.
Quelle nation! quelle gloire, quel honneur d'être Français!
L'Assemblée a duré jusqu'à deux heures du matin. Elle se reforme
aujourd'hui à midi pour entendre l'arrêté rédigé et faire au Roi une
députation.
Nous avons fait dans six heures ce qui devait durer des mois, ce qui
nous effrayait ; quel puissant moyen de faire taire les incendiaires et
les déclamateurs! Il m'est impossible d'écrire ; je suis trop agité par
tous les sentiments.
A deux heures, on a apporté une lettre des trois nouveaux ministres,
pleine de témoignages de respect pour l'Assemblée. Ils déclarent qu'ils
n'exerceront aucune fonction publique que de son agrément.
On chante le Te Deum dans tout le royaume.
Source : Gallica-Bnf, Journal d’Adrien Duquesnoy
du 3 mai 1789 au 3 avril 1790, tome 1, pages 264 à 268 Publié pour la Société d'histoire contemporaine en 1898. |

Nuit du 4 août : L’Assemblée
nationale vote l’abolition du régime féodal et de certains droits
seigneuriaux sur la chasse, mais le roi ne signera pas. Voilà ce qu'en
dit le compte-rendu : « La séance
s'était étendue bien avant dans la nuit, quand M. le président, après
avoir pris le vœu de l'Assemblée, suspend le cours de ces déclarations
patriotiques, pour en relire les chefs principaux, et les faire
décréter par l'Assemblée, sauf la rédaction ; ce qui est exécuté sur
l'heure à l'unanimité, sous la réserve exigée par les serments et les
mandats de divers commettants. » (Bib. de Stanford - Arch. Parlementaires, tome VIII)
Suivent les articles arrêtés :
- Abolition de la qualité de serf et de la mainmorte, sous quelque dénomination qu'elle existe.
- Faculté de rembourser les droits seigneuriaux.
- Abolition des juridictions seigneuriales.
- Suppression du droit exclusif de la chasse, des colombiers, des garennes.
- Taxe en argent, représentative de la dîme.
- Rachat possible de toutes les dîmes, de quelque espèce que ce soit.
- Abolition de tous privilèges et immunités pécuniaires.
- Egalité des impôts, de quelque espèce que ce
soit, à compter du commencement de l'année 1789, suivant ce qui sera
réglé par les assemblées provinciales.
- Admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires.
- Déclaration de l'établissement prochain d'une justice gratuite, et de la suppression de la vénalité des offices.
- Abandon du privilège particulier des provinces
et des villes. Déclaration des députés qui ont des mandats impératifs,
qu'ils vont écrire à leurs commettants pour solliciter leur adhésion.
- Abandon des privilèges de plusieurs villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc.
- Suppression
du droit de déport (perception du revenu d'un diocèse par son évêque
pour une durée limitée) et vacat (droits de succession), des annates
(impôts du pape), de la pluralité des bénéfices.
- Destruction des pensions obtenues sans titres.
- Réformation des jurandes
- Une médaille frappée pour éterniser la mémoire de ce jour
Il est précisé en plus qu'il sera joué un « Te Deum solennel, et l'Assemblée nationale en
députation (se rendra) auprès du Roi, pour lui porter l'hommage de l'Assemblée, et
le titre de Restaurateur de la liberté française, avec prière
d'assister personnellement au Te Deum. Les cris de vive le Roi! les
témoignages de l'allégresse publique, variés sous toutes les formes,
les félicitations mutuelles des députés et du peuple présent, terminent
la séance. Avant de la lever, M. le président lit une lettre qui lui
est écrite par MM. Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, Le Franc
de Pompignan archevêque de Vienne, et M. le comte de La Tour-Du-Pin,
appelés par le Roi au ministère. (...) La séance est suspendue à deux
heures après minuit, et continue à demain midi. »
Source : Bib. de Stanford - Archives Parlementaires, tome VII, du 5/05 jusqu'au 15/09/1789
|
5 août : A l'Assemblée, à la présidence siège M. Le Chapelier, à la fin
des échanges M. le comte de Montmorency fait la lecture de
l'arrêté, tel qu'il a été libellé par le comité de rédaction. Le projet
d'arrêté stipule, « considérant,
1° Que dans un État libre, les propriétés doivent être aussi libres que les personnes ;
2° Que la force de l'Empire ne
peut résulter que de la réunion parfaite de toutes les parties, de
l'égalité des droits et des charges ;
3° Que tous les membres
privilégiés, et les représentants des provinces et des villes se sont
empressés de faire, comme à l'envi, au nom de leurs commettants, entre
les mains de la nation, la renonciation solennelle à leurs droits
particuliers et à tous leurs privilèges ; Et il est suivi de 19
articles faisant loi reprenant les arrétés de la nuit !
6 août :
A la Constituante, le député Buzot déclare que les biens du clergé sont
à la nation et l'on continue de parler des droits de chasse.
7 août : De retour à Paris, M. l'abbé d'Eymard, député Alsacien, ainsi
que pour M. de Rohan, exprime ses regrets de n'avoir pu pas se rendre
plus rapidement à l'Assemblée et l'explique en raison des troubles
survenus en Alsace. Le Garde des sceaux expose à l'Assemblée les «
malheurs
publics » et M. Necker demande un emprunt de 30 millions. Il est décidé
dans la capitale d'un arrêté de la
Commune pour faire cesser les attroupements sé́ditieux.
8
août : A la Constituante, une députation de la ville de Saint-Denis se
présente à la barre pour obtenir le pardon de ceux qui ont assassinés
le maire le 2 août à Saint-Denis. La requête est prise en considération par le
Président de la séance. Une députation des habitants de la Guadeloupe,
introduite à la barre, présente une pétition qui a pour but de : 1°) fixer
le nombre de députés à l'Assemblée nationale pour l'île ; 2°) déterminer les formes
de l'élection ; 3°) d'accepter provisoirement les députés
présents en attendant leur confirmation ou leur invalidation. Le Président
renvoie l'examen de la pétition au comité de vérification. Plus tard,
sur la question du crédit le député Buzot demande : « Pourquoi
répéter ici les emprunts? Oubliez-vous que c'est la forme la plus
onéreuse et la plus dangereuse qu'un gouvernement obéré puisse mettre
en usage? Avez-vous oublié que le gouvernement n'a cessé d'emprunter?
60.000.000 aux notaires, 24.000.000 à la caisse d'escompte, 89.000.000
d'anticipations, 69 millions de retard dans les rentes ; en un mot, car
je ne puis suivre tous ces emprunts accumulés, un total de 369.000.000 dont il est redevable, qu'il a empruntés de force ou de gré! »
Dimanche 9 août : Toujours à l'Assemblée constituante, sur l'emprunt, Pétion de Villeneuve refuse, « Le
projet de voter un emprunt sous notre caution individuelle ne peut pas
être admis. Nous violerions en cela l'esprit de nos mandats, quoique
nous parussions en observer la lettre. Plusieurs membres de l'Assemblée
pourraient ne vouloir pas se soumettre à la solidarité ; d'ailleurs,
les prêteurs ne se soucieraient pas d'être forcés de courir après leur
gage, et l'emprunt serait manqué ; il doit donc être fait au nom et
sous la garantie de la nation. C'est à nous de le voter librement, et
de surveiller par un comité l'emploi des deniers pour qu'ils ne soient
employés qu'à des besoins indispensables. Je propose donc
l'établissement de ce comité ; ce sera un sûr moyen de tranquilliser
nos commettants et d'inspirer de la confiance. L'intérêt proposé par le
ministre me paraît illégal. C'est en s'écartant de la loi que le
gouvernement a causé tous nos malheurs, et a sans cesse accru la masse
excessive de nos dettes. » L'Assemblée décrète l'emprunt de 30 millions à̀ 4,5 % : 2,6 millions seront souscrits.
10 août : A la chambre des députés à Versailles (jusqu'en octobre), il
est débattu de la dîme, l'impôt sur les récoltes prélevées par l'Église
catholique apostolique et romaine, et qui peut être dénommée
comme gallicane dans une voie autonome du saint Siège.
11 août : A Versailles, le roi « Mande et ordonne à tous les
officiers et gardes de ses capitaineries de continuer leurs fonctions
pour le fait seulement de la conservation des moissons et récoltes ;
enjoint aux maréchaussées de s'y réunir, aux milices bourgeoises d'y
veiller, et aux troupes réglées de prêter main-forte sur la réquisition
des officiers de police. Et sera la présente ordonnance imprimée et
affichée partout ou besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore. »
(Signé, Louis) Dans la capitale, Jean-Paul Marat fait imprimer le
numéro un du Moniteur patriote.
Ce qui devait être un de ses premiers périodiques rapidement sans
suite. Le Parlement de Paris prend son dernier acte de jugement, et
selon l'origine du condamné à mort. M. Louis Tonnelier de la ville de
Château-Landon incarcéré depuis 1787 à la Conciergerie, il se voit condamné
à être roué vif en place publique sur le marché de Château-Landon,
c'est-à-dire, « à avoir les bras, jambes, cuisses, reins rompus vifs, par l'exécuteur de haute justice ; » suite à son procès, son appel est au final rejeté. (Histoire parlementaire de la Révolution française, tome 3, page 48, MM. Buchez et Roux, 1834)
12 août : En Normandie, des émeutes éclatent à Caen, le major Belzunce
est mis à mort par le peuple pour avoir insulté la cocarde tricolore.
Le comité municipal démissionne le lendemain.
13 août : A Versailles, les membres de l'Assemblée se rendent chez le roi pour assister au Te Deum
en mémoire de la nuit du 4 août. M. Le Chapelier, président, s'adresse
là Louis XVI, et accepte le titre de restaurateur de la liberté
française. Parution du 1er numéro du Journal d’État et du Citoyen
de Louise-Félicité de Kéralio-Robert, première femme dirigeant une entreprise de
presse. Elle publiera dans d'autres titres dont le Mercure national
et s'investira en faveur de la République.
14 août : Une Lettre à M. Grégoire, député de Nancy est adressée
par les députés de la nation juive de Bordeaux. L'abbé Henri Grégoire (ci-contre en portrait)
avait été l'auteur au mois d'avril-mai 1789, d'une « Motion en faveur des Juifs,
précédée d'une notice historique, sur les persécutions qu'ils viennent
d'essuyer en divers lieux, notamment en Alsace, et sur l'admission
de leurs députés à la barre de l'Assemblée nationale. » (Source : Gallica-Bnf)
|
|
 |
15 août : En ce jour férié et de l'Assomption
(de Marie, mère de Jésus), Louis XVI dans son carnet de notes
journalières, il écrit : « Bain, la grand-messe. vêpres, la procession et le salut. » Le roi avait le jour du 14 juillet noté : « Rien. » (Source : Archive.org, Louis Nicolardot, Journal de Louis XVI, page 136, Paris-1873)
 Bateau de poudre arrêté au port Saint-Paul, estampe de Jean-Louis Prieur (Musée Carnavalet)
Bateau de poudre arrêté au port Saint-Paul, estampe de Jean-Louis Prieur (Musée Carnavalet)
16 août : A Paris, la découverte et l'arrêt d'un bateau de poudre au port Saint-Paul provoque des émeutes.
17 août : M. Stanislas de Clermont-Tonnerre, monarchiste en faveur
d'une nouvelle constitution (appelé monarchien) est élu à la tête de l'Assemblée par ses
pairs. Il sera à nouveau président des séances le 12 septembre en battant
deux de ses concurrents : MM. Pétion de Villeneuve et Redon,
et pour 15 jours dans un premier temps (système de rotation des
présidences avec vote, ainsi que pour les secrétaires chargés des
comptes-rendus).
18 août : Belgique, à Liège,
le prince-évêque est chassé par la
population, qui s'empare de l'hôtel-de-ville et de la citadelle, la
montée du prix du pain et la faim à l'origine de ce mouvement. A Paris,
réunion de 3.000 garçons tailleurs en face des Tuileries (actuel musée
du Louvre), pour demander 40 sous par jour, et de garçons perruquiers aux Champs-Élysées.
19
août : A Paris, en opposition à la Société des Amis des Noirs créée en 1788, est
fondé à l'hôtel de Massiac, le club du même nom, par de riches colons de
l'île de Saint-Domingue.
20 août : A Versailles, l'Assemblée commence l'examen de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, par son préambule et les trois
premiers articles, dont le 1er article qui stipule que : Les
hommes naissent libres et demeurent égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » La déclaration des droits sera adoptée en totalité le 26 août.
21 et 22 août : Dans la capitale, la disette commence à se faire sentir et les boulangers rationnent le pain. Le jour suivant, « Paris
n'a offert, la journée du 22, rien de bien particulier ; il y a eu,
comme les jours précédents, des débats dans les districts, sur la
nomination des officiers pour la milice bourgeoise, et M. de La Fayette
a bien de la peine à les accorder. Les Architectes-Ingénieurs, chargés
de la démolition de la Bastille, présentèrent à ce général de la milice
citoyenne les boulets trouvés dans les murs, et lancés par l'armée du
grand Condé, sous la minorité de Louis XIV. » (Il est fait référence à la Fronde, 1648-1650) « Mon
Général, le présent que nous vous offrons est le seul digne de vous :
ce n'est ni de l'or ni des pierres précieuses, c'est du fer, ce sont
des boulets trouvés dans les mines de l'antre du désespoir et des
cachots de la douleur et du despotisme sont les plus nobles trophées
que l'on puisse dédier au héros-citoyen, que la liberté publique a
trouvé pour défenseur dans les deux mondes » (Source : Gallica-Bnf, Supplément aux Révolutions de Paris, page 6)
23 août : Devant la Constituante le député et pasteur Rabaut de Saint-Etienne déclare à la tribune : « Ainsi,
Messieurs, les Protestants font tout pour la patrie ; et la Patrie les
traite avec ingratitude : ils la servent en citoyens ; ils en sont
traités en proscrits : ils la servent en hommes que vous avez rendu
libres ; ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une
Nation Française, et c’est à elle que j’en appelle, en faveur de deux
millions de Citoyens utiles, qui réclament aujourd’hui leur droit de
Français. Je ne lui fais pas l’injustice de penser qu’elle puisse
prononcer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue, où il
n’y subsistera que comme un de ces mots barbares et surannés dont on ne
se sert plus, parce que l’idée qu’il représente est anéantie. Mais,
Messieurs, ce n’est pas même la Tolérance que je réclame ; c’est la
liberté ». Jean-Paul Marat publie un Projet de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, suivi d'un plan de Constitution juste, sage et libre, qu'il adresse au comité des cinq de l'Assemblée, en charge de préparer le préambule de la Constitution. (Source : Gallica-Bnf)
Lundi 24 août : A l'Assemblée sise à Versailles, Robespierre déclare, « Vous
ne devez pas balancer de déclarer franchement la liberté de la presse.
Il n'est jamais permis à des hommes libres de prononcer leurs droits
d'une manière ambiguë ; toute modification doit être renvoyée dans la
Constitution. Le despotisme seul a imaginé des restrictions : c'est ainsi qu'il est parvenu à atténuer tous les droits... Il n'y a pas de tyran sur la terre qui ne signât un article aussi modifié que celui qu'on vous propose. La liberté de la presse est une partie inséparable de celle de communiquer ses pensées. » La liberté de la presse est reconnue et met fin à la censure préalable. Parution du premier numéro de la Chronique de Paris,
ce quotidien est fait par MM. Aubin-Louis Millin de Grand-Maison et
l'abbé Noël François, directeurs de la publication et avec pour
contributeurs et collaborateurs : Nicolas de Condorcet, Joseph Delaunay, Rabaut Saint-Étienne, et Jean-François Ducos. « Avis au public : Ce
journal paraît depuis lundi. Il rend compte de tout ce qui se passe
d’intéressant dans la Capitale. On y trouve les nouvelles publiques et
particulières, l’analyse de toutes les nouveautés politiques et
littéraires, la notice des Pièces de théâtre des différents Spectacles,
les débuts, les anecdotes les plus piquantes, la nécrologie des hommes
célébrés, le cours des effets publics, l’annonce des spectacles, etc. » (Source : Gallica-Bnf)
25 août : A Versailles, les élus de Paris et M. de Lafayette sont reçus avec un certain dédain par la reine Marie-Antoinette.
|
Mercredi 26 août : Depuis Versailles, l'Assemblée vote de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, ci-contre.
De leur côté, les Juifs de Paris remettent une adresse à la Constituante : « convaincus
de la necéssité où sont tous les habitants d'un grand empire à se
soumettre à un plan uniforme de police et de jurisprudence. » et ils renoncent aux "privilèges" (ou Lettres patentes) d'avoir des représentants propres désignés par l'Etat. (Source : Persée, Philippe Sagnac - Les juifs et la Révolution, 1789-1791)
L'assemblée
municipale adopte le projet de règlement de la Garde nationale de
Paris. il est célébré un messe en musique à l'église Saint-Sulpice, où l'on interprète un Te Deum. En Normandie, 45 villages autour de Condé-sur-Noireau forment une alliance défensive.
|
|  |
27 août : Dans un
mémoire lu à l'Assemblée, M. Necker demande un second emprunt de 80
millions à 5%. A Paris, est organisé un attroupement de gens de maison, pour demander le renvoi des domestiques étrangers. Le décret de la Chambre impériale de
Wetzlar condamne la révolution de Liège.
28 août : A Versailles, ouverture des débats sur la constitution, le député Mounier lit son plan.
29 août : Parution du premier numéro du Journal des débats et des décrets,
de huit pages consacrées à l'Assemblée nationale et qui deviendront
rapidement quotidiennes. Le périodique est imprimé à Versailles chez M.
Baudouin, qui a racheté le titre au député du tiers de la sénéchaussée
de Clermont, M. J.F. Gaultier de Biauzat, avocat. Le journal était né
de la volonté d'informer ses administrés Clermontois et en tira un
bénéfice de popularité. Il sera racheté en 1795 par M. Bertin et édité
jusqu'en 1805 avant de changer de nom. (Disponible sur le site Retronews de la
Bnf)
30 août : Paris : La
discussion du veto provoque des mouvements de mécontentements. Aux
jardins du Palais-Royal, le marquis de Saint-Huruges est nommé au café
de Foy pour conduire une députation chargée de signifier aux partisans
du veto leurs vœux. La députation est escortée de 1.500 citoyens, mais
la garde nationale l’empêche de passer.
31 août : La
municipalité de Paris ferme trois des cinq ateliers de charité destinés aux sans-travail ou bras-nus. L'abbé Fauchet prononce son deuxième discours de sur la Liberté française
devant les districts réunis du faubourg Saint-Antoine. Les
députés des Juifs de Metz, des trois Évêchés, de Lorraine et d'Alsace
demandent à l'Assemblée d'avoir les mêmes droits civils que les
citoyens français : « Il
n'y a aucun inconvénient à nous laisser ce que nous avons été jusqu'à
ce jour, il y en aurait de grands, au contraire, à changer notre
existence. » (Source : Persée, M. Ph. Sagnac, Les Juifs et la Révolution)
IX – Le mois de septembre 1789
Mardi 1er septembre : Versailles,
à l'Assemblée constituante, Honoré-Gabriel de Mirabeau se prononce en faveur du veto absolu (ainsi que dans son journal Le courrier de Provence) ; en soirée, l'abbé Grégoire
demande à ce que le débat soit consacré à la situation des Juifs, ce
qui est lui est accordé. Dans la capital, il est pris un arrêté
de la Commune contre les attroupements, celle-ci organise de nombreuses
patrouilles au Palais-Royal, et le café de Foy est fermé. Un autre
arrêté́ empêche les colporteurs de crier aucun autre écrit que les décrets de l'Assemblée et les actes officiels.
Discours de Mirabeau
SUR LE VETO (1)
 Buste de Mirabeau sculpté par Henri Frédéric Iselin (crédit Ch. de Versailles)
Buste de Mirabeau sculpté par Henri Frédéric Iselin (crédit Ch. de Versailles)
« Messieurs,
dans la monarchie la mieux organisée, l'autorité royale est toujours
l'objet des craintes des meilleurs citoyens ; celui que la loi met
au-dessus de tous devient aisément le rival de la loi. Assez puissant
pour protéger la Constitution, il est souvent tenté de la détruire. La
marche uniforme qu'a suivie partout l'autorité des rois n'a que trop
enseigné la nécessité de la surveiller. Cette défiance, salutaire en
soi, nous porte naturellement à désirer de contenir un pouvoir si
redoutable. Une secrète terreur nous éloigne, malgré nous, des moyens
dont il faut armer le chef suprême de la nation, afin qu'il puisse
remplir les fonctions qui lui sont assignées.
Cependant, si l'on considère de sang-froid les principes et la nature
du gouvernement monarchique, constitué sur la base de la souveraineté
du peuple ; si l'on examine attentivement les circonstances qui donnent
lieu à sa formation, on verra que le monarque doit être considéré
plutôt comme le protecteur des peuples que comme l'ennemi de leur
bonheur.
Deux pouvoirs sont nécessaires à l'existence et aux fonctions du corps
politique : celui de vouloir et celui d'agir. Par le premier, la
société établit les règles qui doivent la conduire au but qu'elle se
propose, et qui est incontestablement le bien de tous. Par le second,
ces règles s'exécutent, et la force publique sert à faire triompher la
société des obstacles que cette exécution pourrait rencontrer dans
l'opposition des volontés individuelles.
Chez une grande nation, ces deux pouvoirs ne peuvent être exercés par
elle-même ; de là, la nécessité des représentants du peuple pour
l'exercice de la faculté de vouloir, ou de la puissance législative ;
de là, encore, la nécessité d'une autre espèce de représentants pour
l'exercice de la faculté d'agir, ou de la puissance exécutive. Plus la
nation est considérable, plus il importe que cette dernière puissance
soit active; de là, la nécessité d'un chef unique et suprême, d'un
gouvernement monarchique dans les grands Etats, où les convulsions, les
démembrements seraient infiniment à craindre, s'il n'existait une force
suffisante pour en réunir toutes les parties et tourner vers un centre
commun leur activité .
L'une et
l'autre de ces puissances sont également nécessaires, également chères
à la nation. Il y a cependant ceci de remarquable : c'est que la
puissance exécutive, agissant continuellement sur le peuple, est dans
un rapport plus immédiat avec lui ; que, chargée du soin de maintenir
l'équilibre, d'empêcher les partialités, les préférences vers
lesquelles le petit nombre tend sans cesse au préjudice du plus grand,
il importe à ce même peuple que cette puissance ait constamment en main
un moyen sûr de se maintenir.
Ce moyen existe dans le droit attribué au chef suprême de la nation
d'examiner les actes de la puissance législative, et de leur donner ou
de leur refuser le caractère sacré de la loi. »
Mirabeau
cherche à établir que l'alliance nécessaire entre le prince et le
peuple n'est durable qu'à ce prix ; cependant ce veto ne devra exister
que lorsque la Constitution sera définitivement votée. Il ne méconnaît
pas les objections graves qu'on peut faire, mais elles disparaissent
devant cette vérité que le prince, s'il n'était armé du droit de veto
serait contraint de recourir aux coups de force. (2)
« Le prince est le
représentant perpétuel du peuple, comme les députés sont ses
représentants élus à certaines époques. Les droits de l'un, comme ceux
des autres, ne sont fondés que sur l'utilité de ceux qui les ont
établis.
Personne ne
réclame contre le veto de l'Assemblée nationale qui n'est effectivement
qu'un droit du peuple confié à ses représentants, pour s'opposera toute
proposition qui tendrait au rétablissement du despotisme ministériel.
Pourquoi donc réclamer contre le veto du prince, qui n'est aussi qu'un
droit du peuple confié spécialement au prince, parce que le prince est
aussi intéressé que le peuple à prévenir l'établissement de
l'aristocratie? Mais, dit-on, les députés du peuple dans l'Assemblée
nationale n'étant revêtus du pouvoir que pour un temps limité, et
n'ayant aucune partie du pouvoir exécutif, l'abus qu'ils peuvent faire
de leur veto ne peut être d'une conséquence aussi funeste que celui
qu'un prince inamovible opposerait à une loi juste et raisonnable.
Premièrement, si le prince n'a pas de veto qui empêchera les
représentants du peuple de prolonger, et bientôt après d'éterniser leur
députation? (c'est ainsi, et non, comme on vous l'a dit, par la
suppression de la Chambre des pairs que le Long Parlement renversa la
liberté politique de la Grande-Bretagne.) Qui les empêchera même de
s'approprier la partie du pouvoir exécutif qui dispose des emplois et
des grâces? Manqueront-ils de prétextes pour justifier cette
usurpation? les emplois sont si scandaleusement remplis! les grâces si
indignement prostituées!
Secondement le veto soit du prince, soit des députés à l'Assemblée
nationale, n'a d'autre vertu que d'arrêter une proposition; il ne peut
donc résulter d'un veto, quel qu'il soit, qu'une inaction du pouvoir
exécutif à cet effet. »
Mirabeau énumère les principales objections que l'on pourrait faire à cette prérogative du veto et s'efforce de les réfuter.
« Passez
de cette considération aux instruments du pouvoir qui doivent être
entre les mains du chef de la nation. C'est à vingt-cinq millions
d'hommes qu'il doit commander ; c'est sur tous les points d'une étendue
de trente mille lieues carrées que son pouvoir doit être sans cesse
prêt à se montrer pour protéger ou défendre : et l'on prétendrait que
le chef, dépositaire légitime des moyens que ce pouvoir exige, pourrait
être contraint de faire exécuter des lois qu'il n'aurait pas
consenties! Mais par quels troubles affreux, par quelles insurrections
convulsives et sanguinaires voudrait-on donc nous faire passer pour
combattre sa résistance? Quand la loi est sous la sauvegarde de
l'opinion publique, elle devient vraiment impérieuse pour le chef que
vous avez armé de toute la force publique : mais quel est le moment où
l'on peut compter sur cet empire de l'opinion publique?
N'est-ce pas lorsque le chef du pouvoir exécutif a lui-même donné son
consentement à la loi et que ce consentement est connu de tous les
citoyens? N'est-ce pas uniquement alors que l'opinion publique la place
irrévocablement au-dessus de lui, et la force, sous peine de devenir un
objet d'horreur, à exécuter ce qu'il a promis? Car son consentement, en
qualité de chef de la puissance exécutive, n'est autre chose que
l'engagement solennel de faire exécuter la loi qu'il vient de revêtir
de sa sanction. Et qu'on ne dise pas que les généraux d'armée sont
dépositaires de très grandes forces et sont néanmoins obligés d'obéir à
des ordres supérieurs, quelle que soit leur opinion sur la nature de
ces ordres. Les généraux d'armée ne sont pas des chefs héréditaires ;
leur personne n'est pas inviolable ; leur autorité cesse en la présence
de ceux dont ils exécutent les ordres : et si l'on voulait pousser plus
loin la comparaison, l'on serait forcé de convenir que ceux-là sont,
pour l'ordinaire, de très mauvais généraux, qui exécutent des
dispositions qu'ils n'ont pas approuvées. Voilà donc le danger que vous
allez courir. Et dans quel but? »
La
nation sera donc plus tranquille et courra moins de risques de
retourner au despotisme (comme la Suède par exemple) si le roi est
pourvu du droit de veto.
« Par une suite de ces considérations puisées dans le cœur humain et
dans l'expérience, le roi doit avoir le pouvoir d'agir sur l'Assemblée
nationale, en la faisant réélire. Cette sorte d'action est nécessaire
pour laisser au roi un moyen légal et paisible de faire à son tour
agréer des lois qu'il jugerait utiles à la nation, et auxquelles
l'Assemblée nationale résisterait. Rien ne serait moins dangereux ; car
il faudrait bien que le roi comptât sur le vœu de la nation, si, pour
faire agréer une loi, il avait recours à une élection de nouveaux
membres, et quand la nation et le roi se réunissent à désirer une loi,
la résistance du corps législatif ne peut plus avoir que deux causes :
ou la corruption de ses membres, et alors le remplacement est un bien ;
ou un doute sur l'opinion publique, et alors le meilleur moyen de
l'éclairer est, sans doute, une élection de nouveaux membres.
Je me résume en un seul mot, messieurs : annualité de l'impôt,
responsabilité des ministres ; et la sanction royale, sans restriction
écrite, mais parfaitement limitée de fait, sera le palladium de la
liberté nationale, et le plus précieux exercice de la liberté du
peuple. »
Note :
1. Le projet de Constitution proposait de donner au roi un droit de
veto sur les décisions de l'Assemblée. Trois partis s'étaient formés :
les uns proposaient le veto absolu ; les autres le veto suspensif ;
d'autres enfin étaient d'avis de donner à l'Assemblée la
toute-puissance. Mirabeau prit la parole en faveur du veto suspensif.
2. Annotations de Joseph Reinach en gras et en italique.
Source : Gallica-BnF, Joseph Reinach, L'Éloquence française
depuis la Révolution jusqu'a nos jours, pages 4 à 9, éditeur Delagrave (Paris, 1894)
|
2 septembre : A Versailles, sont lus les discours de MM. Barnave et de Target en faveur du veto
suspensif. A Paris, il est procédé à l'arrestation de M. de Saint-Huruge au Palais-Royal et des patrouilles
saisissent brochures et journaux.
3 septembre : A l'Assemblée, le débat sur le véto continue.
4 septembre : A la Constituante, le député Mounier fait un rapport au nom du du comité de la constitution et un discours sur les deux chambres et le veto absolu.
5 septembre : A l'Assemblée, le débat sur le véto continue, avec des
interventions de MM. Mounier, Piéton et Thouret. Louis XVI demande aux
évêques de faire des prières publiques pour favoriser le retour au
calme.
6 septembre : Versailles, l'épouse du comte d'Artois émigre,
Marie-Thérèse de Savoie accompagnée de sa suite rejoint son mari à
Turin (Royaume de Sardaigne).
 Dons patriotiques des femmes en blanc, estampe de Nicolas Ponce
Dons patriotiques des femmes en blanc, estampe de Nicolas Ponce
7 septembre : À l'Assemblée, 11
femmes et filles d'artistes, vêtues de blanc, viennent offrir leurs
bijoux : commencement des « dons patriotiques » Ils seront réguliers
et en général en début des séances parlementaires, après la lecture du
compte-rendu de la veille et de l'ordre du jour, qui peuvent être
suivis d'Adresses ou des pétitions avec ou sans députation.
8 septembre : A Versailles, Louis XVI reçoit l'ambassadeur du royaume de
Sardaigne, une rencontre non
mentionnée dans son carnet mensuel.
9 septembre : Le maire de Troyes, M. Claude Huez est accusé d'avoir empoisonné
les farines, il est mis à mort, son cadavre traîné dans les rues.
10 septembre : L'Assemblée décide que le corps législatif ne sera
composé que d'une chambre ou mono-caméral ; elle discute une adresse de la ville de
Rennes qui déclare traîtres à la patrie ceux qui acceptent le veto,
et création d'un comité pour la réforme de la jurisprudence
criminelle.
11 septembre : La Constituante refuse d'entendre la délibération
du Conseil du roi sur le veto. À l'issue d'une séance tumultueuse, le vote en faveur du « veto
suspensif » est accordé au roi par 673 voix contre 325. Ce qui fut un compromis entre le veto
irrévocable et pas de veto du tout. Des "partis" ou coalitions font jour, au moins cinq
se forment.
Siégent, à partir de la droite de l’hémicycle :
- Les « Noirs », le camp des contre-révolutionnaires (libéraux
conservateurs ou monarchistes), regroupant les
ultras de la noblesse et du clergé comme l’abbé Maury, Cazalès, le
comte de Montlozier, le vicomte de Mirabeau (l'oncle). Ils étaient
environ 300 députés.
- Les « Monarchiens » ou « Anglomanes » on retrouve, MM. Malouet, Mounier, et
Clermont-Tonnerre, Lally-Tolendal, qui prônent une monarchie constitutionnelle à
l’anglaise et pour deux chambres. (environ 300 membres)
Siégent, du centre à la gauche de l’hémicycle :
- Le « parti dit national », avec Sieyès et
Honoré de Mirabeau, plus que jamais ambiguë au sein d'une
tendance fluctuante et mouvante, représentative de son centre de
gravité au début … et le secrétaire de Mirabeau est un certain Danton
(élu
seulement en 1792, ou hormis son district, il est impliqué dans les transactions sonnantes et
trébuchantes entre Louis XVI et Mirabeau). C'était le groupe le plus
imposant au commencement.
- Les « Patriotes »
unis dans un triumvirat : Duport, Alex-Lameth et Barnave qui se
détachera du centre, comme des minoritaires.
- Les « Minoritaires » ou les « Démocrates », avec Robespierre, Buzot, l’abbé Grégoire, Prieur de la Marne, Pétion de Villeneuve.
12 septembre : A Paris, parution du premier numéro du Publiciste parisien puis rapidement L’Ami du Peuple de Marat, journaliste, ci-contre en gravure (Source : Gallica-Bnf). La Société des Citoyens de Couleur, colons américains est créée. A l'Assemblée, il est décidé que la
législature sera de 4 ans. Démission du comité de constitution composé de MM.
Mounier, Lally, Clermont-Tonnerre (il est toutefois élu président de l'Assemblée), Bergasse, Talleyrand, Sieyès. À Orléans,
émeute, un convoi de grain est attaqué, des habitants de Saint-Sauveur
et d’Olivet tentent d’entrer en ville pour piller les boulangeries.
La révolte est réprimée par la garde nationale, 90 tués.
|
|  |
13 septembre : A Versailles, il éclate une révolte
de la faim, la foule veut pendre un boulanger et dévaste sa
maison. A Orléans un meneur est pendu, en guise de protestation les gens du
peuple ont retiré leurs cocardes. Le pape, Pie VI, écrit à Louis XVI qu’il
veut éviter une rupture avec la France.
14 septembre : Le faubourg Saint-Antoine va en procession pour̀
Sainte-Geneviève, portant un modèle de la Bastille en carton haut de
quatre pieds (environ 1 mètre et 20 cm). A Tréguier, l’évêque publie un mandement contre les
droits
de l’homme et l’abolition de la féodalité.
15 septembre : L'Assemblée décrète la personne du roi inviolable et
sacrée, et discussion sur la succession de la couronne. La disette à
Paris, les boulangeries sont assiégées. Camille Desmoulins publie son Discours de la Lanterne aux parisiens :
«
Quels remerciements ne vous dois-je pas? Vous m'avez rendu à jamais
célèbre et bénie entre toutes les lanternes. (...) Il cherchait un
homme, j'en ai trouvé 200 mille. (...) Chaque jour je jouis de l'extase
de quelques voyageurs Anglais, Hollandais ou des Pays-Bas, qui me
contemplent avec admiration ; prise qu'une lanterne ait fait plus en
deux jours que tous leurs héros en cent ans. »
Source : Gallica-BnF, 68 feuillets
16 septembre : A Paris, sur la base d'un rapport de l'avocat
Jacques-Alexis Thuriot de la Rosière, l'assemblée des représentants de
la commune décide de rassembler en un seul endroit les papiers ou
archives de la Bastille ; « considérant
que ces papiers sont infiniment importants, qu'il est essentiel de les
examiner, d'en faire l'analyse et même de la rendre publique ».
17 septembre : Charles-Henri d'Estaing, commandant de
la garde citoyenne de Versailles, engage la municipalité à requérir
un régiment pour le maintien de l'ordre.
| 18 septembre : La
lettre du roi, contenant ses observations critiques sur les décrets du
4 août, provoque le mécontentement de l’Assemblée. Motion de Volney,
elle demande l'élection d'une nouvelle assemblée, « véritablement
nationale ». Et le colon et propriétaire à Saint-Domingue, M. Moreau de Saint-Méry (en portrait ci-contre) est admis comme député de la Martinique à la Constituante. A Paris, le libraire Luchet du
Journal de la Ville est assiégé par des garçons boulangers, lui
reprochant d'avoir publié que le pain contenait de la chaux. |
|  |
19 septembre : Les
60 districts de Paris élisent la nouvelle assemblée générale des
représentants de la Commune. A Versailles, à l'Assemblée la motion de Volney, à
laquelle s'oppose Mirabeau, est renvoyée. Le président redemande au roi la promulgation des arrêtés du 4 août. A
Rouen, la puissante machine à filer d'un filassier est démantelée,
et sa boutique mise à sac.
20
septembre : En Martinique, à Saint-Pierre et Fort-Royal
(Fort-de-France) sont organisées des fêtes patriotiques, où sont
portées des cocardes tricolores. Le comte de Vioménil, le nouveau
gouverneur de l'île depuis avril est dans un premier temps réticent aux
manifestations patriotiques. (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 97)
21 septembre : A la Constituante, sous la présidence de M.
Clermont-Tonnerre, à la séance du matin, celui-ci lit la lettre que lui
a remis la vieille le roi : « sur
la demande faite à Sa Majesté d'ordonner la promulgation des arrêtés
des 4 août et jours suivants, et de revêtir de sa sanction le décret
porté par l'Assemblée nationale, le 18 du courant, concernant les
grains. » Sa réponse est :
« Vous
m'avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés
des 4 août et jours suivants ; je vous ai communiqué les observations
dont ces arrêtés m'ont paru susceptibles ; vous m'annoncez que vous les
prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez
de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés.
Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la
promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les
formes qui doivent en procurer immédiatement l'exécution ; mais comme
je vous ai témoigné que j'approuvais l'esprit général de vos arrêtés et
le plus grand nombre des articles en leur entier, comme je me plais
également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui
les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon
royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l'intérêt
dont nous sommes, animés pour son bonheur et pour l'avantage de l'État
; et je ne doute point, d'après les dispositions que vous manifestez,
que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction
toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans
vos arrêtés. J'accorde ma sanction à votre nouveau décret du 18 de ce mois, concernant les grains. »
Versailles, ce 20 septembre 1789, signé, LOUIS. Cette réponse est reçue avec acclamation et reconnaissance.
Source : Bib. de Stanford - Archives Parlemenataires, tome IX, page 53
22 septembre : A Versailles est voté l'article premier de la Constitution : « Le
gouvernement français est monarchique. Il n'y a point en France
d'autorité supérieure à la loi ; le roi ne règne que par elle. »
A Paris, les districts de la Trinité, des Petits-Pères et des
Cordeliers demandent l'éloignement des troupes. Le compositeur
M. Johann C. Vogel - décédé en 1788 - est interpréte en public avec son
opéra en français Démophon, une oeuvre musicale très prisée durant la Révolution et l'Empire.
23 septembre : A la Constituante sont promulgués des décrets sur le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif et il est procédé à la suspension de la collation des bénéfices
ecclésiastiques.
24 septembre : À l'Assemblée, M. Jacques Necker
présente un tableau déplorable de la situation des finances et
du crédit, et demande une contribution au quart du revenu. (Source : Persée.fr, Rapport de M. Necker, premier ministre des finances, sur l'état annuel des finances)
Vendredi 25 septembre : La Constituante débat sur la dédicace de l'édition des
Œuvres de Voltaire par M. Palissot, et décide de ne recevoir aucune
dédicace. Un décret annonce la suppression de la gabelle et fixant le
prix du sel à 6 sols la livre. Le n°15 de l'Ami du peuple est dénoncé
à l'assemblée de la Commune, pour fausses inculpations contre son
administration.
26 septembre : A l'Assemblée est accepté le plan de M. Necker, vote de la
contribution volontaire au quart du revenu. Départ de Paris de Thomas
Jefferson, ambassadeur ou ministre des Etats-Unis, il est nommé au poste de Secrétaire
d'état dans son pays.
27 septembre : Paris, il est organisé une bénédiction des drapeaux de la garde nationale
parisienne à Notre-Dame, et l'on y joue un Te Deum solennel. A l'Assemblée, c'est le troisième discours de
l'abbé Fauchet sur la Liberté française.
28 septembre : En Alsace,
les Juifs sont mis sous la protection de la loi. A Paris les religieux
de Saint-Martin-des-Champs font l'offrande des biens de
l'ordre de Cluny. J.P. Marat via L'Ami du peuple dénonce la Commune de Paris.
29 septembre : A Versailles, à la Constituante, le rapport de M. Thouret est
déposé sur la division territoriale et administrative du royaume. En
Martinique, cette fois, c'est le Gouverneur M. de Vioménil qui organise
des fêtes à Fort-Royal et fraternise avec les planteurs et les "libres
de couleurs" (souvent des métis). (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 97)
30 septembre : Dans la capitale, la Commune décide de la libre circulation des imprimés.
X – Le mois d’octobre 1789
Jeudi 1er octobre : A
l'Assemblée, à la séance du matin, l'article 4 de la constitution est adopté sur le consentement des
repreésentants de la Nation à l'impôt et à l'emprunt : « Aucune
contribution en nature ou en argent ne peut être levée, aucun emprunt
direct ou indirect ne peut être fait autrement que par un décret exprès
des représentants de la nation. ». Ensuite M. Jacques Necker
présente la rédaction de son plan de finances. Le soir à Versailles est donné à l'Opéra royal, un
banquet en l'honneur de l'arrivée du régiment de Flandre pour plus de 200
convives organisé par les Gardes du corps. Durant le banquet la famille royale
vient saluer, la reine tenant par la main le dauphin. L'on boit
beaucoup de vin, l'on trinque à la famille royale, qui lors de son
passage est ovationnée, et l'orchestre joue : Ô Richard, Ô mon Roi d'André Gétry (Extrait du Ballet de l’Opéra Royal par le Concert Spirituel Choeur et orchestre de M. Hervé Niquet, 6 minutes).
Et la présence et la circulation de cocardes blanches signes des Gardes
du corps ou noires en
faveur de Marie-Antoinette sera très mal accueilli par les Parisiens,
le bruit de cette agape sera très mal perçu, quand le pain vient à
manquer.
2 octobre : La Constituante, à nouveau demande au roi l'acceptation des décrets du 4 août et la déclaration des droits. Dans la capitale, le banquet
des gardes du corps et du régiment de Flandre provoque la colère à
cause des propos contre-révolutionnaires, ainsi la circulation de la
rumeur enfle, le banquet devient une orgie dans la presse patriotique.
Et Marat, Danton et Desmoulins appelleront à marcher sur Versailles.
3 octobre : Il est décrété l'autorisation du prêt à intérêt (ancienne usure), à un taux fixé par la loi. Les Annales patriotiques et littéraires et affaires politiques de l'Europe, ce journal libre est rédigé par une Société d'écrivains patriotes et
dirigé par M. Louis-Sébastien Mercier, qui publie ce jour son premier
numéro sur 4 pages. Ce journal va paraître jusqu'en 1794. (Source : Gallica-Bnf)
4 octobre : A Paris, il est pris un arrêté au district des Cordeliers,
signé par Georges Danton dénonçant « l’orgie », et enjoignant à Motier de Lafayette
d'aller à Versailles demander le départ du régiment de Flandre. Dans la Chronique de Paris (page 202, n°51) on apprend que : « Dans
la nuit du 4 au 5 du courant, il a été commis à Versailles un vol
très-considérable, qu’on évalue à 300.000 livres. On soupçonne un nommé
Courciel, laquais, né près Besancon en Franche-Comté. On promet 200
louis aux personnes qui pourraient découvrir le coupable. »
| Lundi 5 octobre : A
la prison de Bicêtre, le prisonnier J.C.G. le Prévôt de Beaumont
(1726-1823, ci-contre en gravure), avocat de profession, ancien secrétaire du clergé de
France a été mis sous clef du temps de Louis XV pendant vingt-deux ans,
dans plusieurs géoles (la Bastille et Vincennes entre autres) ou lieux pour les insensés d'île de France comme
Charenton. Son crime, avoir dénoncé au moins un "pacte de famine", au
Parlement de Rouen, qui aurait été concerté entre MM. Laverdy, de
Sartine, Boutin, Amelot, J.P.C. Lenoir, Vergennes, etc., etc. Ce dernier
est rendu ce jour à la liberté . |
|  |
5 et 6 octobre : Marche
des femmes de Paris sur Versailles, le général Lafayette est à la traîne et
plutôt chahuté. M.
de Lafayette, parti de Paris, avec le consentement de la Ville, sa
marche est composée d’un corps d'armée de près de 15.000 hommes de la Garde nationale parisienne. Le lendemain matin, il fait mettre toute la troupe en rang de bataille sur la Place D’arme. Il est
tombé une forte pluie une partie de la nuit et se produisent des
averses dans la matinée du 6 octobre. Vers 1 heure du matin, les
députés retournent à l'Assemblée au son du tambour. Dans la nuit, le
roi accepte enfin les décrets du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. A 6 heures,
éclatent de violents incidents devant le château, qui est envahi par le
peuple ; des Gardes du corps sont poursuivis et tués dans les
appartements et le parc. Après l'intervention de la Garde nationale, le
roi annonce au balcon son choix de se rendre à Paris.
Les Parisiennes dont les Dames de la Halle, 3 à 4.000 femmes selon L.S. Mercier ramènent ainsi le roi dans la
capitale, pour y faire sa résidence principale. Les époux royaux sont
escortés par la Garde nationale, et d’une partie du régiment de Flandre. L'Assemblée se déclare inséparable du roi. Sont de retour dans la capitale : « le boulanger, la boulangère et le petit mitron », c'est-à-dire, le roi, la reine et le dauphin. Après le 14 juillet, cela a été la deuxième plus grande
manifestation populaire de l'année.
|
Stanislas Maillard (*) porte-parole des Parisiennes
devant la Constituante à Versailles
 Stanislas Maillard (*) Stanislas Maillard (*)
A peine M. Target finissait de parler, qu'une députation d'un
très-grand nombre de citoyennes de Paris, déjà arrivées à Versailles,
se présente à la barre. Maillard est à leur tète, et porte la parole.
Maillard : « Nous sommes venus à
Versailles pour demander du pain, et en même temps pour faire punir les
gardes du corps qui ont insulté la cocarde patriotique. Les
aristocrates veulent nous faire périr de faim. Aujourd'hui même on a
envoyé à un meunier un billet de 200 livres, en l'invitant à ne pas
moudre, et en lui promettant de lui envoyer la même somme chaque
semaine.
L'Assemblée pousse un cri d'indignation, et de toutes les parties de la salle, on lui dit : Nommez !
Maillard :
« Je ne puis nommer ni les dénoncés, ni les dénonciateurs, parce
qu'ils me sont également inconnus ; mais trois personnes que j'ai
rencontrées le matin dans une voiture de la cour m'ont appris qu'un
curé devait dénoncer ce crime à l'Assemblée nationale.
Une voix s'élève alors à
la barre, et désigne M. l'archevêque de Paris. L'Assemblée entière
s'empresse de répondre que ce prélat est incapable d'une pareille
atrocité.
Maillard : « Je
vous supplie, pour ramener la paix, calmer l'effervescence générale et
prévenir des malheurs, d'envoyer une députation à MM. les gardes du
corps, pour les engager à prendre la cocarde nationale, et à faire
réparation de l'injure qu'ils ont faite à cette même cocarde.
Plusieurs membres
s'écrient que les bruits répandus sur les gardes du Roi sont
calomnieux. Quelques expressions peu mesurées, échappées à l'orateur,
lui attirent alors une injonction du président de se contenir dans le
respect qu'il doit à l'Assemblée nationale. Le président ajoute que
tous ceux qui veulent être citoyens peuvent l’être de leur plein gré,
et qu'on n'a pas le droit de forcer les volontés.
Maillard : « Il
n'est personne qui ne doive s'honorer de ce titre ; et s'il est, dans
cette diète auguste, quelque membre qui puisse s'en croire déshonoré,
il doit en être exclu sur-le-champ.
Toute la salle retentit
d'applaudissements, et une foule.de voix répètent : Oui, oui, tous
doivent l'être, nous sommes tous citoyens ! Au même instant, on apporte
à Maillard une cocarde nationale de la part des gardes du corps. Il la
montre aux femmes comme un gage de leurs dispositions pacifiques, et
toutes s'écrient : Vive le Roi ! vivent les gardes du corps !
Maillard : « Je
suis bien loin de partager les soupçons qui agitent tous les esprits ;
mais je pense qu'il est nécessaire, pour le bien de la paix, d'engager
Sa Majesté à prononcer le renvoi de ce régiment qui, dans la disette
cruelle qui afflige la capitale et les environs, augmente les malheurs
publics, ne fût-ce que par l'augmentation nécessaire qu'il occasionne
dans la consommation journalière.
L'Assemblée
décide que M. le président se rendra à l'instant vers le Roi, avec ceux
de MM. les députés qui voudront l'accompagner, pour lui demander
non-seulement l'acceptation pure et simple de la déclaration des droits
et des dix-neuf articles de la Constitution, mais pour réclamer aussi
toute la force du pouvoir exécutif sur les moyens d'assurer à la
capitale les grains et les farines dont elle a besoin.
M. le président se transporte chez le Roi, avec la députation, sur les cinq heures du soir.
(*) Stanislas Maillard, héros de la Bastille... !
Source : Bib. de Stanford - Archives Parlementaires, 5 octobre 1789, tome IX, page 343
|
|
|
Les 5 et 6 octobre 1789
selon l'Almananach des patriotes français
0

«
Nous avons déjà parlé de l'insulte faite à la cocarde (le 4 octobre,
Orgie à l'opéra de Versailles), nous n'avons pas ajouté qu'on avait
amené le dauphin dans la salle du banquet ; ce qui avait provoqué ce
mouvement d'enthousiasme qui a eu des suites si funestes.
Les femmes arrivèrent lundi (5 octobre) à Versailles vers une heure. Le district de
Saint-Antoine les suivit bientôt. Le roi était à la chasse. Dès qu'il
eut appris leur arrivée, il se rendit au château. Toutes les grilles
étaient fermées. Le régiment de Flandres & les Gardes du roi
étaient en ligne sur la place d'armes. On ne laissa entrer qu'un petit
nombre de femmes. Le roi les reçut avec cette bonté qui lui est si
naturelle, & embrassa même la plus jolie.
Cependant les femmes du dehors voulurent forcer les lignes. Un Garde
du-Corps eut l'imprudence de faire feu. Une d'entre elles fut tuée. Ce
meurtre fut bientôt vengé fur deux gardes-du Corps; trois furent
grièvement blessés; cinq démontés : les autres fe retirèrent : A six
heures.du soir, une division de la Milice nationale, qui demandait à
grands cris, dans la place de l'hôtel-de-ville, d'être conduite à
Versailles, partit enfin sous les ordres de M. de La Fayette, qui avait
reçu ceux de la commune. Elle était composée d'environ douze mille
hommes, & d'un nombre infini de volontaires armés de crocs, de
piques, de fourches, etc. Elle traînait avec elle vingt-deux canons. Un
grand nombre de femmes portant des piques, de gros bâtons, des épées,
même des fusils, les accompagnaient. Quelques unes tiraient elles-mêmes
les plus petits canons. Cette troupe arriva entre onze heures &
minuit dans l'avenue de Versailles.
M. de la Fayette reçut alors un courrier du roi pour l'instruire de ses
intentions paternelles & pacifiques; & lui dire que le prince
demandait à le voir. La Milice parisienne demeura sous les armes. La
Milice de Versailles se joignit à elle ; & le régiment de Flandres,
commandé par le Marquis de Lusignan, un des plus respectables membres
de notre minorité, se mit à la suite de la première compagnie de nos
grenadiers.
Le roi assura M. de La Fayette que la Garde nationale aurait à l'avenir
la garde de sa personne, & qu'il était prêt à lui donner toutes les
marques d'estime & de confiance que son zèle avait droit
d'attendre. Une partie de cette Milice passa la nuit dans les églises.
Vers les six heures du matin, des gardes du roi arrêtés par le peuple,
ayant tenté de s'échapper en poignardant ceux qui les détenaient,
furent à l'instant massacrés, & ce sont leurs têtes sanglantes qui,
portées dans Paris, ont renouvelé des scènes d'horreur qui
déshonoreraient, s'il était possible, la cause de la liberté.
Pendant la nuit, plusieurs femmes ont pénétré dans la salle de
l'Assemblée nationale, & ont témoigné leurs vives inquiétudes sur
les desseins antipatriotiques de la majorité. M. de La Fayette ayant
fait connaitre au roi qu'il ne pourrait faire cesser la défiance &
les alarmes des habitants de Paris qu'en se fixant au milieu d'eux, sa
majesté, toujours prête à donner à ses fidèles sujets de nouvelles
preuves de son amour, décida sur-le-champ de s'établir au château du
Louvre avec toute la famille royale.
C'était un spectacle vraiment nouveau que ces troupes nombreuses de
femmes, de soldats, de citoyens armés, qui se succédaient sans cesse,
portant des rubans, des branches d'arbres, des pains au bout de leurs
baïonnettes, & des portions de l'habit ou de l'armure des Gardes du
corps; mais ce qui frappa davantage, ce fut l'arrivée du roi.
M. Bailly, accompagné des représentants de la commune, fut lui porter
les clefs de la ville, & lui prononça un discours suivant : « Sire,
c'est un beau jour que celui où votre majesté vient dans fa capitale
avec son auguste épouse, avec un prince qui sera bon & juste comme
Louis XVI. » Etc.
Source : Google-livres, Almanach des Patriotes
ou précis des révolutions de 1789, pages 21 à 30
Chez Lagrange libraire, vis-à-vis du Palais Royal (Paris, 1790)
|
|
|
LES CONSÉQUENCES DE L'ÉMEUTE
« L'émeute s'était surtout faite contre les
monarchiens. Leur chef, Mounier, qui présidait l'Assemblée, n'ayant pu
persuader Louis XVI de quitter Versailles le 5 au soir, ne songea plus
qu'à soulever les provinces contre Paris. Il partît pour le Dauphiné
mais n'y rencontra que froideur et hostilité. La province approuva le
fait accompli. Les parisiens heureux de posséder le roi multipliaient en
son honneur les protestations d'amour et de fidélité, protestations
dont la sincérité était accrue par les avantages remportés : la
sanction des décrets du 4 août et de la déclaration des droits. La
Révolution semblait assurée du lendemain. » (Albert Mathiez - Les Grandes journées de la Constituante)
LA SITUATION APPRÉCIÉE
PAR MARIE-ANTOINETTE
Les deux lettres suivantes du 7 et 10 octobre furent écrites par la reine à
l'ambassadeur d'Autriche M. Mercy :
Dessin de la reine, ci-contre
|
|  |
7 octobre : « Je me
porte bien, soyez tranquille. En oubliant où nous sommes et comment
nous y sommes arrivés ; nous devons être contents du mouvement du
peuple, surtout ce matin, j'espère, si le pain ne manque pas, que
beaucoup de choses se remettront. Je parle au peuple; milices,
poissardes, tous me tendent la main. Je la leur donne. Dans l'intérieur
de l'hôtel de ville, j'ai été personnellement très bien reçue. Le
peuple ce matin, nous demandait de rester, je leur ai dit de la part du
Roi, qui était à côté de moi, qu'il dépendait d'eux que nous restions ;
que nous demandions pas mieux ; que toute haine devait cesser; que le
moindre sang répandu nous ferait fuir avec horreur. Les plus près m'ont
juré que tout était fini. J'ai dit aux poissardes d'aller répéter tout
ce que nous venions de leur dire. Je suis désolée que nous soyons
séparés. Mais il vaut bien mieux que vous restiez où vous êtes pendant
quelque temps. Vous aurez de mes nouvelles le plus souvent que je
pourrai. Adieu, comptez à jamais sur tous mes sentiments pour vous
». Dans la capitale, on se bouscule aux Tuileries pour voir le roi et
la reine qui sont acclamés. A Versaillles, l'Assemblée se tient
toujours à la salle des Menus Plaisirs, mais c'est plutôt la panique,
200 élus demandent l'obtention de passe-ports pour la capitale.
8 octobre : A Paris, suite à un mandat d'arrêt provenant du Châtelet,
Jean-Paul Marat s'échappe pendant l'intervention de la Garde nationale à son
domicile et se cache. Son journal de 8 à 16 pages, l'Ami du Peuple,
ne paraît plus du 9 octobre au 4 novembre, puis du 25 novembre au 18
décembre de cette fin d'année (hormis deux numéros : 26 novembre et 11 décembre). Voici ce qu'en dit la Chronique de Paris (page 183), ce jour : « Quelques
membres de la commune voulaient qu’on mit M. Marat, auteur de l'Ami du
Peuple, en prison, à cause de l'extrême hardiesse de cette feuille. M.
le maire leur a rappellé les vrais principes de la liberté de la
presse, et il a été décidé que ceux qui se croiraient calomniés par M.
Marat, intenteraient contre lui une action juridique. » (Source : Gallica-Bnf)
9 octobre : Louis XVI fait une Proclamation : Et informe « Que c'est au milieu d'eux (les Parisiens) qu'Elle (sa majesté le roi) annonce
à tous les habitants de ses Provinces, que lorsque l'Assemblée
Nationale aura terminé le grand ouvrage de la restauration du bonheur
public. Elle réalisera le plan qu'Elle a conçu depuis longtemps,
d'aller sans aucun faste visiter ses Provinces, pour connaître plus
particulièrement le bien qu'Elle y peut faire, et pour leur témoigner
dans l'effusion de son cœur, qu'elles lui sont toutes également chères.
Il se livre d'avance à l'espoir de recevoir d'elles ces marques
d'affection et de confiance qui seront toujours l'objet de ses voeux,
et la véritable source de son bonheur. Le Roi se flatte encore que
cette déclaration de sa part engagera tous les habitants de ses
Provinces à seconder par leurs encouragements, les travaux de
l'Assemblée Nationale, afin qu'à l'abri d'une heureuse Constitution, la
France jouisse bientôt de ces jours de paix et de tranquillité dont une
malheureuse division la prive depuis si longtemps. » A Paris, signé LOUIS. (Source : Gallica-Bnf, 2 pages) A la Constituante, il est décidé de mettre fin à la torture avec par exemple l'article 3 qui stipule : « On ne condamnera plus au fouet, et nul ne sera flétri d'un fer chaud, s'il n'est condamné aux galères perpétuelles. »
10 octobre : Deuxième lettre de la reine : « L'Assemblée va venir ici, mais on dit qu'il y
aura à peine 600 députés. Pourvu que ceux qui sont partis calment les
provinces au lieu de les animer sur cet événement-ci, car tout est
préférable aux horreurs d'une guerre civile ». (Source : Les grandes journées de la Constituante – Le roi et l’Assemblée à Paris – Albert Mathiez)
11 octobre : Dans la capitale à l'église des Petits-Pères, les Dames de la Halle font chanter un Te Deum, les enfants du duc d'Orléans y assistent.
12 octobre : l'Assemblée arrête la formule de promulgation des lois : Louis XVI n'est plus roi de France et de Navarre, il devient, « par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français ».
Requête de Marat à l'Assemblée, il se plaint de la violation de son
domicile. Il est aussi question de la Lettre de M. de Polverel sur les États de Navarre en raison de son mémoire sur le sujet. (Source : Persée.fr) Le comte d’Artois, émigré depuis juillet, demande à
l’empereur Joseph II d’intervenir en France.
13
octobre : A la Convention, c'est le début de la discussion sur les
biens du clergé ; discours de MM. Maury, Camus, et Barnave. A Alençon, troubles et arrestation du vicomte de Caraman. Dans le quotidien la Chronique de Paris (page 202, N°51), il est question de M. Marat qui « a
dit-on, écrit au district des Carmes que c’était à lui qu’il avait
réservé l’honneur de le protéger. Le district n’est probablement pas
ambitieux ; car il a refusé cet honneur. Le district des Cordeliers,
sur la lettre qui lui a été adressée par le sieur Marat, auteur de
l'ami du peuple, par laquelle il réclame sa protection, a déclaré qu’il
défendrait de tout son pouvoir les auteurs de son arrondissement, des
voies de fait, sauf à ceux qui se trouveront offensés dans leurs
personnes ou dans leur honneur, à se pourvoir par toutes les voies de
droit. Cet arrêté nous paraît infiniment sage, non pas que nous
approuvions les calomnies de M. Marat, nous en deviendrions les
complices ; mais c’est dans les tribunaux et par les moyens de droit,
que les offensés doivent en obtenir réparation. » (Source : Gallica-Bnf)
14 octobre : L'Assemblée accorde au duc d'Orléans un passe-port pour
l’Angleterre. Les Planteurs résidant à Paris font
admettre trois de leurs représentants MM. Moreau de Saint-Merry, le
comte de Dillon et le Chevalier de Perpigna. Les débats s'engagent sur la division du royaume en
départements. Mirabeau lit un projet de loi martiale. Le soir, se
présentent à la demande des députés de la Lorraine plusieurs envoyés
juifs des provinces des Trois-Evêchés, d'Alsace et de Lorraine soient
admis à la barre. L'autorisation est accordée, intervient alors M.
"Besr-lsam-Besr" ou M. Berr Isaac Berr (nom mal orthographié par le
compte-rendu de l'Assemblée), juif est-il indiqué à la suite de son
patronyme : « Messeigneurs,
c'est au nom de l'Eternel, auteur de toute justice et de toute vérité ;
c'est au nom de Dieu qui, en donnant à chacun les mêmes droits, a
prescrit à tous les mêmes devoirs ; c'est au nom de l'humanité outragée
depuis tant de siècles par les traitements ignominieux qu'ont subis,
dans presque toutes les contrées de la terre, les malheureux
descendants du plus ancien de tous les peuples, que nous venons
aujourd'hui vous conjurer de vouloir bien prendre en considération leur
destinée déplorable. (...) Puisse le voile d'opprobre qui nous
couvre depuis si longtemps se déchirer enfin sur nos têtes! que les
hommes nous regardent comme leurs frères ; que cette charité divine,
qui vous est si particulièrement recommandée, s'étende aussi sur
nous qu'une réforme absolue s'opère dans les institutions
ignominieuses auxquelles nous sommes asservis, et que cette réforme,
jusqu'ici trop inutilement souhaitée, que nous sollicitons les larmes
aux yeux, soit votre bienfait et votre ouvrage. » (Archives parlementaires, tome IX, pages 444 à 449 avec l'annexe)
15 octobre : Dernière séance de l’Assemblée nationale à Versailles.
Le comte de Mirabeau envoie une note secrète au roi (son frère est député et vicomte, surnommé "Mirabeau-Tonneau"). Devant la multiplication des
demandes de passe-ports, l'Assemblée décrète qu'ils ne seront
délivrés que pour des causes urgentes et pour un temps déterminé.
16 octobre : Arrivée du député Mounier à Grenoble.
17
octobre : A Rouen, la faim pousse les ouvriers à saccager six
filatures. En Martinique, l'assemblée coloniale s'oppose aux volontés
du Roi et elle décide, que des députés des paroisses élus en
proportion des votants, se réuniraient en Assemblée générale coloniale
pour nommer deux représentants à l'Assemblée nationale et favorise
les deux villes de Saint-Pierre et Fort Royal. (Source : Manioc, J. Lucrèce, Histoire de la Martinique, page 97)
18 octobre : A Paris, le roi passe en revue une division de la Garde nationale. Malgré la pluie,
il s’est rendu ce matin à pied sur les Champs-Elysées, accompagné d’une
garde d’honneur de 500 hommes et il a parcouru tous les rangs avec de
M. de Lafayette. En Bretagne, à Lannion, la foule s’empare d’un convoi
de blé destiné à Brest.
19 octobre : Fondation du club des Jacobins, il devient officiellement
la Société des Amis de la Constitution.
Les premières salles
provisoires et les séances de l'Assemblée constituante ont lieu dans la
capitale dans un premier temps à l'Archevêché, dans la chapelle.
20 octobre : Le journaliste Antoine-Joseph Gorsas annonce le changement du titre de son journal : Le Courrier de Paris dans les Provinces et des Provinces à Paris, le n°1 « Les
circonstances qui me forcent à changer le titre de cet ouvrage
périodique, n’ont peut-être jamais été plus capitales, et jamais titre,
peut-être, n’a été adopté plus à propos. La correspondance de nos
Provinces à Paris est déjà, mais encore va devenir DE LA PLUS GRANDE
importance, et je commence cette espèce de nouvelle carrière avec
le même esprit de patriotisme qui ne cessera de m’animer. »
21 octobre : Le vote de la loi martiale
est probablement le fait le
plus marquant de cette fin d’année riche en innovation administrative.
Cette loi sera la porte ouverte à des répressions sanglantes.
Maximilien
Robespierre dit non au vote de la loi martiale, visant à réprimer les
attroupements populaires. A Paris, à 8 heures du matin le nommé
Denis François, boulanger, sis rue de la Juiverie ou rue du Marché-Palu
(cela dépend des témoignages, mais elles se trouvaient toutes deux au
sein de ce qui est devenu depuis le XIXe siècle la rue de la Cité, en
1834), district de Notre-dame (île de la Cité), est
enlevé de sa
boutique par une foule. Il est conduit à l'hôtel-de-Ville, où il se
voit accusé d’avoir chez lui des pains pourris ; la fureur populaire
sans attendre que la justice soit rendue l'arrache à ses juges, et il
est pendu à un réverbère (ou lanterne) place de
Grève. Sa tête au bout d'une pique est promenée dans les rues et sa
femme est humiliée par la foule. Cette dernière sera reçue par le
couple royal aux Tuileries, et le boulanger François inhumé six jours
plus tard.
22 octobre : A l'Assemblée, vote en faveur du suffrage (censitaire) par
les citoyens « actifs » malgré les oppositions de Grégoire, Duport et
Robespierre. Aux élections prochaines, le corps électoral sera composé
de 4.298.360 citoyens actifs ou électeurs et pouvant être élus, pour
environ trois millions de citoyens « passifs », qui pourront assister aux
réunions et faire des propositions, mais sans être éligible. Une
députation de « citoyens libres et de couleur des colonies » vient
réclamer à l’Assemblée l'égalité des droits politiques.
23 octobre : A Paris, s'élève une protestation d'habitants du district de Saint-Martin-des-Champs contre la loi martiale.
24 octobre : La Révolution trouve écho en pays Brabant (au nord de la
Belgique) où Joseph II l'empereur d’Autriche est déclaré déchu. L'on publie le Manifeste des
insurgés Belges, ainsi l'empereur Joseph II perd toute autorité sur les Pays-bas autrichienś.
25 octobre : Le comte de Mirabeau, s'adresse à son oncle, capitaine de vaisseau : « J'ai
toujours pensé comme vous, mon cher oncle, et maintenant beaucoup plus
que jamais, que la royauté est la seule ancre de salut qui puisse nous
préserver du naufrage ».
26 octobre : Pierre-Louis Roederer est élu député du Tiers à
l'Assemblée pour le bailliage de Metz ; en remplacement de M. Poulet
dont l'élection a été invalidée.
Jeudi 27 octobre : Dans la région d'Anvers se déroule bataille de Turnhout,
la ville assiégée par les armées impériales du Saint-Empire et défendue
par les troupes belges de M. Van der Mersch, la cité est attaquée. Au
bout de quelques heures c'est la déroute. Ainsi commence peu à peu au fil des semaines la Révolution
brabançonne qui donnera lieu aux éphémères Etats-Unis de Belgique (fin le 2 décembre 1790). En
France depuis Versailles, Louis XVI sanctionne favorablement la loi
martiale du 21 octobre contre les attroupements.
28 octobre : A l'Assemblée, il est rendu compte des voeux
ecclésiastiques et des courriers reçus à ce sujet de religieux au
comité des rapports. M. Target demande l'ajournement du fond, et
présente le décret suivant : « l'Assemblée
ajourne la question sur l'émission des vœoeux, et cependant, et par
provision, décrète que l'émission des vœoeux sera suspendue dans les
monastères de l'un et de l'autre sexe. » Plusieurs députés du
clergé demandent un temps de débat plus long, mais le décret proposé
est adopté. Puis M. le maire de Paris fait état d'un événement arrivé
ce matin à Vernon (à 85 kilomètres de distance, actuel département de
l'Eure) : « Le
sieur Planter, habitant de cette ville, chargé des approvisionnements
de Paris, a été saisi par le peuple, qui a voulu le pendre. La corde a
cassé deux fois ; ce citoyen n'est pas mort, et l'on s'efforce en ce
moment à le soustraire aux fureurs de la populace. Des troupes vont
être envoyées à son secours ; mais elles ne peuvent arriver qu'à cinq
heures. Une lettre de l'Assemblée pourrait rétablir le calme et sauver
le sieur Planter. Il ne s'agit pas seulement de garantir la vie de ce
citoyen, il faut encore ordonner une punition exemplaire pour réprimer
des fureurs qui s'étendent sur tous les approvisionneurs. »
L'Assemblée donne son aval au juge de Vernon, et de répondre vite, et
celui-ci se concertera avec le pouvoir exécutif pour l'exécution des
lois. La séance est levée à quatre heures (du soir). Un nouveau
journal à caractère révolutionnaire est publié, il se nomme le Courrier de l'Assemblée nationale, mais n'aura que quatre numéros connus ou conservés.
29 et 30 octobre : La Constituante confirme le vote censitaire, pour
être
éligible, il faut être contribuable, disposer de certains revenus pour
pouvoir voter ou être élu. L’on distinguera ainsi les citoyens «
passifs » et « actifs ». Le décret du « Marc d’argent » est
accepté, pour être éligible, un citoyen actif doit être propriétaire
foncier et contribuable pour au moins un marc d’argent. Pétion et
Prieur
de La Marne s’y opposeront à leur tour. Le 30, si les débats sont pour
beaucoup autour des biens du clergé, le député du Tiers de Paris,
Jean-Baptiste Target fait une motion sur l'instruction publique : « L'instruction! C'est la législation des esprits ; elle fait descendre sur le peuple
la sagesse de ses représentants ; elle éclaire quand la loi commande ;
elle plie les mœurs ; elle accommode les idées aux besoins de la
révolution ; elle donne aux décrets qu'il faut observer, la puissance
des pensées que l'esprit humain produit de lui-même et qu'il embrasse
comme son propre ouvrage ; enfin, dans le temps des intrigues, des
fausses rumeurs, des séductions accumulées, des maximes pernicieuses,
c'est l'instruction qui doit venir au secours de la vérité outragée et
ramener la paix : elle renverse également les projets des esclaves et
des despotes. Le moment est donc venu où notre premier devoir est
d'instruire. »
31 octobre : En Corse, un certain lieutenant Napoléon Buonaparte se trouve parmi
les émeutiers d’Ajaccio. Une Garde nationale s’y organise. Dans le périodique le Courrier de l'Assemblée nationale (n°IV, page 8) : « On écrit de Vernon (Normandie) que
le calme y est parfaitement rétabli, et qu’on amène à Paris pour y être
jugés, cinq hommes qui étaient au nombre des auteurs de l’émeute
arrivée dans cette ville. On mande qu’il a été arrêté à Rouen dix mille
sacs de bled destinés pour la capitale ; cette nouvelle paraît assurée
sur des témoignages qui ne sont aucunement suspects. »
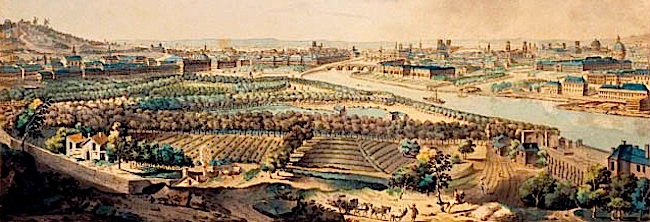 Paris, une vue depuis Chaillot
Paris, une vue depuis Chaillot
XI - Le mois de novembre 1789
Dimanche 1er novembre : Au sein du cirque national du jardin du Palais-Royal se tient une grande salle, qui en cette soirée
sert à un concert qualifié de spirituel, où est jouée une symphonie de
Joseph Haydn, suivi de plusieurs concertistes, et la soirée ouvre à partir de 6 heures du soir.
2 au 7 novembre : L'Assemblée décréte que les
biens du clergé sont mis à disposition de la Nation, par 568 voix pour
et 346 contre, l’Etat met ainsi la main sur 10% des richesses de la nouvelle
nation en marche. Le 3 et jours suivants, Il est décrété que les Parlements du royaume (13 en tout) ne
peuvent plus agir et sont suspendus, au cours du mois. Des
contestations s’ensuivront à Rouen. Les députés ne peuvent devenir
ministres, contre l'avis de Mirabeau. Une discussion est engagée sur le découpage des départements.
4
novembre : A Paris, M. Bailly écrit à M. de Lafayete pour que soit
protéger par un détachement le convoi de blé en provenance de Picardie.
Le district des Petits-Augustins désigne des commissaires pour
vérifier la quantité de farine et des fournées prévues pour cette
nuit chez les boulangers. Le soir, au théâtre Français (Comédie française), c'est la première représentation de Charles IX ou la Saint Barthélemy,
avec le comédien François-Joseph Talma, de Marie Joseph Chénier, et la tragédie en cinq actes avec une salle pleine
remporte un grand succès. Cette pièce présente pour la premiere fois un
roi de France massacrant son peuple, du jamais vu et entendu sur scène. Au bout de
trente-trois représentations, la pièce sera interdite par Louis XVI
à la demande d'évêques effrayés par un tel spectacle. Mirabeau
s'opposera à la censure. (Source : Gallica-Bnf, Alfred Copin, Talma et la Révolution, édité en 1888)
5 novembre : En Corse, à Bastia éclatent des troubles entre l'armée et
les citoyens. A Paris, les députés examinent un plan d'organisation et
d'administration de Paris et de la police, selon M. Dupont de Nemours « Alors
on saura que Paris, inférieur en territoire, mais supérieur en
contributions et en population aux plus grandes provinces du royaume,
vaut et pèse autant et plus qu'aucune de ces provinces. Alors la ville
de Paris ne sera plus regardée comme une simple municipalité ; elle
sera un des éléments principaux de l'organisation de l'Etat, et ce ne
sera que de ce moment qu'elle deviendra véritablement capitale du
royaume, non par une simple accumulation de maisons, mais par la
constitution qui lui sera donnée. Nous
examinerons dans le paragraphe suivant quelle doit être la forme que la
dignité de département oblige de donner en effet à la constitution de
Paris, afin qu'il n'y ait dans son sein aucune autorité supérieure à
celle de sa municipalité que celle de l'Assemblée nationale et celle du
Roi. » L'Ami du Peuple ou le Publiciste Parisien
(n°29) est de nouveau publié depuis le 8/10, Marat après avoir remarqué
que l'on avait tenté, en son absence, de lui ravir le nom de son
périodique :
« J'ai
dévoilé, longtemps avant l'événement la Conjuration prête à éclater le
cinq de ce mois, et j'ai quelques titres à la confiance publique. Dieu
nous préserve de quelque Conjuration nouvelle qui remette la Nation
dans les fers! Les bons Citoyens ne doivent cesser d'y veiller. Pour
confondre les ennemis de la Patrie plus que jamais ligués contre elle,
il est indispensable que les bons Citoyens de chaque District
s'assemblent sans délai, et chassent sans miséricorde de tous les
Comités, les gens, suspects et les Citoyens connus pour n'avoir pas fait
preuve de patriotisme et de probité ; il est indispensable qu'ils les
récomposent ensuite d'un très-petit nombre de membres intègres et
indépendants ; seul moyen de purger l'Hôtel-de-Ville. L'Hôtel-de-Ville
purgé ; le talisman du ministère tombera, l'Assemblée Nationale
marchera comme elle le doit. Ses Décrets funestes sur le veto, sur le
droit à la couronne, par la grâce de Dieu, sur la loi martiale seront
révoqués (N'est-il
pas étrange que M. le Comte de Mirabeau ait participé à ces trois
décrets funestes?) ; la constitution sera ce qu'elle doit être ;
l'abondance renaîtra avec la paix et le bonheur. »
6 novembre : A la chambre des députés, « M.
de Mirabeau, qui avait la parole pour ce matin, a parlé longtemps sur
la nécessité de remédier aux malheurs que peuvent produire, et que
produisent déjà dans toutes les branches du commerce la disparition de
notre numéraire, soit par son exportation continuelle à l'Etranger,
soit par les accaparements et thésaurisations particulières. » Et
il est discuté de la dette des Etats-Unis et de la possibilité de
transfèrer une partie de la créance en envoi de blé par bateau.
7 novembre : Devant les jeux de pouvoirs au sein de l'Assemblée
nationale, le député Adrien Duquesnoy note dans son Journal, après
avoir cité quelques figures connues (MM. Mirabeau, Barnave, Target,
etc.) : « Quel
que soit l'art avec lequel on la déguise, l'ambition perce toujours ;
ses manoeuvres n'échappent pas aux hommes un peu habitués à observer,
et l'Assemblée s'est fort, bien aperçue qu'en voulant faire inviter les
ministres, on n'avait eu d'autre objet que de les faire renvoyer. Mais
on a bien mieux encore déjoué la petite ruse des ambitieux ; M.
Lanjuinais (député de la Sénéchaussée de Rennes)
a proposé que, pendant la session actuelle, aucun membre ne pût
accepter, non seulement aucune place au ministère, mais aucune autre
place, charge, pension, etc. Cette proposition a été accueillie avec
transport, et elle devait l'être. » (Source, Gallica-Bnf, tome II, pages 23 et 24)
8, novembre : A Paris, Après un dîner chez la comtesse de Flahaut, M. Gouverneur Morris, étasunien, lit « une
proposition du comte de Mirabeau, dans laquelle il dépeint avec
vérité la terrible situation du crédit dans ce pays-ci ; mais il ne
réussit pas aussi bien à trouver le remède qu'à révéler la maladie.
Cet homme sera toujours puissant dans l'opposition, mais ne sera jamais
grand dans l'administration. Je crois son intelligence affaiblie par la
perversion de son cœur. Il est un fait que bien peu de gens
soupçonnent, c'est que l'esprit ne peut être sain là où la morale ne
l'est pas. » (Source : Archive.org, Journal de Gouverneur Morris, page 127, éditions Plon, Paris-1901)
9 novembre : Dans la capitale, a lieu l'installation et les premières séances de
l'Assemblée constituante à la salle du Manège, rue des Tuileries (le bâtiment était dans l'axe
actuel de la rue de Rivoli).
10 novembre : A Paris, en fin de journée, Gouverneur Morris se rend « à la représentation de Charles IX,
tragédie sur le massacre de la Saint-Barthélémy. Il est extraordinaire
qu'une telle pièce soit représentée dans un pays catholique : l'on y
voit un cardinal excitant le roi à violer ses serments et à massacrer
ses sujets, puis, dans une réunion des assassins, bénissant leurs
épées, les absolvant de leurs crimes et leur promettant le bonheur
éternel, et tout cela avec les splendeurs de la religion établie. Un
murmure d'horreur parcourt l'auditoire. Il y a plusieurs tirades
s'appliquant à l'époque actuelle, et je crois que cette pièce, si
elle parcourt les provinces comme c'est probable, portera un coup fatal
à la religion catholique. Mon ami l'évêque d'Autun (Talleyrand) a
fortement contribué à la détruire, en attaquant les biens d'église. Il
n'y eut sûrement jamais de nation marchant plus vite à l'anarchie :
elle n'a plus ni loi, ni morale, ni principes, ni religion. » (Source : Archive.org, Journal de Gouverneur Morris, page 130, éditions Plon, Paris-1901)
11 novembre : A Paris, Danton signe un arrêté dans le district des
Cordeliers, où il est demandé aux représentants de la commune de prêter
serment sous peine de révocation
12 et
13 novembre
: A la Constituante, il est décrété une municipalité dans
chaque ville ou bourg du pays, soit environ 42.000 communes. M. Lachèze
est désigné comme secrétaire de l'Assemblée (sic). La journaliste
Félicité-Louise de Keralio suite à une demande auprès du Garde des
sceaux, M. Jérôme Champion de Cicé, d'ouvrir une librairie, elle reçoit
une
réponse négative, parce que c'est une femme. Le lendemain, un décret
ordonne la déclaration des biens de l'Eglise catholique devant les
juges royaux et municipaux.
14 novembre : M. Necker à l'Assemblée lit son Mémoire,
qui a pour but la conversion de la caisse d'escompte en banque
nationale, son texte est renvoyé au Comité des finances. Premiers
inventaires : un décret ordonne à tous les monastères et chapitres dans
lesquels existe une bibliothèque, de déposer aux greffes des sièges
royaux ou des municipalités voisines, les états et catalogues de leurs
livres et manuscrits, d’assurer la garde des collections et de prévenir
toute soustraction d’ouvrage (sanctionné
par le roi le 27 novembre). A l'Académie royale des Sciences, lors
d'une séance, M. Lavoisier a fait un exposé sur comment fondre et
préparer le platine pour les Arts, M. Condocert a fait l'éloge de M.
Granjean la Fouchy, ancien secrétaire de l'académie en présence de M.
Bailly maire de Paris, et a terminé par cet adage : « Plus l'homme est éclairé, plus il est libre. » (Source : Chronique de Paris n°84, du 15/11 - Gallica-Bnf)
15 novembre : Lyon, un corps de volontaires s'est formé pour mettre un arrêt aux « brigandages, qui
répandent une terreur profonde dans la population, et contre lesquels
les milices régulières sont impuissantes. La terreur n'est pas moindre,
à Paris, non plus que l'activité des brigands. Mais, dans la capitale,
le vol organisé se couvre d'un prétexte patriotique. Des citoyens,
pleins de zèle pour la chose publique et pour les intérêts du Trésor,
arrêtent les passants dés deux sexes qui portent des bijoux, et les
leur arrachent, après leur avoir reproché leur mauvais civisme. Ces
bijoux devaient être remis au président de l'Assemblée pour la
souscription nationale. Des événements fort graves se passent en
Brabant. On lance un manifeste proclamant la déchéance de l'empereur
Joseph Il, frère de Marie-Antoinette, et repoussant le joug de la
maison d'Autriche. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, 15 novembre 1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, page de une)
16 novembre : A la chambre des députés, c'est l'adoption de quatre articles au projet relatif à la formation des assemblées primaires, M. le Président, M. Jacques-Guillaume Thouret, avocat de profession, a décrété les articles suivants :
1° Chaque district sera partagé en divisions, appelées cantons, d'environ quatre lieues carrées, lieues communes de France ;
2° Que dans tout canton il y aura au moins une assemblée primaire ;
3° Que lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élevera pas à 900, il n'y aura qu'une assemblée dans ce canton ; mais, quand il s'élevera au nombre de 900, il s'en formera deux de 450 chacune au moins ;
4° Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu'il sera
possible, au nombre de 600, qui sera le taux moyen, de telle sorte
néanmoins que s'il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins
nombreuse soit au moins de 450. Ainsi, au delà de 900, mais avant
1.050, il ne pourra y avoir une assemblée complète de 600, puisque la
seconde aurait moins de 450 ; de ce nombre 1.050, et au delà, la
première assemblée sera de 600, et la dernière de 450 au plus. Si le
nombre s'élève à 1.400, il n'y en aura que deux, une de 600 et de
l'autre de 800 ; mais à 1.500, il s'en formera une de 600 et deux de
450, et ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens actifs de chaque
canton. On propose de délibérer sur l'article suivant : « Chaque assemblée primaire députera au district à raison d'un membre sur deux cents votants. »
17 novembre : La ville de Gand est libérée par les patriotes belges des
troupes de l'Empire germanique de Joseph II. Dans la capitale, à la
salle des Manèges, il est question du projet de constitution concernant
les bases de la représentation nationale, voici ce qu'en dit M. Pétion de Villeneuve : « La
combinaison des trois bases est une idée ingénieuse, beaucoup plus
subtile que solide. Les deux bases factices qu'on veut réunir à la
population donneront lieu à une inégalité certaine dans la
représentation. La représentation est un droit individuel ; voilà le
principe incontestable qui doit déterminer à admettre uniquement la
base de la population, On vous a dit que cette base variera, tandis que
celle du territoire est invariable ; mais vos divisions territoriales
seront nécessairement inégales en étendue ; la différence de leur
valeur respective sera encore une autre source d'inégalité. Ainsi,
cette base immuable sera immuablement inexacte et injuste. La base de
la contribution n'est pas plus convenable. En donnant une
représentation à la fortune, vous blessez tous les principes, et dans
votre supposition même vous êtes encore injustes, puisque vous
n'accordez pas de représentation aux impositions indirectes. N'espérez pas, en combinant ces éléments vicieux,
parvenir à un sage résultat. Vous n'avez pas même l'avantage de
simplifier l'opération. En effet, pour donner à la population le tiers
que vous lui réservez dans la représentation, il en faudra connaître la
totalité. Si vous adoptez cette base unique, cette connaissance
suffirait seule à l'organisation d'un système aussi juste que simple.
La population changera, dit-on ; vous changerez vos propositions avec
elle, et tous les dix ans vous pourrez réparer les erreurs que
l'expérience vous aura dénoncées.
» La constitution ou ce qui concerne en particulier la représentation
nationale entre dans ses premiers débats. Engagés en septembre avec
l'adoption d'un article premier, les échanges iront jusqu'à une
adoption complète des textes soumis en septembre 1791, dont voilà les
premiers articles en cours d'adoption, susceptibles d'évoluer au
cours des mois qui vont s'écouler :
Art. 1er. La population sera la base unique et immuable de la représentation nationale.
Art. 2. L'Assemblée nationale sera composée de 700 membres.
Art. 3. La totalité de la population du royaume sera divisée en sept cents parties.
Art. 4. Chaque département
enverra à l'Assemblée nationale autant de députés qu'il aura de sept
cents parties de la population totale du royaume, ce qui sera à peu
près un député par trente-six mille individus.
Art. 5. Il y aura dans chaque département autant de districts que le département aura de députations.
Art. 6. Chaque district nommera son député à l'Assemblée nationale.
Art. 7. La population de chaque
district sera à peu près de 36.000 individus, et de 6,000 citoyens
actifs. S'il arrivait quelques variations dans la population de chaque
district, l'assemblée provinciale rétablirait l'équilibre et le niveau
pour l'élection seulement des députés à l'Assemblée nationale.
Art. 8. La population de chaque
district étant à peu près de 6.000 citoyens actifs, l'assemblée
d'élection de chaque district sera composée de 120 électeurs à peu
près.
Art. 9. Chaque assemblée
primaire enverra à l'assemblée d'élection de son district un député sur
50 citoyens actifs, ce qui formera le nombre de 120 électeurs.
Sources : Archives Parlementaires, Standford, tome X, du 12/11 au 24/12 1789
18 novembre : Dans la capitale, « On
s'entretient d'une manifestation royaliste faite au théâtre de Monsieur
par les dames de la Halle, à la première représentation duSouper de Henri IV.
On y boit à la santé du roi ; toutes ces dames se lèvent, poussent des
cris, elles sautent sur la scène, et esquissent un pas de ballet. Ces
mêmes dames avalent chanté des couplets devant l'Assemblée nationale. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, 18 novembre 1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, page de une)
19 novembre : Le premier acte fédératif et le ralliement du Dauphiné à
la France, il se tient au petit bourg de l'Etoile, près de Valence. Il
est le fait des députés de vingt communes se déclarant comme « soldats
de la Patrie, armés. »
20 novembre : A l'Assemblée, M. Necker vient présenter un plan pour la
création d'une banque. Le comte de Mirabeau d'entrée de jeu s'y oppose.
21 novembre : Sept jours avant M. Necker déclarait avoir besoin de 170
millions de livres et comme une urgence. De son côté, ce
jour même, M. Lavoisier présente à l'Assemblée le bilan de la Caisse d'escompte
accusant un trou de 27,5 millions de livres. M. J.J. Mounier démissionne de son siège de député du Dauphiné.
22 novembre : Dans la région du Poitou, face à des inquiétudes de
famine et lors de deux réunions (la première s'était tenue le 7 novembre), les municipalités portuaires de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie ont tenu : « des séances communes, auxquelles » elles ont convoqué «
les négociants et principaux habitants, afin de discuter les
propositions du Comité de Nantes, relativement à la réception des blés
à embarquer pour l'approvisionnement de cette ville. » (...) « Considérant
que les achats de grain froment multipliés, pour être expédiés par ce
port tant pour le Comité de Nantes que pour ailleurs, en ont déjà porté
le prix à 400 livres le tonneau, beaucoup trop cher pour le peuple, et
qu'il est à craindre que la continuation des achats n'en augmente
encore le prix, ce qui deviendrait inquiétant et donnerait lieu de
craindre des suites fâcheuses que, pour les éviter, nous pensons que
tout bon habitant résidant à Saint-Gilles, à Croix-de-Vie et aux
environs, doit être invité à prendre l'engagement de n'acheter aucun
blé froment au-dessus de 400 livres le tonneau, mesure de Saint-Gilles
; que les orges, seigles et gaboreaux, les aliments de la portion du
peuple la moins aisée, doivent être conservés. » Et les municipalités prendraient des mesures si ces décisions n'étaient pas respectés. (Source : Gallica-Bnf, Ch.-L. Chassin, La préparation de la guerre de Vendée, 1789-1793. Tome 1, page 83)
23 novembre : A Rennes et ses alentours le refus de l'impôt est fort,
le Comité provisoire interdit les attroupements et il protège les
commis des Fermes (en charge de collecter l'impôt). A Paris, c'est la parution d'un nouveau titre de presse du matin avec le Journal universel, ou Révolutions des royaumes, proche
des idées de Lafayette et du duc d'Orléans, son rédacteur et directeur
est M. Pierre Jean Audouin (fin du quotidien en 1795).
24 novembre : Naissance du « Moniteur universel ou Gazette nationale », journal de référence, il sera publié jusqu'en 1869.
25 novembre : A la Constituante, il est décrété que : « Toutes
les fonctions municipales sont électives ; tous les citoyens actifs,
habitant la commune, concourront à leur élection ; le chef du corps
municipal prendra le nom de maire. Les assemblées ne pourront se former
par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou
arrondissements. Les élections municipales se feront au scrutin de liste.
Ainsi sont définitivement abolies, non seulement les anciennes
divisions territoriales qui résultaient du droit féodal, mais encore
toutes les divisions intérieures qui parquaient les citoyens par
professions ou suivant les antiques coutumes. L'origine du pouvoir, des
fonctions, de la loi, réside désormais dans une addition d'unités
absolument égales entre elles. Le royaume est découpé par des lignes
arbitraires qui enferment des départements, des districts, des communes
ou communautés, comme on disait alors, et les citojens compris dans ces
limites concourent aux mêmes votes. Mais
ils pourraient aussi bien voter avec les voisins, puisque l'uniformité
logique a été substituée à la diversité issue de la tradition. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, 25 novembre 1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, page de une)
26 novembre : A Paris, le procureur du roi au Châtelet, après
avoir mené un réquisitoire, porte plainte contre le sieur Jean-Jacques
Rutledge (ou Rutlidge, journaliste et franco-irlandais), « pour s'être immiscé, sans mandat, dans l'administration de l'approvisionnement de Paris. » (Source : Gallica-Bnf, A. Tetuey, Sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Rév. française. Tome 1, page 133)
27 novembre : Supplique et pétition des citoyens de couleur des isles et colonies franc̜aises,
sur la motion faite à l'Assemblée, par M. de Curt, député de la
Guadeloupe. Accompagné du texte, signé au Comité des Citoyens de
couleur, par MM. Joly ; Raimond, aîné ; Ogé, jeune ; Du Souchet de
S.-Réal ; Honoré de S.-Albert ; Fleury ; tous commissaires et députés
des citoyens de couleur des îles et colonies françaises. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)
28 novembre : C'est la naissance du journal de Camille Desmoulins : Les Révolutions de France et de Brabant,
parution jusqu'au 12 décembre 1791. A l'Assemblée M. Tremblay du
Rubelle présente son mémoire sur la destruction de la mendicité : « On
peut se rappeler à ce sujet qu'en 1778 il y avait à Amiens un nombre
considérable de pauvres ; on y forma le projet de détruire la mendicité
; on fit une quête dans la ville, et l'on en annonça la distribution :
le jour même que les magistrats publièrent la défense de mendier dans
les rues, les mendiants disparurent; et dans la crainte d'être arrêtés,
retournèrent à leurs travaux. Le pauvre valide ne manque le plus
souvent de subsistance que parce qu'il se refuse au travail, ou qu'il
ne peut pas s'en procurer : un peu de surveillance peut empêcher l'un
et l'autre ; c'est donc de l'ordre qu'il faut en cette partie, et non
de l'argent. Mais pour ôter toute ressource aux gens de mauvaise
volonté de continuer à vivre dans leur dangereuse oisiveté. »
29 novembre : A l'Etoile, près de Valence, a lieu la première
fédération des Gardes nationales de France (12.000 hommes), entre celles du Vivarais et
du Dauphiné.
30 novembre : La Corse devient partie intégrante de la France, le
député Salicetti contribue à sa promulgation comme entité du
royaume. Depuis Londres Pasquale Paoli, réfugié en Angleterre depuis 20 ans écrira le 20 décembre de cette même année : « C'est
avec un transport de joie bien vive que j'ai appris ce que l'Assemblée
nationale a fait pour ma Patrie. En admettant la Corse parmi les
provinces de la France, elle a trouvé le moyen le plus infaillible
d'attacher les habitants de cette île au gouvernement français ; en
faisant rentrer dans cette île nos compatriotes expatriés, elle attache
à la Constitution un nombre considérable d'individus qui la défendront
jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
» Louis XVI sanctionnera (il ne s'agit pas de sanctionner une faute),
c'est-à-dire approuvera le texte favorablement en janvier de l'année
1790 par Lettres patentes.

L'ancien Palais-royal du Louvre fin XVIIIe siècle
XII - Le mois de décembre 1789
Mardi 1er décembre : Une émeute se déroule à Toulon, le comte de Rioms
est envoyé en prison avec quatre autres officiers. A l’Assemblée, M. Joseph Guillotin
(1738-1814) propose l'égalité des peines pour tous les citoyens et la décapitation
« par l'effet d'un simple mécanisme »
face au discours de l'abbé Maury
en faveur des supplices traditionnels. Vous pouvez consulter à ce sujet
les propositions de M. Guillotin, dont l'adoption ce jour du 1er
article : Articles sur les lois criminelles, dont l'Assemblée nationale a ordonné l'impression le premier décembre 1789, pour être discutés dans la séance du 2 (Source : Gallica BnF, 3 feuillets).
2 décembre : L'astronome M. de Lalande « annonce
dans une communication faite à l'Académie des sciences, que l'astronome
anglais M. HershelI ; avec son télescope de vingt-pieds, a nettement
distingué la tranche de l'anneau de Saturne, qu'il a découvert deux
nouveaux satellites de Ia curieuse planète, dont l'un débordait sur
l'anneau comme un grain de chapelet enfilé dans un ruban de soie. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, 2 décembre 1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, page de une)
3 décembre : La Constituante refuse la création d'un Comité colonial, suite
à une discussion sur les « gens de couleur » et sur la base d’une
motion de l’abbé Grégoire. Le peintre Claude Vernet connu pour ses marines décède à l'âge de 75 ans dans la capitale. Au Mans, c'est l'exécution des trois meurtriers du comte
de Montesson.
4 décembre : Ile Bourbon (la Réunion), une circulaire du gouverneur
David Charpentier de Cossigny aux commandants de quartiers, les invite
à convoquer les habitants en assemblées paroissiales, pour constituer
une assemblée coloniale et désigner un député pour aller à
Paris et veiller aux intérêts de la colonie.
5 décembre : Les bois de l’Est et de l’Ouest de la capitale, de
Boulogne et de Vincennes sont saccagés par des paysans, s’ensuivent 87
arrestations. Selon Marat, il dépose un mémoire au comité municipal des recherches : Dénonciation faite au tribunal du public, par M. Marat, l'Ami du Peuple, contre M. Necker, premier ministre des Finances. (Source : Gallica-Bnf) Selon Jean-Paul Marat, il est arrêté, ou ce qu'il a écrit dans sa dénonciation de Necker se voit décréter d’accusation pour calomnie.
7 décembre : A Paris, Le paysan magistrat, de M. Collot d'Herbois, la comédie en cinq actes et en prose est représentée pour la première fois au théâtre de la Nation. (Source : Gallica-Bnf)
8 décembre : A la Maison de Bicêtre, sise
à Gentilly, dans le sud de la capitale, un groupe d'une trentaine de
prisonniers arrivent à faire s'écrouler un pan de mur, ce qui permet de
passer au travers et de prendre la fuite, mais les fuyards sont
rapidement arrêtés et remis au cachot. (Source : Gallica-Bnf Paul Bru, Histoire de Bicêtre, page 65, 1890 Paris)
9
décembre : La Constituante décide la création des départements dans un processus fédératif, et
non fédéraliste (à ne pas confondre). Les décrets seront fixés le 26 février 1790.
10 décembre : A Bruxelles, c'est début de l'insurrection des patriotes
belges avec distribution de cocardes à la sortie de la messe
(Révolution brabançonne).
11 décembre : A l'Assemblée, les forêts se trouvent sous la sauvegarde de la Nation.
12 décembre : La ville de Bruxelles est libéré par les patriotes Belges. A Paris, le journaliste Marat, arrêté, il comparaît à l’Hôtel-de-Ville pour absence de preuve pour une de ces dénonciations, il est rapidement relâché par Lafayette. A Marseille,
la loi martiale est proclamée.
13 décembre : Fortes agitations à Senlis,
suite à un drame perpétué par un horloger fou, M. Louis Michel Rieul
Billon, qui par vengeance organise un attentat, l'on dénombre 25 morts
et quarante-et-un blessés.
14 décembre : A la chambre des députés est décrétée la loi sur l'organisation des communes (wikisource), à l'article 2, les anciens officiers et membres municipaux seront remplacés par un vote désigant un maire et son conseil, ainsi qu'un procureur pour les villes de plus de 10.000 âmes chargé de défendre leurs intérêts, désignés au sein des citoyens actifs avec au moins 3 membres (moins de 500 habitants), par quartier ou arrondissement à l'article 7. Pour la capitale, « attendu
son immense population, elle sera gouvernée par un règlement
particulier, qui sera donné par l'Assemblée nationale, sur les mêmes
bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes
les municipalités du royaume. » Il est précisé à son 50ème article que : « Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :
- De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;
- De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;
- De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;
- D'administrer les établissements qui appartiennent
à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont
particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée
;
- De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
15 décembre : Motion de M. Godard, l'un des représentants de la Commune, faite à l'assemblée générale de la Commune sur l'étendue et l'organisation du département de Paris : « Paris
était à la vérité un gouffre, qui dévorait tout ; tous les hommes
riches du Royaume y faisaient leur séjour ; toutes les grandes places y
étaient exercées ; toutes les affaires s'y traitaient. Mais tout reflue
aujourd'hui dans les Provinces : un nombre infini de places va y être
créé ; toutes les affaires se traiteront se termineront sur les lieux ;
nous n'aurons plus ici ni financiers qui s'enrichissaient de l'argent
des Provinces, ni bénéficiers opulents à qui l'argent des Provinces
était envoyé dans une quantité incalculable. La Révolution que Paris a
faite est donc toute entière au profit des Provinces ; et l'on pourrait
dire que Paris seul y perdrait, si la liberté qu'il gagne n'était pas
une conquête qui réparât ses autres pertes. (...) Je
conclus donc à l'admission du Plan de M. l'abbé de Syeyes. Paris doit
être dans un Département. Paris doit être ou avoir lui-même un
Département. » (Source : Gallica-Bnf, pages 15 et 16)
16 et 17 décembre : A la Constituante, il est décrété que les troupes
françaises seront
recrutées par engagement volontaire et la conscription ou la
mobilisation des citoyens est rejetée. Il est proposé que les prêtres
puissent se marier. Le lendemain, Jacques Necker envoie un nouveau rapport à l'Assemblée sur les finances.
18 décembre : La commune de Paris « a
fait du colportage une profession privilégiée ; elle a réduit le nombre
des colporteurs à trois cents, et les a astreints à se munir d'une
plaque et d'une autorisation. Cette mesure, si contraire aux principes
de l'abolition des privilèges et de la liberté du travail, soulève une
vive rumeur dans le monde des gazetiers. On se plaint que déjà la
presse soit soumise à un régime d'exception. On fait un tableau
lamentable des douze ou quinze cents colporteurs privés de leur
gagne-pain. Mais ies malins font remarquer que l'ordonnance est sans
date, et, par conséquent, non valable. C'est une de ces tentatives sans
suites aont la Commune de Paris est coutumiére. » (Source : Gallica-Bnf, Le Matin, 18 décembre 1889, rubrique QUATRE-VINGT-NEUF, page de une)
19 décembre : L'Assemblée décrète la vente des bien
domaniaux et ecclésiastiques jusqu'à hauteur de 400 millions. A noter, la naissance
des assignats et la mise en oeuvre pour la même somme, pour répondre aux paiements des domaines.
20 décembre : Depuis Londres, Pasquale Paoli fait part d'une lettre
exprimant sa joie
des décrets du 30 novembre sur la Corse intégrée au royaume français
(lire la citation au 30 novembre). Dans la capitale, l'Hôtel de Ville
fait part de ses inquétudes et prévient des transports de farine du
prieuré de Saint-Matin-des-Champs (les locaux sont devenus trop petits
pour que tous les sacs de farines y soient entreposés) aux
magasins de l'Ecole Militaire. A l'annonce de la programmation de la
pièce le 28/12, L'Esclavage des Nègres, un
drame en 3 actes, au théâtre de la Nation, les milieux coloniaux
s'agitent et font publier chaque jour des articles contre l'auteure,
Olympe de Gouges (ou de Gouge). Elle-même fait publier, ce jour, un article dans la Chronique de Paris (4 pages quotidiennes, plus une page supplément recto-verso - page 474) pour promouvoir son spectacle révisité. (Source Gallica-Bnf)
 Messieurs (*),
« Messieurs (*),
« Voici la neuvième année que j’essayai de
peindre,
dans un drame, toute la rigueur de l’esclavage des noirs. Il n’était
point alors question d’adoucir leur sort et de préparer leur
liberté. Seul, j’élevai la voix en faveur de ces hommes si malheureux
et si calomniés. A l’impression, l’intérêt du sujet fit oublier la
médiocrité de l’auteur.
Ce drame présenté à la Comédie Française, il y a quelques années, et que j’avais mal-à-propos intitulé, l’heureux naufrage,
a essuyé plus d’une tempête. Echappé aux écueils et aux vents
contraires de l’autorité, il vogue maintenant avec liberté vers la
scène, sous ce titre ; l’esclavage des noirs.
Si je n’avais à craindre que la faiblesse de mes talents et la
puissance de mes ennemis, l’époque actuelle du rétablissement de la
liberté semblerait me promettre quelqu’indulgence pour un ouvrage qui
la défend ; mais ne suis-je pas encore en bute à tous les protecteurs,
fauteurs du despotisme américain (1), sans compter encore etc. etc.
etc...? Que mon sexe obtienne au moins du public, le jour de la
première représentation, le même intérêt qu’il a accordé à l’auteur de
Charles IX. Je dois dire
encore que je n’ai pas puisé le dialogue de ce drame dans les
événemens du jour, et que j’ai consacré ma part d’auteur à augmenter
la contribution patriotique, dont j’ai eu la première idée dans une
brochure imprimée depuis quinze mois.
Si cette pièce pouvait avoir la même fortune que Figaro ou Charles IX, en vérité, messieurs, je n’en serais pas fâchée pour ma gloire et pour la cause patriotique. »
Note :
(*) Le portrait d'Olympe de Gouges en
peinture est possiblement de Rose-Adélaïde Ducreux, qui ne signait pas
ses oeuvres (1761-1802)
(1) On sait qu’ils viennent de publier un libelle sanglant contre la Société des Amis des Noirs : mais ils se sont bien gardés d’y nommer M.
de La Fayette, M. le duc de la Rochefoucauld, etc. qui se font
cependant honneur d’être comptés parmi les amis des noirs.
De Gouges
Paris, ce 19 décembre 1789
|
21 décembre : M. le marquis Charles de la Villette, ami et protecteur de Voltaire, rédige dans la Chronique de Paris un
article (page 478, n°119), où il propose d'élever un monument à
Voltaire dans la basilique Ste Geneviève, en face, précise-t-il, du
tombeau de Soufflot (architecte, grand inspirateur du néo-classicisme)
et il termine par cet éloge : « Descartes
renversa la philosophie d'Aristote ; Voltaire a renversé le fanatisme
et les préjugés. Le premier, en généralisant les nombres, invente
l’algèbre, et fournit à l’esprit humain le fil qui le conduit dans le
labyrinthe des hautes sciences ; le second devient la lumière de son
siècle, et
fait passer dans les âmes cette tolérance universelle, cette haine du
despotisme qui a servi de levain à notre glorieuse révolution.
Et quand l’un repose parmi les morts sous les voûtes ogives d’une
église gothique, l’autre mérite de recevoir l’hommage des vivants dans
un temple de gloire, où l’on admire ces chapitaux corinthiens, et ces
belles colones, image de son immortalité. » A l'Assemblée M. Bertrand Barrère de Vieuzac, député des Etats de Bigorre fait des propositions Sur la nécessité faire de ce pays d'Etats un département? (22 pages), il souhaite entre autres que la ville de Tarbes devienne le chef lieu et en explique les raisons. (Sources : Gallica-Bnf)
22 décembre : A la Constituante, les femmes sont exclues du droit de vote. La loi sur la division du royaume en département est
approuvée, il en existera 83. M. Guillotin soumet les plans sur la réorganisation des
ateliers de charité et de subsistance des pauvres, et lecture du rapport de M. Thouret sur le pouvoir
judiciaire. Par décret, la surveillance des établissements charitables est confiée à l'administration civile.
23 décembre : A l’Assemblée, Stanislas de Clermont-Tonnerre défend les
droits de
citoyenneté des protestants, des comédiens, des juifs et du bourreau.
En faveur d'une monarchie constitutionnelle, il est l'un des artisans
de l'émancipation des Juifs et a laissé pour cette journée la formule
suivante : « Il
faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs
comme individus ; il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps
politique ni un ordre ; il faut qu’ils soient individuellement
citoyens. Mais, me dira-t-on, ils ne veulent pas l’être. Eh bien! S’ils
veulent ne l’être pas, qu’ils le disent, et alors, qu’on les bannisse.
Il répugne qu’il y ait dans l’État une société de non-citoyens et une
nation dans la nation. » et précise que « l’état présumé de tout homme domicilié dans un pays est d’être citoyen. » Robespierre dans le même sens intervient sur la question des comédiens, il n'approuve pas
l'idée qu'ils soient l'objet d'une loi spécifique, et sur la question des Juifs il
déclare : « On vous a dit sur les juifs des choses infiniment
exagérées et souvent contraires à l'histoire. Comment peut-on leur
opposer les persécutions dont ils ont été les victimes chez différents
peuples? Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons
expier, en leur rendant les droits imprescriptibles de l'homme dont
aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. On leur impute
encore des vices, des préjugés, l'esprit de secte et d'intérêt les
exagèrent. Mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos
propres injustices? Après les avoir exclus de tous les honneurs, même
des droits à l'estime publique, nous ne leur avons laissé que les
objets de spéculation lucrative. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à
la vertu, en leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens ; songeons
qu'il ne peut jamais être politique, quoiqu'on puisse dire, de
condamner à l'avilissement et à l'oppression, une multitude d'hommes
qui vivent au milieu de nous. Comment l'intérêt social pourrait-il être fondé sur la violation des
principes éternels de la justice et de la raison qui sont les bases de
toute société humaine? » Décès de l'abbé Charles de l'Épée, fondateur de l’institut des
sourds-muets, il sera enterré au cimetière Saint-Roch. Les États de Flandre se déclarent comme « nation
indépendante » de l'Empereur d’Autriche.
24 décembre : Dans la capitale, se produit l'arrestation du marquis de Favras, accusé de comploter pour l'évasion du
roi et pour une tentative d'assassinat sur MM. Bailly et Lafayette, il est aussi l’ancien garde du corps de Mirabeau. A la Constituante, contre discours de M. Maury sur les droits
civiques des comédiens et des juifs. Honoré-Gabriel de Mirabeau prend parti dans son journal Le Courrier de Provence : « On ne peut leur refuser l'exercice de tous les droits nationaux. » Cependant les Protestants et les comédiens
deviennent des citoyens à part entière suite aux interventions de
Robespierre, Roederer et Clermont-Tonnerre. Les Juifs restent néanmoins exclus du
décret par l'Assemblée en ces termes : « qu'elle n'entend rien préjuger relativement, aux Juifs, sur lesquels elle se réserve de prononcer. » Sinon,
il est arrêté que les non-catholiques peuvent à présent postuler à des
emplois publics. Ce même jour des comédiens du théâtre de la Nation
s'adressent directement par courrier sur leur droit à la citoyenneté,
au président de l'Assemblée en ces termes :
« Monseigneur,
Les Comédiens français ordinaires du Roi, occupant le théâtre de la
Nation (la Comédie française), organes et dépositaires des
chefs-d'œuvre dramatiques, qui sont l'ornement et l'honneur de la scène
française, osent vous supplier de vouloir bien calmer leur inquiétude.
Instruits par la voix publique qu'il a été élevé, dans quelques
opinions prononcées à l'Assemblée nationale, des doutes sur la
légitimité de leur état, ils vous supplient, Monseigneur, de vouloir
bien les instruire, si l'Assemblée a décrété quelque chose sur cet
objet, et si elle a déclaré leur état incompatible avec l'admission aux
emplois et la participation aux droits de citoyen. Des hommes honnêtes
peuvent braver un préjugé que la loi désavoue, mais personne ne peut
braver un décret, ni même le silence de l'Assemblée nationale sur son
état. Les Comédiens français, dont vous avez daigné agréer l'hommage et
le don patriotique, vous réitèrent, Monseigneur, et à l'auguste
Assemblée le vœu le plus formel de n'employer jamais leurs talents que
d'une manière digne de citoyens français et ils
s'estimeraient heureux si la législation réformant les abus qui peuvent
s'être glissés sur le théâtre daignait se saisir d'un instrument
d'influence sur les mœurs et sur l'opinion publique. »
Les Comédiens ordinaires du Roi. Signé, Dazincourt, secrétaire.
25 décembre : A Paris, se produit l'arrestation du marquis de Favras. Olympe de Gouges reçoit des menaces via une lettre anonyme : « Je
crois pouvoir vous dire, au nom de tous les colons, que depuis
longtemps, leurs mains leur démangent de se saisir d'un ami des Noirs. » Depuis Rome, l'ancien gouverneur de Saint-Domingue (1753-1757),
Joseph, Hyacinthe, François de Paule de Rigaud de Vaudreuil, en exil
depuis le 14 juillet, s'adresse par lettre (n°15) au comte d'Artois
(petit frère du roi et futur Charles X) sur la situation en Europe (extraits)
:

Le Comte de Vaudreuil (1740-1817), peinture d'Elisabeth Vigée-Lebrun de 1784
« On a la nouvelle que l'Empereur (d'Autriche) est retombé malade et est en grand danger. On dit aussi que l'Angleterre arme à force et
a ouvert un emprunt de cent millions ; que le marquis de Lansdowne va
rentrer dans le ministère, et que la puissance de M. Pitt baisse tous
les jours. Je ne mets pas en doute (quoi qu'on vous en ait dit) que
l'argent des Anglais ne soit le principal moteur de la révolution que
nous avons éprouvée, et de celle du Brabant. Ils ne nous ont pas
pardonné la guerre d'Amérique, et je sais que le marquis de Lansdowne,
autrefois lord Shelburne, avait une correspondance très-suivie avec
l'abbé Morellet et plusieurs autres chefs de la démocratie ; que son
fils, lord Wycombe, a été à Paris pendant tout le temps de la
révolution, et animait tous nos jeunes gens, voyait tous les gens de
lettre du parti, et rendait compte de tout à son père.
Si, après cela,
le marquis de Lansdowne rentre dans le ministère, tout est éclairci, et
voilà le chemin qu'il aura pris pour y arriver. Dans ce cas, la Prusse,
la Hollande sont du secret, et nous avons à redouter, peut-être à
espérer, une attaque prochaine. Je dis peut-être à espérer, car qui
sait si la menace d'un envahissement n'ouvrirait pas tous les yeux, ne
ranimerait pas tous les coeurs français, et ne ramènerait pas à
l'autorité légitime et nécessaire? Nos héros de paix disparaîtraient ;
nos législateurs iraient se cacher dans des trous, et la noblesse
française volerait à la défense de la patrie ralliée sous notre Roi.
Vous nous montreriez le bon chemin, et nous vous y suivrons avec valeur
et succès. Si nous succombions, l'honneur du moins serait sauvé, au
lieu que notre avilissement actuel n'est pas supportable. On dit encore que le maréchal de Broglie arrive à Turin très incessamment. »
|
26 décembre : A Paris, Monsieur, frère du roi, futur Louis XVIII
répond devant la Commune parisienne aux accusations
de complicité avec Favras. A la Constituante, il est ordonné aux généraux
de proclamer « la souveraineté du peuple » dans tout le pays rassemblé
en
une seule
unité légale. M. le duc de Mailly, député de Péronne, donne sa
démission et M. de Folleville, dont les pouvoirs ont été vérifiés est
admis pour le remplacer.
27 décembre : Dans la capitale, M. Gouverneur Morris, un des pères de la constitution des Etats-Unis, note dans son journal que « sur M. de Favras a été trouvée une lettre de Monsieur (frère du roi),
semblant prouver qu'il y était intimement mêlé ; il s'était
immédiatement rendu chez Monsieur avec la lettre qu'il lui
avait remise, disant qu'elle n'était connue que de lui et de M. Bailly
; qu'en conséquence il n'était pas compromis. Monsieur avait été ravi
de cette information ; hier matin, cependant, il l'avait envoyé
chercher, et, au milieu de ses courtisans, avait parlé en termes
irrités d'une note qui avait circulé la veille au soir, l'accusant
d'être à la tête du complot. La Fayette répondit qu'il ne connaissait
qu'un moyen d'en découvrir les auteurs, c'était d'offrir une prime,
et c'est ce que l'on allait faire, Monsieur déclara alors son
intention d'aller à l'Hôtel de Ville l'aprè̀s-midi, et en conséquence
l'on fit des préparatifs pour le recevoir; il vint et prononça le
discours que nous avons vu, discours écrit par Mirabeau qu'il regarde
comme une canaille. » (Source : Archive.org, Journal de Gouverneur Morris, page 158, éditions Plon, Paris-1901)
Lundi 28 décembre : A l'Assemblée, un
décret ordonne aux intendants et aux administrations provinciales de
rendre compte de leurs gestions. Dans la soirée, il s'agit de la première représentation à la Comédie Française de L'esclavage des nègres, (Source : Gallica-Bnf) drame
en trois actes, récit en prose,
une pièce de théâtre rédigée par Olympe de Gouges il y a plusieurs
années, dont une partie a été remaniée par ses soins. Voici ce qu'elle
a adressé à la Chronique de Paris (page 506, n°126) et a publié ce même jour : « Messieurs, Au
moment où je vais être jouée, j’apprends qu'il se forme contre ma pièce
un parti redoutable. Je n'ai pourtant point développé, dans mon drame,
des principes incendiaires et propres à armer l’Europe contre les
colonies. Rassurez, je vous prie, par la publicité de cette lettre, des
personnes prévenues, qui, si elles viennent à la Comédie Française,
sentiront qu’il ne faut pas toujours juger sévérement un ouvrage par le
titre qu’on lui donne. » (Source : Gallica-Bnf)
29 décembre : La chambre des députés refuse un don de 900.000 livres
envoyé par des Genèvois, dont un certain Étienne Clavière pour alléger
le fardeau de la dette. La Chronique de Paris (page 511, n°127) fait état de la pièce de Me de Gouges, jouée hier, L'Esclavage des Nègres, en ces termes : « La
représentation a été très-tumultueuse. Les amis des noirs et des
planteurs ont perdu également des efforts que l’ouvrage ne méritait pas
; il n’a point eu de succès, et ne peut être dangereux ni utile. Comme
le spectacle était à tout moment interrompu, un plaisant a fait la
motion de ne siffler que dans les entractes. Nous ne ferons aucune
réflexion. Nous répéterons seulement, avec Piron, qu’il faut de la
barbe au menton pour faire un bon ouvrage dramatique. »
30 décembre : Le tribunal de police a condamné le sieur Cheradame
entrepreneur de l'enlèvement des boues et immondices de Paris, à 300
livres d’amende pour contravention aux réglements. (Source : Gallica-Bnf, la Chronique de Paris, page 516, n°128)
Jeudi 31 décembre : À l'Assemblée, les Dames de la Halle font leur compliment de nouvelle année, et les Juifs
dits Portugais font une adresse à cette dernière sur leurs inquiétudes
(au nom des 245 familles de Bordeaux qui bénéficient d'un statut propre et discordant avec les autres "nations juives" du royaume).
à suivre...
|
|
|