|
|
| Une famille républicaine et fouriériste : Les Milliet ? |
 |
Présentation
La famille Milliet et sa parenté avec la famille Payen est constitutive
de l’histoire d’une famille socialiste et républicaine. Des
Fouriéristes dans l’âme et d’esprit, qui est le fait d’une découverte
récente, me concernant, et fort instructive. Il s'agit de personnes
quasiment inconnues, s’il n’y avait ces courriers et sa mise en forme
près de
quarante ans plus tard par un de leurs fils. Il a fallu reconstituer
quelques éléments
généalogiques, se limiter à deux générations, parents et enfants, dont
notamment Alix et son frère Paul, le narrateur ou Jean-Paul son prénom
à l’état civil, et pour ne pas le confondre avec un homonyme
librettiste, plus son époux Henri Payen mort à son domicile des suites de graves
blessures aux côtés des troupes parisiennes fédérées.
Il ne s’agit pas de reconstituer une biographie familiale dans toute
son étendue, je ne peux que vous inviter à découvrir les deux tomes
publiés par Jean-Paul Milliet (1)
lors de la première guerre mondiale,
à qui nous devons une approche de la Commune de Paris hors des sentiers
battus,
et pas seulement. Nous sommes loin des querelles politiques et
militaires de l’Hôtel-de-Ville de la capitale, de ses annexes de mars à
mai 1871, mais dans l’étonnement, presque au milieu des ruines de la
guerre civile, à suivre une famille valeureuse et engagée, à la lecture
d’un échange de lettres reconstituées par un auteur féru en peinture et
en histoire de l’Art.
Paul Milliet, le rédacteur est venu un jour avec ses écrits sous le
bras demander en toute modestie, selon Charles Péguy, si les Cahiers
de
la Quinzaine pouvaient le publier. De plus, il disposait de textes
inédits de Victor Hugo et de Béranger. On imagine mal Chales
Péguy, à la fois mystique et patriote, sinon chrétien, républicain, et
socialiste hétérodoxe ou déjà dissident des premières heures de la
SFIO, le renvoyer pour ce motif, nous sommes en 1910 :
« C’est une véritable
bonne fortune pour nos cahiers que de pouvoir commencer aujourd’hui la
publication de ces archives d’une famille républicaine. Quand M. Paul
Milliet m’en apporta les premières propositions, avec cette
inguérissable modestie des gens qui apportent vraiment quelque chose il
ne manqua point de commencer par s’excuser, disant : - Vous verrez.
Il
y a là-dedans des lettres de Victor Hugo, de Béranger. (Il voulait
par
là s’excuser d’abord sur ce qu’il y avait, dans les papiers qu’il
m’apportait, des documents sur les grands hommes, provenant de grands
hommes, des documents historiques, sur les hommes historiques, et,
naturellement, des documents inédits.) (…) On y verra
comment le
tissu même du parti républicain était héroïque, et ce qui est presque
plus important combien il était cultivé ; combien il était classique ;
en un mot, pour qui sait voir, pour qui sait lire, combien il était
ancienne France, et, au fond, ancien régime. »
Charles
Péguy, Notre Jeunesse, page 2
Il
y aurait de quoi incliner que
la démarche était plus artistique, une
esthétique à cerner, sans en dénier l’intérêt historique. L'objet n'est
pas de vous dévoiler le contenu des textes ou les 4 chapitres de Paul Milliet sur la
Commune, mais vous inciter à lire ce qui a constitué un numéro des Cahiers de la Quinzaine
sur plus de 200 titres édités. Il a semblé utile d'y joindre
différentes explications dans l'idée de mettre en relief une famille admirable,
une perception de la république qui n'était pas encore gagnée. Et ce
que peut recouvrir l'oeuvre de Charles Fourier, et qui furent ses
héritiers?
Le
père Félix Milliet, ancien militaire, poète et rentier était un ex.
quarante-huitard (1848), il avait pris les routes de l’exil après le
coup d’état de Napoléon III en décembre 1851 avec sa famille en Suisse.
Son fils Jean–Paul, ainsi que son frère aîné Fernand ont aussi pas mal
parcouru de chemins et pays, d’abord comme soldats de carrière, du
temps de la coloniale, puis pour Jean-Paul à Rome pour des recherches
muséographiques. Il travailla pour la mise en oeuvre et la fabrication
de moules, pour des statuaires pas encore
recensées, ceci à partir de 1872 lors de son exil. Ce ne fut que
tardivement que les deux livres
d'Une famille de républicains fouriéristes. – les Milliet,
ont
été
publiés, le dernier tome, le fut deux ans avant sa disparition en 1918
avec un douzième livre et des rajoûts par rapport à l'édition initiale.
A ce titre, impossible de ne pas rendre compte de l’intérêt des textes
des Cahiers de la Quinzaine
dirigés par Charles, puis
Marcel Péguy, je
n’avais pas envisagé d’y trouver un si beau témoignage d’une famille
républicaine « disciple » de la pensée de Charles Fourier, et surtout
permet de connaître des acteurs connus et moins connus au quotidien et
à divers titres au sein de la Commune insurrectionnelle de Paris. J’y
suis venu grâce des recherches sur Bernard Lazare, que Charles Péguy a
mis en exergue dans ce même texte : « Notre
Jeunesse » au sujet de
l’affaire du capitaine Dreyfus : « Le plus grand de tous,
Bernard-Lazare, quoi qu’on en ait dit, quoi qu’on en ait, plus
lâchement, laissé dire, a vécu pour lui, est mort pour lui, est mort
pensant à lui. » (page 66)
« Les papiers de M.
Milliet que nous publierons donneront immédiatement l’impression
d’avoir eux-mêmes été choisis d’un monceau énorme de papiers. On ne
peut naturellement tout donner. À partir du moment où M. Milliet
m’apporta les premiers paquets de sa copie, un grand débat s’éleva
entre nous. Il voulait toujours, par discrétion, en supprimer. Mais
j’ai toujours tout gardé, parce que c’était le meilleur. On en avait
assez supprimé pour passer des textes à la copie, pour constituer la
copie elle-même. – Cette lettre est trop intime, disait-il. –
C’est
précisément parce qu’elle est intime que je la garde. Il avait marqué
au crayon les passages qu’il pensait que l’on pouvait supprimer.
J’achetai une gomme exprès pour effacer son crayon. Il voulait
s’effacer. Je lui dis : Paraissez au contraire. Un homme qui ne se
propose plus que de se rappeler exactement, fidèlement, réellement sa
vie et de la représenter est, devient lui-même le meilleur des papiers,
le meilleur des monuments, le meilleur des témoins ; le meilleur des
textes ; il apporte infiniment plus que le meilleur des papiers ; il
est infiniment plus que le meilleur des papiers ; il apporte, à
infiniment près, le meilleur des témoignages. »
Charles
Péguy, Notre Jeunesse, page 29
S’il pouvait y avoir une démarche
vieille France au regard de Péguy, pour autant ils ont été des
communards authentiques, même s’il faudrait utiliser le mot de «
communeux ». Le terme "communard" fut employé par les assaillants
Versaillais pour déterminer qui était à exécuter sur le champ. 150 ans
après, ce vocable est peu usité, qui plus est, cela mériterait une
analyse plus précise des langages populaires de l’époque. A l'exemple de certains
termes comme ambulance, ou ambulancière, ils ne correspondent plus à l’usage
courant qui leurs sont attribués, au plus significatif, il faudrait
parler d’hôpitaux de campagne et d’aides soignant(e)s. Au fil du temps,
le terme communard est devenu le plus courant et avait bien évidemment
une autre résonance en 1871 dans la bouche des bouchers de Thiers.
L’intérêt est dans la partie aveugle de ces bourgeois engagés aux côtés
des ouvriers et des soldats parisiens face aux actes sanguinaires des
armées de Thiers, ce qui en fait un apport spécifique, rare, qui
mérite d’être connu. Plus qu’un simple témoignage, il faut y voir un
document historiographique
sortant de l’ordinaire, et comme nous sommes en présence de plusieurs
membres de deux familles. Et plus, avec des amis de la famille de
Monsieur
Félix Milliet et Madame Louise Milliet (née de Tucé), il importe de
pouvoir comprendre une histoire familiale propre et singulière. De
comment s’y mélange l’histoire et le combat pour une république sociale
et démocratique, un ensemble constitutif de leurs engagements
respectifs.
A commencer par celui qui a rédigé ce texte, qui fut lors de la
Commune un jeune lieutenant au sein des Fédérés, Jean-Paul Milliet,
peintre et historien d’art. Il a été le rédacteur d’une « Famille
de républicain(e)s fouriéristes ». Cette histoire fait de correspondances a
été publiée en onze volumes dans les Cahiers de la Quinzaine et le
premier texte est paru en 1910. Le dixième livre en 1911, pour ce qui
nous concerne, et il évoque des événements intimes et politiques propres à
la Commune de Paris, à travers une famille pas vraiment ordinaire. Ou
peut-être pas, une famille que l’on pourrait qualifier de très
politisée et partageant un idéal commun la République. Leurs
attachements à certains idéaux de Fourier trouvaient sa relation avec
ce
qu’ils nommaient la Colonie, située dans l’ancien département
de
l’Oise, l’on peut parler d’un phalanstère de petite taille, ou plus
exactement d’un
groupement de sociétaires, dont Louise Milliet a été
l’administratrice des lieux. La Colonie était composée en son sein d'une quinzaine de
familles dans les années 1860 (à ne pas confondre avec celui de Guise
dans l’Aisne bien plus imposant).
Félix Milliet, Louise de Tucé et leurs enfants
« Mon père, dont la
famille était originaire de Savoie, rappelait par ses traits le type
des anciens Allobroges (sic) : cheveux châtains, qui ne blanchirent
jamais, et grande moustache d'un blond roux. Sa taille était un peu
au-dessous de la moyenne ; son teint coloré et ses yeux gris
extrêmement vifs marquaient un tempérament à la fois sanguin et
nerveux. Son caractère primesautier était sensible, passionné,
bouillant, irascible, mais sans rancune, franc, loyal, affectueux et
bon. La probité lui était si naturelle qu'il ne concevait même pas la
possibilité de la moindre atteinte à la délicatesse. Son
désintéressement absolu et son dévouement à ses principes lui
attirèrent de nombreuses et durables sympathies. »
Paul
Milliet, Une
famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome I, la vie
familiale
Félix Milliet naquit en 1811 à Valence dans la Drôme, il
décéda en 1888
à Paris (5e). Devenu orphelin très tôt de ses parents, il fut pris en
charge par son oncle, directeur de la manufacture des armes de
Saint-Etienne. Jeune adulte, il se forma un temps au droit lors de ses
études universitaires, toutefois après 1830, il bifurqua et s’engageait
dans la cavalerie en se présentant à l’école de Saint-Cyr. Il passa de
sous-officier à capitaine des hussards, et fut amené à vivre dans
diverses garnisons : Pontivy, Alençon, Montoire. Il démissionna en 1844
depuis son cantonnement du Mans pour se consacrer à la poésie, à la
rédaction de chansons contestataires, dans lesquelles il s’affirma
comme un chansonnier en vogue, « à la manière de Béranger » et avec les
encouragements de celui-ci.
|
|
 |
Milliet père a connu un certain succès au
point d’alerter les autorités publiques sur ses convictions
républicaines, et passer pour un agitateur, si ce ne n'est pour un dangereux
conspirateur... Il manifesta ainsi son rejet viscéral de la tyrannie,
entre autres, dans le journal irrégulier, ou souvent saisi, le Bonhomme
Manceau, qui connut divers titres en raison de la censure. Il rédigea ainsi sa : « haine de
la
tyrannie, la pitié pour ceux qui souffrent, l’aspiration vers une
organisation plus équitable de la société, la foi dans un avenir de
paix et d’harmonie mondiale ». (2)
 |
|
Chanson de Félix Milliet
 |
Félix Milliet se revendiqua démocrate, socialiste, il fut un disciple de
Fourier, comme une bonne part de ses contacts, il a été surtout un
proche de Victor Considérant, ami de la famille. Tous les deux furent
des francs-maçons plutôt actifs, V. Considérant devint membre de
l’internationale en 1869 après son retour des Etats-Unis et a participé
à la Commune parisienne.
« Socialiste
convaincu, F. Milliet n'était pas partisan de la « guerre des classes
» (note : langage plus propre à G. Sorel). Pour lui, le peuple est
composé de tous les citoyens, riches et
pauvres, Français et étrangers. Déjà les haines de races (comprendre
entre nationalités ou nationaux) tendent à disparaître ;
l'internationalisme et le
pacifisme rendront de plus en plus rares les guerres de conquêtes, mais
non la guerre sociale entre patrons et ouvriers. Une répartition plus
équitable des richesses entre le capital, le travail et le talent, peut
seule arrêter cette lutte fratricide, aussi folle et aussi condamnable
que le chauvinisme d'autrefois. »
Paul
Milliet, Une famille de républicains fouriéristes : les Milliets.
Tome I, chansons
politiques, page 43
Plusieurs années auparavant Félix
et
Louise Milliet, cette dernière faillie engager sa dot pour un élevage de chevaux, au
désespoir de
sa mère. Le couple s’était trouvé associé à
son projet « utopiste », avec la création d’un phalanstère au Texas
(1852), qui périclita rapidement en quelques années. Cependant ils
restèrent en Europe, ne suivirent pas V. Considérant outre-Atlantique.
Les
époux Milliet devinrent sociétaires à parts égales dans le
couple, puis Alix, leur fille repris le flambeau du mouvement
phalanstérien, ainsi tous les trois se consacrèrent à ce qui n’a été
qu’un «
phalanstérion » (un petit phalanstère) de 37 hectares dans la forêt de
Rambouillet, appellé par les Milliet la « Céleste
Colonie », toujours
en activité à Condé-sur-Vesgre. A ne pas confondre avec l’imposant
familistère de Guise situé dans l’Aisne, la dite Colonie resta
à cet
égard plus modeste, en construction et nombre de propriétaires des
lieux.
« Notre ancien
collègue, le Dr Barbier, du Mans, avait pris une part non
moins active aux travaux de la Loge des Arts et Commerce et aux
campagnes de la presse républicaine. Le petit journal, qu'il rédigeait
avec F. Milliet et Silly, « Jacques Bonhomme », se réclamait de
l'immortel programme de « la Montagne », pour dénoncer les « prétentions
dynastiques et dictatoriales qui os[aient] menacer la
République. »
(…) Quant au sieur « Barbier Jacques-François. 40 ans,
médecin, rue de Bône, 1 », il était porté sur la liste des 36
citoyens
honorés des attentions du préfet Migneret, et observés par la police «
comme soupçonnés de donner l'impulsion et
d'être chefs de section dans
le parti socialiste ». Il fut de ceux qui, le 5 décembre
1851,
tinrent conseil chez Fameau pour décider d'une prise d'armes. Il était
trop tard. Le mouvement n'eut pas lieu ; mais Barbier n'en était pas
moins compromis. Placé d'abord sous la surveillance de la police, avec
interdiction de séjour dans la Sarthe, et menacé de pis, il put,
déguisé en prêtre, échapper aux sbires, et gagner Jersey. L'île était
pleine de réfugiés. Autour de V. Hugo, de Schoelcher, de Pierre Leroux,
de Vacquerie, gravitait un petit monde cosmopolite, d'ailleurs un peu
mêlé. »
Bulletin
de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, pages 440
et 441 (1911)
Quant à Félix Milliet établit dans
la ville du Mans, le chef-lieu de la Sarthe, plutôt ancré dans des
convictions républicaines fortes, il participa avec ses amis de
condition bourgeoise, comme le docteur Barbier que l’on vient de citer (son
fils Fernand sera l'époux de sa fille), en tant qu’orateur de la
loge maçonnique, il se fit remarquer comme activiste lors de la
révolution de 1848.
Milliet père a été l’auteur de chansons subversives
relayées par le groupement de « Propagande démocratique et sociale » en
1850. Après le coup d’état de Napoléon III du 2 décembre 1851, 250
sarthois républicains furent arrêtés, dans le groupe des accusés, Félix
Milliet. Il se vit bannir de France et envoyé à Nice. Mais il s’échappa
et prit l’exil depuis Valence pour la Suisse, où il résida et milita de
même pour ses convictions, avant de se voir expulsé pour son activisme
maçonnique et républicain, par le Conseil fédéral, sous la pression de
l’ambassadeur français.
|
|
Chanson de Félix Milliet
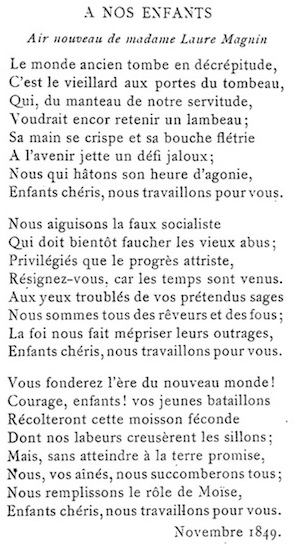
|
Puis il se rendit à Londres
un court temps
avant de rejoindre avec de faux papiers son épouse et ses enfants à
Samoëns en Savoie, pas encore française (ou pas avant 1860), sous
tutelle Piémontaise. De même, le temps de son exil, il a enseigné le
dessin dans un collège de Bonneville à partir de 1853, et il n'a pu
remettre les pieds à Genève qu'à partir de 1858.
Plus que probable, Félix et
Louise Milliet profitèrent de l’amnistie de
1859 pour revenir sur le territoire national, ce qui correspondit peu
ou prou vers 1860 à leur arrivée et installation dans la capitale
boulevard Saint-Michel avec la cadette, Louise, mais sans le fils aîné
Fernand, officier d’active était mobilisé en d’autres lieux ou
casernements. Entre-temps, la petite Jeanne était morte. Sa fille Alix
à
la même période allait se marier avec Henri Payen. Après les
épousailles, ils s’installèrent dans le 10e arrondissement (rue
Martel) rejoint par son frère Jean-Paul.
Lors du second siège et de la Commune de Paris en avril et mai 1871, le
père se trouvait à la « Colonie » dans l’Oise (l’ancien département,
aujourd’hui dans les Yvelines) où il passait sa retraite, après avoir
connu des ennuis de santé. Sinon il se consacra
à la peinture, au jardinage, et aux activités quotidiennes en tant que
sociétaire. Contrairement à Louise son épouse, une femme de
tempérament, qui a vécu les événements de la Commune jusque sous ses
fenêtres, non loin du Palais du Luxembourg. Elle tint un rôle pilier
auprès de ses trois derniers enfants au moment du décès d’Henri Payen
son beau-fils, le mari d’Alix, l’aîné Fernand lui était en Algérie.
Dans l’ensemble on peut parler d’une famille soudée et aimante.
Alix l’épistolière a laissé ainsi des archives manuscrites auxquelles
son frère Jean-Paul dans ses dernières années d’existence a su donner
une forme (plutôt contestée en matière d’authenticité). Après un
chapitre romancé sur un « mariage d’amour » dans le premier tome, celle
de ses parents, notre narrateur a laissé un court portrait de sa
génitrice en ces termes, et des dessins les représentants :
|
« Le
visage de ma mère
respirait à la fois la douceur et la fermeté. Ses yeux étaient d'un
bleu foncé, ses cheveux bruns, presque noirs, ses joues d'une fraîcheur
éblouissante, des bandeaux plats encadraient l'ovale très pur de son
visage. Ses belles mains ressemblaient à celles de la Joconde, dont
elles avaient souvent la pose. La noblesse naturelle de ses manières,
le charme de son sourire, et la finesse de ses traits justifiaient
pleinement une réputation de beauté dont elle ne semblait pas se
douter. Elle attachait plus de prix au renom que lui méritaient son
intelligence, sa droiture et son inépuisable bonté. »
Paul Milliet, Une
famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome I, la vie
familiale
|
|
 |
Louise Milliet née de Tucé, en
1822, au Mans, fut entre autres, directrice des Ménages sociétaires
et
membre de l’Ecole sociétaire, et décéda à Paris en 1893. Félix
à 28 ans épousa
Louise à Montoire-sur-Loir (Loir-et-Cher), en 1839, alors âgée de 18
ans et ils eurent ensembles cinq enfants :
- Fernand, l’aîné,
naissait au Mans en août 1840, militaire de
carrière, il s’engagea aux côtés de Garibaldi à l’âge de 17 ans, il
épousa Euphémie Barbier en 1872 à Amné (Sarthe), qui fut la fille du
docteur Barbier, ancien combattant de lutte de son paternel, cité plus
haut et mort en 1867, Fernand mourut en avril 1885.
- Alix naquit en 1842 au Mans,
ambulancière pendant la Commune, artiste
plasticienne et membre ou sociétaire de la Colonie. Elle fut l’épouse
et la veuve d’Henri Payen, sergent de la garde nationale de mars à
mai 1871, il en fut de même lors d’un second mariage avec un nouveau
veuvage, Alix décéda en 1903 à Paris, et a tenu une place singulière
dans le phalanstère de Condé-sur-Vesgre (3), comme sa mère
administratrice.
- Jean-Paul ou Paul vit jour en
1844 au Mans, peintre, archéologue,
historien d’Art, il décéda en 1918 dans la capitale, il prit en charge
la mémoire familiale en tant qu’auteur d’une famille de
républicains
fouriéristes – Les Milliet, en deux tomes (1915-1916), des
parutions
sorties à l’origine dans les Cahiers de la Quinzaine en onze
volumes
entre 1910 et 1911.
- Jeanne née en 1848, décéda
précocement en 1854.
- Louise, la cadette ou Louizon,
ou bien l’américaine naquit en 1854,
elle a été la mère de deux enfants avec Paul Hubert (1852-1922) son
mari,
elle décéda en 1929.
Il importe de préciser que Félix
Milliet n’exerçait pas un ordre
patriarcal, comme il pouvait être courant,
au sens de la seule autorité admise dans l’espace familial. Ce qui
avait depuis le code Napoléon fait des femmes des mineures, et sous
l'autorité du seul père ou du mari. Pire, ce que l’on nomme une
domination
sexiste, une situation vécue par la majorité du genre féminin, sous le
coup d'une oppression certaine. Mais en ce domaine, Félix fut un homme
plutôt en avance sur son temps,
ouvert à la libre expression des femmes, à leur émancipation dans la
société.
Des idéaux contraires aux thèses phallocratiques de Joseph
Proudhon, et une des particularités de Charles Fourier fut d'avoir été
un acteur en faveur de la libération des femmes des carcans moraux de
son époque. Ce qui faisait que ce type d’engagements pouvaient
être perçus pour des moeurs extravagants, voire dissolus, et être
l’objet
des commérages sur les questions de sexualité, le sujet tabou par
excellence. Plus simplement parce certains fouriéristes furent en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, avec des mœurs qui
ne correspondaient pas à la morale
ambiante sur les saints sacrements du mariage… et ils pouvaient même
prôner
l’union libre.
Et cet enjeu sur l’égalité des deux sexes avait aussi créé une césure au sein
de la fédération française de l’Internationale
avec les partisans de Proudhon, sur cette question spécifique. Ceci
en opposition aux autres mouvances minoritaires, dont les prises de
position d’Eugène Varlin (adhérent à l'Internationale en 1867), ou
d’autres internationalistes sur le sujet
des femmes, qui soutenaient leur participation pleine à la vie publique
et à l’action politique.
A la lecture des courriers de sa femme, Louise Milliet, il s’y affirme
une autorité très marquée et pas une conjointe soumise au paternalisme
ambiant. Elle a eu des engagements, de même au sein de l’Ecole
sociétaire, et a tenu une place motrice comme détentrice de parts de la
Colonie.
Pour anecdote, Alix (en dessin), fait part dans ses
courriers de son
inquiétude de se faire gronder par sa mère, pour sa participation aux
soins donnés aux Fédérés. Les deux filles ont eu plutôt loisir de vivre
comme elles l’entendaient, au même titre que les deux garçons, mais
dans le cadre d’une famille bourgeoise, avec toutefois ses propres
conventions, faut-il préciser. Félix à ce sujet manifesta pour sa
dernière fille certaines volontés, comme ne reconnaître qu’un mariage
civil, mais a pu préciser qu’il ne s’opposerait pas aux choix des
futurs époux. Toutefois, le prétendant rompit et il n’y a pas eu de
suites à cette histoire de mariage, sauf une réponse sèche de rupture.
Alix
représentée par Paul
|
|
 |
Lettre de Félix
Milliet à M. Beaumetz : « Notre fille est maîtresse de ses actions, de
ses affections encore plus, — et nous croyons qu'elle les a bien
placées dans la circonstance présente. — C'est à elle de s'entendre
avec vous au sujet de la question en litige. Quelle que soit votre
détermination, j'y souscris pour mon compte. Mais votre liberté ne
saurait en rien enchaîner la mienne. Je viens donc vous dire simplement
que, reconnaissant le mariage civil comme seul valable, et
n'appartenant à aucune religion, je ne ferai jamais un acte religieux
pouvant impliquer contradiction et donner un démenti à mes opinions
bien connues et hautement exprimées. J'ai personnellement beaucoup de
sympathie pour vous, cher Monsieur, aussi soyez bien persuadé que, de
quelque façon que se termine le petit démêlé entre vous et ma fille,
vous n'aurez en moi qu'un homme ami et, tout naturellement, Bien à
vous, Félix »
Nous sommes loin d’une famille
ouvrière, pour autant, leur mode de vie est intéressant. Leurs
convictions furent souvent mises à l’épreuve, même si elles n’entraient
pas dans le cadre du communeux (ou communard), que l’on peut envisager
dans une démarche plus combative ou contestataire. Avec leurs mots, les
uns et les autres expriment des critiques sur le cours des événements
politiques, militaires, sociaux, etc., que l’on peut partager ou pas,
mais sans se désolidariser du mouvement. Ce qui ne fut pas négligeable.
Artisan bijoutier,
Henri Payen a
vécu au sein d’une famille qui vivait
du négoce de l’orfèvrerie, l’époux d’Alix fut le plus proche du
Parisien moyen les armes en main, mais l’on en sait assez peu sur lui.
Les courriers d’Alix des années 1860 n’apportent que des détails sur
ses premières appréhensions maritales et les liens qui se sont tissés
au fil des années avec cet homme de condition sociale moins importante,
un artisan à son compte et travaillant pour la fabrique de son père. A
sa disparition à la suite de ses blessures le 30 mai 1871, Alix allait
supporter en plus du deuil des problèmes financiers, ce n’était pas non
plus l’opulence de la très grande bourgeoisie. Après la disparition
d’Henri, le journaliste du Rappel et républicain Edouard
Lockroy fut un
moment envisagé comme possible nouvel époux d’Alix ; après une distance
prise, il n’en fut rien, il fit le choix d’une autre union. Dans les
années 1880, un nouveau mariage se solda par un nouveau veuvage.
|
|
 |
Sinon Paris a parfois des airs d’un petit monde où beaucoup se
connaissaient, la fermentation des idées depuis le 4 septembre 1870
avait pu souder un camp républicain radicalisé par les dérives du
pouvoir, néanmoins un camp très hétéroclite, au moment des combats
décisifs en arme ou pas. Dans les espaces fortifiés souvent en ruines,
de nombreuses femmes cantinières et ambulancières agirent avec les
moyens du bord, et pour certaines comme la courageuse Alix aux avants-postes.
La
Commune de Paris n’a pas été uniforme, au contraire, cet apport
d’une famille bourgeoise, plutôt rentière et socialiste permet de
saisir une part de sa complexité avec la présence de ce courant de
pensée se réclamant de Fourier. Cependant, les différents courriers
familiaux
sont révélateurs d’un état d’esprit assez commun, sur les
incendies et la destruction de la colonne Vendôme, ou bien
l’arrestation des généraux Chanzy et de Langorian, mais pas dans les
termes de la propagande Versaillaise et encore moins de son côté.
Avec un regard propre et une
place à prendre en considération dans les événements, Alix fut
certainement la plus intrépide et la plus valeureuse, hormis Henri
Payen lors du second siège en uniforme et au front. A son poste
d’ambulancière, Alix Payen-Milliet par ses lettres apporte des
informations riches
sur le conditions de vie des soldats, les siennes, et leurs
comportements d’hommes du peuple, aussi sur les bombardements, sur le
caractère de quelques-uns, dont le pitre de service (un chanoine), et bien sûr sur
son mari Henri, un sergent apprécié par ses soldats.
| Il n’est pas simple du coup de comprendre avant le
chapitre sur
Delbrouck l’implication et la position de Jean-Paul au printemps 1871,
sauf qu’il fut obligé de prendre l’exil par la suite, et à son tour
attendre l’amnistie à la fin des années 1870. Lieutenant, il officia
aux côtés de Louis-Joseph Delbrouck (en desssin), architecte, membre de
l’internationale, avec la particularité d’être tous les deux pacifistes
et
sans armes, ils ont eu durant le second siège la charge des missions
pour le Génie et de colmater les brèches des défenses. Comme sur les
remparts de Vanves ou de Passy, quand Delbrouck fut arrêté et fait prisonnier. Peu
de temps après il décédait (juillet 1871). Voilà de manière brève
l’attitude de
Jean-Paul Milliet face à la guerre : |
|
 |
« Pacifiste en
théorie, j'aurais voulu atténuer à mes propres yeux la contradiction
apparente entre mes principes et mes actes. — Je ne suis pas de ceux
qui se résignent facilement à être illogiques. — J'ai la satisfaction
de n'avoir point tué de ma main; je n'ai pas tiré un coup de fusil et
je n'ai pourfendu personne. Cependant, il faut l'avouer, la distinction
est subtile entre la légitime défense et l'attaque meurtrière. Les
embrasures que nous construisions pour les canons, les tranchées
derrière lesquelles s'abritaient les tirailleurs, nous rendaient
complices d'odieuses mais nécessaires boucheries ».
Paul
Milliet, Une famille de républicains fouriéristes : les Milliets. Tome
II, Delbrouck.
Paul Milliet a été le « biographe
» d’une saga familiale, plus exactement le narrateur d’un monde qu’il
enjoliva et a pu prendre certaines distances avec les faits de 1848 et
d'autres aspects. Il
peut sembler très en retrait dans cette histoire familiale au moment de
la Commune. Du moins, nous n’apprenons pas grand-chose sur sa
participation, autre que dans l’ombre de Delbrouck, ce qui confirme sa
discrétion, une modestie qui enthousiasma dans un premier temps Charles
Péguy. Mais qui s’avéra un échec éditorial, un stock d’invendu en
retour sur les bras, ce qu’il ne précisa pas.
| Au final, notre narrateur, Paul, se fit imprimer à compte
d’auteur,
mais n’obtint pas plus de succès. Ce sont les écrits d’Alix qui ont
retenu l’attention de Michèle Audin : « Alix Payen a peu
attiré
l’attention des historiens. Pourtant, elle a participé à la lutte avec
courage et détermination, et elle a décrit avec sensibilité les combats
violents, souvent furieux – et la vie du bataillon sous les obus.
»
Cette somme fut sortie de son oubli par l’ancien et défunt éditeur
François Maspéro dans les années 1970, et il reste aussi des archives
sur Félix Milliet et les autres membres de la famille, notamment au
Mans, et a été édité l’an dernier sur l’héroïsme d’Alix Payen née
Milliet : « C’est la nuit surtout que le combat devient furieux » de
Michèle Audin (éditions Libertalia, 2020) et auteure deux autres
ouvrages sur la Commune : La Semaine sanglante et Eugène
Varlin chez le
même éditeur. |
|
 |
Faut-il prendre le texte de Paul Milliet sur la Commune pour un récit?
une série de témoignage? ou une page d’histoires concordantes? ou bien
une esthétique allant au-delà d’une simple histoire familiale? Il est
très probable que Jean-Paul Milliet fut avant tout un esthète. La
création plastique a été son domaine de prédilection. Et son œuvre ne
peut se résumer à ces derniers exposés sur sa famille. Mais l’on
remarque que le dessin, la peinture, la sculpture et le collage ont
tout autant de place que l’histoire sociale et politique des Milliet.
Sans parler de la place de l’écrit et des chansons du père. S’il ne
s’agit pas d’une famille d’artiste à proprement parler, Félix
réalisateur du kiosque à musique à la Colonie, donne le là d’un intérêt
significatf aux Arts à partie égale avec la politique et l’engagement
en
collectivité sous formes diverses, tout comme Charles Fourier et ses
disciples.
C’est
pourquoi il vaut mieux éviter de chercher à les classer, que
Charles Fourier ait été un précurseur intellectuel, un fil conducteur,
il n’y a pas doutes, mais le combat républicain prédomina et a pu ne
pas correspondre à tous les vœux de son initiateur. Et en ce début de
1871
rien n’était joué. La menace bonapartiste et principalement royaliste,
les dits Ruraux, ou la majorité des élus du corps législatif,
n’avaient
pas pour objectif l’existence même d’une république démocratique et
sociale. Le combat oublié de ces communalistes et fédérés qui voulurent
prendre en main leur destin, les mena pour beaucoup à la mort, en
prison ou à l’exil, sinon à se taire et entrer en clandestinité. Même
si cette famille fouriériste n’a été qu’un épiphénomène dans des
réalités politiques bien plus complexes, c’est néanmoins utile pour
comprendre leurs différentes participations ou la présence de disciples
de Charles Fourier dans l’événement communal et l’insurrection du 18
mars 1871. Une composante sociale et politique qui a souvent été
ignorée, volontairement ou pas.
| Pour autant, Jean-Paul Milliet (en photo) a pu s’égarer
dans son récit et au sein de ses
différents livres. S’il il lui a pris
quelques fantaisies, la question
du plaisir et de les alterner ont été des utopies sociales de Fourier
(qui conservent quelques charmes…). Son livre édité par Péguy met en
avant
des lettres en relation avec le quotidien de la
Commune, c’est là tout son intérêt, et il permet de découvrir le rôle
d’Alix épouse d’Henri Payen, à ses côtés, et d’autres figures… Comme
Louis-Joseph
Delbrouck, coopérateur, polytechnicien et architecte municipal, un des
chapitres de
ce livre, qui au détour des courriers fait référence à certains
personnages comme le colonel Lisbonne, Delescluze, Frankel, Flourens,
etc. Rien de si exceptionnel dans la réalité des
faits, en toute limite, il faudrait parler de courriers
apocryphes, sur lesquels, il faut s’interroger sur la fiabilité, sans
pour autant négliger un texte cohérent, bien sourcé, compréhensible par
le
plus grand nombre. Son contenu vaut le détour, à prendre au mieux comme
un témoignage avec
ses failles ou ses manques. |
|
 |
Le fouriérisme et ses
projets utopistes?
A la recherche d’un ordre parfait…? c’est un peu tout le drame de cet
homme qui reste à découvrir, et si je n’avais pas rencontré la famille
Milliet, je n’aurais pas envisagé d’en savoir plus sur le père
tutélaire des phalanstères. Il n’est pas simple de fait de résumer
l’existence d’un génie en lutte contre les réalités implacables de son
propre monde, qui a dû faire face à un réel abrupt, ne lui laissant
qu’une belle fuite pour exprimer des talents.
Charles Fourier naquit à
Besançon en 1772, fils d’un drapier décédé en 1781, il connut un
héritage, dont il ne profita guère, que son père léguât sous des
observances
très strictes, avec un contrat en trois clauses, pour ses 20, 25 et 30
ans. Il ne respecta que la première exigence, travailler dans le
commerce, mais refusa toute idée de mariage et conçu en dehors de ses
activités professionnelles un édifice conceptuel très étrange.
On pourrait parler d’un homme en colère, il a détesté le commerce pour
son absence de morale, a préconisé la disparition de l’argent, de la
pauvreté dans le cadre de ses théories sociales qui visaient, ni plus,
ni moins, à changer les bases des sociétés humaines, à
révolutionner le vivre en commun, sans chercher à constituer une classe
sociale contre une autre.
Trois de ses oeuvres sont à citer :
- Théorie des quatre
mouvements (1808)
- Traité de l'association
domestique agricole (1822)
- Nouveau monde industriel et
sociétaire (1829)
«
La Théorie des Quatre Mouvements ne rencontra aucun succès, et
personne ne prêta attention aux idées de l'auteur, à son analyse des
passions comme à sa métaphysique. (...) Le Nouveau Monde industriel
et sociétaire,
qui lui avait coûté beaucoup d'efforts, est le plus méthodique de ses
ouvrages, celui auquel ses disciples eurent davantage recours pour leur
propagande. Les journaux et les revues du temps en parlèrent un peu,
presque tous ironiquement, il est vrai. Fourier, encouragé, se remit
alors à la recherche d'un candidat, c'est-à-dire d'un individu assez
riche pour faire les frais d'une première expérience. Que demandait-il
à un pareil homme? Dans le sommaire du Traité de l'Association,
il définissait ainsi les qualités de ce commanditaire à venir : « Tout
ambitieux honorable. Il n'en faut qu'un seul qui soit tenté de devenir
le premier homme du monde : il n'aura même pas besoin d'une grande
fortune ; s'il possède 10.000 francs, il peut créer la colonie de
fondation. N'y prit-il que pour 10.000 francs d'actions, il peut se
réserver le titre de fondateur. Il est assuré de voir, après deux mois
d'exercice, les peuples et les monarques le porter aux nues, de faire
tomber à plat l'orgueilleuse civilisation, prouver qu'elle n'a jamais
eu la moindre connaissance en garantie sociale ou action composée, pas
même sur la garantie primordiale, celle du travail et de la subsistance.
»
Maurice
Harmel, Portraits d'hier, Charles Fourier, pages 173 et 174
(1910)
François-Marie, Charles Fourier (en peinture) dans sa
jeunesse s’était juré de bannir le négoce de
toute l’humanité, bien qu’il ait été une partie de sa vie dans les
affaires commerciales (vente et comptabilité). Il a de plus vécu dans
une famille commerçante de longue date, ce qui a nourri ses premières
aversions aux entourloupes qui étaient exercées sur la taille des
tissus. Ce fut personnage très moral et obsédé par l’ordre, et comme
tout a été toujours un peu contradictoire chez lui, on lui connaît une
vie libertine, mais aucune relation amoureuse durable à mentionner.
Pareillement,
ami de Brillat-Savarin, il se passionna pour la gastronomie, de même
préconisa la Gastrosophie ou l’art de se nourrir en cultivant
et
cuisinant ses propres produits du jardin à l’assiette, ou à l’usage des
conserves, mais il refusait certains aliments qui ne lui semblaient pas
dignes de son estomac, comme les macaronis et la cuisine anglaise.
|
|
|
Confronté
à une affaire de spéculation à laquelle il participa à
Marseille, le fait d’avoir balancé une cargaison de riz à même le port,
pour ne pas voir le prix baisser de la céréale, lui provoqua une
immense révolte. Face à un phénomène récurant, il s’emporta plus d’une
fois. Il a très
mal vécu la Révolution française pour ses violences, pendant laquelle
il perdit l’ensemble de ses investissements lors des émeutes de Lyon en
1793 et fut par la suite incarcéré. Comme il a détesté la guerre, bien
qu’il ait
voulu un court temps s’engager dans l’armée, puis se consacrer au
clergé, pour qui il a nourri aussi un rejet, il n’en fit rien. Faute de
pouvoir accéder à ses propres désirs, ou selon ses propres volontés, il
allait connaître une bonne partie de sa vie des hauts, puis des bas, et
une vie plutôt retirée, ce
fut assez tardivement qu’il commença à faire connaître ses idées et
susciter de l’intérêt auprès des générations des années 1820 et
1830.
Charles Fourier a développé des idées pour un système universel dont
l’harmonie lui servit de métronome, il a ainsi dérouté de nombreux de
ses contemporains, au point de passer pour une personne dérangée, voire
à provoquer l’hilarité de ses interlocuteurs, pendant que lui
continuait sans sourciller ses explications. Certains le prirent pour
un homme incapable de rire, on peut présumer qu’en présence d’autres
personnes inconnues ou peu réceptives, il devait avoir un comportement
plutôt rigidifié. Il fut un solitaire en raison de sa grande timidité.
Comme il peut encore surprendre, en raison des originalités de son
œuvre et une volonté un tant soit peu maniaque de tout classifier,
selon des suites de série, et cet intérêt qu’il a eu pour les
mathématiques. Tout ce qu’il voulait était passionnel et au prix de cet
entendement, ce grand amateur de musique, tout devait être absolument
harmonieux. Et si l’on peut résumer, pour retenir les choses
essentielles, il s’est intéressé à l’écologie et à l’agriculture, à
l’urbanisme, à l’architecture, etc., et a été le promoteur d’une
organisation
très ficelée de la vie collective en phalanstère. Une idée qui va
donner lieu à plusieurs expériences dans la longue histoire des
utopies, Thomas More avec son livre Utopia en 1516 est le
créateur de ce terme. L'utopie était pour Rabelais un pays
imaginaire. Le vocable u-topia peut signifier en grec ancien : n'être
en aucun lieu.
Fourier a échafaudé diverses théories sociales, il est à considérer
comme un des premiers théoriciens socialistes, que Marx et Engels
avaient épinglé dans le Manifeste avec d’autres comme des
socialistes,
bourgeois et utopistes. Il est préférable, même si les qualificatifs ne
sont pas faux, de parler de socialisme primitif, ne nous renvoyant pas
aux âges des cavernes…, mais à la première moitié du XIXe siècle. Le
fouriérisme, qui plus est improbable en dehors de groupes de
sociétaires libres de leurs opinions, et, surtout souverains dans leurs
décisions. Le fouriérisme fut donc une branche du socialisme avec
diverses ramifications tout au long de ce siècle, et qui a touché en
particulier des milieux de la petite et de la moyenne bourgeoisie,
notamment en 1848, dans les fiefs citadins républicains. Beaucoup
d’idées, rarement abouties dans leurs dimensions communautaires,
l’idéal d’un monde nouveau
dans leurs cœurs. Les passions et raisons se
bousculèrent, mais ne purent pas toujours faire leur cheminement vers
des réussites accomplies, les dominations ne furent pas que sociales,
mais des réalités interindividuelles difficilement contournables et
sujettes aux dissensions.
Les
théories sociales parfois farfelues et les idéaux communautaires,
plus exactement sociétaires de Fourier sont tombés dans une certaine
désuétude, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient totalement oubliés,
mais que dire sur ces premiers socialistes, ou ce qui émergea, après la
restauration monarchistes de 1815? Saint-Simon autre figure du
socialisme primitif et de ses doctrines progressistes, en apparence le
plus connu, a eu un de ses disciples, Prosper
Enfantin, qui suivit l'influence de Fourier, il se trouva lui
aussi
porteur d’un projet phalanstérien.
Les "socialistes" des
premiers âges sont rarement cités ou mis à la connaissance du public,
comme un certain Just Muiron, qui a été un des premiers à se
laisser porter par cette œuvre en
partie visionnaire, qui aurait pu passer aux oubliettes. Flora Tristan
alla consulter Charles Fourier après son retour du Pérou, Pierre Leroux
s’en inspira ;
et Victor Considérant (en dessin, 1808-1893) fut celui qui dirigea à la
suite de son mentor le périodique La Phalange, journal de la science sociale
(publié à partir de 1832, et n'a rien de militaire). Dans les années
1850, V. Considérant
embarqua plusieurs centaines de personnes dans son aventure texane, et
a
été
la dernière grande figure connue du mouvement sociétaire.
|
|
 |
Il y avait quelque chose de religieux dans la démarche de Fourier, un
retour au premier christianisme, bien qu’anti-clérical, il se fondit
dans une mystique, croyant pouvoir changer le cours des choses et
apporter sur terre un message universel, qui ne pouvait qu’insuffler
une
transformation profonde. En
quelque sorte permettre l’avènement du
paradis sur terre..., dans l’ensemble, il en est resté des expériences
collectives, novatrices, mais pour beaucoup sans lendemain. S’il a pu
exercer une certaine autorité intellectuelle à partir de 1825, après la
mort de Saint-Simon, et au-delà de son décès en 1837 ; notre
personnage plus que singulier a su faire partager dans les milieux
républicains et révolutionnaires ses idées pas vraiment conformistes.
Sans grille ou distinction sociale, au titre d’une prophétie par le
biais de la propagande, qui devait aider à cette victoire d’un autre
ou monde nouveau,
et en finir avec l'ancien.
Selon ses espérances, nous allions être tous producteurs et
consommateurs du fruit de notre travail à part égal, non pas tout à
fait, le mérite devait être pris en considération sans chercher à
appauvrir les moins méritants. Il visait l’existence de multiples
communautés organisées en commune de 400 à 500 familles, ce qui devait
donner les moyens à tous de vivre dans le bonheur et une jouissance
certaine, au titre de plaisirs à renouveler pour en décupler sa nature,
et c’est ainsi que fut élaboré un nouveau mode d’habitation. Sous la
même bâtisse, logements, commerces, salles communes, et lieux de
loisirs ou de cultures, comme un théâtre, une salle de danse, etc, et
notamment un très grand réfectoire, les repas devaient se prendre
ensemble. Je vous renvoie à la lecture en annexe sur le Phalanstère de
Fourier expliqué par Victor Considérant.
Incontestablement son œuvre a donné matière à une mouvance politique
socialiste et républicaine sans recherche d’une forme partisane autre
que faire école, et à
ouvert une sensibilité philosophique en rien fixiste, par certains
côtés libertaire. Il faut aussi retenir un travail de mathématicien,
sur lequel je ne peux apporter de grands éléments, sauf pour Fourier
d’avoir connu une frustration notable, de n’avoir pouvoir pu exercer
ses plus fortes capacités dans le champ des abstractions mathématiques
(4). Son parcours personnel est
assez atypique en des périodes plutôt agitées. Il en va de même avec
tous ces socialistes qualifiés d’utopistes, il est impossible de le
construire d’un seul ensemble, et l’invention du mot « socialisme »
serait imputable à Pierre Leroux (mort en 1871). Quand il est surtout
question de pluralisme des opinions, et des influences d’une pensée
évolutive tout au long du siècle, souligner que les dits socialistes
utopistes ou premiers ont été idéologiquement composites, en France
comme ailleurs. Avec la mort de Victor Considérant, la dernière grande
figure républicaine et fouriériste en 1893, se tournait une page, déjà
presque oubliée par ses contemporains, celle du fouriérisme militant
qui rejetait l’ordre social établi pour inventer un monde nouveau.
Au sujet de « L’École
sociétaire : Les disciples de Fourier
récusaient le qualificatif de fouriéristes car ils ne souhaitaient pas
se réclamer d’un homme mais d’une science, la science sociale. Ils ne
voulaient pas non plus créer un parti politique. La plupart d’entre eux
étaient hostiles à cette forme d’organisation. C’est pourquoi ils
créèrent, dès les années 1830, l’Ecole sociétaire. Cette structure
avait pour but la publication des œuvres de Fourier, l’étude de la
doctrine, mais aussi la vulgarisation de ses théories. C’était une
organisation dont les principaux outils furent la propagande orale par
les conférences, la propagande écrite par les livres, les brochures et
les journaux, puis la propagande par la réalisation pratique. »
Nathalie
Brémand (2009). Les premiers socialismes - Bib.
virtuelle de l’Université de Poitiers
Il faut noter que seuls trois
projets de natures fouriéristes
virent le jour au XIXe siècle dans l’hexagone : la colonie de
Condé-sur-Vesgre (1833), le Familistère de Guise (à l’initiative de M.
Godin, riche industriel, de 1857 à 1969) et la Maison Rurale d’enfants
pour
l’expérimentation sociétaire de Ry (de M. Adolphe Jouanne, 1864 à
1882). En dehors de la France, il faut y ajouter une expérience
agricole en Algérie et les échecs patents d’Etienne Cabet et des
Icariens aux Etats-Unis, puis celui de Victor Considérant. Les projets
utopistes élargis à leurs autres dimensions sociales et politiques ont
en général disparu comme neige au soleil, à part la Colonie et
de
Guise, des modèles qui ont survécus depuis tant bien que mal.
Ces entreprises humaines sur des projets en collectivités autarciques
ont eu une très forte tendance à s’enliser dans des querelles
intestines et interindividuelles, et le phénomène a été bien plus large
à l’échelle du globe, et bien plus ancien. Ces projets à caractère
utopiques finirent mal en général, comme les histoires d’amour (sic).
Penser à l’échelle de 300 à 500 familles comme le familistère de
Guise, soit environ 1800 à 2000 hommes, femmes et enfants, la taille
plus modeste de la Colonie
de Condé-sur-Vesgre, bien qu’elle voulue
s’agrandir, l’échelle des membres resta modeste, et l’endroit n’a connu
que très tardivement les commodités du confort : sans chauffage, l'eau
des canalisations gelaient en hiver et le frigo tarda. Cette première
expérience fut inspirée et conçue par Charles Fourier, mais pas jusqu’à
sa finalité architecturale et agricole, car sur des terres sur des
terres
sablonneuses, peu propices aux cultures vivrières, et un manque de
moyens financiers pour mener à bien l’entreprise. Ce qui advint vers
1860 une Société Civile Immobilière (SCI), elle se composa d’une petite
vingtaine de familles sociétaires dans la forêt de Rambouillet. Cette
forme juridique a possiblement évité que l’expérience ne s’essouffle
trop rapidement ; mais c’est une simple survivance et lointaine du
projet initial.
Les
Milliet, père, mère, et leur fille Alix y ont exercé leurs talents, il
n’était pas possible d’échapper à des éclaircissements sur ce génie
bizarre et ses ambitions, et finalement très attachant pour comprendre
comment
cette famille a été de plein fouet dans l’histoire de la Commune aux
côtés des communeux. Les découvrir ainsi des acteurs ou observateurs
peu connus de ce court moment révolutionnaire, échappant aux trames
habituelles, délivre une fraîcheur plutôt la bienvenue, dans
ce torrent de nouvelles sur front de guerre civile. Tout n’a pas été
conduit sous la volonté impérieuse d’une dialectique matérialiste et
historique, et l’on a probablement minoré des pensées et des idées
ingénieuses.
Il se peut, que je n’aie pas fait suffisamment état que Fourier et ses
disciples, ils ont été aussi des féministes primitifs, ou en ce domaine
des
avant-gardistes en comparaison à d’autres familles socialisantes, qui
ont plus discouru que misent en pratique les idées en leur sein. Même
si l’émancipation des femmes a souvent été indissociable de ce
socialisme primitif et de ses suites, cette prise en considération du
rôle
moteur a resurgi dans les années 1970 et ouvrit à des chemins
régénérateurs dans une société alors profondément enracinée dans le
patriarcat.
Nota bene : Il a été rajouté au livre 10,
La Commune et le second siège de Paris de Paul Milliet au sein des Cahiers
de la Quinzaine, une lettre d'Alix Payen de son deuxième
tome et une de Fernand n'a pas été éditée. Sinon il a été rajouté un
chapitre supplémentaire, pour épilogue, du tome II qui dispose d'un 12ème livre non édité par
Péguy, avec l'annonce du 16 mai1877 - La
République était sauvée et définitivement fondée -fait
principalement d'échange des courriers avec
sa mère, et son retour en France.
|
Notes
du texte :
Vous pouvez consulter le site de la biblothèque virtuelle de
l'université de Poitiers, sur les premiers socialismes, ainsi que le
dictionnaire biographique du mouvement social : Le MAITRON
(voir les liens sur les personnes).
1 - Une famille de républicains fouriéristes
: Les Milliet, de Paul Milliet (Tome
1 & tome 2)
2 - Site
de l'association des études fouriéristes et des Cahiers de Charles
Fourier
3 - Louise et Alix Milliet : « Deux colones engagées » (Pdf), Danielle
Duizabo (2012)
4 - Quand un professeur de mathématique raconte Charles Fourier à sa
fille - Grenoble - Institut Fourier (vidéo
de 8 minutes)
|
|
|
|
|
| La Commune et le second siège de Paris (1871)
|

Photo de M. Leibet - Ruines du Fort d'Issy vues du nord
|
Chapitre I : -
Les ruraux. - Premières manifestations. - Les canons de
la Garde nationale. - Le Comité Central. - Le 18 mars, proclamation de
la Commune. - Les droits de Paris. - Sortie du 3 avril. - Mort de
Flourens. - Premiers succès de Dombrowski. - Réformes : L’Assistance
publique, les Finances, le Travail, la Fédération des artistes,
l’Enseignement. - Les délégués à la Guerre.
L’Assemblée de Bordeaux fut élue sous l’œil des Prussiens, alors que la
province mal informée et trop crédule ajoutait foi aux calomnies des
monarchistes. Ceux-ci représentaient les Parisiens comme des
fanfarons et des traîtres, qui avaient voulu livrer la ville dès le 31
Octobre. A Paris, au contraire, on croyait la province animée de
l’ardent patriotisme que Gambetta avait cherché à lui inspirer ; on la
supposait prête à tous les sacrifices pour continuer la
lutte.
Le 8 février 1871, ayant à nommer 43 députés, nous avions porté en tête
de liste : Garibaldi, Victor Hugo, Louis Blanc, Gambetta, Dorian,
Delescluze, Clemenceau, Littré, Raspail, Edgar Quinet... Mais, parmi
les membres du Gouvernement de la Défense, bien peu furent réélus par
les Parisiens, qui les avaient vus à l’œuvre.
L’aberration des ruraux semble aujourd’hui inconcevable ; ils nommèrent
Trochu, d’Aurelle et leurs pareils. Évidemment ils ne les
connaissaient pas.
Trois cent cinquante députés républicains, résolus à continuer la
guerre, furent envoyés à l’Assemblée, contre quatre cents
réactionnaires, qui avaient promis d’y mettre fin. Et pourtant, même
parmi les électeurs les plus affamés de paix, bien peu avaient eu
l’intention d’appeler au pouvoir un empereur ou un roi.
Bonapartistes et royalistes coalisés allaient profiter de ce malentendu
pour essayer de renverser la République.
Ils étaient dupes des mots ces républicains
modérés qui crurent
défendre le suffrage universel, en s’alliant aux partisans du pouvoir
héréditaire. Comme si une génération avait jamais le droit de lier
par
ses engagements les générations futures.
Par son empressement à accepter toutes les conditions du vainqueur,
l’Assemblée de Bordeaux manifesta. Il semble que les ruraux eussent
perdu la notion de l’honneur. A qui fera-t-on croire qu’un pays
comme la France aurait pu être subjugué, si la nation tout entière
s’était soulevée dans un élan unanime d’indignation patriotique?
Émasculés par une longue servitude, et n’ayant plus d’autre idéal
qu’entasser des écus, des lâches ont voulu la paix à tout prix, la paix
honteuse. Ce sont là des dures vérités qu’il faut dire.
La haine contre Paris se traduisit aussitôt par d’insolentes
provocations. Pour gouverneur on nous envoya Vinoy, complice du coup
d’État de décembre (1851), signataire de la capitulation. Et qui
va-t-on nous imposer comme général en chef de la garde nationale? —
D’Aurelle de Paladine, le dévot et pusillanime bonapartiste que
Gambetta avait trop tardivement destitué!
A Paris, l’indignation était extrême et légitime : « Les membres
n’obéissent plus au cerveau, disait-on. C’est une tête qui pense sur un
cadavre. » (1)
La centralisation, si favorable au despotisme, avait tué la vie en
province. Aucune grande ville n’était libre de gérer ses propres
affaires. A ce mal, les Parisiens proposaient un remède :
remplacer un gouvernement centralisé à l’excès par les libres
fédérations de communes autonomes, à l’imitation des cantons
suisses. La capitale ne prétendait nullement imposer aux autres
villes son organisation municipale, elle ne voulait que donner
l’exemple de progrès immédiatement réalisables.
« Paris qu’on accuse de gouverner la France, a toujours été serf de la
France. Paris fait les révolutions, mais la province fait les
gouvernements. Les révolutions durent trois jours ou trois mois ; les
gouvernements durent vingt ans. — Paris fait les journées de juillet
1830 ; la province se livre aux d’Orléans et maintient Louis-Philippe
pendant dix-huit années. — Paris fait le 24 février et les journées de
juin 1848 ; la province lui envoie ses Falloux et Louis-Napoléon
Bonaparte. — Pendant vingt années, Paris vote contre l’Empire,
et pendant vingt ans la province consacre l’Empire par la
nomination des candidats officiels et deux plébiscites dont on connaît
les écrasantes majorités. — Paris fait le 4 septembre et proclame une
seconde fois la République ; la province nomme l’Assemblée de Bordeaux
qui affirme son intention de rétablir la monarchie. — Paris
endure la famine et donne son sang pour sauver l’honneur de la France
et l’intégrité du territoire national ; la province vote la paix, cinq
milliards d’indemnité aux Prussiens, la cession de l’Alsace et de la
Lorraine. » (2)
Si
les ruraux veulent un roi, qu’ils le prennent, nous n’en voulons pas.
Ainsi, après avoir combattu les ennemis de la France, nous allions
avoir à combattre les ennemis de la République.
Lorsqu’il eut à donner son opinion sur les actes de la Commune, Louis
Blanc vieilli, qui n’avait rien compris à ce mouvement et s’en était
séparé, lui rendit pourtant une justice tardive : « Il ne faut
pas confondre les révolutions qu’enfantent l’ambition, la colère, la
cupidité, les passions envieuses d’un ou de plusieurs hommes, avec les
révolutions qui sont des évolutions, et qui naissent du développement
historique de la vie sociale, contrarié par des pouvoirs aveugles ou
tyranniques ; les premières méritent toute réprobation, mais il
n’en est pas de même des secondes. Quant à celles-ci, il est vrai
qu’elles apportent, hélas ! avec elles trop souvent un mélange de bien
et de mal, mais leurs effets s’expliquent par leurs causes ;
l’intensité des maux qu’elles produisent, se mesure à la gravité des
abus qui les rendirent inévitables, et lorsque au prix de
souffrances passagères, une révolution met au monde une vérité
libératrice, il est aussi vain de s’en plaindre, qu’il le serait de
maudire cette loi de la nature qui associe les douleurs de
l’enfantement à l’entrée d’un homme dans la vie. » (3)
Louis Blanc a raison : c’est grâce à la Commune que certaines réformes
fécondes sont parvenues à maturité. Cette révolution fut à la
fois politique et sociale.
2
Jules Favre avait solennellement promis que la France ne céderait « pas
un pouce de son territoire, pas une pierre de ses forteresses » ;
— et notre chère Alsace était livrée à l’ennemi, avec Metz et une
partie de la Lorraine.
Ducrot avait juré de ne rentrer dans Paris que « mort ou victorieux ».
— Beau serment, oublié dès le lendemain.
Trochu, énergique en paroles, avait dit : « Le Gouverneur de Paris ne
capitulera pas. » — Puis, jésuitiquement, il avait chargé Vinoy de
signer à sa place une reddition que son inertie coupable avait
préparée. Partout l’incapacité, partout le mensonge.
Comment le peuple, tant de fois trompé, aurait-il pu faire confiance au
cauteleux diplomate qui se résignait de si mauvaise grâce à maintenir
ce louche régime qu’il appelait « une République sans républicains »?
Pouvions-nous oublier ces massacres de la rue Transnonain dont Thiers
le Cruel avait taché son casier judiciaire? Joyeux, il flairait déjà la
Semaine sanglante.
Paris avait supporté le froid, la faim, les privations de toutes
sortes, les obus... Une seule consolation lui restait : la République,
espoir de justice sociale. Comment ne se serait-il pas défié de cet
homme auquel il faisait peur et dont il se sentait détesté?
Trop de paroles avaient été mensongères ; il ne croyait plus qu’aux
actes. Or, Thiers s’efforçait de désarmer la garde nationale, la
République était en danger.
Ce désarmement, ni Jules Favre, ni même Bismarck n’avaient osé
l’ordonner. Dès qu’il fut question de permettre aux Prussiens d’entrer
dans l’enceinte, spontanément, cinquante mille hommes se portèrent en
armes à leur rencontre : « Ce mouvement d’indiscipline et de fierté »
était d’autant plus beau que les forts étaient déjà occupés par les
Prussiens et que leurs canons étaient braqués sur la ville. Les
Parisiens se seraient sacrifiés si le salut de la France avait pu être
acheté à ce prix : « Plutôt Moscou que Sedan », répétait-on
partout, (4)
Sur la place de la Concorde, les majestueuses statues de pierre qui
personnifient les principales villes de France, avaient été voilées de
longs crêpes noirs, poétique symbole du deuil profond de la
patrie.
Les manifestations commencèrent le 24 février sur la place de la
Bastille. Le soir, la colonne était illuminée et les bataillons
défilaient tout autour, apportant des couronnes d’immortelles qui
venaient décorer le monument depuis la base jusqu’au faîte. Les plis
flottants du drapeau rouge enveloppaient le flambeau du Génie d’or si
hardiment lancé dans le ciel. Plus bas on lisait en lettres énormes : «
Vive la République universelle ! »
Ce cri était prématuré, mais il aura son heure. Des discours enflammés,
tout pleins d’illusions généreuses, furent prononcés. Qui n’eût été ému
de voir ce peuple indomptable oublier ses longues souffrances et les
détresses de l’odieux présent, dans une vision prophétique de
l’avenir?
« A cet instant même où l’Allemagne lui faisait une guerre de race, où
Guillaume et ses agents ne cachaient pas le désir et l’espoir
d’anéantir la France, que pensaient ces Français, que disaient ces
Parisiens? — Ils proclamaient la Fédération des peuples! En réponse aux
obus de Bismarck, ils offraient à l’Allemagne la Liberté, la
Fraternité! Sous le feu des canons Krupp, braqués contre la grande cité
révolutionnaire, ils confessaient la Solidarité humaine! »
(5)
En attendant, un conseil de guerre jugeait les accusés du 31 Octobre.
Flourens, Blanqui et plusieurs autres furent condamnés à
mort.
Ancien représentant de Paris, Victor Considérant publia le 20 avril une
adresse aux Parisiens. Il espérait nous faire sortir de cette situation
terrible et proposait une paix fondée « sur le caractère libre et
juridique de toute société, de toute coopération » ; il réclamait,
lui aussi, « l’autonomie absolue des communes urbaines et des
cantons-communes ». Il faisait même le rêve d’étendre un jour cette
paix « absolue, européenne, définitive... par la Confédération
juridique de tous les Peuple unis ».
3
Le 28 février, les Parisiens s’aperçurent avec indignation que, par une
impardonnable négligence, le gouvernement avait abandonné les canons de
la garde nationale, près de la place Wagram, dans la zone accordée à
l’occupation des Allemands, (6) Sans attendre les ordres officiels,
chaque bataillon se rendit au parc et enleva les pièces qui lui
appartenaient. Les femmes s’attelèrent aux canons, escortées par les
gardes nationaux en armes. Un officier à cheval sur la pièce,
tenait le drapeau déployé. (7)
« C’était vraiment un spectacle grandiose et rappelant les plus beaux
jours d’enthousiasme de la première Révolution. Un certain nombre de
marins et de soldats, gagnés par la fièvre générale, se joignirent à
ces cortèges. »
« Paris n’avait plus de gouvernement. Les hommes de l’Hôtel de Ville
étaient partis à Bordeaux. L’armée était sans armes. Aucune police dans
les rues. La Commune existait déjà de fait. Paris, livré à lui-même,
vivait de sa vie propre. Il y avait bien, quelque part, un général de
décembre, nommé Vinoy, mais sans autorité ; personne ne s’en occupait.
» (8)
Dans les faubourgs, ou était résolu à recevoir les Prussiens à coups de
fusil. Heureusement, les chefs, comprenant l’impossibilité de la
résistance, s’employèrent à calmer les esprits. Ils chargèrent les
gardes nationaux de former un cordon autour des quartiers concédés à la
courte occupation de l’ennemi. C’est en leur remettant à eux-mêmes le
soin de se contenir, que l’on empêcha les violences redoutables de leur
désespoir.
Se rendant compte de cette effervescence, les maires conseillaient avec
sagesse de laisser provisoirement à la garde nationale son artillerie.
Les généraux eux-mêmes appuyaient cette proposition, et la guerre
civile aurait pu être évitée. Mais Thiers, aveugle et obstiné, donna à
l’armée l’ordre d’aller reprendre de vive force les
canons.
4
Le 18 mars, les soldats de ligne chargés de cette opération
fraternisaient avec le peuple, et Paris se couvrait de barricades.
Place Vendôme, le général Vinoy, avec quatre mille hommes, se repliait
devant quelques centaines d’insurgés.
Moins prudent, le général Lecomte commande une décharge sur la foule,
mais ses soldats le renversent à coups de crosse ; il est livré aux
gardes nationaux qui l’emmènent prisonnier. Clément Thomas, vieillard à
barbe blanche, que son amitié pour Trochu avait rendu impopulaire,
allait de groupe en groupe d’un air affairé. « II est reconnu, il est
saisi et jeté dans le même corps de garde que le général Lecomte... Les
malheureux, conduits dans un jardin, furent cotés contre la muraille et
tombèrent foudroyés, l’ex-général en chef de la garde nationale par dix
balles de gardes nationaux, le général Lecomte par les balles de ses
soldats. (9)
Thiers et le gouvernement tout entier furent affolés de terreur, les
forts furent abandonnés et, si le Comité central se fût
immédiatement emparé du Mont-Valérien, la victoire lui eût peut-être
été assurée. C’est dans de pareilles circonstances que la promptitude
de coup d’œil décide du succès. La panique gagna deux ou trois cent
mille citoyens. Thiers se crut fort habile en donnant à tous les
fonctionnaires l’ordre de venir le rejoindre à Versailles. La «
capitale décapitalisée » se trouva privée subitement de toute
administration. Funeste et irréparable bévue. Thiers ne connaissait pas
les ressources de l’esprit parisien.
La rapidité avec laquelle tous les services municipaux furent
réorganisés tient du prodige. (10) Pas un jour de retard dans le
paiement de la solde des troupes !
Élu par deux cent quinze bataillons de la garde nationale, le Comité
central se trouvait être le seul gouvernement de Paris. Dans un
manifeste, il repoussa les injustes accusations portées contre lui. Ce
pouvoir, il ne l’avait pas cherché, on le lui avait imposé ; il
promettait de le céder immédiatement à la Commune dont il allait hâter
l’élection. Que n’a-t-il tenu sa promesse !
18 mars. — « Derrière un cercueil lui vient de la gare d’Orléans
(devenue depuis Austerlitz), un vieillard, tète nue, que suit un long
cortège ; Victor Hugo mène au Père-Lachaise le corps de son fils
Charles. Les Fédérés présentent les armes et entrouvrent la barricade
pour laisser passer la gloire et la mort. » (11)
5
Les maires et les députés de Paris ne surent malheureusement se mettre
d’accord ni entre eux ni avec le Comité central. Les uns,
comprenant la nécessité urgente d’élire un nouveau Conseil municipal,
estimaient que le peuple de Paris avait 1e droit de se convoquer
lui-même et de fixer la date du vote. Les autres, esclaves d’une
légalité stricte qui n’était guère de saison, voulaient attendre qu’une
convocation régulière des électeurs eût été faite par l’Assemblée. Ils
n’avaient pas fait tant de façons le 4 Septembre.
J’accompagnais le capitaine Delbrouck lorsque, le 19 mars, il se rendit
à la mairie de Montmartre pour s’entendre à ce sujet avec Clemenceau.
Le jeune maire, dont l’autorité était déjà grande, se montra très
irrité des meurtres accomplis la veille. Et, en effet, ces exécutions
sommaires allaient servir de prétexte à d’abominables représailles.
Malgré les efforts de Babick et de quelques autres, le Comité central
ne les désavoua pas assez hautement et refusa d’en rechercher les
auteurs.
Lorsque, le 23 mars, les maires de Paris se présentèrent devant
l’Assemblée, la gauche se leva en signe de respect pour ces hommes qui
représentaient une ville de deux millions d’âmes. Mais comme aux cris
de « Vive la France! », les maires répondaient : « Vive la
République! », les ruraux furieux leur refusèrent la parole : « A
l’ordre! à l’ordre! criaient-ils, faites-les évacuer! » — Le
tumulte augmente, les députés de la droite se retirent entraînant ceux
des centres et avec eux le Président et les membres du gouvernement,
(12)
Cependant, dans la séance de nuit, la majorité, comprenant la grave
responsabilité qui allait peser sur elle, approuvait de « très
bien » les excuses présentées en son nom. Les propositions
conciliatrices n’en furent pas moins renvoyées aux bureaux,
c’est-à-dire enterrées.
L’Assemblée de Versailles prétendait s’immiscer comme au temps de
l’Empire dans nos affaires municipales. Paris défendit ses droits. On
ne saurait méconnaître la justice de ses revendications. Comment, les
pauvres gens qui avaient bravement combattu pendant le siège,
auraient-ils pu économiser sur leur maigre solde le prix de leur loyer?
Ne fallait-il pas imposer aux propriétaires un léger sacrifice et
accorder tout au moins aux locataires un délai? Les commerçants
demandaient aussi la prorogation des échéances et la révision
nécessaire d’une loi dite « des cent mille Faillites », parce qu’elle
eût fait de tous les négociants parisiens autant de
banqueroutiers.
La ligue « d’Union républicaine des droits de Paris » fut fondée
par les députés Ranc, Clemenceau, Floquet, Lockroy, Corbon,
Laurent Pichat. Son manifeste du 5 avril réclamait : la reconnaissance
officielle de la République ; puis pour la capitale, la libre gestion
de ses affaires municipales, de ses finances, de l’assistance
publique, de l’enseignement primaire. Un conseil élu organiserait la
garde nationale et la police urbaine. (13)
6
En désorganisant tous les services, Thiers avait contraint les
Parisiens à s’emparer du gouvernement. En attaquant nos forts, il
obligea la garde nationale à les défendre. Toutefois les Fédérés
commirent une imprudence folle lorsque, sans ordre de la Commune et
contre l’avis formel de la Commission exécutive, ils tentèrent un coup
de main sur Versailles. S’imaginant peut-être que les soldats
mettraient la crosse en l’air comme à Montmartre, ils sortirent de
Paris le 3 avril.
Avant le jour, sous la conduite de Bergeret, six mille hommes et huit
bouches à feu se dirigeaient vers le pont de Neuilly, aux cris de : « A
Versailles! » — « Les bataillons gravissaient gaiement le
plateau des Bergères, quand un obus tombe dans les rangs, puis un
second. Le Mont-Valérien a tiré. » (14)
Le commandant du fort avait promis à Luillier (15) de rester neutre et
de laisser passer les Parisiens. Les Fédérés crièrent à la trahison et,
s'éparpillant à la débandade, rentrèrent dans Paris.
« L'armée avait fait un grand nombre de prisonniers du côté de
Châtillon. L'officier commença par faire sortir des rangs tous les
soldats qu’on put trouver parmi les insurgés. Fusillés. Puis la colonne
continua sa route. Au petit Bicêtre, on rencontra le général
Vinoy. Il fit arrêter la colonne : « Y a-t-il des chefs? » —
Duval sortit des rangs avec deux officiers d’état-major. « Vous
savez ce qui vous attend, qu’on fasse former le peloton. » Les trois
officiers fédérés sautent un fossé, s'adossent à une maisonnette et
tombent en criant : « Vive la Commune ! »
Le général Le Flô, ministre de la guerre, dit à un membre de
l’Assemblée : et ils sont morts comme de bons bougres. »
(16)
Thiers n’en écrivit pas moins à l’archevêque de Paris pris comme otage
: « Jamais nos soldats n’ont fusillé les prisonniers. » Et Vinoy
dans son livre raconte que « leur chef, le nommé Duval, est mort
pendant l’affaire ».
Cependant, par la route d’Asnières, Flourens s’avançait avec un millier
d’hommes dans la direction de Rueil. Dix mille fantassins et deux
brigades de cavalerie envoyés contre eux les mirent en déroute.
Flourens essaya vainement de rallier ses troupes... Abandonné par
elles, il ne se résignait pas à se retirer. (17)
Il descendit de cheval et suivit tristement le rivage de la Seine, ne
répondant pas à Cipriani, son ancien camarade en Crète, jeune et
vaillant Italien prêt à toutes les nobles causes et qui le conjurait de
se réserver. Las et découragé, Flourens se coucha sur la berge et
s’endormit. Cipriani avisa une maisonnette ; Flourens l’y suivit,
déposa son sabre et se jeta sur le lit. Un individu envoyé en
reconnaissance les dénonça et une quarantaine de gendarmes cernèrent la
maison. Cipriani veut se défendre, il est assommé. Flourens reconnu à
une dépêche trouvée sur lui, est conduit sur le bord de la Seine où il
se tient debout, tête nue, bras croisés. Un capitaine de gendarmerie,
Desmarets, accourt à cheval, hurle : « C’est vous, Flourens, qui
tirez sur mes gendarmes! » et se redressant sur les étriers, lui
fend le crâne d’un coup de sabre furieux. « Cipriani, encore vivant,
fut jeté avec le mort dans un petit
tombereau de fumier et roulé à Versailles. Ainsi finit ce bon chevalier
errant que la Révolution aima. »
Saluons, même quand ils se trompent, ceux qui savent mourir pour une
idée.
Les généraux Eudes et Duval durent aussi se retirer devant des forces
supérieures. Des gardes nationaux étaient cernés « Rendez-vous, vous
aurez la vie sauve », leur fait dire le général Pellé. Ils se
rendent. « Aussitôt les Versaillais saisissent les soldats qui
combattaient dans les rangs fédérés et les fusillent. Les autres
prisonniers sont acheminés sur Versailles. Leurs officiers, tête nue,
les galons arrachés, marchent en tête du convoi. »
(18)
De nombreux chefs furent fusillés sans jugement, ce qui porta à son
comble l'exaspération des Parisiens.
La Commune lit à ses défenseurs de solennelles funérailles : « Trois
catafalques, contenant chacun trente-cinq cercueils, enveloppés de
voiles noirs, pavoisés de drapeaux rouges, traînés par huit
chevaux, roulèrent lentement, annoncés par les clairons et les Vengeurs
de Paris, Delescluze et cinq membres de la Commune, l’écharpe rouge,
tête nue, menaient le deuil. Derrière eux, les parents des
victimes, les veuves d’aujourd’hui soutenues par celles de demain. Des
milliers et des milliers, d’immortelle à la boutonnière, silencieux,
marchaient au pas des tambours voilés. Quelque musique sourde
éclatait par intervalles comme l’explosion involontaire d’une douleur
trop contenue.
Des femmes sanglotaient, beaucoup défaillirent. Delescluze s’écriait :
« Quel admirable peuple! Diront-ils encore que nous sommes une bande de
factieux! » Au Père-Lachaise, il s’avança sur la fosse commune. Les
cruelles épreuves de la prison de Vincennes avaient brisé son enveloppe
si frôle. Ridé, voûté, maintenu seulement par sa foi indomptable, ce
moribond salua ces morts : « Justice, disait-il, justice pour la grande
ville, qui, après cinq mois de siège, trahie par son gouvernement,
tient encore dans ses mains l’avenir de l’humanité... Ne pleurons pas
nos frères tombés héroïquement, mais jurons de continuer leur œuvre et
de sauver la Liberté, la Commune, la République. » Rien n’était
noble comme ce vieillard altéré de justice, dévoué au peuple sans
phrases et malgré tout. » (19)
Le 6 avril, les Versaillais s’avancèrent jusqu’à l’ancien parc de
Neuilly. Bergeret qui s’était fait fort de conserver cette
position fut remplacé par Dombrowski, officier polonais dont Garibaldi
avait apprécié la valeur à l’armée des Vosges. Delescluze et
Vaillant firent accepter le nouveau général. — « Les Fédérés de Neuilly
virent un jeune homme, de petite taille, à l’uniforme modeste, (20)
inspecter les avant-postes, au pas, sous la fusillade. Au lieu de
la furia française, d’entrain et d’éclat, la bravoure froide et comme
inconsciente du Slave. En quelques heures, le nouveau chef eut conquis
son monde. L’officier se révéla bientôt.
Le 9, pendant la nuit, avec deux bataillons de Montmartre, Dombrowski,
accompagné de Vermorel, surprit les Versaillais dans Asnières, les en
chassa, s’empara de leurs pièces ; puis, du chemin de fer, avec
les wagons blindés, il canonna de flanc Courbevoie et le pont de
Neuilly. Son frère enleva le château de Bécon qui commande la route
d’Asnières. Vinoy ayant voulu reprendre cette position dans la nuit du
12, ses hommes repoussés s’enfuirent jusqu’à Courbevoie. »
(21)
L'énergie de la garde nationale pendant le second siège de Paris, dans
cette lutte follement disproportionnée, est la réfutation la plus
éclatante des reproches dédaigneux de Trochu et de Vinoy, la preuve
d’un courage que des chefs incapables n’avaient pas su employer contre
les envahisseurs. Mais c’est étrangement intervertir les rôles et
fausser la vérité que de rejeter sur Paris la responsabilité du sang
versé. En Russie, quand les prisonniers politiques sont injustement
maltraités, ils se laissent mourir de faim, et, comme leurs geôliers
sont des hommes, ils sont pris de pitié. Ce sentiment-là était inconnu
aux ennemis de la République.
7
Une des mesures les plus odieuses dont Thiers porte la responsabilité,
ce fut la désorganisation de l’Assistance. (22) La situation des
indigents était exceptionnellement dure, et Treilhard, nommé directeur
par la Commune, eut une lourde tâche. Il s’en acquitta avec
conscience et probité, et s’efforça de réorganiser promptement les
services. Le personnel de l’hôpital Beaujon fut
laïcisé.
La Commune répartit ses travaux entre neuf commissions et délégua l’un
de ses membres dans chacune d’elles. (23) Ces neuf délégués réunis
constituaient la Commission exécutive. Les réformes sont
mûres à Paris trente ans avant d’avoir germé en province. Une longue
séparation ne pouvait qu’accentuer les divergences entre le pays et sa
capitale. — La Commune a commis bien des erreurs et bien des fautes, la
discorde l’a empêchée de formuler et de réaliser un programme
d’ensemble cohérent, mais son action n’est pas restée stérile :
quelques-unes de ses décisions, prématurées alors, ont passé depuis
dans la pratique :
Dès le 2 avril, la Commune décréta la séparation des Églises et de
l’État, la suppression du budget des cultes, la confiscation comme
propriétés nationales des biens des congrégations. D’autres
réformes montraient aussi un esprit excellent :
Le
cumul des fonctions fut interdit. Le maximum des traitements fut fixé à
6.000 francs. Le serment politique fut aboli. Certains actes, tels que
testaments, donations entre vifs,
reconnaissances d’enfants naturels, adoptions, contrats de mariage,
etc..., devaient être dressés gratuitement par les officiers
publics.
Simple sergent, je ne me suis trouvé en relations personnelles avec
aucun des membres de la Commune ; mais je sais pourtant et
j’affirme que la plupart d’entre eux furent d’une probité
scrupuleuse, pleins de courage, de dévouement et doués d’une
remarquable intelligence.
Je citerai seulement quelques exemples :
- Camelinat, ouvrier bronzier, délégué à l’Hôtel des Monnaies, se
montra à la hauteur de sa tâche. (24)
- Aux Postes, Theisz, ouvrier ciseleur, trouva moyen de rétablir en
partie les communications avec la province.
« Mais Jourde les dépasse tous par sa lucidité calme de bon comptable.
Il veille avec exactitude aux rentrées légitimes et force les
Compagnies de Chemins de fer à verser leurs arriérés d’impôts, en tout
deux millions. Il n’a que des rapports légaux avec l’oligarchie
financière et conserve intacts les 214 millions de titres trouvés
au ministère des Finances. » (25)
La Banque de France, qui avait en caisse plus de trois milliards, avait
été imprudemment abandonnée par le gouvernement. Beslay, nommé
commissaire délégué, parvint à la protéger contre Raoul Rigault. Dans
sa déposition à la Commission d’enquête, M. de Ploiuc reconnut que «
sans le concours de Beslay, la Banque de France n’existerait pas ».
(26)
Quelques-uns des membres de l’Internationale résistèrent avec succès
aux mesures violentes proposées par le Comité central ; Frankel,
délégué à la Commission du Travail, de l’Industrie et des Échanges,
commença l’organisation des associations coopératives ouvrières. Son
but était l’émancipation des travailleurs par les travailleurs
eux-mêmes. Un local fut mis à la disposition des Chambres syndicales.
Le 20 avril, il fit interdire le travail de nuit des boulangers.
D’accord avec Malon, il proposa d’avoir recours aux associations
ouvrières pour la confection des vêtements
militaires. Il fixa un minimum de salaire pour le travail à la journée
ou à façon. Les circonstances ne lui permirent pas de réduire
comme il l’aurait voulu la journée à huit heures. Dans les ateliers du
Louvre, où l’on réparait et transformait les armes, ce fut la journée
de dix heures qui fut adoptée. Le directeur et les chefs d’atelier
étaient élus par leurs ouvriers. Partout Frankel chercha à remplacer
l’autorité despotique irresponsable des patrons ou de l’administration
par l’autonomie des ouvriers organisés en syndicats. (27)
Frankel s’occupa aussi, avec Vaillant, de développer l’enseignement
professionnel. Le 13 mai, une école d’art industriel pour les jeunes
filles fut ouverte rue Dupuytren.
Vaillant, ingénieur et médecin, délégué à l’Enseignement, fit appel aux
initiatives corporatives. Les cours de l’École de Médecine étaient
suspendus ; il demanda aux docteurs, aux professeurs libres et
aux étudiants de désigner des délégués, afin d’élaborer un
nouveau programme. (28) Il s’associa à l’action de la Fédération
des artistes qui, sous la présidence de Courbet, s’occupa de la
conservation des Musées. L’École des Beaux-Arts avait assurément besoin
de réformes, mais je crois que Vaillant se trompa, lorsqu’il
proposa de supprimer le budget de cette école. Un enseignement
supérieur est la condition nécessaire d’un bon enseignement secondaire
ou pratique.
Une Commission examina les titres des candidats à renseignement du
dessin.
Pour l’enseignement primaire, Vaillant organisa à l’École Turgot des
réunions d’instituteurs et d’institutrices qui, d’accord avec les
parents, devaient étudier les programmes et les méthodes.
Il eût voulu fournir aux écoles les ressources nécessaires pour
résoudre le problème de l’instruction laïque, gratuite et obligatoire,
(29) et assurer aux instituteurs un traitement en rapport avec leurs
importantes fonctions.
Tous ces vœux n’ont été jusqu’ici qu’imparfaitement réalisés. Déjà
l’école du 20ème arrondissement habillait et nourrissait les enfants,
fondant ainsi ces Caisses des écoles qui rendent aujourd’hui de si
grands services et qui sont appelées à en rendre de plus
grands encore dans l’avenir.
A la Bibliothèque Nationale, J. Vincent, administrateur incapable, fut
remplacé par mon savant ami, Élie Reclus. Ce choix était
excellent.
Dans un moment où l’on ne songeait guère à se divertir, Vaillant
comprit l’importance éducative des fêtes publiques. — Quant aux
théâtres, il voulait supprimer les subventions qui créent des
privilèges, et remplacer les directeurs officiellement imposés par de
libres associations entre les acteurs.
8
La Commune fut moins heureuse dans le choix des délégués à la Guerre.
Elle avait supprimé le titre de général en chef, mais en un pareil
moment, l’unité de direction était une nécessité. Cluseret, officier de
carrière en France et aux Etats-Unis, essaya de réorganiser les
compagnies de marche, et plaça la plupart des Fédérés sous les ordres
du colonel La Cécilia, après avoir fait arrêter « l’incapable et
prétentieux » Bergeret.
La rapidité avec laquelle l’armée de Versailles fut formée prouva
que Gambetta avait raison, et que la lutte aurait pu être
continuée contre les Prussiens. Le Flô, ministre de la guerre, n’avait
d’abord que 40.000 soldats, mais il est vrai, avec la permission de
Bismarck, qui lui rendit 60.000 prisonniers, il réunit très
promptement 130.000 hommes bien armés, munis de vivres et de tout le
matériel de siège, (30) Ces troupes furent mises sous les ordres des
généraux Mac-Mahon, Vinoy, Cissey, Ladmirault, Douay, Clinchant et
Ducrot, tous monarchistes, haïssant la capitale républicaine et «
détestant une population pleine de mépris pour leur incapacité ».
(31)
Les plus absurdes légendes ont été répandues sur les hommes de la
Commune par des gens que la peur et la haine aveuglaient : A les en
croire, la garde nationale n’aurait été qu’un ramassis de malfaiteurs :
12.000 selon M. Claude, chef de la Sûreté, 35.000 selon d’Aurelle
; sans compter 8.000 repris de justice que la Commune
aurait fait venir de province! Ces invraisemblables mensonges ont été
forgés pour excuser des actes de cruauté qui, eux, ne furent que trop
réels. La Commune fut élue par deux cent trente mille voix.
(32)
Les Allemands avaient gardé les forts de l'Est et du Nord. Les Fédérés
occupaient les forts d’Ivry, de Bicêtre, de Montrouge, de Vanves et
d’Issy ; les villages de Neuilly, Asnières et Saint-Ouen.
Les effectifs de la garde nationale étaient considérables sur le
papier, mais la fuite d’un grand nombre d’officiers avait désorganisé
les bataillons. Il y eut des membres de la Commune qui respectaient
assez la liberté de conscience pour n’imposer à personne de prendre
part à une guerre civile.
Le décret qui rendait le service obligatoire souleva de vives et
légitimes protestations. Le Rappel écrivait : « Une guerre entre
citoyens est une guerre entre opinions. Au fond de celle-ci, il y a le
duel de la Monarchie et de la République. Mais comment forcer les
Français à tuer des Français? Si celui que vous enrôlez est
monarchiste, vous feriez ce que fait le gouvernement de Versailles en
contraignant les républicains des départements à marcher contre
Paris..., ce que faisaient les Prussiens, lorsqu’ils obligeaient les
paysans français à travailler à leurs tranchées. En guerre étrangère,
il faut la levée en masse ; mais en guerre civile il ne faut que
des volontaires. »
Ce principe fut bien moins respecté par Thiers que par la Commune. Il
fit fusiller impitoyablement tous les soldats qui refusèrent de marcher
contre leurs frères de Paris. — Je me souviens que dans notre compagnie
se trouvait un jeune Breton très silencieux, mais très consciencieux et
très brave. Dès le début de la Commune, il nous avoua franchement qu'il
était catholique et royaliste. — « Allez donc à Versailles » lui
répondis-je, et il partit.
Comme pendant le premier siège, ce qui manqua à Paris, ce fut l’unité
dans la direction supérieure des opérations. Je ne sais même pas si un
homme de génie serait parvenu à triompher des envieux, des
calomniateurs, et à se faire obéir. La garde nationale ayant choisi ses
chefs, se sentait libre de révoquer à toute heure ceux qu’elle avait
élus. De simples soldats tiennent toujours grand compte à un officier
de son indulgence, de sa bonne humeur, de son affabilité ; ils ne
peuvent juger de son savoir et ils n’aiment pas la sévérité,
fût-elle juste et nécessaire. Ils devinent le courage et l’énergie,
mais « l’entrain et l'élan ne suffisent pas pour donner aux
mouvements des troupes cette cohérence et cette unité de
direction qui, seule, assure la victoire ». (33)
Après la sortie désordonnée de Bergeret, de Flourens, d’Eudes et de
Duval, on avait senti la nécessité de nommer directement les officiers
supérieurs et de concentrer le commandement ; mais Cluseret ne fut
délégué à la guerre que du 3 avril au 28 ; Rossel donna sa
démission onze jours après sa nomination ; Delescluze ne le remplaça
que pendant quelques jours et céda la direction militaire à
Billioray.
Aucun de ces chefs ne fut à l’abri des dénonciations jalouses qui
paralysèrent toute action. M. Bourgin semble avoir eu raison d’écrire
que Félix Pyat et le Comité central furent, au point de vue militaire,
« les mauvais génies de la Commune ».
ANNEXE AU CHAPITRE PREMIER
« Cluseret était grand ; il avait peut-être quarante ans, le teint
blanc, les cheveux et la barbe noirs, une figure bellâtre. Son écriture
est très nette, sa rédaction beaucoup moins ; ce qui dément les
analystes qui prétendent juger l’homme sur son écriture. Le caractère
de Cluseret manquait surtout de netteté, et son esprit de décision...
C’était peut-être un bon et intelligent capitaine d’infanterie... Jeune
homme distingué, il était devenu un homme médiocre... Délégué à la
guerre, il n’a pas su vouloir, ni continuer ce qu’une fois il avait
voulu ; il n’a pas su se soumettre au rôle secondaire que lui donnait
l’inintelligence de la Commune ; il n’a pas su non plus le secouer...
Cluseret allait au feu très carrément. Il n’a pas mis l’uniforme une
seule fois ; il marchait devant, en chapeau rond et en veston, et
on le suivait... Il n’a pas su choisir les hommes ; tous ceux
qu’il a favorisés étaient des médiocrités parfaites. Roselli, son chef
de génie et le colonel Mayer ont été les plus désastreusement médiocres
de tous. » (Rossel, Papiers posthumes, page 205).
Flourens avait 32 ans. Il était fils du secrétaire perpétuel de
l’Académie des Sciences, qu’il suppléa dans son cours du Collège de
France en 1863. L’année suivante les Cléricaux lui firent refuser
l’autorisation de reprendre son enseignement. Il donna des conférences
à Bruxelles, écrivit des articles dans les journaux républicains et la
Rive Gauche. En 1865, il est à Constantinople où son cours de langue
française obtient un grand succès, (34)
Sous ce litre « l’Orient, justice pour tous », il écrivit dans le
Courrier de Constantinople une série d’articles destinés à amener la
fraternisation entre les diverses races orientales. Il fonda le journal
l’Etoile d'Orient, que le gouvernent turc ne tarda pas à supprimer.
— A Athènes, il fut persécuté par le gouvernement grec, pour
avoir voulu, selon la loi, parler en plein air. En 1866 il prit part à
l’insurrection crétoise.
Pendant une année, au milieu de ces braves montagnards, il souffrit la
faim, le froid, toutes les fatigues et tous les dangers d’une guerre
insurrectionnelle, couchant dans la neige et se nourrissant de racines
et d’herbes sauvages bouillies. Il envoyait des correspondances aux
journaux d’Europe, afin d’intéresser les esprits à la cause de
l’indépendance crétoise, et soutenait les espérances des insurgés. En
1868, des élections ayant été faites en Grèce pour le parlement
hellénique, la Crète, qui voulait s’y faire représenter, envoya
une députation dont Flourens fut nommé président. A Athènes, il
fut arrêté de nuit et jeté sur un paquebot qui le ramena à Marseille. A
peine en liberté, il retourna à Athènes et là, caché, continua une
polémique violente contre le ministère Bulgaris. Obligé de partir
pour Naples, il fut incarcéré par le gouvernement italien
pour un article paru dans le Popolo d'italia. De retour en France en
1869, il fut condamné à trois mois de prison pour avoir continué deux
réunions à Belleville, malgré la dissolution prononcée par le
commissaire de police. Ayant fini sa peine au mois d’août, il se
battit en duel avec Paul de Cassagnac qui, dans le Pays, avait
violemment attaqué les orateurs des réunions publiques. Après 26
minutes d’assaut, il fut blessé d’un coup d’épée en pleine poitrine.
Quand Victor Noir fut assassiné par le prince Bonaparte, Flourens et
Rochefort conduisaient le cortège et avaient le commandement de la
journée. Flourens voulait marcher contre la police, mais le peuple
désarmé eût été mitraillé. Rochefort eut le bon sens de mener le
cercueil au cimetière de Neuilly.
Impliqué par la police impériale dans le Complot des bombes, Flourens
fut condamné par la Haute-Cour de Blois aux travaux forcés à
perpétuité. — Rentré en France au 4 septembre, il commanda les
bataillons de Belleville. Trochu lui donna par dérision le titre de
major de rempart, ne voulant pas le nommer colonel. Le 31 octobre, il
installa Blanqui à l’Hôtel de Ville.
|
Notes du
chapitre I :
(1) Arthur Arnould, Histoire de la Commune.
(2) Arthur Arnould. I, page 116.
(3) Discours du 17 septembre 1871.
(4) Arthur Arnould.
(5) Arthur Arnould, I, 95.
(6) Trente mille Allemands allaient entrer aux Champs-Elysées le 1er
mars.
(7) Les canons furent transportés aux Batignolles, à Montmartre, à
Belleville et place des Vosges, Voir Vuillaume, Mes cahiers rouges, IV,
167.
(8) Arthur Arnould.
(9) Elie Reclus, la Commune au jour le jour, Schleicher,
éditeur.
(10) C’est principalement à Jourde et à Varlin que revient l’honneur de
cette réorganisation. On put constater alors l’inutilité d'un grand
nombre de hauts fonctionnaires, véritables parasites que la faveur dote
de grasses sinécures.
(11) Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, librairie Dentu,
page 104.
(12) Elie Reclus, page 36.
(13) Parmi les adhérents à cette ligue on peut citer ; Maurice
Lachâtre, Isamberl, l’architecte Émile Trélat, les peintres Manet
et
Jobbé-Duval, Beslay, Frédéric Morin, Loiseau-Pinson, Stupuy, André
Lefèvre, Mario Proth, Yves Guyot, Chauvin, Paraf-Javal, etc... — Les
journaux le Rappel, le Temps, le Siècle, le National, la Vérité, se
rallièrent au même programme, ainsi que les chambres syndicales de
patrons et d’ouvriers. — Cependant quelques députés refusèrent leur
adhésion : Louis Blanc, H. Brisson, Edmond Adam, Tirard, E.
Farcy,
Peyrat, Edgar Quinet, Langlois et Dorian furent assez aveugles pour se
fier à l’Assemblée, supposant contre toute évidence qu’elle n’oserait
pas attaquer la République. Leur inertie reste
inexplicable.
(14) Lissagaray, page 181, — Vuillaume, IV, page 185 et suivantes.
(15) Ancien officier de marine, Luillier avait une certaine instruction
militaire et « quand il n’était pas brûlé par l’alcool, des moments de
lucidité à faire illusion ».
(16) Camille Pelletan, la Semaine de mai, page 14.
(17) Je résume le récit de Lissagaray, page 182
(18) Lissagaray, page 184.
(19) Lissagaray.
(20) Cette simplicité contrastait avec le luxe de dorures qui avaient
rendu ridicules Bergeret et son état-major.
(21) Lissagaray, page 204.
(22) Il y avait 6.000 malades dans les hôpitaux et les
ambulances.
(23) Cluseret à la guerre, Jourde aux finances, Viard aux subsistances,
Paschal Grousset aux relations extérieures, Frankel au travail et aux
échanges, Protot à la justice, Andrieu aux services publics, Vaillant à
l’enseignement, Raoul Rigault à la sûreté
générale.
(24) Les Cahiers rouges de Vuillaume en fournissent beaucoup
d’autres.
(25) Les lecteurs des Cahiers se souviennent des intéressants détails
donnés par Vuillaume (IV, 213, et VI, 360) sur la fameuse pièce au
trident.
(26) Georges Bourgin, Histoire de la Commune, Cornély, éditeur, page
116. — « L’administration de Jourde était jugée si bonne qu’on lui
refusa la démission qu’il donnait à l’occasion de l’élection du Comité
de Salut public. »
(27) Tous ces gens-là sont morts pauvres.
(27) Voir Georges Bourgin, page 126 et suivantes,
(28) Journal officiel des 18, 24 et 27 avril.
(29) La question fut posée dès le 27 avril.
(30) « La plus belle armée du monde » selon Thiers. Ce dont la Commune
ne semble pas s’être rendu compte, c’est que, si elle eût triomphé,
même partiellement, les Allemands se fussent unis aux Versaillais pour
l'écraser.
(31) Georges Bourgin.
(32) Tous repris de justice, sans doute!
(33) Georges Bourgin.
(34) Les renseignements suivants sont extraits de notes biographiques
écrites par Flourens lui-même et reproduites dans l’ouvrage d'Elie
Reclus, la Commune au jour le jour, page 97. |
|
Livre
X : 1871 - LA COMMUNE
- Cahier de la Quinzaine : 7ème cahier de la 13ème série
|
|
|
|
DELBROUCK
|
Une peinture de
M. de Neuville - Les dernières cartouches (1873)
|
Chapitre II :
La conciliation armée. — Lettres de madame Pape. — Intervention
de la franc-maçonnerie. — Delbrouck médiateur. — Dombrowski à
Neuilly.
« C’est
pourquoi le penseur frémissant est forcé
D’employer la lumière à des choses sinistres ;
Devant les rois, devant le mal et ses ministres.
Devant ce grand besoin du monde, être sauvé,
Il sait qu’il doit
combattre après avoir rêvé. » Victor Hugo
Dans la Légion du Génie auxiliaire, Delbrouck n’accepta pas le
commandement en chef qui lui fut offert après le départ de
Viollet-le-Duc et de nombreux officiers supérieurs, mais il y
conservait une influence considérable, parce qu’il était aimé et vénéré
de tous.
Persuadés qu’en continuant leurs travaux de fortification, ils
défendaient non seulement Paris, mais la République menacée, presque
tous nos soldats et quelques-uns de nos officiers se rallièrent à la
Commune. Je fis comme eux.
Delbrouck ne se lassait pas de répéter : « Il faut à tout prix éviter
l’effusion du sang. » Nous n’avions qu'une idée, qu’un but, la
conciliation, l’apaisement. Mais nous comprenions aussi que l’Assemblée
de Versailles ne ferait aucune concession, si elle ne se trouvait pas
en présence d’un peuple armé, résolu à soutenir par la force ses justes
revendications.
Thiers avait déclaré la guerre à Paris, quand furent incarcérés les
généraux Chanzy (1) et de Langorian.
Delbrouck les visita dans leur prison et fit passer leur correspondance
à leurs familles. Son éloquence contribua assurément beaucoup à les
faire mettre en liberté. (2) Comme pendant le premier siège, nos
travaux, purement défensifs, consistaient à réparer les brèches faites
aux remparts ou dans les forts. Nous installions pour les canons des
embrasures, et pour les hommes des abris blindés qui ont sauvé la vie à
plus d’un soldat.
Delbrouck n’a jamais porté d’armes, ni sabre ni revolver. Mystique, un
peu à la façon de Tolstoï, il a toujours écouté la voix intérieure qui
lui disait de se laisser tuer plutôt que de se défendre par le
meurtre.
Dans l’anarchie actuelle des relations internationales, il est à
souhaiter que, si de pareils sentiments venaient à se généraliser, ce
soit d’abord en Allemagne. On ne peut méconnaître leur beauté ;
l'avenir leur appartient, avenir encore lointain, hélas! — La puissance
de suggestion de notre capitaine était si grande que nous la subissions
avec la certitude de suivre le droit chemin.
Pacifiste en théorie, j’aurais voulu atténuer à mes propres yeux la
contradiction apparente entre mes principes et mes actes. — Je ne suis
pas de ceux qui se résignent facilement à être illogiques. — J’ai la
satisfaction de n’avoir pas tué de ma main ; je n’ai pas tiré un coup
de fusil et je n’ai pourfendu personne. Cependant, il faut l’avouer, la
distinction est subtile entre la légitime défense et l’attaque
meurtrière. Les embrasures que nous construisions pour les canons, les
tranchées derrière lesquelles s’abritaient les tirailleurs nous
rendaient complices d’odieuses mais nécessaires boucheries. On trouvera
singulière notre façon de comprendre la conciliation, mais il y a
des circonstances plus fortes qu’une volonté individuelle.
2
Dame Pape-Carpentier à Paul M. - Versailles, 23
avril 71.
Pardonnez-moi celte
insistance, (3) cher Monsieur Paul, et voyez-y moins la marque d’une
amitié pourtant très réelle, qu’une preuve du prix que j’estime
votre existence et votre action pour le triomphe même de l’idée que
vous croyez servir. L’heure n’est pas venue où le sang des justes
est fécond. Elle n’est pas venue, ou plutôt elle est passée. C’est par
la vie et la pensée qu’il faut désormais combattre pour la justice, non
par l’homicide, sous quelque drapeau qu’il s’accomplisse. Un coup de
canon n’est pas une raison, et le triomphe ainsi obtenu est une défaite
pour le succès définitif. C’est maintenant qu’il faut dire : malheur
aux victorieux !
Mais le malheur est aussi
pour la marche du progrès. Le sang versé pour la République est la plus
grande accusation que les populations portent contre elle. Et moi je
lui en voudrais amèrement de faire périr des hommes comme vous et notre
digne ami M. D. (Delbrouck).
Je dois aussi vous prier
de repasser tout ce que je vous ai dit sur la complexité de moteurs et
d’agents qui se trouvent au fond du mouvement actuel. (4) Les nouveaux
renseignements que j’ai recueillis ne font que confirmer ce que je vous
ai déjà dit à ce sujet. Si vous devez un jour causer à votre admirable
mère la douleur épouvantable de n’avoir plus qu’un cadavre ensanglanté,
dans les bras qui ont presse tant de fois un fils chéri, attendez
encore, afin de ne pas empoisonner cette douleur par la pensée d’un
sacrifice inopportun.
Je vous serre la main,
cher monsieur Paul, avec les plus maternelles supplications d’un
cœur tout dévoué à vous et à la République. Embrassez pour moi votre
mère et votre sœur. Que je voudrais pouvoir dire à M. D. tout ce que
je pense et l’arrêter lui aussi. La vue et la pensée de sa pauvre
petite Marie me tue.
Allons, cher monsieur, à
bas l’orgueil, et du cœur, du cœur, du coeur, de la tendresse pour ceux
qui vous aiment, de l’humanité pour tous.
Madame Pape à Madame Milliet. -
Compiègne, 30 avril 1871.
Chère
amie,
Donnez-moi de vos
nouvelles et de celles de votre cher fils, de vos chers enfants.
M. Paul a-t-il reçu ma lettre de Versailles ? Qu’en est-il advenu? Je
pense à vous sans cesse, ce n’est point une exagération. Mon cœur et
mon esprit sont tendus vers vous avec une angoisse inexprimable.
J’apprends à l’instant que vous ne souffrez plus de la faim, c’est un
soulagement. Si j’apprenais que vous êtes tous bien portants, je
respirerais. Quand je dis tous, je pense à M. Delbrouck aussi et
à sa chère petite Marie. Mon Dieu! faut-il assister à cette lutte
monstrueuse et héroïque à la fois? L’histoire ne vit rien de
pareil. Est-ce l’enfantement dont parle l’Évangile? Est-ce la
convulsion de l’agonie? Non, non, la France expie, mais elle ne mourra
pas. Paris enfante dans la douleur ; il se rachète par le martyre.
Paris est un fou sublime. Ne dites pas cela à votre fils.
De vos nouvelles de grâce
; nous embrassons de tout coeur vous et Louise, et moi je vous aime du
coeur le plus dévoue.
Marie
Si vous pouviez nous
envoyer quelques journaux sous enveloppe, cela nous ferait un plaisir
extrême.
Ma mère répondit à Madame Pape.
Pour moi, je ne crois pas avoir écrit une lettre à cette époque ;
nous
avions autre chose à faire. Il ne me reste que mes souvenirs.
3
Le 17 avril, la Commune de Lyon avait envoyé à Paris M. Barodet « pour
offrir ses bons services aux patriotes de la conciliation ». — Cent
sept chambres syndicales de patrons et d’ouvriers, représentant plus de
cent mille citoyens, déléguèrent dans le même but une commission de
dix-huit membres au gouvernement de Versailles.
Dufaure, ministre de la Justice, répondit avec une dureté ironique «
qu’il adorait la conciliation, mais après le triomphe
».
Le 25 avril, quatre gardes nationaux, surpris par des chasseurs à
cheval, avaient déposé leurs armes. Un officier survint et déchargea
sur eux son revolver. « Deux furent tués ; les autres,
laissés pour morts, se traînèrent jusqu’à la tranchée voisine, où l’un
d’eux expira ; le quatrième fut transporté à l’ambulance. »
Le lendemain, Léo Meillet raconte à la Commune cet assassinat.
L’indignation secoue les plus modérés. Lissagaray a donné une sorte de
procès-verbal de cette séance : « Cela crie vengeance! s’écrie-t-on, il
faut user de représailles. Fusillons les prisonniers que nous avons
entre les mains. » — Plusieurs : « L’archevêque de Paris ! » — Antoine
Arnaud : « Qu’on exécute publiquement douze gendarmes! » — Tridon : «
Pourquoi prendre douze hommes contre quatre ? Vous n’en
avez pas le droit? » — Ostyn s’oppose aux exécutions. —
Vaillant : « C’est la propriété qu’il faut frapper. » — Avrial et
Jourde : « Qu’on procède légalement! » — Arthur Arnould : « Qu’on
s’en prenne à Thiers en démolissant sa maison! » — Le généreux Cambon
se leva : « Si les gens de Versailles fusillent nos prisonniers,
que la Commune déclare devant la France, devant le monde, qu’elle
respectera, elle, tous les prisonniers qu’elle fera.
»
La discussion devenait très vive, lorsque l’annonce d’une délégation de
francs-maçons imposa un peu de calme. Ranvier les conduisait : ils
proposaient d’aller planter les bannières maçonniques sur les remparts
: « Si une seule balle les touche, les francs-maçons marcheront
d’un même élan contre l’ennemi commun. »
« L’intervention de cette puissance mystérieuse avait jeté un
grand espoir dans Paris. Le 29 au matin six mille frères, représentant
cinquante-cinq loges, étaient rangés dans le Carrousel... Une musique
grave et d'un caractère rituel précédait le cortège : des
officiers supérieurs, les grands maîtres, les membres de la
Commune et les frètes avec le large ruban bleu, vert, blanc,
rouge ou noir, suivant le grade, suivaient, groupés autour de
soixante-cinq bannières pour la première fois paraissant au soleil.
Celle qui marchait en tète, la bannière blanche de Vincennes, montrait
en lettres rouges la devise fraternelle : « Aimons-nous les uns les
autres. » Une loge de femmes fut surtout acclamée.
« Un ballon libre, marqué des trois points symboliques, alla semer dans
l’air le manifeste de la Franc-Maçonnerie.
« La bannière blanche fut dressée au poste le plus périlleux, l’avancée
de la porte Maillot. Les Versaillais cessèrent leur feu. — Au pont de
Courbevoie, devant la barricade versaillaise, un officier reçoit les
délégués et le général Montaudon leur permet de se rendre à Versailles.
» (5)
Mais Thiers, résolu à ne rien accorder, ne voulait pas même admettre la
députation. Le lendemain les balles versaillaises trouaient les
bannières.
A son tour, «l’Alliance républicaine des départements » vint adhérer à
la Commune. Millière présenta à l’Assemblée une foule nombreuse de
citoyens originaires de la province.
Un congrès réuni à Lyon déclara responsable devant la nation souveraine
celui des deux partis qui repousserait la conciliation. — Thiers menaça
d’envoyer vingt-cinq mille hommes contre la ville rebelle.
Quand Thiers eut lancé sa première bombe contre Paris, nous pensions
que tous les députés de Paris qui étaient encore à Versailles
protesteraient solennellement contre cette infamie et viendraient
prendre avec nous leur part du danger. Nous avions rêvé que Louis
Blanc, que Langlois, que Dorian, que Farcy, que Brisson, que Victor
Schœlcher, qu’Edgar Quinet iraient se poster à la porte Maillot,
et, devant les Vinoy, les Charette, les Cathelineau, les
Gallifet, ils étendraient la main : « Nous défendons de toucher à
Paris! » Oui, nous rêvions cela. Nous nous trompions. Un seul a
agi, un seul s’est employé pour la conciliation : Victor Schœlcher. Il
publia avec Floquet et Lockroy la proposition à l’Assemblée d’un traité
de paix. » (6)
Lorsque Schoelcher, Lockroy et Floquet portèrent à Versailles ce projet
de transaction Thiers ne voulut pas reconnaître aux Fédérés la qualité
de belligérants et refusa tout armistice. Victor Considérant ne fut
pas plus heureux.
Delbrouck entreprit d’agir seul. A deux ou trois reprises il
essaya de s’interposer comme médiateur entre l’Hôtel de Ville et
Versailles. « Et le voilà qui court de l’un à l’autre, fort maltraité
d’ailleurs des deux parts. Il traversa plusieurs fois les lignes,
marchant la nuit aussi bien que le jour. Une fois il fut arrêté aux
postes versaillais, retenu avec des malfaiteurs et conduit sous la
pluie jusqu’au quartier de Longjumeau. » (7)
C’est, je crois, pendant la première absence de mon capitaine que je
fus chargé de conduire de nuit, à la porte Maillot, un petit
détachement de sapeurs. Je commençai par placer mes hommes un peu à
l’abri derrière un épaulement, puis je me mis à la recherche du
colonel qui devait nous expliquer le travail à faire. Epuisé de
fatigue, il s’était jeté un instant tout habillé sur un lit, dans une
maison voisine que l’on m’indiqua. Le colonel se leva aussitôt et me
conduisit à la redoute construite en avant de la porte Maillot. Là, une
importante batterie commandait la grande avenue de Neuilly. Mais le tir
des Versaillais était si précis que la plupart des embrasures avaient
été démolies. A la place de l'une d’elles surtout il n’y avait plus
qu’un monceau des décombres : « Vous le voyez, me dit le colonel, ils
ont de bons pointeurs. Nos artilleurs ont dû se retirer avec leurs
pièces, mais je vais les faire revenir, aussitôt que vous aurez réparé
le dégât. »
Pendant toutes ces explications, le colonel, avec une bravoure
que j’admirai, se tenait debout au milieu de l’embrasure la plus
maltraitée, à l’endroit le plus périlleux. Le jour n’était pas encore
levé et le canon tonnait, un peu moins fréquemment, il est vrai,
à cette heure matinale. Nos sapeurs m’attendaient, et, avisant près de
là un chantier de construction, l’un d’eux me donna l’idée de
réquisitionner quelques poutres pour hâter l’exécution de notre
travail.
Deux par deux, nos hommes prirent sur leurs épaules de lourds
madriers. Nous traversions la grande place nue qu’on nomme rond-point
de la porte Maillot, quand un obus tomba tout près de nous. Un éclat
vint frapper dans le dos l’un des porteurs qui s’aplatit sur le sol, à
demi écrasé par la poutre. Au lieu de s’enfuir, son compagnon, avec une
présence d’esprit et un dévouement vraiment admirables, s’agenouilla
près du blessé, dégagea la plaie du vêtement qui la couvrait et la suça
longuement en recrachant bien vite le sang. Les matières explosibles
sont en effet des poisons dont on peut atténuer la virulence en
traitant une blessure comme une piqûre de serpent. C’est probablement
le courage de ce brave homme qui sauva la vie de son
camarade.
Cependant quelques-uns de nos sapeurs avaient été pris d’une sorte de
panique et s’étaient dispersés derrière les maisons. Pour les rallier,
j’employai un moyen qui m’avait déjà réussi une autre fois : Je me
plaçai à l’endroit même où l’obus venait de tomber et, alignant ma
petite troupe, je commençai à faire l’appel. Je n’avais pas fini, que
les fuyards, revenus en hâte, répondaient : « Présent! » J’aurais
su leurs noms et ils craignirent de passer pour des lâches.
Je les conduisis à la redoute, mais là, quand ils virent l’état
lamentable de la batterie, ils commencèrent à murmurer : « On
veut nous faire tuer. Ce sont des traîtres qui commandent de pareils
travaux! », et quelques mécontents semblaient prêts à refuser d’obéir.
Alors, me souvenant de l’exemple que venait de me donner le colonel, je
montai debout au milieu de l’embrasure en ruines et, pendant que les
obus passaient par dessus nos têtes, j’expliquai le travail à faire et
son importance : « Si les obus tombent trop près, abritez-vous dans la
tranchée ; en attendant : à la besogne, et vivement! » Aucun ne
refusa et le travail fut exécuté avec un zèle et une rapidité dont le
colonel nous fit compliment.
C’est là, je crois, le seul bien petit exploit que j’aie accompli, et
je l’avoue, je ressentis aussitôt après une sorte de fatigue
physique provenant sans doute de l’effort de volonté que j’avais du
faire.
Notre compagnie fut appelée dans des directions très diverses, le plus
souvent hors de l’enceinte, dans les forts, ou à Neuilly. Nos travaux
furent commandés par La Cécilia et son état-major, mais je n’ai pas eu
l’occasion d’être placé directement sous les ordres de Rossel. Ce
vaillant officier s'était rangé comme nous sans hésitation « du
côté du parti qui n’a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses
rangs de généraux coupables de capitulation ».
Delbrouck connaissait personnellement quelques-uns des membres du
Gouvernement de la Défense nationale. Une seconde fois, il quitta
l’uniforme, franchit, je ne sais comment, les lignes des assiégeants,
et parvint à se faire introduire auprès d’Ernest Picard. Il plaida
éloquemment la conciliation et fut écouté avec une certaine
bienveillance. Cependant le ministre ayant jugé ses propositions
inacceptables, lui demanda :
— Et maintenant, qu’allez-vous faire?
— Je vais rejoindre ma compagnie, reprit simplement
Delbrouck.
Et vous ne faites pas immédiatement arrêter cet homme! s’écria avec
indignation un secrétaire présent à la scène. Mais l’autorité morale de
Delbrouck était telle qu’il inspirait le respect même à ses
ennemis. Il revint attristé, non découragé ; au contraire,
plus que jamais résolu à défendre les droits de Paris.
Le Comité central considérait toute tentative de conciliation comme une
trahison. Les démarches de Delbrouck avaient été dénoncées, il
commençait à devenir suspect et, sans la protection de Delescluze, il
eût été déjà arrêté. Le commandant Roselli-Mollet, qui le faisait
surveiller, profita de sou absence pour envoyer à la caserne Lowendal
l’ordre suivant : « La première compagnie de la Légion du Génie partira
immédiatement pour se mettre à la disposition du général
Dombrowski. En cas de refus, faire arrêter le capitaine.
»
Cet ordre me fut remis, à moi simple sergent, vers quatre heures du
matin. Pas un de nos lieutenants à la caserne! Réunissant à la hâte les
quinze ou vingt hommes de la compagnie, que nous avions sous la main,
(8) je partis aussitôt.
Dombrowski avait installé ce jour-là son état-major dans une serre, au
fond d’un jardin, entre le boulevard Inkermann et la rue Borghèse.
Notre petit détachement, placé avec quelques autres sous les ordres
d’un capitaine que nous ne connaissions pas, arriva de grand matin. Le
général était assis devant une table couverte de plans. C’était un
homme de petite taille, à la moustache blonde, aux yeux d’un bleu pâle,
scrutateurs et pénétrants derrière leurs lunettes d’or. Sa physionomie
était calme, impassible et énergique. Il se leva et donna à nos
officiers des instructions très précises : « Vous traverserez la rue
Perronet. Une mitrailleuse versaillaise est installée au bout de
cette rue, qu’elle balaie régulièrement. Vous attendrez qu’elle ait
tiré, et vous donnerez à vos hommes l’ordre de traverser rapidement, en
abritant leurs têtes au moyen des pelles et des pioches. Vous remplacez
des troupes qui ont passé toute la nuit dans les maisons du boulevard
d’Argenson. Les Versaillais occupent l’autre côté de ce boulevard.
Entassez les meubles et les obstacles derrière les portes cochères
; pendez les matelas des lits devant les fenêtres et recommandez
de ne les soulever que pour tirer sur les assaillants. Vous serez
remplacés à la tombée de la nuit. »
Ces conseils étaient excellents, ils furent suivis à la lettre. Arrivés
à l’angle de la rue Perronet, nous attendîmes que la mitrailleuse eût
tiré. Les coups se succédaient à courts intervalles, avec une
régularité formidable. A peine le fracas de la décharge eût-il été
entendu, que nous nous élançâmes au pas de course. Mais
nous fûmes salués par une vive fusillade. J’avais à mes côtés un
brave garçon jeune et vigoureux, nommé Lazerges; il tomba frappé
de cinq blessures et m’entraîna dans sa chute en criant : « Vive
la Commune ! » Son corps m’avait préservé ; aucune balle ne
m’avait atteint. Je me relevai vivement et nous entrâmes par les
jardins dans la maison que nous étions chargés de défendre.
Les Fédérés que nous allions remplacer étaient épuisés de fatigue,
sanglants, noirs de poudre et dans un état de surexcitation indicible,
les yeux fiévreux, la parole brève. Ils nous donnèrent quelques
indications précieuses : monter aux étages supérieurs d’où l’on
dominait mieux l’ennemi, et même sur les toits pour faire un feu
plongeant ; s’abriter derrière les cheminées. — Ils partirent,
emportant quelques blessés.
Je n’oublierai jamais cette scène. On parlait peu. Chacun s’embusquait
de son mieux à côté des fenêtres sur lesquelles les balles pleuvaient.
Comme un chasseur à l’affût, chaque sapeur glissait le canon de son
fusil derrière le matelas, qui formait une sorte de bouclier
suspendu, lançait un regard furtif au dehors pour viser, lâchait la
détente et se retirait. Un jeune ouvrier nommé Mazier, doux et honnête
garçon qui avait été l’ordonnance du lieutenant de Vesly pendant le
premier siège, fut de suite blessé à l’épaule.
Cependant les Versaillais, qui occupaient l’autre côté du boulevard
d'Argenson, recevaient des renforts. Les maisons s’emplissaient de
soldats dont la fusillade devenait de plus en plus nourrie et plus
meurtrière. Puis voici que l’artillerie s’en mêla. Le toit de la maison
que nous occupions s’effondra sous un obus. Notre situation était à peu
près celle des soldats représentés dans le tableau célèbre intitulé : «
Les dernières cartouches ».
Déjà les sapeurs versaillais commençaient à frapper à coups de haches
contre la porte cochère, prête à céder sous leurs efforts. Pour tirer
sur eux, il eût fallu se pencher en dehors des fenêtres, et c’était une
mort certaine. Sans doute il eût été plus héroïque de nous faire tuer
jusqu’au dernier ; mais la position n’était plus tenable. Le capitaine,
très calme, ne voulant pas nous laisser prendre et fusiller
inutilement, ordonna la retraite. Nous partîmes en bon ordre, précédés
des morts et des blessés que nos hommes portaient sur leurs épaules. Il
fallut traverser de nouveau la rue Perronet, mais cette fois la
mitrailleuse ne tira pas. (9)
Dombrowski, avec son jeune frère, se promenait de long en large sur le
boulevard Inkermann, région où tombait une véritable pluie de balles
mortes. En nous voyant revenir avant la nuit, il fronça le sourcil,
mais le funèbre défilé lui fit comprendre que la partie était
momentanément bien compromise sur ce point.
Nous étions brisés, plus encore par l’émotion que par la fatigue. —
Pour ma part, je n’ai jamais éprouvé cette réaction qui fait affluer le
sang au cerveau, cette colère aveugle qui fait voir rouge, je me
demandais ce que Delbrouck aurait fait à ma place. Nous ne pouvions pas
refuser d’obéir à un chef qui nous ordonnait de mettre une maison en
état de défense, et d’autre part, comment oublier que, derrière cette
porte prête à céder, j’aurais pu voir surgir mon frère? L’idée de
brûler la cervelle à un Français ou de lui enfoncer ma baïonnette dans
le ventre, me faisait horreur. Qu’aurais-je fait s’il eût fallu me
défendre dans une lutte corps à corps? J’ai peine aujourd’hui à
analyser les sentiments complexes qui m’agitaient. L’instinct de
la conservation l’eût-il emporté sur le profond respect que j’ai
toujours eu de la vie humaine, ou bien, disciple de Delbrouck, me
serais-je laissé tuer plutôt que de devenir un assassin? Je l’ignore.
(10)
Une longue hérédité nous a façonnés de telle sorte que nous ne pouvons
refuser notre admiration au courage physique, nécessaire tant que la
guerre subsistera. Digne de respect et de récompense au point de vue
militaire et patriotique, cette fureur sanguinaire n’en reste pas moins
odieuse au point de vue humain.
Quant à nous rendre, l’idée ne nous en vint pas un seul
instant.
Plus opiniâtre que Ducrot, Dombrowski ne se tenait pas aisément pour
battu. Il nous fit créneler les murs des jardins et mettre en état de
défense quelques maisons de la rue Perronet. Enfin, l’artillerie qu’il
réclamait vainement depuis longtemps étant arrivée, la situation
changea. Bientôt la mitrailleuse ennemie était réduite au silence, et,
le général nous ayant accordé un repos dont nous avions grand besoin,
nous regagnâmes la caserne, pendant que les Fédérés, avec un entrain
admirable, reprenaient à l’assaut les positions un instant
perdues.

Le lendemain, ma mère, visitant l’ambulance du Luxembourg, apprit de
nos blessés les dangers que nous avions courus. Son inquiétude était
extrême. Ce fut peut-être sur ses instances, — je le suppose du moins,
— que M. Delbrouck me chargea de l’inspection de notre
casernement. J’avais à indiquer le nombre des lits disponibles. De
plus, la caserne Lowendal contenait un important dépôt d’effets
d’équipement, et de nombreux détournements avaient été commis de nuit.
J’organisai une active surveillance et, avec l’aide d’un jeune
architecte, je commençai un plan et un inventaire des dortoirs. Mais
ces fonctions pouvaient être remplies par des hommes plus âgés que moi
et je demandai souvent à mon capitaine de l’accompagner dans ses
travaux aux avant-postes.
Louise M. à son père – Paris, le 24 avril 71.
Je voudrais bien aller
te rejoindre à la Colonie, mais nous ne pouvons pas laisser Paul et
Alix, car ils sont continuellement exposés. Alix s'est faite
ambulancière et suit Henri partout. Elle a été au fort d’Issy, elle est
maintenant au fort de Vanves. La vie qu’elle mène est très fatigante et
pleine de dangers ; elle est vraiment courageuse ; quel dévouement!
mais on doit être bien heureuse de se rendre utile.
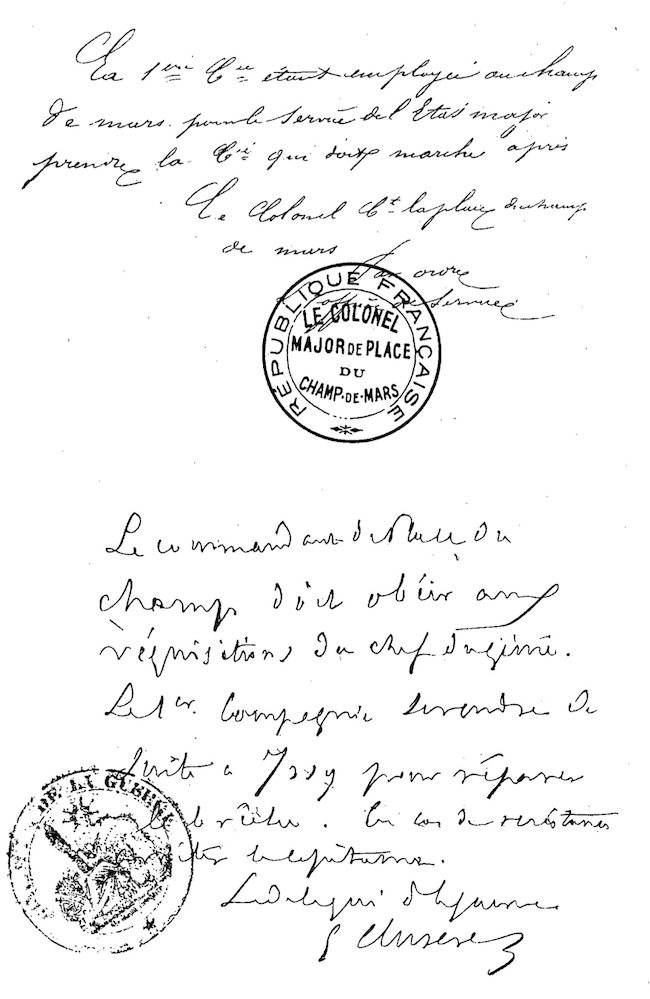 Maman, Marie Delbrouck et
moi nous allons tous les jours à l’ambulance du Luxembourg pour voir
les blessés de la compagnie de Paul. On a fait l’amputation d’un
bras à Mazier. Un autre, Lazerges, blessé à Neuilly, a reçu cinq balles
à la tête. Il a entraîné Paul dans sa chute. Il se tenait la tète
d’une main, de l’autre il prit son képi et étendit le bras en criant :
Vive la République ! Vive la Commune! Paul n’a qu’une légère
écorchure au genou. (11)
C’est triste de voir tous
ces martyrs de la République victimes de leur courage et de leur
dévouement. Il y a des blessures atroces, des ventres fendus, des
crânes à moitié emportés ; cela fait mal d’entendre les gémissements
de douleur. Le capitaine Lefort de la 2° compagnie a reçu une
halle en pleine poitrine, elle est ressortie par le dos. Il a un
poumon traversé, cependant il est si vigoureux qu’on espère le sauver.
Il mange déjà des côtelettes.
M. Delbrouck et un autre
monsieur, munis d’un laissez-passer de la Commune, se sont rendus à
Versailles pour lâcher de faire entendre raison aux Ruraux ; mais avec
des crétins pareils il n’y a pas de conciliation possible. Des
gendarmes les ont arrêtés. Si on avait trouvé leur laissez-passer de la
Commune, ils auraient été fusillés sur-le-champ, mais, ils l’avaient
mâché et jeté en boulettes. Ils sont restes plus de 24 heures sans
manger, conduits entre deux gendarmes comme des malfaiteurs, insultés
tout le long du chemin. Les Versaillais criaient ; « Voyez!
ont-ils l’air assez canailles! » — Quand nous racontions cela à nos
pauvres blessés, au Luxembourg, ils étaient indignés, surtout le brave
Lazerges ; il en pleurait de rage. Quand ils parlent de M. Delbrouck et
de Paul, c’est avec enthousiasme et vénération ; tous donneraient leur
vie pour eux. Enfin M. Delbrouck a pu, non sans peine, accomplir sa
mission ; mais parler aux Ruraux, autant vaudrait parler à une bûche. —
On dit que l’Assemblée va demander secours aux Prussiens ; cela ne
m’étonne pas, ils sont assez lâches pour cela. En tout cas, ce n’est
pas à nous à céder, nous ne plierons pas, — Lorsque les païens
voulaient forcer les chrétiens à adorer leurs dieux, ils ne demandaient
qu’une petite prière à Jupiter ; c’était bien peu de chose, et
cependant ceux-ci préféraient la mort. Ils avaient la foi. Nous aussi
nous avons la notre, nous voulons la République. Les royalistes veulent
l’escamoter et nous faire adorer leur fétiche, un roi! Espérons que les
honnêtes gens triompheront de la réaction ; sinon, nous serons encore
heureux d’avoir fait notre devoir, d’avoir défendu le progrès et
la liberté, et de mourir martyrs de la République.
De quel droit l’Assemblée
vient-elle se mêler des affaires de Paris? Ce troupeau d’oies n’a rien
fait, si ce n’est du mal. La Commune, elle, a brûlé la guillotine
; ses décrets ont toujours en vue l’amélioration physique et
morale du peuple. — On a réquisitionné les vicaires de Saint
Jacques. Brigitte et Madeleine (Pape) les ont vus qui traversaient
l’église tout effarés. Ils étaient déguisés en hommes, avec des
moustaches postiches et des culottes. Ils gardaient leur chapeau
gibus pour cacher leur tonsure ; ils avaient un cigare à la bouche et
une dame au bras.
Madame Milliet à M, Félix
Milliet - Paris, 4 mai 71.
Mon cher ami, j’ai
reçu ton petit mot. Pour te répondre je dois mettre ma lettre
dans une enveloppe mystérieuse, et je n’aime pas ces mystères,
n’ayant rien à cacher. Les occasions ne me manqueront pas pour
t’écrire, mais toi, prie les personnes qui viendront à Paris d’y mettre
tes lettres à la poste, cela est facile. Quant à revenir auprès
de nous dans l’état de santé où tu es, je ne vois pas ce que tu
viendrais y faire ; reste paisiblement à bêcher ton jardin. J’ai bien
souvent l’envie d’aller te rejoindre à la Colonie, mais je serais trop
inquiète des enfants; j’attendrai un armistice. Les choses sont
tellement tendues qu’elles ne peuvent rester longtemps dans cet état. A
Paris on ferait bon marché de la Commune qui fait sottises sur
sottises, si on ne détestait pas davantage
l’Assemblée.
Madame Milliet à M. Félix
Milliet - Paris, 13 mai 71.
Nous sommes bien
peinés de la longue durée de ce triste état de choses. Quand Paris aura
ses franchises municipales (et il faudra bien qu’il finisse par les
avoir), il les aura bien gagnées. Comme dans tous les sièges, les
assaillants perdent plus de monde que la place. Il y a eu, dit-on,
trois mille tués et blessés du côté d’Ivry, Fédérés et
Versaillais; ces derniers y étaient bien pour les deux tiers.
Depuis hier matin et toute la nuit nous entendons le canon et la
fusillade; nous ne connaissons pas encore les résultats.
Généralement, après ces massacres, les deux partis se trouvant au
même point. A Neuilly, depuis 15 jours, les uns prennent une barricade,
le lendemain les autres la reprennent.
Notre espoir c’est que
les grandes villes réclament comme Paris les franchises municipales.
L’Assemblée n’oserait pourtant pas bombarder toutes les villes
au-dessus de vingt mille âmes.
Le pauvre fort d’Issy est
en triste état ; il se fera probablement sauter, mais la position ne
sera pas plus tenable pour les Versaillais que pour les
Fédérés.
J’espère que tu ne crois
pas un mot de tous les mensonges débités par les journaux de
Versailles. Il est impossible d’être de plus mauvaise foi. Le
gouvernement s’obstine à considérer la révolution de Paris comme le
fait d’une poignée de factieux. Une poignée de factieux qui a fait fuir
le gouvernement et qui tient en échec la plus belle armée que l’on ait
jamais vue, et cela depuis six semaines, et ils n’ont pas fini. Ils
devraient comprendre qu’il y a là quelque chose au fond, une idée qui
vaut la peine d’être discutée ; mais non, ils sont aveugles, comme tout
ce qui est vieux et destiné à tomber. Pour moi je crois que c'est
l’enfantement laborieux d’une, ère nouvelle, et non point l’agonie de
la France. Je regarde et j’écoute. Le grand malheur c'est le, manque
d’hommes supérieurs ; les uns sont trop vieux, les autres sont des
fruits verts, pas mûrs du tout.
Alix est à
Levallois-Perret, toujours bien exposée, mais remplie d’entrain et même
de gaieté, autant qu'il est possible d’en avoir dans d’aussi pénibles
circonstances.
|
Notes du
chapitre II
(1) A la gare d'Orléans, on avait vu un
officier général en grand
uniforme. Il fut arrêté. On croyait tenir d’Aurelle, c’était Chanzy.
Léo Meillet le protégea en le faisant entrer dans la prison du
secteur.
(2) Chanzy dut faire la promesse écrite de ne pas servir contre Paris.
— De son côté Victor Considérant, qui connaissait Raoul Rigault,
parvint à faire mettre en liberté M. Émile Allard, ingénieur des Ponts
et Chaussées, injustement arrêté et qui sans cette intervention, eût
probablement péri.
(3) C’était la seconde lettre que Madame Pape m’écrivait pour me
dissuader de me rallier à la Commune.
(4) Assurément des éléments très disparates s’y trouvaient réunis;
néanmoins tous restaient d’accord sur un point : le maintien de la
République.
(5) Lissagaray.
(6) Elie Reclus, page 100.
(7) Émile Trélat.
(8) Notre effectif était loin d’être au complet et, après de longues
fatigues, les hommes mariés avaient parfois la permission de passer la
nuit dans leur famille.
(9) Elle avait probablement été dirigée contre la maison que nous
devions fortifier.
(10) Le sergent Bérail a su analyser avec une remarquable précision ce
qu'éprouve un tempérament sanguin et vigoureux dans un combat corps a
corps : « Je me sers de ma baïonnette rouge de sang, je casse des tètes
à coups de crosse. Je ne me connais plus, ma vue est troublée, un bruit
formidable m'étourdit, Je suis d'une force prodigieuse, et la
poudre
m'a enivré. Mes lèvres sont sèches et je ne m'aperçois même pas qu'un
filet de sang coule de mon front, » — (Général Ambert, Récits
militaires)
(11) Lazerges m’avait servi de bouclier. Des cinq blessures qu'il
avait revues, trois étaient à la tête, mais les balles n'avaient pas
pénétré profondément, il avait un sang vigoureux et réchappa
miraculeusement. Mazier au contraire, pauvre garçon d’un tempérament
scrofuleux, mourut d’une blessure à la clavicule gauche ; la balle
était restée entre l'omoplate et la tête de l’humérus, et les
chirurgiens ne surent pas l'extraire. |
|
Livre
X : 1871 - LA COMMUNE
- Cahier de la Quinzaine : 7ème cahier de la 13ème série
|
|
|