VI – Le mois de
juin 1790
Mardi 1er juin :
Parution du premier numéro de l'Ami du roi, des Français, de
l'ordre et surtout de la vérité, rédigé et dirigé par
l'abbé Royou alias Monjoye. A partir de ce jour, le comte de Mirabeau
est en contact régulier avec la Cour.
2 juin : A l’Assemblée, un décret ordonne des poursuites contre les
individus soulevant le Peuple et donne leur caractéristique. L'évêque
de Rodez rend compte de sa visite à l'Hôtel-Dieu devant le comité de
mendicité du 21 mai. Jean-Paul Marat lance un nouveau journal Le Junius Français, journal politique et
édite son premier numéro. Mais ce périodique de huit pages ne durera
pas, le dernier numéro sera le 24 juin et il sortira de manière
épisodique.
3 juin : A la
Martinique, à Saint-Pierre après la messe et une procession, les
"libres de couleur" (les affranchis dont souvent des métis) porteurs de
la cocarde tricolore sont
pourchassés, sept personnes se font tirées dessus et décèdent et sept
autres
sont pendues. A Paris, c'est le jour de la Fête Dieu,
dès le matin les députés sont invités à la messe donnée à
Saint-Germain-de-l'Auxerrois et une procession est organisée, le tout
en présence de la famille royale.
4 juin : A la Société des Amis des Noirs est présenté un plan de
travail en six points : « l°. Tableau de l'Afrique ; 2°. Tableau de la
traite des noirs ; 3°. État des noirs esclaves dans les îles ; 4*. Etat
des colonies, et conséquences pour leur commerce de l'abolition de la
traite ; 5°. De l'état des esclaves chez les anciens et parmi les
nations européennes actuelles ; 6°. Méthode pour amener graduellement
et avec fruit l'abolition de l'esclavage. Cinq
membres de la société ont entrepris cette tâche immense. Chacun se
dévoue à en exploiter une branche, d'après un plan commun de travail ». Signé par MM.
Piéton de Villeneuve, président et Brissot de Warville, secrétaire, et
extrait de l'Adresse
aux amis de l'humanité . (Source : Gallica-Bnf, 4
pages)
5 juin :
Parution du Journal de la Société de
1789 de Condorcet, « Ainsi,
la société de 1789 doit être considérée comme un centre de
correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un
foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n'est ni une
secte ni un parti, mais une compagnie, d'amis des hommes, et, pour
ainsi dire, d'agents du commerce des vérités sociales ».
(Source : Gallica-Bnf) Le
traitement des ministres est porté à 100.000 livres, celui des
Affaires étrangères à 180.000 livres par an. Sans parler des fonds
secrets et douceurs du pouvoir. A
l’Assemblée, M. Bailly (ci-contre) le
maire de la
capitale propose : |
|
 |
«
L'idée de fédérer toutes les fédérations particulières
dans une
grande cérémonie nationale, qui aurait lieu dans la capitale le jour
anniversaire de la prise de la Bastille, fut exprimée par Bailly dans
une adresse qu'il présenta à la Constituante, le 5 juin 1790, au nom de
la municipalité parisienne. Déjà la division
des provinces ne
subsiste plus, disait Bailly, cette division qui faisait en France
comme autant d'états et de peuples divers. Tous les noms se confondent
dans un seul ; un grand peuple ne connaît plus que le nom de Français.
» La Fédération générale ne serait pas seulement un acte de communion
en la Patrie, elle aurait encore un triple but : « défendre la
liberté
publique, faire respecter les lois de l'empire et l’autorité du
monarque ». Dans ces derniers mots se révèle la pensée politique
de
Bailly et de son parti. Effrayés par la continuation des troubles, par
l'indiscipline croissante de l'armée, par les revendications des
citoyens passifs qui ont trouvé un organe éloquent dans Robespierre,
les bourgeois révolutionnaires croient le moment venu de réveiller le
sentiment monarchique en le faisant servir à la défense de leurs
conquêtes politiques : « le roi verra un grand nombre de ses enfants,
terminait Bailly, se presser autour de lui, élever un cri de vive le
roi, prononcé par la liberté, et ce cri sera celui de la France
entière. I l s'agissait donc d'attacher
le roi à la Révolution et la
Révolution au roi ».
Les
Grandes journées de la Constituante d'Albert Mathiez
6 juin : Fête de la Fédération et le mouvement fédératif à Lille : « une sorte d'exaltation populaire qui n'a
pu se maintenir » : Une fête révolutionnaire provinciale et ses
aménagements : la Fédération de Lille de Me Odile Lesaffre-Ramette (Source : Persée.fr, 16 pages)
7 juin : Paris, place de l'hôtel-de-ville, la Garde du
Roi composée de cent soldats Suisses avec à leur tête M. de Brissac
prêtent le serment civique en allemand. Sont présents à cette cérémonie
le commandant-général M. de Lafayette et le maire de la capitale, M.
Bailly.
8 juin : A l'Assemblée, l'on adopte l'article 8 du projet de décret sur
l'organisation du clergé.
9 juin : A la Martinique, la guerre civile éclate, les troupes venues
de Fort-Royal encerclent la ville et le gouverneur prêt à ordonner
l'assaut. Les propriétaires ou « Békés » de Saint-Pierre ont tout fait
pour attiser la colère des autorités. L'affaire remonte au 3 juin, à
l'occasion de la fête-Dieu, les « gens de couleurs » voulaient
organiser des manifestations égalitaires. Le refus des planteurs a fait
dégénérer la cérémonie en une sanglante chasse à l'homme noir, au cours
de laquelle les békés ont perdu toutes mesures dans la haine raciale.
L’on a pu constater Les corps des hommes pendus ce jour à l'entrée de
la ville. En France, les dépenses royales sont réduites à 25
millions
de livres au
lieu de 31 millions en 1789.
Sur la demande de Louis XVI, la part
de
Marie-Antoinette est fixée à 4 millions. Le Châtelet de Paris se
prononce par défaut sur la séparation de corps et d'habitation des
époux Sade et décide la restitution par le marquis de la dot de 160.842
livres. A l'Assemblée se concrétise le
mouvement fédératif, en décidant qu'il y aura une fête de la
Fédération ou célébration patriotique à Paris, le 14 juillet prochain.
|
La
fête de la Fédération :
son organisation et sa préparation

Préparation de la fête de la Fédération - Champs de mars
« L'idée de
fédérer toutes les fédérations particulières dans une
grande cérémonie nationale, qui aurait lieu dans la capitale le jour
anniversaire de la prise de la Bastille, fut exprimée par Bailly dans
une adresse qu'il présenta à la Constituante, le 5 juin 1790, au nom de
la municipalité parisienne. « Déjà la division des provinces ne
subsiste plus, disait Bailly, cette division qui faisait en France
comme autant d'états et de peuples divers. Tous les noms se confondent
dans un seul ; un grand peuple ne connaît plus que le nom de Français.
» La Fédération générale ne serait pas seulement un acte de communion
en la Patrie, elle aurait encore un triple but : « défendre la liberté
publique, faire respecter les lois de l'empire et l’autorité du
monarque». Dans ces derniers mots se révèle la pensée politique de
Bailly et de son parti. Effrayés par la continuation des troubles, par
l'indiscipline croissante de l'armée, par les revendications des
citoyens passifs qui ont trouvé un organe éloquent dans Robespierre,
les bourgeois révolutionnaires croient le moment venu de réveiller le
sentiment monarchique en le faisant servir à la défense de leurs
conquêtes politiques : « le roi verra un grand nombre de ses enfants,
terminait Bailly, se presser autour de lui, élever un cri de vive le
roi, prononcé par la liberté, et ce cri sera celui de la France
entière ». Il s'agissait donc
d'attacher le roi à la Révolution et la
Révolution au roi.
Le décret
du 9 juin ordonna que
chaque garde nationale choisirait 6
hommes sur 100 pour se rendre au district. Les députés des gardes
nationales ainsi choisis choisiraient à leur tour un homme sur 200 pour
se rendre à Paris le 14 juillet. La dépense serait supportée par le
district. L'armée de ligne serait représentée comme la garde nationale.
On espérait ainsi faire cesser les divisions qui s'étaient souvent
manifestées entre les citoyens soldats et les soldats tout courts.
Chaque régiment députerait à Paris l'officier le plus ancien de
service, le bas officier et les 4 soldats dans le même cas. La
Fédération devait avoir lieu sur les bords de la Seine, au Champ de
Mars, qu'on se hâta d'aménager par des corvées patriotiques et
volontaires.
Les
travaux de préparation dans la capitale
Il faut voir
cette fourmilière de citoyens, cette activité, cette
gaieté dans les plus durs travaux ; il faut voir cette longue chaîne
qu'ils forment pour tirer des charrettes surchargées ; des pierres
énormes cèdent à leurs efforts, ils entraîneraient des montagnes. Il
n'est point de corporation qui ne veuille contribuer à élever l'autel
de la patrie : une musique militaire les précède ; tous les individus
se tiennent trois à trois, portant la pelle ou la pioche sur l'épaule ;
leur cri de ralliement est ce refrain si connu d'une chanson nouvelle
qu'on appelle « le Carillon national ». Tous chantent à la fois : « Ça
ira, ça ira, ça ira » : oui, ça ira, répètent tous ceux qui les
entendent. Personne ne se croit dispensé du travail par son âge, son
sexe ou son état : on a vu passer les tailleurs, les cordonniers, ayant
à leur tête les frères tailleurs et les frères cordonniers. L'école
vétérinaire, les habitants des villages très éloignés sont accourus,
ayant à leur tête le maire avec son écharpe, la pelle sur l'épaule.
Tous ont des drapeaux ou des
enseignes. Sur celui des charbonniers on
lit : Le dernier soupir des aristocrates... Les bouchers avaient sur
leur flamme un large couteau et l'on lisait dessus : Tremblez,
aristocrates, voici les garçons bouchers. D'énormes monceaux
disparaissaient sous leurs bras vigoureux. Les ouvriers de la Bastille
ont amené dans les charrettes tous les instruments qui ont servi à la
démolition de cette forteresse. Les employés des postes, ayant à leur
tête M. d'Ogny, les domestiques de l'enceinte des Italiens, les acteurs
de Mademoiselle de Montansier, conduits par leur directrice, sont venus
contribuera cette œuvre patriotique... Les chartreux conduits par dom
Gerle ont quitté eux-mêmes leurs cellules pour venir participer à ces
travaux civiques. Le roi est venu jouir de ce spectacle nouveau ;
soudain la pelle et la pioche sur l'épaule, les citoyens ont formé
autour de lui une garde d'honneur. Il a visité tous les ateliers. »
Les
Grandes journées de la Constituante – Pages 81 et 82
Albert
Mathiez – Les
éditions de la passion
|
10 juin : A Paris, Louis-Ange Pitou, journaliste au Journal général de la cour
et de la ville, se rend au palais des Tuileries à la demande de
Marie-Antoinette, qui le congratule pour sa fidélité envers le roi et
ses prises de position, notamment dans l'affaire Favras. Elle lui fait
don de son portrait en miniature et d'une somme d'argent. Louis-Ange
Pitou par la suite de cette rencontre se consacrera à défendre la
monarchie et devenir un actif propagandiste.
11 juin : A Paris, il
parvient la nouvelle de la mort de Benjamin
Franklin, la Constituante ajourne ses travaux en signe de
deuil, un service funéraire est improvisé devant son portrait au café Le Procope. Intervention du comte
de Mirabeau devant les parlementaires :
« Franklin est
mort... (Il se fait un profond silence.) II
est rétourné au sein de la Divinité, le génie qui affranchit l'Amérique
et versa sur l'Europe des torrents de lumières ! Le sage que deux
mondes réclament, l'homme que se disputent l'histoire des sciences et
l'histoire des empires, tenait sans doute un rang bien élevé dans
l'espèce humaine. Assez longtemps les cabinets politiques ont notifié
la mort de ceux qui ne furent grands que dans leur éloge funèbre; assez
longtemps l'étiquette des cours a proclamé des deuils hypocrites : les
nations ne doivent porter que le deuil de leurs bienfaiteurs ; les
représentants des nations ne doivent recommander à leurs hommages que
les héros de l'humanité. Le congrès a ordonné, dans les quatorze États
de la confédération, un deuil de deux mois pour la mort de Franklin, et
l'Amérique acquitte en ce moment ce tribut de vénération et de
reconnaissance pour l'un des pères de sa constitution. Ne serait-il pas
digne de vous. Messieurs, de nous unir à l'Amérique dans cet acte
religieux, de participer à cet hommage rendu à la face de l'univers, et
aux droits de l'homme, et au philosophe qui a le plus contribué à en
propager la conquête sur toute la terre? L'antiquité eût élevé des
autels au puissant génie qui, au profit des mortels, embrassant dans sa
pensée le ciel et la terre, sut dompter la foudre et les tyrans.
L'Europe, éclairée et libre, doit du moins up témoignage de souvenir et
de regret à l'un des plus grands hommes qui aient jamais servi la
philosophie et la liberté. Je propose qu'il soit décrété que
l'Assemblée nationale portera pendant trois jours le deuil de Benjamin
Franklin (La partie gauche applaudit avec transport). »
Source : Bib. de Stanford, Archives
Parlementaires, page 170 et 171, tome XVI
11 et 12 juin : A Avignon, ville et résidence papale, les Avignonnais
proclament leur volonté d'être rattachés à la France. Le
lendemain, les
élus Avignonnais mandent au représentant du pape de quitter la ville,
puis ils procèdent à l'élection d'ecclésiastiques et décident de
rejoindre le royaume français. A l’Assemblée, le service dans la garde
nationale est rendu
obligatoire pour l'exercice des droits de citoyen actif. Dans la
capitale les ossements trouvés depuis mai dans
les souterrains de la Bastille sont transférés au cimetière de l'église
St-Paul, et une plaque est apposée au frais de Pierre-François Palloy.
La Cour à l'annonce du décés de la duchesse douairière de Bavière prend
le deuil pour sept jours.
13-17 juin : A Strasbourg, l’on fête la Fédération. Pendant plusieurs jours à Nîmes, de
nouveaux des troubles surviennent,
des groupes armés entrent dans la ville. Des protestants, des
catholiques, des républicains et des royalistes se font face et entrent
en conflit. Le désordre est général, il y a de nombreux tués, et les
heurts réguliers. La Bagarre de Nîmes en
est le final, le 14 et 15 juin, quand les protestants, appuyés par des
renforts Cévenols
s'affrontent dans des combats de rue aux catholiques
contre-révolutionnaires. Ces troubles d'une grande violence laisseront
pour bilan, la mort de plus de 300 personnes. Le 17, c'est
progressivement le retour au calme et l'ordre public fini par régner
selon le Récit des événements arrivés à Nîmes envoyé par
l'administration du département du Gard à l'Assemblée
nationale et à l'ordre du jour du 26 juin. (Source : Persée.fr, 2
pages)
Samedi 14 juin : A Saint-Domingue, l'Assemblée coloniale arrête les
décisons suivantes : « Nous
déclarons que nous ne pouvons ni ne devons proposer à l'assemblée
nationale que le décret suivant, conforme aux ordres de nos commettants
: L’assemblée nationale, considérant la différence absolue du régime de
la France à celui des Colonies, déclare par cette raison, que son
décret des droits de l’homme ne peut ni ne doit les concerner, décrète
qu’il n'y sera pas promulgué sous quelque prétexte que ce puisse être
; décrète encore qu’elle reconnaît aux Colonies françaises le droit de
faire elles-mêmes leur constitution, qui sera envoyée à leurs députés
pour être présentée à la sanction nécessaire. » Toujours au nom de
la colonie, il est précisé : « Et
si l’horrible scission doit avoir lieu, vous lèverez au moins des mains
pures, et vers la mère-patrie, dans vos derniers adieux, en la
quittant pour jamais, et
vers les colonies qui vous bénissant à votre retour, vous diront vous
avez fait votre devoir sans pouvoir faire des heureux, c’est à nous de
vous consoler. » Selon Julien Raimond sur ses Preuves
complètes et matériellles etc. de 1795. Le
tout signé, par MM. Cocherel, le citoyen
Ogormaud, Mangalon et Daugé, et MM. Brulley, président et Thomas Millet
secrétaire. (Extraits de la Gazette
imprimée à St-Domingue, à
la rubrique Nouvelles Diverses, n°51, du samedi 28 juin 1790,
imprimé arrêté de l'assemblée coloniale)
15 juin : Manche, le journal l'Argus ou l'homme aux cents yeux
fait paraître son premier numéro, c'est le citoyen
Pierre-Charles-François Mithois surnommé le "Marat coutançois" qui est
à l'initiative de sa parution. Ce périodique est imprimé à Coutances.
16 juin : La municipalité d'Avignon demande son rattachement au
royaume. A Besançon, l’on fête la Fédération.
17 juin : M. de Villette, ancien protecteur de Voltaire fait une motion au club de 1789.
(Source Gallica-Bnf, 1 page)
18 juin : En Espagne, à Aranjuez, le Secrétaire d'Etat (équivalent à un premier ministre),
le comte José de Floridablanca est victime d'un attentat perprétré par
un français, nommé Perret avec un couteau, et il échappe de peu à la
mort.
19 juin : A l'Assemblée, il est approuvé un décret abolissant la
noblesse héréditaire, les titres de prince, duc, comte, marquis etc.,
ces nominations disparaissent des actes, seule le vrai nom de famille
est accepté. On ne pourra plus dire majesté, son excellence, etc... On
ne pourra plus faire porter
des livrées à ses serviteurs, ni posséder des armoiries. Et « que l’encens ne sera brûlé, dans les temples, que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à qui que ce soit... »
20 juin : Au champ-de-Mars, dans la matinée, Louis XVI passe en revue
1.500 hommes de la Garde nationale.
21-26 juin : Rome, le pape Pie VI ayant refusé de céder à ses sujets,
les Avignonnais renouvellent leur demande de réunion à la France. La
Constituante est en pleine délibération sur la Constitution civile du
clergé, et réserve sa réponse.
22 juin : Paris, plan de la ville et
des faubourgs divisé en 48 sections (ci-dessus, au lieu de 60
districts), il est décrété par l'Assemblée nationale et sanctionné par le
Roi. (Source : Galllica-Bnf)
23 juin : Louis XVI signe le décret qui met fin à la noblesse
héréditaire, elle est abolie "pour toujours"
en France. La mesure concerne environ 400.000 personnes et va être très
contestée dans les milieux conservateurs et monarchistes.
24 juin : A Nantes, la première pierre de la « colonne de la liberté »,
un monument dédié au roi et à la Révolution est posée.
25 juin : A Paris, M. Etienne de Polverel, juriste, livre son Opinion sur l'aliénation et l'emploi des biens
nationaux, et sur l'extinction de la dette publique. Lue à
l'Assemblée de la Société des Amis de la Constitution (Source :
Numelyo, 62 pages)
26 juin : A l'Asssemblée, il est pris un décret sur les principes
constitutionnels de la marine, un rapport fait au nom du
Comité de la marine, par M. de Curt, député de la Guadeloupe et
secrétaire du comité. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)
27-28 juin : A
la Constituante, il est promulgué un décret portant
règlement de l'organisation municipale de Paris, sa composition : Un
maire, seize administrateurs, trente-deux membres du Conseil,
quatre-vingt-seize notables, un procureur de la Commune, deux
substituts. Sinon est aussi publiée la Proclamation du Roi relative aux opérations préalables à
l'élection des maires et officiers municipaux de Paris, ordonnée par les lettres patentes
(Source : Gallica-Bnf, 4 pages) Le
village de Montmartre est incorporé à la commune de
Paris. Le 28, devant l'Assemblée lors de la séance du soir, M. Paul
Nairac, député de Bordeaux, dans
un discours expose ses motifs, sur le commerce de
l'Inde. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)
29 juin : Rouen,
l'on fête la Fédération. Monseigneur Boisgelin, évêque
d'Aix, reconnaît au pape, en bon gallican, une primauté, mais pas
d'avantage.
30 juin : A l’Assemblée, il est approuvé un décret prescrivant la
nomination immédiate des directoires de département et de district.
VII – le mois de juillet 1790
Jeudi 1er juillet :
Brest, un vaisseau de guerre est lancé et vient de
voir
le jour à l'arsenal de la ville. Le navire Etat-de-Bourgogne
est
le premier-né d'une série de nouveaux vaisseaux de 118 canons et de 64
mètres long. Une fois mis en service, il transportera plus de 5.000
tonnes avec une voilure de 4.640 mètres carrés et 1.100 hommes
d'équipage.
2 juillet : Le garde du corps de Louis XVI, M. Lefèvre de Luberque
reçoit la croix de Saint-Louis, suite à une blessure reçue lors des
journées des 5 et 6 octobre 1789 (Il émigrera le 5/09 prochain à
l'étranger).
3 juillet : Entrevue secrète entre Mirabeau et Marie-Antoinette au
château de Saint-Cloud. En rapport avec
Louis XVI par courrier depuis quelques semaines, Mirabeau aurait dit de
cette rencontre avec la Reine : « Elle
est bien
grande, bien noble et bien malheureuse, mais je la sauverai. Rien ne m’arrêtera, je périrai plutôt que
de manquer à mes promesses » Nicolas de Condorcet publie dans
le Journal de la Société de 1789 (n°5) un article Sur
l'Admission des Femmes au Droit de Cité, où il «
demande maintenant qu’on daigne réfuter ces raisons autrement que par
des plaisanteries et des déclamations ; que surtout on me montre entre
les hommes et les femmes une différence naturelle, qui puisse
légitimement fonder l’exclusion du droit. »
(Source :
Gallica-Bnf, texte intégral).
3-9 juillet : A Toulouse l'on fête la Fédération, les manifestations et
réjouissances attirent près de 100.000 personnes. Le serment est prêté
le 4/07.
4, 6, 8 et 9 juillet : A la Constituante, il est promulgué un décret
sur l'organisation des forces navales du royaume. Le 6, il est pris un
autre décret qui approuve l'organisation provisoire des archives de
l'Assemblée. Le 8, on examine un nouveau projet sur l'ordre judiciaire,
et sur les juges de paix en particulier, et, le 9, il est décidé d'un
décret
réglementant l'aliénation des biens nationaux.
6 juillet : Il est publié un pamphlet, le Grand diner des conspirateurs : (...) dans la salle des Cordeliers, rue de l'Observance : lettre de l'auteur du Journal du diable à M. de Lameth.
Après avoir écrit quelques méchancetés sur Marat, Robespierre, le duc
d'Orléans, etc., nous avons les portraits plutôt cinglants, en voici 2
courts extraits : « Est-ce-un
Desmoulins? Celui-là, c’est autre chose. Comme il dit indistinctement
du mal de tout le monde, et que quelquefois il a de l’esprit, il a
encore auprès d’une certaine classe un certain crédit. (...)
Danton, direz-vous? Danton ah! monsieur, permettez-moi de rire un
instant sur une pareille idée. Danton! Il est plaisant celui-là.
Danton, mais que diable a-t-il donc tant fait? Il a manié le district
des Cordeliers comme il a voulu, il fait tous les jours des motions sur
la terrasse des Feuillants. Voilà en vérité de belles promesses pour
être mis au premier rang. » Ce texte serait de
Jean-Lambert Tallien, journaliste, il se rapprochera du parti
Dantoniste, et siégera à la Convention avec cette mouvance. (Source : Archive.org, pages 3 et 4)
7 juillet : Dans une lettre, la reine informe son frère, l’empereur
Léopold II, de sa rencontre avec le comte de Mirabeau.
10 juillet : A Paris, après des pressions populaires François-Noël
Babeuf - alias Gracchus à partir de 1793 - est libéré et se trouve à la
tête d'une publication, Le
correspondant Picard (40 numéros jusqu'en 1791). Après avoir été
l'auteur de deux numéros dans la capitale du Journal de la
Confédération, le dernier titre a été publié le 3 du même mois.
11 juillet : Jean-Paul Marat remarque dans son journal l’utilisation
qu'en retire Lafayette du serment auprès des Gardes nationaux : « Il surprit leur consentement à des
ré̀glements captieux (spécieux ou fallacieux) dont
ils n’étaient capables, ni de sentir les conseéquences, ni de pré́voir
les suites ; il les lia par le serment, il les plia en vils mercenaires
à la discipline militaire comme à̀ l’unique règle de leurs devoirs, il
leur inspira la funeste manie de ne reconnaître que les ordres de
leurs chefs etc. » (numéro 159, de L'Ami du Peuple)
 Légende : Le dégraisseur
patriote. Patience Monsieur votre
tour viendra - Le Pressoir - Il
n'a plus de remède
Légende : Le dégraisseur
patriote. Patience Monsieur votre
tour viendra - Le Pressoir - Il
n'a plus de remède
12 juillet : A l’Assemblée, c'est le vote final sur la Constitution
civile du
clergé. Curés et évêques seront désormais élus : un évêque par
département au lieu des 139 évêchés.
« ART.
21. — Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu
prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé,
le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui
lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de
maintenir, de tout son pouvoir, la constitution décrétée par
l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi ».
« ART. 38. — Les curés élus et institués
prêteront le même serment que les évêques, dans leur église, un jour de
dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers
municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront
faire aucune fonction curiale ».
« Sire,
Dans, le cours de ces événements mémorables qui nous ont rendu des
droits imprescriptibles, lorsque l'énergie du Peuple et les vertus de
son Roi ont présenté aux Nations leurs Chefs de si grands exemples,
nous aimons à révérer en votre Majesté le plus beau des titres, celui
de Chef des Français et de Roi d'un Peuple libre. Jouissez, Sire, du
prix de vos vertus, et que ces purs hommages que ne pourrait commander
le despotisme soient la gloire et la récompense d'un Roi citoyen. Vous
avez voulu que nous eussions une Constitution fondée la liberté et
l'ordre public. Tous vos voeux, Sire, seront remplis : la liberté
nous est assurée, et notre zèle garantit l'ordre public. Les Gardes
nationales de France jurent à votre majesté une obéissance qui ne
connaîtra pas de bornes que la Loi, un amour qui n'aura de terme que
celui de notre vie. »
Source : Gallica-Bnf, Adresse
au Roi, prononcée par M. de La Fayette (Evreux, 1790)
14 juillet : En
Corse, après vingt ans d'exil à Londres, Pasquale Paoli arrive à
Macinaggio, il est de retour dans sa patrie et à la descente du navire,
il embrasse le sol. A Paris, c'est le fête de la Fédération nationale,
ci-dessous, «
L'assemblée
nationale, en expliquant son décret du 8 juin dernier, décrète que la
municipalité de Paris est autorisée à remplir les fonctions du
directoire de district, par rapport aux biens ecclésiastiques,
non-seulement dans la dite ville, mais encore dans toute l'étendue du
département de Paris ; et ce, provisoirement, jusqu'à ce que
l'administration du dit département et de ses districts, ainsi que
leurs
directoires soient en activité. Sanctionnée le premier août 1790. »
(Nouvelle
législation ou collection de tous les décrets – édité en 1792
chez Devaux) Au théâtre de la Nation,en soirée l'on joue la
première représentation, de la pièce en un acte et en vers, Le journaliste de
l'ombre ou Momus aux champs Elysées de M. Joseph Aude. (Source
: Gallica-Bnf, 84 pages)
CAMP FÉDÉRATIF de PARIS
0
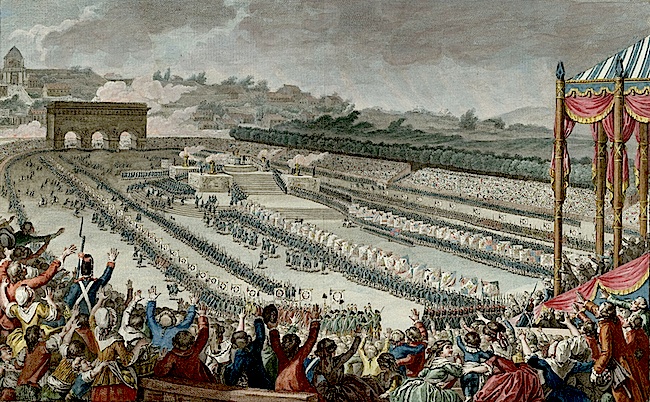
Champ de Mars - fête de la Fédération
Du
mercredi 14 Juillet 1790.
Note
: Fait de huit feuillets au prix de 2 sols, ce journal probablement
unique (?) présente
ou explique le déroulement de la journée de la fête de la Fédération au
Champs de Mars.
La cérémonie du serment fédératif a eu lieu dans le plus grand
appareil, et sans aucune espèce d’accident.
Le Champ de Mars était entouré de quarante rangs de gradins. Au pied de
l’Ecole militaire, était une tribune d’environ quarante pieds de
largeur et de la longueur de la façade de ce bâtiment. Au milieu de
cette tribune, s’élevait un trône magnifiquement sculpté et doré,
surmonté d’une aigle, destiné pour le Roi. A droite était un riche
fauteuil pour le Président de I’Assemblée. Au-dessus de cette tribune
était celle préparée pour la Reine, M. le Dauphin, Madame Royale,
Monsieur, Madame, Madame Elisabeth et quelques Dames de la Cour.
En face de
cette tribune, et à l’autre bout du Champ de Mars, s’élevait
majestueusement un arc de triomphe avec trois portes, sur lesquelles on
lisait d’un côté les quatre inscriptions suivantes :
La Patrie ou la
Loi peut seule nous armer,
Mourons pour la défendre et vivons pour l’aimer.
Consacrés au grand travail de la Constitution,
Nous la terminerons.
Le pauvre sous ce défenseur,
ne craindra plus que l’oppresseur ;
Lui ravisse son héritage.
Tout nous offre d’heureux présages,
Tout flatte nos désirs ;
Loin de nous écartez les orages,
Et comblez nos plaisirs.
De l’autre côté , on lisait les quatre inscriptions qui suivent :
Nous ne vous
craindrons plus subalternes tyrans,
Vous qui nous opprimiez sous cent noms différents.
Les droits de
l’homme étaient méconnus depuis des siècles, ils ont été rétablis pour
l’humanité entière. Le Roi d’un peuple libre est seul un Roi puissant.
« Vous qui
chérissez cette liberté, vous la possédez maintenant, montrez-vous
dignes de la conserver ».
Au milieu du Champ de Mars était élevé une superbe autel, soutenu par
quatre colonnes, dont chaque face portait la même inscription :
Les mortels
font égaux, ce n’est pas leur naissance.
C’est la seule vertu qui fait la différence.
De Tous cette inscription, on lisait ces mots :
La loi dans tout Etat doit être universelle,
Les mortels, quels qu’ils soient sont égaux devant elle.
On lisait de
l’autre côte le serment civique, décrété par l’Assemblée :
Nous jurons de rester à jamais fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi,
de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par
l’Assemblée nationale, et acceptée par le Roi ; de protéger
conformément aux Lois, la sûreté des
personnes et des propriétés,
la circulation des grains et des subsistances du Royaume, la perception
des contributions sous quelque forme qu’elle existe, & de demeurer
unis par les liens indissolubles de la fraternité »,
On lisait sur
le derrière des colonnes :
« Songez aux trois mots sacrés qui garantirent les décrets, la Nation,
la Loi et le Roi. La Nation c’est vous, la Loi c’est encore vous, c’est
votre volonté, le Roi c’est le gardien de la Loi. La colonne qui
faisait face à l’arc de triomphe , portait l’emblème de la liberté avec
les attributs qui la caractérisent, celle qui lui était parallèle
portait l’emblème du génie avec ce mot : Constitution.
Le Roi est arrivé entre trois & quatre heures ; Sa Majesté est
venue occuper le trône qui lui avoir été préparé. Le président de
l’Assemblée s’est assis sur le fauteuil qui était à fa droite ;
suivaient les Députés ; à la gauche du Roi était la Commune de Paris.
Tous les Gardes nationaux des Provinces, pêle-mêle avec ceux de Paris,
occupaient les deux premiers gradins autour du Champ-de-Mars ; les
autres étaient occupés par les spectateurs.
La première décharge de canon a été faite au moment où la marche est
sortie de la place de Louis XV ; la fécondé, lorsqu’elle est entrée au
Champ-de-Mars, la troisième, lorsque M. de La Fayette a paru ; la
quatrième, lorsque le Roi est arrivé.
Le Roi placé, M. l’évêque d’Autun est monté à l’autel, où il a dit la
messe accompagnée d’une musique superbe. Ce prélat patriote avait
braqué sur lui tous les yeux des amis de la révolution. Il avait pour
ceinture des rubans aux trois couleurs de la Nation ; les prêtres qui
l’aidaient dans ces fonctions sacrées, portaient les mêmes ceintures.
Après la célébration de l’office divin, on a béni les Enseignes, sur
lesquels étaient écrits ces mots :
Confédération du 14 Juillet. Département
du....
Cette cérémonie achevée, M. de La Fayette a prêté le serment au nom de
tous les Confédérés, et au bruit du canon ; après lui M. le président
de l’Assemblée Nationale s’est levé, a salué le Roi, et l’a prêté au
nom de l’Assemblée. Les Membres de l’Assemblée, la Commune de Paris, et
300.000 personnes ont répété au même instant ces mots : je le jure ;
chacun levait les mains au ciel ; c’était un spectacle ravissant que de
voir dans le même moment 600.000 bras en l’air, et un peuple entier
demandant à Dieu d’être propice à ses vœux.
Le serment prêté par le président, le Roi s’est levé ; on a observé le
plus religieux silence, et Sa Majesté a lu son serment avec une dignité
et un attendrissement qui s’est communiqué à tous les spectateurs à
portée d’entendre ce généreux prince.
Après Sa Majesté, M. le Dauphin, que la Reine tenait dans ses bras, a
agité ses petites mains ; il les a tendu vers le ciel, et a prêté son
serment de la meilleure grâce du monde ; le serment était répété au
même instant par son auguste mère. Moniteur, Madame, & Madame
Elisabeth.
Le peuple n’a cessé d’applaudir cette auguste famille.
La cérémonie du ferment achevée, le Te Deum a été chanté au son des
tambours, des timbales, et au bruit d’une salve d’artillerie, dont le
service a fait l’étonnement des gens de l’art ; le Roi est parti
comblé de bénédictions ainsi que l’Assemblée, et les Gardes nationales
ont défilé dans le meilleur ordre.
Les députés
de la ville de Lyon sont arrivés samedi et à cinq heures du soir sur la
place d’armes devant l’hôtel-de-ville. Leur bonne contenance et l’air
martial des Lyonnais a fait le plus grand plaisir. Le tambour-major,
par sa taille, figurait parfaitement bien à la tête des tambours et des
musiciens, qui étaient en grand nombre.
On a remarqué qu’il était, et à juste titre, le plus richement vêtu des
autres tambours-majors de toutes les députations. Son habit galonné en
or sur toutes les coutures, semblait rappeler qu’il faut ne pas
abandonner entièrement un usage qui soutient de fortes manufactures, et
fait vivre une infinité d’ouvriers. Le présent destiné pour M. de
Lafayette faisait un très-bel effet à côté du drapeau. Chacun lisait
avec plaisir l’inscription.
Cives Lugdunenses optimo civi.
(Les citoyens de Lyon sont les meilleurs citoyens)
Les députés des campagnes de Lyon présentaient une autre compagnie en
tout aussi bon ordre et avec un air non moins martial. On a remarqué
que celui qui portait l’emblème du Lyon avec l’inscription : Campagnes de Lyon,
était en bas de soie blancs, par analogie aux fabriques de soieries
dont cette partie de la France est occupée. — Les Bretons sont arrivés
une heure après les Lyonnais.
Les Bretons sont arrivés samedi soir au nombre de six à sept cents
hommes ; leur premier mouvement a été de rendre hommage au Roi.
Lorsqu’ils se sont trouvés en face du pont Royal, on a donné des ordres
pour les faire passer par la porte des Tuileries, qui est de ce côté.
Ils ont traversé le jardin devant le château. Un d’eux a complimenté le
Roi, qui a paru très-sensible aux cris d’allégresse de ces amis de la
liberté.
Le Roi a passé en revue, hier matin, trois divisions de la Garde
nationale. Les soldats citoyens qui composaient ces divisions, ont pris
un arrêté dans leurs districts respectifs, pour inviter leurs frères
confédérés de vouloir bien assister à cette revue et de partager avec
eux les gardes d’honneur chez le Roi.
C’est à M. Charton qu’on doit les premières sollicitations pour
parvenir à effectuer cette fête mémorable qui était dans l’idée de tous
les bons citoyens. M. Charton est président de la fédération.
On assure que M. de La Fayette est nommé
par le Roi, major-général de la fédération ; M. de Gouvion, aide-major
général.
Un noble d’ancienne souche, déchu des titres par le décret du 18 juin
dernier, parcouru toutes les études de MM. les notaires de Paris, pour
faire accepter le dépôt de sa protestation ; mais en vain : il a été
obligé de la rédiger lui-même. On ajoute qu’il est parvenu à le faire
constater sur les registres du contrôle du domaine ; mais c’est un fait
qu’il faudrait vérifier.
M. Philippe d’Orléans est arrivé dans la nuit du samedi à dimanche, à
deux heures du matin. Il s’est présenté au Roi lorsque Sa Majesté a été
de retour de la revue, et de là s’est rendu à l’Assemblée nationale.
Le premier mouvement des députés qui arrivent à Paris, est de se porter
rapidement sur les ruines de la bastille ; ils descendent dans les
cachots et payent un tribut de sensibilité aux victimes qui ont été
dévorées dans ces gouffres ténébreux ; on voit plusieurs arracher les
dernières pierres pour les emporter chez eux.
Les dernières lettres de Genève nous annoncent qu’il y a un parti fort
nombreux dans cette ville qui, à l’exemple d’Avignon, veut se donner à
la France. Ce parti fait tous les jours des prosélytes, au point qu’il
n’y aurait rien d’étonnant qu’avant peu on ne vît arriver ici des
députés de Genève, chargés d’offrir que cette ville fasse partie de
l’empire Français.
A Paris, de l’Imprimerie du Patriote
Français
|
|
15
juillet : A l'Assemblée, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt au nom du
comité de mendicité mettait au courant les parlementaires sur l'état de
la législation sur la mendicité et les hôpitaux, la répartition des
secours par département, puis districts et municipalités, et sur les
visites
effectuées dans les hôpitaux, hospices et maisons de charité de Paris
et de ses alentours.
16 juillet : Aux Etats-Unis, la ville de Washington District of
Columbia est fondée ou formalisée par le Residence Act. Deux états, le
Marynland et la Virginie ont donné des terres, près de 200 kilomètres
carrés pour que se construise le district fédéral, à ne pas confondre
avec l'état de Washington en bordure du Canada. Sinon la ville
nouvelle est bordée du fleuve Potomac.
17
juillet : En Ecosse, à Edimbourg décède le philosophe Adam Smith,
auteur des Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des nations (1776). A Paris, l'on
joue une pièce de M. Collot d'Herbois en deux actes et en prose, La
famille patriote ou la Fédération,
au théâtre de Monsieur (n'existe plus, et s'est appelé aussi théâtre
Feydeau, au 19-21 de la rue du même nom et proche de l'Opéra ou la
salle
Garnier).
Façade du théâtre Monsieur, ci-contre
|
|
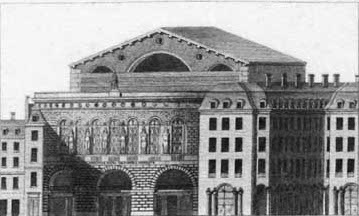 |
18, 19 et 20 juillet : Louis XVI signe le décret du 10 juillet «
sur
les biens des non-catholiques qui se trouvent encore aujourd’hui entre
les mains des Fermiers de la Régie aux biens des Religionnaires
(protestants), seront rendus aux héritiers, successeurs ou ayans droits
des dits fugitifs, à la charge par eux d’en justifier, aux termes et
selon les formes que l’Assemblée nationale aura décrétés, après avoir
entendu à ce sujet l’avis de son Comité des Domaines. Le Roi a sanctionné et sanctionne le dit décret, pour être exécuté suivant sa forme et teneur. » Est édité et prononcé le Discours à la Reine
de M. Joseph Delaunay d'Angers, au nom de la Garde nationale du
Maine-et-Loire. Et à cette occasion, M. Palloy, en charge de la
destruction de la Bastille tresse des louanges au Peuple français
(ci-dessous). Pendant 3 jours, à partir du 18, ont lieu des fêtes et
illuminations, des réjouissances sont offertes dans la capitale, comme
un repas dans tous les districts parisiens par les Gardes nationales, ou bien entre le pont-Neuf et le pont-Royal est organisée une joute avec lance
qui se tient sur la Seine. Le soir, les Champs-Elysées sont illuminés,
et, à la place libérée par la forteresse de la Bastille durant 3
soirées se tient un bal et une illumination champêtre... (Sources : Gallica-Bnf, Musée Carnavalet, Bib. de Stanford)
Fêtes exécutées en mémoire de la Fédération générale : joute sur l'eau, ci-dessous
 Fêtes et illuminations aux champs-Elysées, ci-dessous
Fêtes et illuminations aux champs-Elysées, ci-dessous
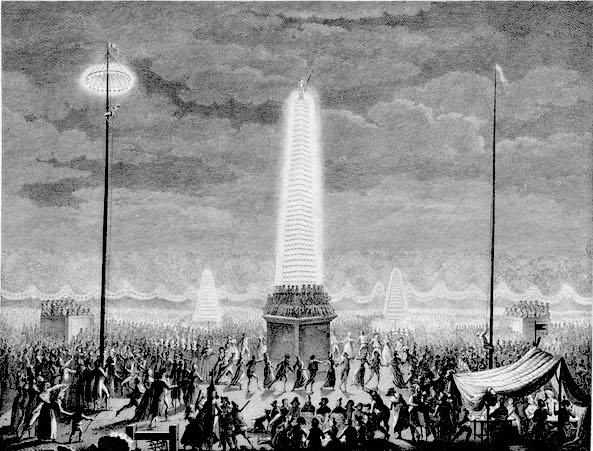 Estampes de Pierre-Gabriel Berthault, graveur - Armand-Parfait Prieur, dessinateur
Estampes de Pierre-Gabriel Berthault, graveur - Armand-Parfait Prieur, dessinateur
22
et 23 juillet : Le Roi, sur les conseils des prélats, accepte la
Constitution civile du clergé, mais demande un délai avant de la
promulguer (la loi sera sanctionnée favorablement fin décembre). Le
lendemain, Louis XVI reçoit des « lettres confidentielles » du pape,
des archevêques de Bordeaux et de Vienne, datées du 10
juillet, qui condamnent la loi civile du clergé.
24 juillet : A Paris, l'Assemblée fixe les traitements du clergé et
renforce les dispositions du serment de la loi civile (lire le 27
novembre).
25 juillet : Gers, le dernier intendant de la ville d'Auch transmet ses
pouvoirs à M. Jean Moysset, le premier président du Conseil-général
gersois. Ce département s'est appelé un court temps département de
l'Armagnac...
26 juillet : A Lyon, la contre-révolution s'organise. A la Constituante
est réduit le pacte de famille avec l'Espagne. Jean-Paul Marat lance un
appel, dans non pas, L'Ami du Peuple, mais
un journal de 8 pages qu'il nomme exceptionnellement
: C'est en fait de nous. Il
demande aux citoyens à ramener de Saint-Cloud le roi et le dauphin au
plus vite, de
mettre sous-clef la reine et son beau-frère (le comte de Provence), de
s'armer dans chaque
district et de couper la tête à cinq ou six-cent personnes pour assurer
le repos, la liberté et le bonheur ; et pour éviter l'effusion de sang
à venir... (Source : Gallica-Bnf)
27 juillet : Est signé le traité de Reichenbach entre la Prusse et
l'empereur
d'Autriche, laissant à ce dernier le champ libre pour réprimer le
soulèvement belge. La Révolution des Français commence à inquiéter les
souverains
européens.
28 juillet : L'Assemblée refuse de laisser passer par le territoire
français des troupes autrichiennes envoyées pour réduire l'insurrection
belge.
29
juillet : Au sein de la Constituante, depuis six mois, les députés
discutent de
l'importance des effectifs et de la nature des troupes. Le comte de
Latour du Pin, ministre de la guerre, a défendu son projet, il a exposé
que la défense des frontières exigerait 250.000 hommes, pouvant être
ramenés à 150.000 en temps de paix. Lameth, au nom du comité militaire,
estime qu'une réserve de 50.000 pour un effectif de paix de
150.000 soldats suffit amplement. Suisse et Italie, les émigrés
présents à
Chambéry et à Turin tentent d’obtenir l’aide du roi de Sardaigne dans
leur lutte contre la France.
30 juillet : Dans la Meuse, il éclate une insurrection du régiment de
la Reine-cavalerie à Stenay.
31 juillet : A l'Assemblée, M. Malouet reprend le contenu violent des
déclarations de Marat dans son édition du 26/07 et dénonce un complot
contre le roi, etc.. « Eh
bien, c'est sous vos yeux, c'est à votre porte, que des scélérats
projettent et publient toutes ces atrocités ; qu'ils excitent le peuple
à la fureur, à l'effusion du sang ; qu'ils dépravent ses mœurs et
attaquent, dans ses fondements, la Constitution et la liberté. Les
représentants de la nation seraient-ils indifférents, seraient-ils
étrangers à ces horreurs? Je vous dénonce le sieur Marat et le sieur
Camille Desmoulins. » Après quelques échanges, il est voté un
décret proposé par M. Malouet et son projet est adopté en ces termes :
« L'Assemblée
nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite, par un de ses
membres, d'une feuille intitulée : C'en est fait de nous, et du dernier
numéro des Révolutions de France et de Brabant,
a décrété que, séance tenante, le procureur du roi au Châtelet de Paris
sera mandé, et qu'il lui sera donné ordre de poursuivre, comme
criminels de lèse-nation, tous auteurs, imprimeurs et colporteurs
d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à,
l'effusion du sang et au renversement de la Constitution ».
VIII – Le mois d’août 1790
Dimanche 1er août : A Nancy : les grenadiers du roi de protestent
contre
l'emprisonnement d'un de leur camarade, le militaire participait aux
séances du club des Jacobins local et y réclamait sa solde. Le
commandement de la place, de Noue, le suspend de toute fonction dans la
compagnie des grenadiers Suisses de Châteauvieux (Loir-et-Cher), les
cavaliers de Mestre de Camp se solidarisent avec elle. « Dans
un climat tendu par le contentieux des masses régimentaires, les
soldats se révoltent contre une punition infligée à l'un de leurs
camarades. De Noue, commandant en chef de la garnison de Nancy, veut
imposer une sanction géné́rale. Les soldats se rebiffent et réclament
la vérification des comptes. De Noue n'insiste pas. » A Grenoble,
Antoine Barnave est élu maire. Mais il démissionnera en novembre.
2, 3 et 4 août : A la Constituante, M. de Noailles demande la permission
de se retirer à Nemours, où ont été observés des troubles, il reçoit
l'autorisation de partir. J.P. Marat dépose ses hommages et remet un
plan de législation criminel à l'assemblée. Le président ordonne la
lecture de la lettre signée par M. Desmoulins, celui-ci demande que
soit établi un rapport sur ce qu'il a pu écrire d'incriminant dans son
journal Les révolutions de France et
de Brabant
au numéro 35. Présent dans l'hémicycle Camille Desmoulins est demandé à
la barre pour s'expliquer et qu'il soit arrêté, mais après
l'intervention de MM. Malouet et Robespierre, Desmoulins s'est
éclipsé... Le 3, il est décidé la suppression des pensions existantes
au 1er janvier 1790, ainsi
que la
règle à observer par les intéressés pour son rétablissement (sic), et
création des « récompenses nationales ». A la séance du 4, qui commence
à neuf heures du matin, il est fait état du bulletin de santé du roi
(depuis le château de Saint-Cloud). M. Jacques Guillaume Thouret,
député du Tiers de Rouen et rapporteur, mène les débats autour du
nouvel ordre judiciaire et aborde les titres IV, V et VI et enchaîne
les articles les uns après les autres. Cela commence par le transfert
des affaires d'un tribunal pour cause d'appel d'un district à un autre,
et le dernier article examiné de la journée est consacré aux greffiers,
à leur nomination et durée dans l'emploi.
5 août : A Paris, un administrateur au département de police dénonce
l'enfer des femmes à la Salpêtrière. Le plus grand lieu de réclusion
des femmes en Europe (environ 8.000 personnes) appartient à cet
ensemble administratif né sous le roi Louis XIV sous le titre «
d’Hôpital général ». Ce n’était pas précisément un hôpital, mais un
espace d’enfermement des plus pauvres ou déviants, et concernant la
Salpêtrière l’on y trouvait notamment les prostituées ainsi que leurs
enfants en bas-âge. Les Hôpitaux généraux deviendront plus tardivement
au mitan du XIXe siècle l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
(AP-HP).
6 août : A l'Assemblée, l’on condamne les mutins comme des traîtres à
leur patrie, mais se propose d’écouter les doléances des soldats.
7 août : Le nom de « Secrétaire de la Maison du roi » est changé en
ministère de l'Intérieur.
8 août : A Saint-Domingue, l'assemblée des colons est dispersée par la
force sur les ordres du gouverneur. Le même jour, le vaisseau le Léopard
est en rade de Saint-Marc. Le navire a embarqué les
85 membres
de l'assemblée coloniale auto-proclamée de Saint-Marc et fait route sur
Brest, suite à une mutinerie de l'équipage. Ils seront nommés les « Léopardins ou la faction des 85 ».
9 août : A Nancy, pour réponse à la condamnation du 6
août, la garnison n'apprécie pas, elle se mutine contre les officiers
et contrôle les caisses de son régiment pour pouvoir être payée.
10 août : Suite au décret du 31 juillet dernier sur la presse de M.
Malouet, Jacques-Pierre Brissot écrit dans Le Patriote français
du jour, que pour « Punir la calomnie, sans blesser la liberté de la
presse, est le problème le plus difficile à résoudre en politique. »
11 août : Au bois de Boulogne, les députés Barnave et Cazalès se
battent en duel au pistolet. Trois coups sont tirés, deux sans effet et
une troisième balle effleure le bord du chapeau de M. Cazalès. M.
Barnave considère l'offense réparée.
12 août : La Constituante donne aux directoires départementaux le
pouvoir d’annuler ou refuser les actes inconstitutionnels des
municipalités, ainsi est étendu le contrôle de légalité des actes
administratifs à son contrôle de constitutionnalité.
13 août : Le Roi fait une proclamation sur le décret pris ce jour,
qu'il n'y aura plus d'apanages
(*) réels et révocation de ceux-ci. (*) Ce sont des biens concédés à un
ou
des enfants en compensation à un renoncement, et pour assurer leur
train
de vie son sens premier, par exemple à des enfants nés hors mariage,
comme le fit Louis XIV.
14 août : A l'occasion de la signature de la paix avec la Russie, le
roi de Suède, Gustave III, évoque une croisade contre-révolutionnaire.
15 août : A Nancy, les soldats Suisses en garnison
du régiment de Châteauvieux se révoltent contre leurs officiers.
16 et 17 août : A l'Assemblée, sont créées les justices de paix
et la
vénalité est abolie (ce qui peut être vendu) des offices de «
jurication » (ce qui
détermine le territoire). La justice sera rendue gratuitement. Le
lendemain, il est approuvé que les excès commis par les
soldats révoltés seront punis comme « crimes de lèse-nation ».
18 août : Dans la région ardéchoise se trame une
conspiration royaliste
à la Commanderie de Jalès. La contre-révolution s'organise un peu
plus. Nous
sommes
sur une terre traditionnelle des guerres de Religion, 20.000 hommes se
sont rassemblés dans le sud de l’Ardèche. Des nobles et des gardes
nationaux hostiles à la Révolution, pour eux l'Assemblée est une chose
monstrueuse. De même, l'oeuvre de la Constitution est tenue pour nulle
et ses membres sont regardés comme des criminels de « lèse-majesté ».
En liaison et accord avec le comte d'Artois et les émigrés, les fédérés
du camp de Jalès sont bien résolus à soulever tout le midi de la France.
19 août : Comme a pu l'écrire l'historien Albert Soboul, « ainsi débutèrent les relations de
Saint-Just et de Robespierre »,
par une lettre envoyée par le jeune citoyen au député, Saint-Just
s'adresse à Robespierre par courrier pour lui demander à ce que
Blérancourt, là où il demeure ne perde pas son marché. Robespierre
conservera longtemps cette lettre sur lui, l'hommage d'un jeune inconnu
de 23 ans. « Vous qui soutenez la
patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l’intrigue,
vous que je ne connais que, comme Dieu, par des merveilles ; je
m’adresse à vous, monsieur. » (...) « Je
ne vous connais pas, mais vous êtes un grand homme. Vous n’êtes point
seulement le député d’une province, vous êtes celui de l’humanité et de
la République. » (Source : L'ARBR, extraits de l'Oeuvre complète de
Saint-Just)
20 août : Première
Adresse des officiers du Jardin des plantes et du Cabinet
d'histoire naturelle, lue à l'Assemblé́e nationale : « tous
les Français sont admis dans les Cours que l'on donne au jardin des
plantes, mais encore les étrangers y forment une partie considérable
des auditeurs ; il n'est pas rare de trouver parmi eux des Péruviens,
des Brasiliens, des Anglo-américains, et même des Asiatiques que
l'étude de l'histoire naturelle attire et retient pendant très
longtemps en France ; et l'établissement du jardin des plantes
n'augmente-t-il pas ainsi la prépondérance et la gloire de la Nation,
par un des moyens politiques les plus nobles et souvent les plus
avantageux? Le
jardin des plantes et le cabinet d'hittoire naturelle sont donc de la
plus grande utilité pour toutes les parties de l'empire. »
(Source :
Gallica-Bnf, 80 pages)
21-22 août : Le Constituante se consacre
au droit d'association, elle autorise par la loi aux citoyens le droit
de s'assembler et de former entre-eux des sociétés libres. Le
lendemain, il est reconnu aux fonctionnaires de l'état le droit d'avoir
une retraite.
23 août : Brevet de volontaire de la Garde nationale Parisienne
attribué à M. Jean Leguy (ci-dessus,
source Musée Carnavalet)
24 au 26 août : A l’Assemblée, est terminé l'examen de la loi
fondamentale en matière de justice et mettant fin aux pratiques du
passé (charges, torture, etc...). Il est instauré la séparation entre
les deux ordres de juridictions un ordre judiciaire et un ordre
administratif, le principe de l'égalité devant la justice et de la
gratuité, le droit de faire appel, le jury populaire
en matière criminelle, la professionnalisation des magistrats, et
comme
principes : la simplification admnistrative, l'indépendance de la
magistrature et la protection des intérêts privés et de la
personne humaine (source Ministère de la Justice - 2007).
Le même jour des déclarations contre la censure au
théâtre sont menées par Joseph Chénier et Robespierre. De son côté, le
roi
sanctionne le décret sur la Constitution civile du clergé. Deux jours
après, l’on aborde la réorganisation de la direction des Postes et
Messageries.
 |
|
27 août : Au
Palais Royal, le roi, devant l'impuissance des
autorités
ou leur refus de ramener l'ordre, nomme le marquis de Bouillé
(ci-contre) pour faire appliquer le
décret du 16 août. Le député et abbé duc de Montesquiou présente un
rapport à l'Assemblée sur l'état des finances, la dette de l'état est
évaluée à plus de 4 milliards de livres françaises, ou l’équivalent de
ce qui va être mis en circulation comme assignats pour renflouer les
caisses et les remettre à zéro. Résultat, si 600 millions ont pris déjà
la route de l’exil avec les émigrés, le cours de cette monnaie va être
soumis à une
rapide dépréciation. Il est aussi décidé la transformation des
assignats en papier-monnaie.
|
28 août : Proclamation
du Roi sur le décret de l'Assemblée nationale, qui désigne les
villes où seront placés les tribunaux de districts. (Source
: Gallica-Bnf, 25 pages et villes classées par département)
29 août : A l'Assemblée, il est voté une loi sur les postes et
messageries, où le facteur ne peut prendre ses fonctions qu’après avoir
prêté serment spécifié par la loi concernant le secret des
correspondances. « Je jure de
remplir fidèlement mes fonctions, de garder et observer exactement la
foi due au secret des lettres et de dénoncer aux tribunaux toutes les
contraventions qui viendraient à ma connaissance ».
|
MÉMOIRES, CORRESPONDANCE ET MANUSCRITS DU GÉNÉRAL
LAFAYETTE, PUBLIÉS PAR SA FAMILLE. (1837)
« Mais c'est en
vain que les ennemis publics espèrent, en multipliant les fatigues de
la garde nationale, de décourager son activité et sa constance. Voués
par nos principes comme par nos serments au maintien de la constitution
et de l'ordre public,sûrs (le commandantgénéral est autorisé à le
déclarer en leur nom, d'être soutenus par toutes les gardes nationales
de France , nous ferons notre devoir avec un zèle inaltérable,et, s'il
le faut, avec une inflexible et sévère fermeté. »
Les détails de cet
ordre du jour
ont rapport à l'exécution des différents arrêtés du pouvoir civil.
Depuis longtemps on cherchait à exciter l'indiscipline dans les troupes
et la désunion entre les soldats et les officiers ; c'était un des
grands
moyens sur desquels la contre-révolution fondait son espoir. Les
histoires du temps ont consigné le triste événement de la révolte de la
garnison de Nancy, réprimée par les gardes nationales et les troupes de
ligne aux ordres du général Bouillé (1). Les patriotes sentirent, pour
la plupart, le besoin de lui donner l'appui de l'assemblée, et dans la
séance du 30 août, Lafayette prononça ces paroles. :
Les informations
que vous avez ordonnées nous feront connaître, je l'espère, les auteurs
des troubles dans les garnisons et les livreront à la rigueur des lois.
Mais il s'agit de la crise actuelle : elle est pressante, notre
situation est délicate ; et c'est pour cela même qu'un bon citoyen
n'hésite pas à donner son avis. Je sais, Messieurs, que M. de Bouillé
portera, dans l'exécution de vos décrets, son énergie, ses grands
talents, et cette loyauté qui le caractérise; il vous demande, et
votre comité vous propose un témoignage, que vous ne pouvez trop vous
hâter de lui donner. Je le réclame pour lui, pour les troupes
obéissantes qui concourront avec leur général à supprimer la rébellion ».
L'Assemblée adopta
dans cette
séance le décret proposé dans le même sens par Barnave. La rébellion
fut réprimée, et le général Bouille reçut, sur la proposition de
Mirabeau, les remerciements de l’assemblée (2).
Notes de l'extrait :
(1) A la suite de graves
désordres dans une partie de l'armée, l'assemblée nationale avait
rendu, le 6 août, un décret qui prohibait dans les régiments toute
association délibérante, autre que le conseil d'administration,
établissait des inspecteurs extraordinaires nommés pas le roi pour
vérifier les comptes de chaque régiment, en présence d'un certain
nombre d'officiers, sous-officiers et soldats, etc. Ce décret fut violé
à Nancy, par la rébellion de trois régiments qui arrêtèrent leur
inspecteur, M. de Malseigne, et un commandant, M. Denoue. Le 16,
l'Assemblée décréta de nouvelles mesures pour réduire les rebelles ; en
conséquence, le 31, M. de Bouille, à la tête d'un corps composé de
troupes de ligne et de gardes nationales, entra de vive force à Nancy,
et après un combat sanglant, y rétablit l'exécution des lois.
(2) « L'insurrection
de Nancy, provoquée par l'aristocratie des officiers, n'en était pas
moins une rébellion très dangereuse contre le gouvernement national et
contre le décret de l'assemblée. Je contribuai beau coup à faire donner
au roi, et au général Bouillé, les moyens de la réprimer ; je traitai
les intérêts de M. Bouillé avec les chefs jacobins d’alors; j'invitai
les gardes nationales à se joindre à lui ; je me joignis à Mirabeau,ou
pour mieux dire, je lui inspirai sa motion pour faire remercier M. de
Bouillé et ses troupes; en un mot, je servis avec zèle, non seulement
l'ordre public, mais le général, qui dans ses Mémoires regrette de
n'avoir pas profité de ces avantages pour trahir plutôt la cause
constitutionnelle ».
Note
du général Lafayette
|
31 août : A Nancy, le marquis de Bouillé entre dans
la ville
après
de durs combats faisant plus de 300 morts, la répression est sanglante
et forte : une trentaine de soldats suisses sont roués ou pendus, plus
de 40 sont condamnés aux galères, et la Garde nationale est
réorganisée.
Suite à cette répression, par M. de Bouillé, de la rébellion de Nancy,
l'Assemblée lui adressera des remerciements, puis les annulera suite au
rapport du député Sillery, et Louis XVI rédigera un
courrier de félicitations (début septembre).
IX – Le mois de septembre 1790
C'est
en septembre ou durant l'été 1790 que commence à paraître : Je suis le véritable
Le Père Duchesne, foutre
de Jacques-René Hébert pour contrer Lafayette. En
novembre apparaît en première page le
dessin ci-contre. Ce
périodique
bi-hebdomadaire de huit pages ne sera pas numéroté avant le mois de
janvier 1791 et il paraîtra jusqu'en 1794. Le journal est imprimé en
1790 chez le sieur Tremblay au sein de la rue basse Saint-Denis (*),
les années suivantes rue des Filles-Dieu chez le même imprimeur. (*)
Proche du boulevard Bonne-Nouvelle dans l'actuel dixième arrondissement
de Paris. (Source : Gallica-Bnf)
|
|
 |
Mercredi 1er septembre :
Le duc de Liancourt fait connaître au comité de mendicité, les
résultats de sa visite avec M. Decretot au Mont-de-Piété,
considéré comme une annexe de l'Hôpital général. A Brest, 2.000 ouvriers des arsenaux se mettent en grève.
2 septembre : Un décret de l'Assemblée
nationale supprime le costume
traditionnel des compagnies judiciaires. Les travaux du comité sur la
mendicité sont repoussés d'un mois à la demande de M. Prieur « pour
donner le temps de connaître les ressources des hôpitaux et autres
établissements de charité, et préparer un travail complet sur cette
partie. » Dans la capitale, il éclate une émotion
en faveur des Suisses. A l'annonce de la répression sanglante des
mutineries de Nancy, des Parisiens se sont rassemblés. Cinq-mille
personnes en début d'après-midi du Palais-Royal
se dirigent vers l'Assemblée. Arrivés aux Tuileries, l'on dénombre
quarante mille citoyens devant la salle du Manège criant :
Les ministres à la lanterne!
Cette foule en colère réclame le renvoi de MM. Necker et de La
Tour du Pin (ministre de la guerre). Puis il est proposé d'aller à
Saint-Cloud, où se trouve le roi lui-même, mais cela reste sans effet.
La rapidité avec laquelle s'est
organisée le rassemblement et son ampleur surprennent. Il sera dit que
ces
manifestants n'avaient rien de spontanés et que des meneurs issus des
Jacobins auraient été la cause de l'agitation
d'aujourd'hui.
3 septembre : A l'Assemblée, l’on réduit le budget de la bibliothèque
du roi de 140.000 à 110.000 livres.
4
septembre : Démission et départ de M. Necker, son remplaçant aux
finances est M. Claude-Guillaume Lambert, baron de Chamerolles
(jusqu'au 4
décembre). Favorable à l'emprunt et refusant d'emettre des assignats,
est la raison officielle de la décision du départ de Jacques Necker de
son poste de ministre. A l'Assemblée, le citoyen anglais et lieutenant
au régiment Royal-Higland, M. Jean Oswald, membre de la société des
amis de la Constitution, offre une ode rédigée par ses soins : le Triomphe de la
liberté (en anglais),
pour honorer la Révolution. Et un exemplaire sera déposé aux archives.
La Constituante s'attribue la direction du Trésor public.
5 septembre : M. Michel Roussier démissionne de son poste de
député. « Il
y joua un rôle assez effacé, fut adjoint au doyen des communes, fit
partie du comité des subsistances, prêta le serment du Jeu de paume, et
ne prit qu'une fois la parole pour proposer une définition du
gouvernement monarchique (...) et ne reparut plus dans les assemblées
parlementaires. » (Source : Biographie extraite du
dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, d'Adolphe
Robert et Gaston Cougny)
6 septembre : A Angers, les femmes réclament la diminution du prix du
pain, elles sont suivies par les ouvriers des carrières. La troupe tire
et tue : 45 hommes, 4 femmes et 2 enfants. A Brest, 2.000 marins des
navires le Léopard en
provenance de
Saint-Domingue et l'America, plus
le Majestueux se
révoltent et parmi leurs doléances portées à l'hôtel de la ville,
ils demandent de ne plus porter le pavillon blanc, mais un drapeau
tricolore, rouge, blanc, bleu de manière verticale (à l'inverse de
celui des Hollandais).
7 septembre : A la Constituante, l’on promulgue un décret sur
l'organisation des Archives nationales.
8 septembre : Marat dans L'Ami du
Peuple (n° 215) après avoir rapporté en quoi consiste le décret
sur le "bouton d'uniforme" et l'importance du sujet en réponse à une
lettre sur l'affaire de Nancy, il remarque « avec
quel soin les ministériels qui l’ont forgé ont supprimé de la
légende la nation qui seule peut vous rappeler la patrie, pour ne
laisser que la loi et le roi. Ils ont beau vous crier la loi, c’est la
nation, et la nation c’est vous, ils mentent impudement, tant que vous
n’aurez pas fait la loi et tant que la loi sera faite par eux, qui sont
vos plus mortels ennemis. » Cette fois, c'est la tête des
ministres qu'il souhaite couper... et demande à se hâter. (Source :
Gallica-Bnf, page 6)
9 septembre A Paris, la Section de l'Oratoire fait une adresse
sur l'émission des assignats-monnaie, ci-après :
0
Adresse de la Section de L'Oratoire (*)
à l'Assemblée nationale
*
Sur
l'émission des assignats-monnaie

(*) Paris en rive gauche ou nord - quartier du Louvre
Ce
n'est pas par des opérations
partielles (et l'expérience l'a prouvé) qu'on remédie à de grands maux
; vous en étiez convaincus, lorsque vous avez commencé le glorieux
monument de la constitution, qui, malgré les clameurs des ennemis de la
liberté, et les transes des êtres liés à l'arbitraire de l'ancien
régime, s'élève néanmoins et atteindra dans peu la perfection et
l'immuabilité, unique but de vos travaux et de nos vœux.
Ce que vous avez fait pour les lois, Messieurs, vous le ferez pour les
finances, autrement l'intérêt qui nous mine finirait par tout absorber.
Vous admettrez, Messieurs, l'émission des assignats-monnaie, idée
conçue parmi vous, idée simple et grande en même temps, qui, exposée
depuis quelque-temps à l'opinion, ne trouve guère de contradicteurs que
ceux qui, vivant et s'enrichissant de la variabilité des effets
publics, n'en peuvent voir l'extinction sans angoisses.
Si vous ne leur donnez la chance des inquiétudes et des hasards ; si
vous ne commettez des fautes qu'ils convoitent, et dont ils puissent
commercer, pouvez-vous aspirer à leurs éloges? Redoutez-les plutôt,
Messieurs, et permettez à une assemblée primaire, placée au centre du
commerce de cette capitale, qui recueille l'opinion publique dans sa
véritable source, de vous exposer ce qui la détermine : en effet, il
existe des agioteurs qui préfèrent un projet de quittances portant
intérêt à celui qui opère à jamais le paiement réel de la dette
exigible ; l'Assemblée ne doit-elle pas être frappée d'une préférence
aussi bizarre qu'alarmante? mais quelques soient les talents et
l'éloquence, les défenseurs de ce projet répondront-ils à cette simple
objection qui s'offre à tous les esprits?
Il
grève l'état de cent vingt
millions net à payer aux porteurs. Or, quiconque a la moindre
connaissance de l'impôt, de ses frais de perception, du déficit
nécessaire qu'il éprouverait, conviendra que pour lever encore une
somme aussi prodigieuse sur des contribuables déjà exténués, il
faudrait la porter au double ; tel est le premier fléau de cette
opération ajouté gratuitement à nos misères; qu'on ne croie pas
non-plus qu'il soit momentané, il doit finir par tout engloutir.
Quel serait effectivement dans les premières années, le porteur un peu
garni de ces quittances, qui voulût échanger un effet qui, sans soins,
sans inquiétude, lui rapporte un intérêt qui lui convient, contre un
bien-fonds qui communément en rapporte un moindre?
Il le gardera dans ses mains, et laissera les biens-fonds aux amateurs
de l'agriculture, qui seront ses fermiers. Mais, dira-t-on, n'est-il
pas juste que les créanciers soient remboursés, et qu'ils ne soient pas
contraints d'employer leurs capitaux à un usage déterminé qui soutient
le contraire? Les porteurs d'assignats ne seront-ils pas maîtres de les
échanger, d'en disposer comme bon leur semblera? ces billets ne
seront-ils pas une véritable monnaie? Veut-on conclure que de ce que
les créanciers auront avec ces titres une faculté exclusive d'acheter
des domaines nationaux, ce privilège qui enrichit l'effet, nuise à la
volonté du porteur?
Tel est cependant un des grands arguments des antagonistes des
assignats ; mais ce n'est plus aux gros capitalistes qu'il faut parler.
Qu'est-ce qui les touche? Le gain immodéré. Quelle est leur patrie? La
bourse. Quels sont leurs vœux? La baisse, quand ils veulent acquérir ;
la hausse, quand ils veulent revendre. C'est à ceux qui, vivant du
revenu modique de leurs fonds, n'ont d'espérance qu'en eux ; et
mesurant habituellement l'avenir avec tranquillité, formés dès
longtemps à l'inaction, à mettre la recette de leurs rentes au nombre
de leurs plus grandes fatigues, ne sont plus faits pour se charger des
soins innombrables des propriétaires : ils n'acquerront pas, s'ils ne
prennent pas ce parti ; croient-ils que les gros capitalistes, qui
convoitent d'avance leurs titres, le fassent? Ceux-ci n'y penseront que
lorsque l'état, incapable de payer avec l'impôt, épuisé d'obligations,
sera contraint de leur tout abandonner.
Pendant
ce cours de calamités, les
bien nationaux seront usurpés, dégradés, les intérêts de ces titres
sans paiement ; et alors, à quelle triste situation ne sera pas exposée
cette classe de porteurs de quittances, la seule inquiétante? Ils
n'auront plus pour eux que la pitié des premiers, qui, concentrant dans
une seule place les effets décriés, en deviendront propriétaires au
prix qu'il leur plaira de fixer.
Et si cependant, à travers mille dangers, l'état parvenait à
s'acquitter aux dépens de sa propriété et des impôts avec ces
accapareurs de quittances ; tant de crises, tant de peines, tant de
sacrifices ne serviraient, comme l'a dit un de vos célébrés orateurs,
qu'à créer un nouvel ordre de grands propriétaires fonciers, qui,
donnant plus au luxe et à la ruine des campagnes qu'à l'art de
fertiliser la terre et d'étendre les bienfaits de l'agriculture,
empêcherait la division des propriétés, fondement inébranlable de l'a-
abondance, mais devenue désormais impossible par cette malheureuse
catastrophe.
Mais quel contraste dans le tableau offert par l'émission des
assignats-monnaie. Ce n'est pas l'imagination qui aime à se dégager
d'images nombres par d'agréables chimères ; c'est un avantage manifeste
d'abord, ensuite des résultats heureux appuyés par l'expérience.
Au
moment où vous acquittez la dette exigible, une levée de cent
vingt millions net, dégagée des pertes et des frais qu'elle entraîne,
disparaît, et rend les autres impositions plus légères et plus sûres,
détermine le paiement de la rente constituée à sa véritable époque,
dégage des entraves du malaise l'état, et les contribuables qui
s'acquittent avec ponctualité.
Dès-là
que ces dépenses sourdes et cachées, et les prodigalités avouées
deviennent désormais impossibles, tout engorgement cesse, l'ordre et le
crédit qui le suit immédiatement renaissent.
Par
rémission des assignats, voyez
les capitalistes, ces hordes d'agioteurs, sont contraints d'employer
leurs fonds innombrables, grossis des fortunes des particuliers et de
la misère publique, à acquérir des biens, ou dans les manufactures,
tous ceux qui habituellement plaçaient dans les emprunts, ouverts par
le gouvernement, subissant la même loi, versant leurs économies de
plusieurs années sur ces objets intéressants, et soutenir de tous leurs
efforts ce qu'ils calomnient aujourd'hui ; vous verrez, Messieurs, si
leur dépit tiendra contre leurs intérêts, et si au plaisir de se nuire
à eux-mêmes, d'enterrer un numéraire qui n'aura plus d'aliment, ils ne
préféreront pas un emploi profitable.
Mais n'a-t-on pas eu la stupide audace de comparer les assignats futurs
aux billets du système, et l'impudeur d'en faire sortir des décombres
où ils étaient ensevelis, pour les montrer au public, comme des garants
du sort futur des assignats. Mais les bases chimériques des premiers
peuvent-elles être opposées à celles de l'émission actuelle, à ces
possessions superbes, qui, enviées depuis tant de siècles, couvrent la
France d'un bout à l'autre, et frappent et charment tous les regards.
Eh quoi! jadis sur le simple préambule d'un édit, sans autre sûreté
que ses phrases, vous portiez en foule votre argent, vous le
précipitiez à force ouverte dans les coffres d'un gouvernement
dissipateur, et aujourd'hui, vous ne voudriez pas d'un effet avec
lequel vous pouvez à l'instant commercer, acquérir, payer, qui vous
offre toutes les ressources, qui a pour garant des biens innombrables,
une nation pleine d'honneur, dont le premier cri et la première loi
furent la probité, qui ne succombe sous le faix (lourd fardeau), et n'a recueilli que
pour vous. Mauvaise foi insigne! craintes artificieuses, dont le
fondement nous à coûté si cher!
Vous rendrez nulle, Messieurs, cette coalition formelle entre les
marchands d'effets, et ceux dont l'intermédiaire, devenu moins utile
dans l'intérieur du royaume d'abord, ensuite au dehors par l'émission
des assignats, doit nécessairement être réduit aux seules affaires du
crédit.
A tous les motifs de presser cette opération salutaire, se joint le
retour de l'hiver, si redoutable dans les temps de détresse ; les
ateliers de charité, qui en sont le signe évident, vont entasser à
grands frais les malheureux ouvriers des manufactures languissantes, en
occuper l'activité à des travaux inutiles, et ces hommes précieux
peut-être n'y pourront tous être admis. Que deviendront-ils?
Ne levez plus vos yeux de ce tableau, Messieurs, fait pour émouvoir ;
puisse-t-il vous déterminer à ce qui nous amène devant-vous! Vous vous
opposerez à cette voracité funeste qui peut tout engloutir ; vous
daignerez condescendre à nos vœux, consignés dans un arrêté que nous
vous présentons avec confiance ; nous croyons qu'il n'en est aucun qui
n'ait pour motif le bien commun de la France ; s'il en est d'erronés,
votre sagesse saura les connaître. Par cette opération, l'aisance
s'introduisant dans les classes les moins aisées, y ramènera le calme
et la circulation, qui sont leur seule ambition ; tout refleurira dans
l'empire que vous avez reconstruit, et l'étranger accourant se fixer
dans la plus belle contrée de l'univers, au milieu d'un peuple heureux
et libre, vous proclamera les libérateurs du monde, et c'est alors
qu'au sein de l'allégresse universelle, vous jouirez de vos travaux
immortels et de vos sacrifices.
Aubriet Commissaire - Rédacteur.
EXTRAIT du registre
des délibérations de la Section de l'Oratoire.
Du 9
Septembre 1790
En
l'assemblée générale de la Section
convoquée en la maniere accoutumée, pour délibérer sur le projet d'une
nouvelle émission d'assignats-monnaie, pour acquitter la dette
exigible. Après avoir entendu, pendant deux séances consécutives tous
les citoyens qui avaient demandé la parole, l'assemblée a été
unanimement d'avis.
1°. Que
l'émission de nouveaux assignats y jusqu'à concurrence de la dette
exigible , serait généralememt avantageuse.
2°. Que leur cours devrait être forcé.
3°. Que ces assignats ne devaient porter aucun intérêt.
4°. Que dans la vente des biens nationaux, les assignats devaient être
reçus en paiement, exclusivement à l'argent.
5°. Que la facilité des échanges paraissait exiger que , dans la
nouvelle émission, il y ait pour une somme des billets de 100, 25 et 6
livres
6°. Que pour assurer le cours & le crédit des assignats,
l'Assemblée nationale serait suppliée d'ordonner la publication dans
les papiers publics, avoués de l'administration, & qui paraissent
chaque jour , de la note exacte de toutes les ventes qui auront eu lieu
dans tout le royaume, ainsi que de la somme & des numéros de tous
les assignats brulés en conséquence des décrets.
7°. Il a été arrêté en outre, que l'Assemblée nationale serait suppliée
de faire précéder l'émission des assignats par une fonte de trente
millions de nouveaux Billons (monnaie en cuivre) y pour être d'abord et
de préférence employés au paiement de la solde des troupes dans les
villes frontières ; ce qui conserverait le numéraire dans le centre du
royaume, et l'exportation à l'étranger.
L'assemblée arrête pareillement que le présent serait imprimé sans
retard et envoyé à M, le président de l'Assemblée nationale, à MM. du
comité des finances, du comité de commerce et d'agriculture, à MM. les
représentants de la ville de Paris, à l'Assemblée nationale, à M. le
maire de Paris, et à MM. les administrateurs de la municipalité
provisoire, et enfin aux quarante-sept autres, sections.
Signé par Etienne Leroux, président et J.A.
Lavau, secrétaire.
Chez Roland, imprimeur de la Section de
l'Oratoire, rue Thibautodé, n°7
Source : Gallica-Bnf, 14 pages, Identifiant : ark:/12148/bpt6k6260845p
|
|
|
10, 11, et 12 septembre : A la constituante, l'on supprime les ordres d'avocats (article 10), «
Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre
ni corporation n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions
». Les avocats sont remplacés par des défenseurs officieux, et l'on
passe ainsi d'une procédure inquisitoire à une procédure accusatoire.
Qui améliore pour beaucoup la défense et la protection des individus
par rapport à l'ancienne loi. Le lendemain, se clôture le débat engagé
depuis le 7/09 et les cours des aides, les bureaux de finances, les
élections (structure administrative des pouvoirs royaux), et les
greniers à sel sont abolis. Le 12, l’Assemblée donne à ses
propres archives le nom d’Archives nationales et
elles sont considérées comme le « dépôt de tous les actes » touchant à
l'organisation du pays, et de « son droit public, ses lois et sa
distribution en départements. »
13 septembre : En rade de Brest, se tient l'Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue à bord du navire le Léopard,
celle-ci s'adresse aux Français. Malgré des éloges sur les nouveaux
pouvoirs en France et la fin du despotisme, sont en cause dans le texte
les autorités locales du roi, le comte de Peynier, et son ministre de
la Marine, M. de La Luzerne, cité deux fois. (Source : Gallica-Bnf, 15 pages)
14 septembre : A l’Assemblée, l’on promulgue une réforme sur la
discipline militaire. Un conseil de discipline est institué dans
chaque corps de troupe. La liste des punitions est publiée : corvées,
piquet, consigne, salle de police, prison, cachot.
15 septembre : Sur l'île Bourbon (île de la Réunion), l'assemblée générale des représentants s'est réunie, « après avoir pris connaissance de l'imprimé qui lui a été adressé par M. de Cossigny (...) contenant les décrets des 8 et 28 mars de l'Assemblée nationale et les instructions relatives ; (...) l'assemblée générale a
été spécialement convoquée pour décider s'il serait envoyé une
députation à Paris et procéder à la nomination d'un ou plusieurs
députés ». (Source: Gallica-Bnf, L'Ile Bourbon pendant la période révolutionnaire, E. Trouette, page 141, tome I, Paris-1888)
16 septembre : A Brest, il éclate une révolte au sein des équipages, les marins des navires le Patriote et le Léopard
sous les ordres du chef de l'escadre, le comte d'Albert de Rions, se
révoltent contre lui.
Celui-ci avait déjà connu en décembre 1789 une mutinerie au sein de
l'escadre de Toulon (il démissionnera, puis émigrera en 1792). A
l'Assemblée, par décret la ville de Niort devient le chef-lieu du
département des Deux-Sèvres, et sanctionné quelques jours plus tard (le
21/09) par le Roi.
17 septembre : Le ministre plénipotentiaire d'Espagne dans la capitale,
M. Fernan Nuñez écrit à son ministre de tutelle, le comte de
Floridablanca : « Hier je suis allé
à Saint-Cloud, faire ma Cour à Leurs Majestés, dont la santé est sans
changement. Le Roi est sorti à cheval l'après-midi. Mais il ne peut
aller au parc de Versailles, car, depuis trois jours, il y a plus de
trois mille chasseurs qui détruisent sa chasse et Sa Majesté ne
veut pas qu'ils soient molestés... Sa Majesté a réformé la majeure
partie de son équipage de chasse » (Source : Albert Mousset, Un témoin ignoré de la révolution, le comte de Fernan Nuñez, ambassadeur d'Espagne à Paris, de 1787 à 1791, page 115, Paris-1924)
Dimanche 18 septembre : Au château de Saint-Cloud, le famille royale découvre la machine hydraulique de M. Augier.
19 septembre : A Paris, les défenseurs de l'ordre tués à Nancy sont
célébrés au champ-de-Mars par des officiers royalistes hostiles à la
Révolution. Le journaliste Elysée Loustalot, rédacteur au sein du journal Les Révolutions de Paris décède ce jour.
20 septembre : La Marche
lugubre pour les Suisses est
un hommage musical pour saluer la mémoire des victimes de Châteauvieux,
que le compositeur F.G. Gossec a écrit cette Marche, pour que « Les
tambours marquent sourdement le pas ; les violons répondent par un
gémissement aigu et plaintif. Ce n'est pas vraiment une mélodie mais
plutôt une suite d'accords poignants, qui frappent par l'audace de leur
harmonie chromatique. Pour renforcer l'effet, Gossec n'a pas hésité à
enrichir l'orchestre militaire de tam-tams, jusqu'alors
inconnus ».
21
et 22 septembre : A l'Assemblée, un décret désigne la ville de Saintes
comme le chef-lieu de la Charente inférieure (aujourd'hui Maritime), et
le lendemain, un décret réglemente l'exercice la
justice militaire, il y est question de la création des tribunaux
militaires.
22-28 septembre : En Belgique, se déroule sur plusieurs jours des
combats, dont la bataille de Falmagne le 22 (et non le 28/09, certaines estampes peuvent induire en erreur), entre
les armées impériales autrichiennes et de la révolution
brabançonne. Devant le manque d'organisation et les divisions entre
patriotes belges, les
troupes impériales remportent la victoire. Les jours qui suivront,
Louis XVI finira par donner son accord pour que les troupes de
l'empereur d'Autriche passe la Meuse par Gizet pour écraser la
révolution belge.
23 septembre : Maroc, le sultan alaouite, Moulay Azid suite à la
capture de deux navires pirates déclare la guerre au royaume d'Espagne,
le lendemain débute le siège de la ville de Ceuta.
24 septembre : A Rome, des cardinaux sont convoqués auprès de Pie VI,
celui-ci cherche à se faire une idée sur la situation en France. A
cette date, « les positions romaines
apparaissent donc beaucoup plus ouvertes qu’on pourrait s’y attendre.
Or, plus de six mois séparent cette congrégation de la formulation
officielle du refus pontifical. On a parlé du « silence » de Pie VI.
Les cardinaux lui conseillaient d’écrire... On a l’impression que la
rapidité des décrets parisiens paralyse les réponses romaines. On
déclarait attendre une détermination de l’épiscopat français : celle-ci
vint, mais Rome attendit encore. » (Source : Open Edition, Rome et la Révolution française, Congrégation du 24/09, de Gérard Pelletier, 2004)
25 septembre : Martinique, M. De Percin un riche planteur prend une
part aux guerres intestines de la période révolutionnaire aux Antilles
; il bat avec d'autres planteurs Jean-François Dugommier, chef de la Garde nationale locale à «
l'Acajou », lui-même propriétaire en Guadeloupe, les combats font 470 morts. M. Dupont député de
Nemours publie son discours sur les assignats, ou sur le projet de créer pour dix-neuf cents millions d'assignats-monnaie, sans intérêt. (Sources : Manioc et Gallica-Bnf, 63 pages).
26 septembre : Dans la capitale, la chambre des députés décrète que
soit versé 10 millions de la Caisse d'escompte au Trésor public. Par
une lettre datée de ce jour, M. « Bailly,
maire de Paris, écrit à Lafayette, commandant de la garde nationale,
que les ouvriers des ateliers de charité ravagent tous les jours les
vignes du territoire de Charonne. Il en a été avisé par la Municipalité
du lieu, et il le prie de faire exercer une surveillance par la garde
nationale de la caserne de Montreuil. » (Source : Gallica-Bnf, Histoire des communes annexées à Paris en 1859. Tome 2, page 12, de M. Lucien Lambeau, Paris 1923)
27 septembre : Lettre de MM. de la municipalité de Brest à MM. les membres de l'assemblée générale de Saint-Domingue à Paris. « Vous
connaissez sans doute la proclamation du roi, dont nous joignons ici un
exemplaire, et vous avez vu, par le décret qui y a donné lieu, qu'on
nous fait un crime d'avoir rempli à votre égard les devoirs sacrés de
l'hospitalité ; qu'on attribue à l'arrivée du vaisseau leLéopard (...) Les
chefs militaires de Brest ont saisi avidement cette occasion pour vous
accuser de la prétendue insurrection des marins, et pour nous calomnier
aux yeux du pouvoir législatif. (...) M.
Hector nous a communiqué ce matin l'ordre du roi, pour transférer à
l'île de Ré le détachement que vous avez laissé à Brest, et que nous ne
verrons partir qu'à regret. Nous ignorons encore quelle sera à cet
égard la décision de MM. les commissaires. Nous vous adresserons
incessamment des exemplaires des pièces que nous, avons fait imprimer
pour mettre dans le plus grand jour votre conduite et la nôtre. Quelque
chose qui puisse arriver, nous ne nous repentirons jamais de l'accueil
que nous vous avons fait, parce que nous avons cru que vous le
méritiez, et que nous le croyons encore. (...) Vos très humbles et très obéissants serviteurs, les membres du bureau municipal. » Signés par MM. Cavellier, procureur de la commune, Nicolas le Roy, Binard et Béchennec. (Source : Gallica-Bnf, pages 1 à 3)
28 et 29 septembre : L'Assemblée décrète et ordonne
l'impression et la communication au Roi de la lettre du directoire du
département de Seine et Oise relativement à la destruction du gibier
dans le parc de Versailles. Ce décret a été pris en raison des plaintes
de Louis XVI... Le jour suivant, un décret est pris pour l'émission de
800 millions
d'assignats, dont des coupures de 100 livres (ci-dessous, source : Musée Carnavalet).
Des troubles se produisent dans la Midi.
30 septembre : L'archiduc Léopold (II) est proclamé empereur
d'Allemagne. En France, parution de la Feuille villageoise de
Cerutti, ancien jésuite, ami de MM. Mirabeau, Bailly, Lafayette et
Necker.
X - Le mois d’octobre 1790
Vendredi 1er octobre :
Village
de
Vaugirard, la compagnie des Grenadiers, Volontaires & Chasseurs
émet avec la municipalité un brevet après l'élection de son nouveau
commandant : « Nous Maires et
Officiers Municpaux, sousignés : certifions que M. Dumas capitaine
d'infanterie, et Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de
St-Louis a été élu commandant de la Garde nationale de Vaugirard
(...) a réuni en sa faveur la majorité absolue des suffrages pour
ce grade ».
A la Constituante, M. Charles Chabroud juriste et député du Tiers pour
le Dauphiné est rapporteur des événements survenus les 5 et 6 octobre
1789. (Persée.fr)
Lors de cette séance sont lus les rapports des commissaires
enquêteurs du Châtelet et M. Chabroud conclue le sien par la mise
en cause du comte de Mirabeau et du duc d'Orléans. S'ensuit un âpre et
long
débat sur les suites judiciaires... sur plusieurs séances et pendant 2
ou 3 jours, qui visera à les dégager de toute responsabilité.
2 et 3 octobre : A l'Assemblée, M. de Mirabeau commence ainsi : « Ce
n'est pas pour me défendre que je monte à cette tribune. Objet
d'inculpations ridicules, dont aucune ne m'est prouvée, et qui
n'établiraient rien contre moi, lorsque chacune d'elles le serait, je
ne me regarde point comme accusé, car si je croyais qu'un seul homme de
sens - j'excepte le petit nombre d'ennemis dont je tiens à honneur les
outrages - pût me croire accusable, je ne me défendrais pas dans cette
Assemblée. Je voudrais être jugé, et votre juridiction se bornant à
décider si je dois ou ne dois pas être soumis à un jugement, il ne me
resterait qu'une demande à faire à votre justice, et qu'une grâce à
solliciter de votre bienveillance, ce serait un tribunal. »
Après une long discours Mirabeau termine son intervention sous des
applaudissements soutenus, de la tribune à sa place. Le lendemain,
c'est au tour du duc d'Orléans d'intervenir : « Compromis
dans la procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris sur la
dénonciation des faits arrivés â Versailles dans la journée du 6
octobre, désigné par ce tribunal comme étant dans le cas d'être
décrété, soumis au jugement que vous aviez à porter pour savoir s'il y
avait ou n'y avait pas lieu à accusation contre moi, j'ai cru devoir
m'abstenir de paraître au milieu de vous dans les différentes séances
où vous vous êtes occupés de cette affaire. Plein de confiance dans
votre justice, j'ai cru, et mon attente n'a pas été trompée, que la
procédure seule suffirait pour vous prouver mon innocence. (...) Ce peu de mots que j'ai mis par écrit, je vais les déposer sur le bureau, pour y donner toute l'authenticité qui dépend de moi. (On applaudit à plusieurs reprises dans la grande majorité de l'Assemblée et dans toutes les tribunes) ».
4 octobre : Le Président des séances de l'Assemblée lit la lettre de M.
de La Luzerne, ministre de la marine sur les troubles à Saint-Domingue et sur
l'agitation des équipages de l'escadre de Brest. (Source
: Persée.fr)
5 octobre : A Paris, il est pris un « Arrêté
du département des hôpitaux relatif aux abus qui se sont introduits en
ce qui concerne l'admission des pauvres dans les ateliers de filature,
décidant que le prix du travail sera toujours inférieur à celui des
travaux de même nature dans les fabriques particulières et réglant les
jours et heures de délivrance des billets d'admission aux pauvres, » signé
M. Bailly et les administrateurs. Lettre de M. Amée, secrétaire de la
section du Jardin-des-Plantes, à M. de Jussieu, lui signalant la
multitude de femmes qui s'amassent aux portes des Bernardins et sont
obligées de revenir plusieurs fois, ce qui aigrit leur humeur bilieuse,
« ces femmes, à son dire, en tout temps ne valant pas grand-chose et encore moins quand la bile est en fermentation » (sic). (Source : Gallica-Bnf, Alexandre Tuetey. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Rév. fr. Tome 3, page 12)
6 octobre : La Cour prend le deuil pour onze jours suite au décès du
duc Cumberland, frère du Roi d’Angleterre, la nouvelle est annoncée par
M. Gower (ambassadeur extraordinaire), lors d'un entretien avec Louis
XVI.
7 octobre : Le capitaine qui a ramené le vaisseau le Léopard
de Saint-Domingue, lors du départ des membres de l'assemblée de
Saint-Marc avait été par décret du 20/09 prié de se présenter devant
l'Assemblée nationale. C'est ainsi que M. de Santo-Domingo, capitaine
de la marine prend la parole devant les députés. Il fera aussi éditer
un livret retraçant les raisons et les conditions dans lesquelles il se
trouva à partir du 29 juillet de cette année : Conduite de M. de Santo-Domingo,
lue par lui-même à
l'Assemblée nationale. (Source : Gallica-Bnf, 8
pages)
M. de Santo-Domingo. «
Je me trouve dans une de ces positions rares où la conduite la plus
pure a besoin d'être justifiée. Je rapporterai simplement les faits, et
j'attendrai sans inquiétude la décision de l'Assemblée nationale et du
roi. Le 29 juillet dernier au matin, M. de La Galissonnière, capitaine
de vaisseau le Léopard,
voulut appareiller pour s'éloigner du Port-au-Prince ; l'équipage s'y
refusa, en disant qu'il savait que les citoyens devaient être
massacrés, et qu'il devait rester pour les secourir : M. de La
Galissonnière observa que la partie française de Saint-Domingue était
divisée en deux parties, dont l'un tendait à l'indépendance : « Eh bien
! dit l'équipage, restons pour conserver la colonie à la France. »
Après avoir inutilement insisté pour le départ, le capitaine descendit
à terre avec son état-major. Je me rendis au gouvernement pour prendre
les ordres de M. de La Galissonnière ; je voulus retourner à bord,
comme le service l'exigeait : il m'ordonna de rester ; j'obéis à cet
ordre que je demandai par écrit. La dissolution du comité de l'Ouest
ayant été effectuée, en vertu d'une proclamation du gouverneur,
j'invitai l'équipage à rentrer dans le devoir, et je me rendis à bord,
sur une permission du capitaine. L'équipage écrivit à M. de La
Galissonnière, pour l'engager à reprendre le commandement ; je lui
écrivis moi-même dans cette vue, et il me répondit qu'ayant perdu la
confiance de son équipage, il ne retournerait pas à bord, et qu'il me
priait seulement de lui renvoyer ses effets. L'équipage s'opposa à ce
renvoi. Mes officiers supérieurs restant à terre, et l'ordre du service
m'appelant au commandement, je le pris et je partis. Etant par le
travers de Saint-Marc, quatre commissaires de l'assemblée générale de
Saint-Domingue me présentèrent un décret qui m'invitait à mouiller dans
la rade pour protéger la ville. M. Vincent parut alors, à la tête de
l'armée, pour dissoudre par la force l'assemblée générale, qui se
détermina à passer en France. (M. de Santo-Domingo fait lecture d'un
grand nombre de pièces, à l'appui des faits qu'il rapporte.) Ainsi dans
toute ma conduite, je me suis conformé aux ordres de mon capitaine ;
j'ai suivi ceux du roi, servi l'humanité, ramené un vaisseau à la
nation : je crois avoir bien mérité de la patrie. »
Source : Bib. de Stanford - Archives
Parlementaires, séance du 7 octobre au soir
8 et 9 octobre : A Paris, c'est l'installation de la première
municipalité
constitutionnelle, élue conformément à la loi organique du 21 mai 1790.
Probablement parti du port de Bordeaux, Thomas Jefferson quitte la
France pour rejoindre New York, tout en pensant lors de son
embarquement que « La révolution française sera terminée dans un an ». (Source : Wikisource, Cornelis de Witt, Thomas Jefferson, sa vie et sa correspondance, page 581) Le lendemain, M. Bailly fait un discours lors de la tenue de la première réunion du Conseil général de la Commune : « Le
jour est enfin arrivé où la Municipalité de Paris est constituée, où
elle va prendre les rennes d'une grande administration. Si la première
Municipalité du Royaume a été établie la dernière, elle a été formée
avec plus de réflexion et de choix : et elle sera recommandable par son
intégrité, par ses lumières, comme elle l'est par l'importance de ses
fonctions. » (Source Gallica-Bnf, 4 pages)
10 octobre : A la Constituante, M. Merlin de Douai est élu président de
l'Assemblée pour les 15 prochains jours, il est le 35ème à sièger. M.
de Talleyrand popose de nationaliser
les biens du clergé, en contre-partie de la prise en charge du salaire
des religieux. Ce débat durera trois semaines, MM. Malouet, Seyiès et
Maury s'y opposeront.
11 octobre : Gilbert de Lafayette refuse toute indemnité comme commandant-général des gardes parisiennes.
12
et 13 octobre : A l’Assemblée, un décret prononce la dissolution de
l'Assemblée de Saint-Marc et ses actes sont annulés. M. Pétion fait une
intervention au sujet des troubles à Saint-Domingue. Le jour
suivant, M. de Talleyrand présente son rapport sur l'instruction
publique et il est décidé de la création d'une commission des monuments
(sa première réunion se tiendra le 8 novembre au collège des
Quatre-Nations). L'on charge la municipalité parisienne et les
directoires des départements de faire l'état des monuments et de
veiller à leur conservation. Saint-Domingue, arrivée du jeune Vincent Ogé au Cap Haïtien brandissant l'étendard de la Liberté. (Source : Musée d'Aquitaine).
13
octobre : A Paris, le « Cercle social » fondé par l'abbé Fauchet au
début de l'année, qui revendique des
droits pour les pauvres et les femmes devient la « Société des Amis de
la vérité » et tient
sa première séance au cirque du jardin du Palais-Royal (Il
s'agissait d'une vaste salle qui n'existe
plus, en raison d'un incendie intervenu en 1799). L'abbé Fauchet a lancé un
périodique dès 1789. Le
tribun du peuple ou Recueil des lettres de quelques électeurs de
Paris avant la Révolution de 1789 : pour servir d'introduction aux
feuilles de La Bouche de fer, le premier numéro date de janvier
1790, en co-direction avec Nicolas de Bonneville. Il faut aussi noter la parution ce même jour d'un nouveau titre, le Journal de la vente des biens nationaux, qui en tant que périodique du
« département
de Paris, voulant instruire le public de toutes ses opérations, désire
employer le moyen le plus sûr de lui donner connaissance de tous les
Biens qui sont en vente. » (Sources :
Gallica-Bnf)
14 octobre : Le député Jérôme Pétion de Villeneuve publie son discours
sur les troubles de Saint-Domingue.
Son avis aux lecteurs précise :
« Je
répète aujourd'hui l'avis que j'ai mis en texte de mon Discours sur
la traite des noirs. Le voici... Je ne me permettrai aucune
réflexion sur le décret que l'assemblée nationale a rendu à
l'occasion des troubles de Saint-Domingue ; j'expose simplement le
discours que je me proposais de prononcer, si la discussion eût été́ ouverte Je me suis fait un devoir de n'y rien changer ». (Source
bibliothèque Manioc, librairie Schoelcher de Fort-de-France).
15 octobre : A l'Assemblée, le Parlement de Paris, la plus ancienne et
la plus puissante des cours souveraines de l'ancien régime, prend fin
par décret après plus d'un demi-millénaire d'exercice, ou depuis
l'année 1254. Le maire de Paris viendra au Palais de Justice poser les
scellés sur les archives du Parlement (transférées en 1847 aux archives
nationales). Sinon sont élus 48 officiers municipaux par les sections de la capitale.
16 octobre : La veille l'évêque de Soissons, monseigneur de Bourdeilles
a annoncé et argumenté son refus de prêter serment sur la Constitution
civile du clergé, le Directoire du district de Soissons en conformité
avec la loi votée le 12 juillet prend des sanctions contre l'évêque
réfractaire. Celui-ci sera déchu de son évéché et de son titre, par le
département de l'Aisne, bien qu'élu en février et l'ayant reconduit à
cette fonction épiscopale.
17 octobre : Au palais des Tuileries, envoyé par le nouvel empereur
d’Autriche, Léopold II, le prince Charles de Lichtenstein vient
annoncer la nouvelle de son couronnementaux aux époux royaux, et il
présente ses lettres de notification.
18 octobre : La Liste de la section des
Tuileries
est un opuscule de 50 pages qui comprend la liste des citoyens actifs
et éligibles de la section, et apporte des précisions sur ses limites
et les rues qui la compose et ses plus de 700 membres avec leurs noms,
leurs situations et adresse de domicile. Il y est entre autres spécifié
les conditions requises pour jouir
des droits de Citoyen actif, suivant les décrets de l'Assemblée
Nationale, des 14 Décembre 1789, 22 Janvier 1790, etc. :
1°. Etre Français ou devenu
Français.
2°. Etre majeur de 25 ans.
3°. Etre domicilié de fait dans le lieu, au moins depuis un an.
4°. Payer 3 livres d'impôt direct, c'est-à-dire, de taille, de
capitation, de décimes, de vingtièmes, rachat de corvées, dixieme
denier sur les offices, ou taxes payées pour la garde.
5°. N'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur
à gages.
6°. N'être ni banqueroutier, ni failli, ni débiteur insolvable.
7°. Avoir payé sa quote-part des dettes de son père, lorsqu'on a reçu
ou qu'on retient une portion quelconque de ses biens, à tel titre que
ce puisse être ; à moins que l'enfant marié n'ait touché cette portion
de biens pour sa constitution dotale ; avant la faillite ou
l'insolvabilité de son pere, notoirement connue.
8°. Avoir fait sa contribution patriotique, quand on a plus de 400
livres de revenu.
9°. Avoir fait le serment civique.
Et aussi les conditions pour être
éligibie à la place de Commissaire de Police et à celle des
seize Commissaires de Section :
1°.
Réunir toutes les conditions néceccaires pour être Citoyen actif.
2°. Payer 10 livres au moins d'impôt direct.
3°. Etre Membre de la Section.
4°. N'être préposé à la perception d'aucun impôt indirect.
19 octobre : La commune de Saint-Mandé est créée à partir du
territoire détaché de la commune de Charenton-Saint-Maurice
(aujourd'hui la ville de Saint-Maurice).
20 Octobre : Georges Danton se fait porte-parole à l'Assemblée, d'un
motion votée par les sections parisiennes qui demandent le renvoi des
ministres. Cette pétition est repoussée, mais les ministres
démissionnent, sauf M. de Montmorin restant aux Affaires étrangères
21 octobre : A l'Assemblée la demande de Jacques François de Menou de
remplacer le drapeau blanc par le drapeau tricolore provoque un débat
violent. Le marquis de Foucauld Lardimalie accuse les défenseurs du
pavillon tricolore de profaner le drapeau blanc : « Laissez à des enfants ce nouveau hochet de
trois couleurs. » A Mâcon, c'est la naissance d'Alphonse de Lamartine, poète, homme politique et auteur de l'Histoire des Girondins en 1847.
22 et 23 octobre : En Charente-Inférieure (aujourd’hui Maritime), il se
produit à Varaize une
émotion populaire, près de 2.000 citoyens et les curés des villages des
alentours en tête s'y rendent, suite à la dénonciation d'un M.
Laplanche par le maire de la commune, M. Pierre Latierce. Ce dernier
est
malmené, l'on a voulu le pendre, puis est pris comme otage. Lors des
accrochages qui s'ensuivent, le maire et puis six autres personnes y
perdent la vie. Fin novembre, l'Assemblée nationale apportera sa
protection et répondra aux besoins de la famille du maire décédé, dont
son fils échappa de justesse à la mort. A Paris, le même jour à la
Convention est approuvé le décret général sur la
désignation des biens nationaux à vendre, sur leur administration et sur
l'indemnité de la dîme inféodée et il est présenté avec tous ses
articles par M. Chasset rapporteur. (Source : Persée.fr)
24 octobre : A Paris, à la Constituante sur
proposition de Mirabeau, il est décrèté que le pavillon tricolore
flottera sur
les vaisseaux de l'état comme signe de « la sainte confraternité des amis de la
liberté ». Et que les cravates tricolores remplaceront les
cravates blanches qui garnissaient les drapeaux des régiments.
25 octobre : A l'Assemblée, Antoine Barnave devient le président des
séances pour les 15 prochains jours. Ce même mois, l'abbé Grégoire,
député du département de la Meurthe, fait publier Lettre aux Philanthropes,
sur
les malheurs, les droits et les réclamations des gens de couleur de
Saint-Domingue, et des autres îles françaises de l'Amérique ; où
il dénonce le député Antoine Barnave. (Source : Gallica-Bnf, 21
pages)
26 octobre : Le ministre de la marine M. de La Luzerne
envoie sa lettre de démission à Louis XVI et il est remplacé par M.
Claret de Fleurieu.
27 octobre : Le député du Tiers du bailliage de Troyes, M. Nicolas
Jeannet dit l'aîné est décédé à l'âge de 51 ans.
28 octobre : Au couvent des Jacobins, M. Dubois-Crancé propose une
motion pour que soit immortaliser en peinture le Serment du Jeu de Paume,
et suggère que ce soit le peintre David qui s'en charge. Ce dernier est
présent et intervient pour la première fois, et il s'ensuit un débat
sur qui sera sur la toile, sa place, etc.
28-29 octobre : A Saint-Domingue, des affranchis, souvent des métis nommés
comme "libres de couleurs" se
révoltent. Le meneur et organisateur du
soulèvement est Vincent Ogé, lui et ses
partisans réclament l'application du décret pris le 8 mars et ratifié par le roi le 28 mars de cette année.
30 octobre : Dans la capitale est représentée pour la première fois L'amour et la raison une comédie en un acte et en prose au théâtre du Palais-Royal, une pièce de Charles Pigault de l'Épinoy dit Pigault-Lebrun (1753-1835), dramaturge et romancier. (Sources : Bnf-Gallica)
31 octobre : A Paris, Gilbert Elliot, comte et député
Whig au Parlement anglais et ami du philosophe Edmund Burke, ce
diplomate d'origine écossaise fait une conférence devant des députés
patriotes (Il sera de 1794 à 1796, vice-roi de Corse...).
XI - Le mois de novembre 1790
Lundi 1er novembre :
C'est la date de publication des Réflexions
sur la
Révolution de
France et sur les procédés de certaines sociétés a Londres, relatifs à cet événement
d’Edmund Burke (du parti Whig ou libéraux en opposition au Tory
anglais, conservateurs). Il décrit l’affaiblissement de la France et
n’approuve
pas les droits de l’homme et du citoyen. Thomas Paine qui sera député
et citoyen
français opposera un avis contraire et radical, sur l’universalité des
droits et la république. Outre-Manche, quelques clubs républicains
existent et selon les
opinions, l’accueil de la Révolution est plus ou moins apprécié et
provoque des tensions vives. (Source : Gallica-Bnf, 360 pages) A Paris, le jeune duc de Chartres, le futur roi Louis-Philippe Ier est
admis au club des Jacobins, il est le fils du duc d'Orléans. «
M.
de Chartres a été reçu, lundi 1er novembre, membre de la Société des
amis de la Constitution. Il est inutile de dire que pour son admission
on n’a dérogé à aucunes des formalités d'usage. Seulement il a été
très-applaudi en entrant. Voici le discours qu’il a prononcé ;
Messieurs, Il y a longtemps que je désirais ardemment d’être admis au
milieu de vous ; l’accueil favorable que vous daignez me faire me
touche infiniment ; j'ose me flatter que ma conduite justifiera vos
bontés ; et je puis encore vous assurer que toute ma vie je serai bon
patriote et bon citoyen. » (Source Gallica-Bnf, La Chronique de Paris du 4/11, n°308 - page 1230)
2 novembre : La Constituante établie une loi qui modifie le Code pénal de la Marine.
3 novembre : Retour dans la capitale, Louis XVI et la famille
royale sont de retour de Saint-Cloud et arrêtent les circulations qui
étaient devenues régulières entre le château de Saint-Cloud et les
Tuileries. La reine Marie-Antoinette s'entretiendra chaque jour avec M.
de Fersen.
4 novembre : Insurrection de l'île de France (actuelle île Maurice).
5 novembre : A Paris, au club des Jacobins, sont présents les députés
de la Corse, M. André ou Andrea Pozzo di Borgo (en sculpture
ci-dessous) intervient et dit à ses
membres :
|
|
|
|
« MESSIEURS,
Flattés
de l'honneur que vous voulez bien
nous accorder en nous admettant dans le sanctuaire de la liberté parmi
les défenseurs et les amis de la constitution, nous ne pouvons mieux
répondre aux voeux d'un peuple qui a tant de fois armé son bras et
versé son sang pour la défense de la liberté qu'en vous priant de nous
accorder l'honneur d'assister à vos séances pendant notre séjour dans
cette capitale, pour nous pénétrer de plus en plus des sages principes
qui vous ont mérité, à juste litre, l'estime et la reconnaissance de
tous les bons citoyens.
|
|
 |
|
|
Les Corses,
réunis aux Français par les liens de l'amour et de la
fraternité, ne sont dans leur île qu'une Société d'amis de la
constitution ; cependant .permettez Messieurs, que, de retour au milieu
de nos compatriotes, nous jouissions
leur annoncer que vous agréez
l'affiliation d'une Société qu'ils formeront sous vos auspices.
Peut-être que
l'Italie, dont nous sommes environnés, ne demeurera pas
indifférente au spectacle de la liberté ; peut-être que cette contrée
infortunée, qui n'existe plus que dans les monuments de l'histoire,
imitant cet exemple, secouera le joug des faibles tyrans qui la
déchirent et de la superstition qui l'avilit. »
|
|
6 novembre : En Dordogne, à Sarlat,
le Conseil général décide
d'interdire toutes les sociétés affiliées au club royaliste des « Amis
de la paix » dans le département. A la Constituante est accueilli une
députation Corse, avec MM. Andrea Pozzo Di Borgo et Antonio Gentili,
qui prennent respectivement la parole à la barre.
7 novembre : Dans la capitale est joué Nicodème dans la Lune, ou la Révolution pacifique, est une comédie en trois actes mêlée de vaudevilles. « Elle fut jouée sur le Théâtre-Français comique et lyrique de la rue de Bondy (il était situé au coin de la rue de Lancry) (...). L'auteur
était un homme d'un esprit original, qui fit du bruit pendant quelque
années et dont on ne se souvient plus guère maintenant. Louis-Jacques
Beffroy de Reigny, plus connu sous le nom de Cousin Jacques dont il
signa ses productions, était né à Laon en 1757. Il avait eu pour
camarades au collège Louis-le-Grand Camille Desmoulins et Robespierre. » (Source : Gallica-Bnf, Théodore Muret, L'Histoire par le théâtre, 1789-1851, Paris, 1865)
8 novembre : M. de Lafayette fait un discours au Corps municipal, et le
comité sur les monuments (ou pour la préservation du patrimoine)
composé de 33 membres est réuni pour la première fois à la bibliothèque
des Quatre-Nations.
9 novembre : A l'Assemblée, le Président, en séance du soir, précise que « L'ordre
du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité
d'agriculture et du commerce, relativement au canal du sieur Brûlée.
» qui a pour but de le faire parvenir jusqu'au nord de la capitale. M.
Poncin rapporteur du comité d'agriculture et de commerce précise que « L'Assemblée
nationale a décrété, le 19 octobre, que M. Brûlée est autorisé à ouvrir
à ses frais un canal de navigation qui commencera à la Beuvronne, près
le pont de Souilly, et arrivera entre La Villette et La Chapelle, dans
un canal de partage. » S'ensuit une présentation du projet et
ses dimensions, la question des indemnisations allouées au sieur
Brûlée, et des compléments au décret pris en sa faveur. Mais il faudra
attendre 1802 au frais de la Ville de Paris pour que commence les
travaux de ce qui adviendra le canal de l'Ourcq. Dans la capitale, il
est joué Le procès de Socrate,
ou Le régime des anciens temps
de J.M. Collot d'Herbois, une comédie en trois actes et en prose
représentée pour la première fois au théâtre de Monsieur. (Source
: Gallica-Bnf)
10 novembre : A Nantes, à l'initiative des Jacobins locaux, une messe
de
requiem est célébrée à la mémoire des victimes des massacres de Nancy.
12
et 13 novembre : A Paris, le marquis de Castries se bat en
duel avec le député Charles Lameth, qui sort de l'affrontement blessé.
Le
lendemain, l'hôtel de Castries
demeure du marquis est attaqué et
pillé, rue de Varenne (plan ci-contre). Aux cris de « Tous
chez le duc! Vengeons Lameth! », ils sont dix mille sous les
fenêtres de l'hôtel particulier avant les actes de saccage. Pas
loin, se tient Lafayette observant avec des troupes et ne donne
aucun ordre d’intervention. Le marquis de Castries au courant du danger sort
épargné de cette émotion populaire, il s’était réfugié
préalablement chez une amie. Et donne lieu à
un débat à l'Assemblée nationale le même jour. A lire, la dévastation de l'hôtel de Castrie avec une proclamation de la municipalité parisienne. (Source Gallica-Bnf, 4 pages)
|
|
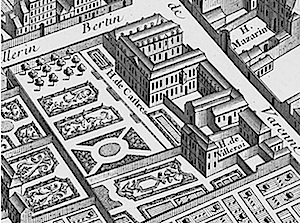 |
14 novembre : Discours prononcé au Club des Jacobins par un curé, électeur du district de Melun. « Encore
quelques années, et des Pontifes défintéressés, patriotes et
populaires, des curés vertueux et plus instruits que ne l'étaient la
plupart de ceux des campagnes, apprendront à leurs habitants à bénir la
révolution, et ils la béniront avec eux. Administré par des citoyens
vivant avec lui, le vertueux laboureur acquittera gaiement des impôts,
dont il connaîtra l'emploi ; il oubliera ses malheurs. Heureux dans
leurs humbles foyers, les manouvriers (saisonniers) des campagnes ne regretteront plus la fécondité de leur mariage ; ils éléveront des citoyens à la Patrie ; les lumières ne seront plus concentrées dans les villes,
et la France ne sera plus qu'une grande famille, dont les membres
auront les mêmes droits, les mêmes motifs d'encouragement, etles mêmes
assurances de parvenir aux honorables fonctions fixées par la
Constitution. » Signé PICHONNIER, Curé d'Andrezel. (Source : Gallica-Bnf, page 8)
15 novembre : A Saint-Domingue, en raison de ses idées
anti-esclavagistes, le commandant du fort Dauphin est arrêté.
16
et 17 novembre : M. du Portail est nommé ministre de la guerre au lieu de M. de la Tour-du-Pin. La Gazette Universelle ou Le Moniteur Universel
annonce que le 7 septembre dernier que les Français établis à Smyrne
ont prêté le serment civique et arboré la cocarde tricolore, et fait
grande sensation... A la Constituante, un décret organise la Corse en
un
seul
département. Le jour suivant est abordé l'organisation du tribunal de
cassation. Sur la proposition de M. Duport, l’Assemblée décrète que le
nombre des membres de ce tribunal sera égal à la moitié des
départements, et que les départements, qui éliront en premier lieu,
seront déterminés par le sort.
18 novembre : A Carpentras, il est mis un arrêt aux signes distinctifs
pour les Juifs
(chapeaux jaunes).
19 novembre : Adressé à l'Assemblée et à la commune de Paris, il est présenté un mémoire pour l'Hôpital général de Paris et pour celui des Enfants trouvés. « L'obligation
de nourrir les pauvres des hôpitaux est indépendante des changements
qui peuvent survenir dans leur administration, et comme la municipalité
de Paris n'a pas manifesté de vœu plus cher que celui de venir à leur
secours, ces observations n'ont eu pour objet que de seconder les vues
bienfaisantes, en lui exposant la situation et les besoins de l'Hôpital
général et de celui des Enfants trouvés. M. le maire et MM. les
administrateurs de la commune y verront aussi quelle est la nature des
soins qu'exigent ces grands établissements, et l'étendue des secours
qu'il sera nécessaire de solliciter pour eux, de la justice et de
l'humanité de l'Assemblée nationale. »
20
novembre : A Paris, Jan Potocki, écrivain et savant polonais, rencontre
le baron de Staël, ambassadeur de Suède, ils évoquent la
possibilité d'une candidature suédoise au trône de Pologne. A
l'Assemblée, sur le rapport de M. Barrère, le château de Vincennes est
mis à la disposition de la commune de Paris pour y renfermer les
détenus, les prisons de cette ville étant devenues insuffisantes. Est
publiée
la Lettre
de J.P. Brissot à Barnave, cette lettre fait néanmoins une
centaine de pages et se concentre sur la situation à Saint-Domingue. (Source
: Gallica-Bnf)
Dimanche 21 novembre : Le
nouveau Garde des Sceaux ou de la Justice est François Duport-Dutertre
sur proposition de
Lafayette en remplacement de Jerôme Champion de Cicé. Dans la Chronique de Paris du jour (Gallica-Bnf
- page, 1298), on peut lire dans un articulet, que Claude
Mansard, de la Société fraternelle des patriotes des deux sexes créée
en février, bien que non cité donne des cours aux Jacobins : « Un
maître de pension par un sentiment de patriotisme, rassemble, tous les
soirs dans une salle des Jacobins, rue St-Honoré, plusieurs artisans,
et des marchands de fruits et légumes du quartier, avec leurs femmes et
leurs enfants, pour lire et interpréter les décrets de l'Assemblée
nationale. Il apporte à cet effet, chaque fois un bout de chandelle
dans la poche, avec un briquet et de l'amadou ; et dernièrement la
lumière sur le point de manquer, plusieurs assistants se cotisèrent
pour faire l'emplette d'une autre chandelle, qui fit durer la séance
jusqu'à dix heures du soir, à la grande satisfaction de l'assemblée.
»
22 novembre : Belgique, retour des armées autrichiennes.
23 novembre : A Uzès,
des
rixes font 32 victimes. A l’Assemblée, l'on décide de la création d'une contribution foncière
répartie sur toutes les propriétés à raison de leur revenu net.
24 novembre : La Constituante promulgue une loi relative à la
suppression des anciens receveurs généraux et à la nomination des
receveurs des districts. Elle ordonne que tous les offices de receveurs
généraux, trésoriers généraux et de receveurs particuliers des
impositions, précédemment créés dans les provinces, seront supprimés à
compter du 1er janvier 1791. Il est décidé que le recouvrement des
impositions qui seront établies par des receveurs nommés par les
districts,éligibles pour 6 ans, et rééligibles, et devant fournir un
cautionnement. Ils encaisseront les fonds des collecteurs communaux.
25 novembre : A Saint-Domingue, il éclate la première révolte générale
des
populations noires.
26 novembre : Louis XVI donne au baron de Breteuil des pouvoirs pour
négocier avec les cours étrangères les conditions de leur intervention.
27 novembre : A la Constituante, il est arrêté que tous les
ecclésiastiques sont astreints à la prestation publique du serment, il
sort renforcé dans son exécution des dispositions en relation avec la «
Constitution Civile du Clergé » :
«
Article 1er. — Les évêques et ci-devant archevêques, et les curés
conservés en fonctions, seront tenus s'ils ne l'ont pas fait, de prêter
le serment auquel
ils sont assujettis par l'article 39 du décret du
24 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui
du 12
du même mois, concernant la Constitution civile du clergé. En
conséquence, ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller
avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est
confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de
maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée
nationale et acceptée par le Roi ; savoir : ceux qui sont actuellement
dans leur diocèse ou leur cure, dans la huitaine ; ceux qui en sont
absents, mais qui sont en France, dans un mois ; et ceux qui sont en
pays étrangers, dans deux mois ; le tout à compter de la publication du
présent décret ».
|
|
 |
29 novembre : A la chambre des députés, le député Barnave présente un
rapport du comité des colonies : « Il
y a peu de temps que vous vous êtes occupés de la situation de
Saint-Domingue; aujourd'hui, celle de la Martinique n'est pas moins
alarmante. (...) C'est vers
la fin de l'année dernière et au commencement de celle-ci que les
premiers troubles ont éclaté. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est
passé pendant l'administration de M. Vioménil, M. Damas (gouverneurs) a comme lui soutenu les habitants. A l'arrivée de vos décrets la joie fut universelle ; mais, le jour de la Fête-Dieu (3 juin), une malheureuse circonstance renouvela les divisions. » Ensuite, Antoine Barnave appui l'idée d'acheminer des troupes
aux colonies, il est aussi décidé d'envoyer des
commissaires aux petites
Antilles, en Martinique notamment ; et selon le Journal des Amis de la
Constitution : « le roi est prié d'envoyer quatre commissaires
(...) 6.000 hommes de troupe avec quatre vaisseaux en ligne
». Il est décidé aussi l'ouverture d'un second entrepôt à la Trinité et
que les navires étrangers pourront hivernés à Fort-Royal
(Fort-de-France).
30 novembre : En Belgique, la ville de Charleroi est reprise par les
troupes Autrichiennes. Sur les côtes de l'île de Groix (Morbihan) un
navire négrier Nantais, le Passe-partout fait naufrage. Périssent le
capitaine, le pilote et deux hommes d'équipage. (Source : archeosousmarine.net)
XII - Le mois de décembre 1790
Mercredi
1er décembre : A l’Assemblée, l’impôt sur le sel, c'est-à-dire la «
gabelle » est
supprimée. Les décrets du 27/11 et de ce jour voit la naissance du
Tribunal de cassation, seul habilité dorénavant à se
prononcer sur les lois, retirant ainsi aux 13 Parlements toute
prérogative ou regard sur les législations, et entraînant de fait leurs
disparitions. Paraît le numéro un, du périodique La Feuille du jour, de M. Pierre-Germain Parisau
(1754-1794), acteur, puis dramaturge et journaliste sous la Révolution.
Ce quotidien faisait sa première page avec l'actualité des théâtres
parisiens, il perdurera jusqu'en 1792. (Sources : Gallica-Bnf)
2 décembre : L'armée autrichienne entre dans Bruxelles et met fin aux Etats-Unis
de Belgique.
3 décembre : Louis XVI lance un appel au roi Frédéric-Guillaume II de
Prusse pour contrer la Révolution. Les Anglais disent non à la
proposition française pour la fixation d'une unité des poids et mesures
(le système métrique n’est pas encore né, on calcule en toise
par exemple).
4 décembre : A la chambre des députés, une lettre de Louis XVI est lue,
où il annonce le remplacement du contrôleur Général des Finances, M.
Lambert, qui lui a donné sa démission, par M. Valdec de Lessart.
5 décembre : Paris, la Constituante, sous la présidence de M.
Pétion, les droits de contrôle des actes
civils et judiciaires sont abolis et création d'un droit
d'enregistrement. Et l'on commence à discuter de la Garde nationale,
Robespierre qui souhaite intervenir est rapidement interrompu et ne
peut s'exprimer devant l'assemblée. Aux Jacobins, Robespierre s’oppose
à Mirabeau contre
l’exclusion des citoyens « passifs » de la Garde nationale. A
Perpignan, des individus tirent sur les jacobins locaux. Le duc de la
Rochefoucauld-Liancourt, en charge du comité de mendicité adresse un
courrier au ministre de la Justice, M. Duport-Dutètre sur l'état
lamentable des maisons de Bicêtre et de la Salpêtrière. Ce dernier lui
répondra favorablement plusieurs jours après, et se rendra en sa
compagnie visiter à Gentilly, la Maison de Bicêtre le 12 janvier 1791.
6 décembre : Bordeaux, création d'une caisse patriotique par le club
local
des Jacobins, elle est chargée d'échanger les assignats contre
des petits billets de confiance. A l'Assemblée débute les débats sur
l'Affaire de Nancy.
7 décembre : L'Assemblée après avoir entendu le rapport de M.
Brûlard de Sillery sur l'affaire de Nancy, qui lui a été fait au nom de
ses comités militaires, des rapports et des recherches, décrète ce qui
suit à l'article 1er : « L'Assemblée
nationale abolit toutes les procédures commencées tant en exécution de
son décret du 16 août dernier, qu'a l'occasion des événements qui ont
eu lieu dans la ville de Nancy le 31 du même mois ; en conséquence,
tous citoyens et soldats détenus dans les prisons en vertu des décrets
décernés par les juges de Nancy, ou autrement, à raison desdits
événements, seront remis en liberté immédiatement après la publication
du présent décret. »
8 (et 26) décembre : M. Jean-Sylvain Bailly, Maire de Paris ré-organise
l'administration de la police parisienne à l'échelle du département,
ci-dessous le texte avec ses administrateurs et les fonctions qui leurs
sont dévolues.
|
ADMINISTRATION
DE POLICE
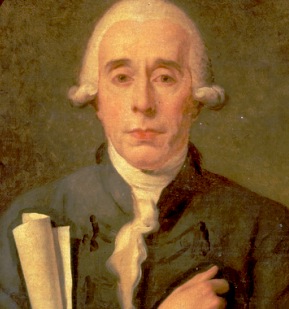
MUNICIPALITÉ
DE PARIS |
|
MAIRE,
M. BAILLY. (en portrait) - ADMINISTRATEURS, MM. THORILLON, JOLLY, PERRON
ET MAUGIS.
« Les Administrateurs,
sous la surveillance de M. le Maire, connaîtront concurremment de
toutes les affaires du Département. Ils décideront ensemble toutes les
affaires difficiles, et concourront, ensemble ou séparément, à la
sûreté et tranquillité publiques, préviendront ou feront cesser les
rixes y batteries et attroupements. Un jour de chaque semaine, et
à l'heure qu'ils conviendront, chacun d'eux fera le rapport des
affaires qui ont besoin du concours de tous. La nature de ces affaires
fera déterminée et jugée par chacun d'eux. Toutes les fois qu'ils le
jugeront convenables, ils appelleront vingt-quatre Commissaires de
Sections, et vingt-quatre Commissaires de Police, pour conférer sur
les opérations, et les changements ou précautions nouvelles, que les
circonstances pourraient exiger.
Les vingt-quatre
Commissaires de
Sections seront pris dans les vingt-quatre Sections, qui n'enverront
pas les vingt-quatre Commissaires de police. Chaque semaine, un
Administrateur tiendra l'audience du Département, et répondra aux
demandes des Sections, lorsqu’elles seront pressées, ou qu'elles
n'auront pas de Département fixe. Chaque semaine, un Administrateur
fera la visite des prisons et maisons d'arrêts, aux termes des
décrets. Ces deux services se feront tour-à-tour.
L'Administrateur de
service aux
prisons pourra se dispenser de venir au Département ; mais alors, le
Secrétaire des parties qui lui feront confiées ira, si besoin est, lui
en rendre compte. Un ou plusieurs Commis iront travailler chez lui,
s'il est nécessaire. Tour-à-tour, un des deux Administrateurs qui ne
seront point de service, fait pour l'audience du Département , soit aux
prisons, sera tenu de se trouver toute la journée au Département, pour
seconder l’Administrateur de semaine. Et le plus ancien des
Administrateurs ira présider le Tribunal de police en l’absence de M.
le Maire.
Il y aura
essentiellement un
bureau central où toutes les affaires du Département seront
enregistrées avec notes des décisions, de manière que le Public, et
les Administrateurs auront la facilité d'y prendre connaissance de
tout. Le chef de ce bureau distribuera à chaque Administrateurs les
affaires qui lui seront plus particulièrement réparties, ou les
remettra aux divers bureaux, si l’Administrateur l'ordonne ainsi.
A ce bureau central
seront
remises toutes les affaires résultantes des requêtes et mémoires
qui, aux termes des décrets, doivent passer au bureau de renvoi établi
chez M. le Maire. Ensemble tous les procès-verbaux et demandes des
Sections qui seront adressées directement au Département de police.
Tous les matins, le
chef du
bureau central sera tenu de représenter à l'Administrateur de service
la feuille de renvoi des bureaux de M. le Maire. Il est entendu que les
affaires pressées seront envoyées directement à l'Administrateur qui va
s'en trouver chargé par la distribution ci-après. Elles pourront aussi
être remises au bureau central, qui, au moment, les répartira dans les
divers bureaux, si l'Administrateur à qui elles sont attribuées l'exige
ou est absent.
*
DIVISION des affaires du
Département entre Messieurs les Administrateurs
qui tous concourront à la sûreté et à la tranquillité publiques.
PREMIERE
DIVISION
M. THORILLON,
Administrateur,
rue des Fosses-St-Marcel, n°5. Connaîtra particulièrement des affaires
concernant : Le militaire, les recrues pour l'armée, et des soldats
de toutes armes en semestre, et particulièrement la garde nationale
Parisienne et le régiment Provincial de Paris. Le balayage et
enlèvement des boues et neiges. L'arrosement. L'illumination. Les
incendies. Les pompes et pompiers, tant pour ce qui regarde les
ordres à donner en cas d'incendies que pour l'achat des pompes,
l'entretien, la solde, l'habillement, équipement des pompiers.
Wauxhals. Panthéon. Bals publics. Clubs, Cirques. Promenades publiques,
Places, Rues, Carrefours, Édifices, Églises Cimetières, pour le bon
ordre, la décence, les mœurs et la sûreté. L'inspection des
Pharmacies et Drogueries, pour assurer l'exécution des règlements
faits et à faire.
DEUXIEME
DIVISION
M. JOLLY,
Administrateur, rue de
l’Observance, Connaîtra particulièrement des affaires concernant : Les
Spectacles. La Librairie, Imprimerie. Gravures. Colporteurs. Marché, et
poste aux chevaux. Les voitures publiques, et de Places. Les
Postes et Ménageries. Halles et Marchés. Les Ouvriers et
Domestiques. Nourrices et Recommanderesses. Le dénombrement des
habitants de Paris.
TROISIEME DIVISION
M. PERRON,
Administrateur, Quai et vis-à-vis du pont de la Tournelle, Connaîtra particulièrement des
affaires concernant : Les Hôtels-Garnis. Les Auberges, Logeurs,
Cassés. Vagabonds, Escrocs, Mendiants, dénonciation de vols. Etrangers,
Juifs. Maisons de jeux, assemblées nocturnes. Femmes publiques.
Empiriques. Passeports. Correspondance avec les Maréchaussées, les
Ministres, Départements et Districts du Royaume.
QUATRIEME DIVISION
M. MAUGIS,
Administrateur, place
Dauphine, Connaîtra particulièrement des affaires concernant : Les
Corps et Communautés. Poids et mesures. Les Fripiers. Les
Revendeurs. Halles aux toiles et aux draps. Les Boucheries et
Tueries. Les Boulangeries. La Bourse, les Loteries. Les Barrières, et tout ce qui est relatif à la perception des droits. »
Fait et arrêté
au Département de Police les 8 et 26 Décembre 1790. Signé, BAILLY,
Maire. THORILLON, JOLLY, PERRON et
MAUGIS, Administrateurs.
|
Jeudi 9 décembre : La FEUILLE DU JOUR, à la première page, l'on découvre les spectacles joués à Paris :
Opéra. Renaud,etc. la Chercheuse d’Esprit.
Théâtre de la Nation. L'Ecole des Pères, etc. le Tombeau de Défilles.
Th. Italien. Euphrosine, les Dettes.
Th. de Monsieur. Azélie, et le conseil imprudent.
Th. du Palais-Royal. Le Café de Rouen, le Duc de Momouth, et le Seigneur supposé , etc.
Th. de Mlle Montansier. Le Sourd, ou l’Auberge pleine, et Spinette et Marini.
Grands-Danseurs du Roi. Capana, Madame de Travers, etc. la Valise perdue etc.
Ambigu-comique. L’Auto-da-Fé, le Sourd, et le nouveau Doyen de Killerine.
Th. de la comédie lyrique. Le Berceau d’HenriIV, et les Vœux forcés.
10 décembre : A Lyon, un complot royaliste échoue. Signature au nom de
l’Autriche, la Prusse et des Etats généraux de Hollande de la
convention de La Haye et met un arrêt aux troubles en Belgique.
11 au 14 décembre : A Aix, l'annonce de l'existence d'une société
monarchique se répend, la rumeur d'un projet contre-révolutionnaire
dans la ville poussent les clubs patriotiques à la colère et des heurts
éclatent ; le 14, l'on dénombre au moins 4 soldats pris pour cible et
décédés suite à une pendaison en public.
12 décembre : L'empire d’Autriche restaure son autorité sur le pays
Brabant, seule la ville de Liège échappe à ce retour à l'ordre. En
France, c'est la création du papier timbré. A Saint-Domingue,
l’assemblée du Cap décide d’élever un buste à Antoine Barnave comme «
défenseur de la colonie ».
13 décembre : A Paris, après sa création, le 5/12, et son installation
au
Palais de Justice, le 9/12, le dit Tribunal des Dix procède à sa
première audience (affaires criminelles).
14
décembre : Autriche, Léopold II adresse une note officielle de
protestation à la France au nom des traités de Westphalie (1648). A
Aix-en-Provence, l'avocat monarchiste Pierre Pascalis sous les verrous
avec M. Guiramand, d'une opinion comparable, les deux hommes sont
pendus à un réverbère par la foule qui s'est introduite de force dans
la prison de la ville.
15 au 21 décembre : A l’Assemblée, il est décidé la suppression de la
vénalité des offices ministériels. Le lendemain, il est accordé 15
millions aux ateliers de charité. Le 18, toutes les rentes foncières
sont déclarées rachetables, il est défendu de créer à l'avenir des
redevances foncières non remboursables. Le 20, sont supprimés les «
apanages » : domaine foncier propre d'un prince et bénéficiant du
revenu exclusif, sans héritier une principauté d’apanage revenait de
droit à la Couronne. La règle fut édictée sous les Plantagenêt au XIIIe
siècle. Le lendemain il est demandé la construction d'une statue de
Jean-Jacques Rousseau. Et l’on versera à Thérèse, sa veuve, une pension
annuelle
de 1.200 livres.
22 décembre : Pierre-François Lepoutre, député du bailliage de Lille, écrit à son épouse : «
Vous me parlez du serment que devront prêter les évêques et curés, que
ce serment trouble un peu les curés des postes de nos environs, je n’en
suis nullement trompé, ma chère Amie. Ils voient bien qu’ils vont
perdre toute leur autorité civile et je crains bien que leur
obstination ne leur cause des chagrins plus tard. » (Source : OpenEdition, Correspondance du député Lepoutre à Paris, du 1/12/1790 au 30/06/1791)
23 décembre : Naissance de François Champollion à Figeac.
Vendredi 24 décembre : L'Assemblée décrète le brûlement des assignats
défectueux (sanctionné le 29/12 par le roi).
Dimanche
26 décembre : Louis XVI décide de sanctionner la Constitution Civile du
Clergé. Outre-rhin, se déroule la rencontre entre Haydn et Beethoven.
27 décembre : A la chambre des députés, 59 élus membres
du Clergé prêtent
serment. Le député de Rouen, Jacques-Guillaume Thouret (avocat), dans
le
cadre des débats sur les questions judiciaires, interpelle sur la
police de sûreté : « cette
police est nécessaire ; et il suffit de dire qu'il est indispensable
qu'elle soit expressément constituée. Mais sur quels principes
doit-elle l'être? » M.
Duport-Dutertre, ministre de la Justice fait la lecture des deux
premiers articles. Le député Jérôme Pétion, un peu après une
intervention de Robespierre sur la police, le juge de paix et leurs
rôles respectifs au sujet de la levée d'un coprs (décès à domicile) ;
Pétion s'inquiète de : « L'argument
par lequel le préopinant vient de terminer son discours me paraît
spécieux ; mais il ne suffit pas pour déterminer l'Assemblée. La
concurrence qu'on vous propose d'établir comme moyen d'émulation serait
plutôt un objet de rivalité et de haine entre des officiers dont les
fonctions sont naturellement incompatibles. Un militaire chargé
d'exécuter la loi, habitué à agir sur-le-champ et sans examiner
pourquoi, n'est pas l'homme à qui on peut confier les fonctions
difficiles de la police. (On applaudit.) Quand la loi est
obligée de confier à un officier public l'exercice arbitraire d'un
pouvoir redoutable, elle doit choisir l'officier qui a la confiance de
ses concitoyens, qui a été élu par eux. Je ne vois, au contraire, dans
l'officier de maréchaussée aucun caractère qui inspire la confiance. Il
est nommé par le roi, il est amovible (révocable) ; enfin il a
cet esprit militaire si incompatible avec les fonctions de la justice
de paix. Je crois donc que, s'il était nécessaire de faire concourir
deux officiers à l'exercice de la police, il faudrait plutôt nommer un
second commissaire par canton que d'employer les officiers de la
maréchaussée. »
Cinq articles sont débattus au cours de la séance.
28 décembre : A la Constituante, M Talleyrand, évêque d'Autin, et MM.
Le Borlhe le Grandpré, et Montjallard, tous les deux curés prêtent
serment chacun leur tour à la tribune, en raison du décret du 27
novembre dernier. Ensuite, M. Eugène Gossuin, député de la généralité
de Valencienne, pour le comité de constitution propose de nommer et
établir des juges de paix dans plusieurs départements et localités, son
décret est approuvé sans débat.
29 décembre : A Paris, Camille
Desmoulins, âgé de 27 ans, après avoir adressé une lettre demandant la
main de sa fille
(17 ans), le 18/12, à son futur beau-père, il épouse Lucile
Laridon-Duplessis
à l'église Saint-Sulpice sous les offices de l'abbé Bérardier, qui
exhorte Camille Desmoulin à respecter davantage la religion... (le
prêtre est un ancien professeur du Collège Louis-le-Grand).
Jean-Georges Lefranc de Pompignan, député du haut clergé pour le
Dauphiné aux Etats Généraux ayant rejoint le Tiers, décède à Paris dans
la paroisse de Saint-Sulpice.
Mercredi 30 décembre : A l'Assemblée, il est décrété, que toute
nouvelle
invention devient la propriété de son auteur, lui garantissant la
pleine et entière jouissance financière de sa découverte. Dans la
capitale, au Cercle social ou au sein de l'Assemblée fédérative des Amis de la Vérité
Me Etta Palm, née d'Aelders se présentant comme une baronne hollandaise
fait lire un discours Sur
l'injustice des loix en faveur des Hommes, au dépens des Femmes,
elle réclame l'égalité des droits politiques.
 |
|
31
décembre : A la Constituante, le député M.
Vincent Ramel de Nogaret (opposant aux départements), l'élu de la sénéchaussée de Carcassonne fait
approuver le décret suivant : « L'Assemblée nationale, après avoir
entendu son comité des Reports, décrète : qu'attendu la cessation des
fonctions judiciaires de la municipalité de Toulouse, par l'effet des
décrets concernant la nouvelle organisation des tribunaux, sanctionné
par le Roi ; l'information attribuée par le décret du 26 juillet
dernier à la municipalité de Toulouse relativement aux troubles qui
ont eu lieu à Montauban,
sera continuée devant le tribunal de district de Toulouse ; à cet
effet, les minutes de toutes les procédures faites à cet égard devant
les Officiers Municipaux de la dite ville, seront transportées au greffe
du dit tribunal ». Le député François Gossin, élu du bailliage de
Bar-le-Duc fait prendre un décret sur la création de tribunaux de
commerce dans les villes portuaires où étaient les Amirautés,
et de
même à Troyes et à Chartres. |
à suivre...
|