|

|
| Cliquez
ci-dessus pour revenir à la page d'accueil |
|
 Infos,
Amérique Latine 2010
Infos,
Amérique Latine 2010
Sommaire de la page 7,
1 - Procès
de la dictature chilienne à Paris, du 8 au 17
décembre 2010
2 - La mémoire des
survivants et la révolte des ombres, Antonia Garcia Castro
3 - Chili : "Coup
d'état 1973", Gabriel Garcia Marquez
4 - Escadrons de la mort, l'école
française, entretien
avec Marie Monique Robin
5 - Le
LKP de la Guadeloupe, un mouvement social instructif ? Paméla
Obertan
6 - L’Amérique
latine : la construction d’une région, José Del Pozo
7 -
Amérique Latine et Colombie en particulier : Rapport sur la
torture en 2010, ACAT
|
|
|
|
|
| Procès de la
dictature chilienne à Paris |
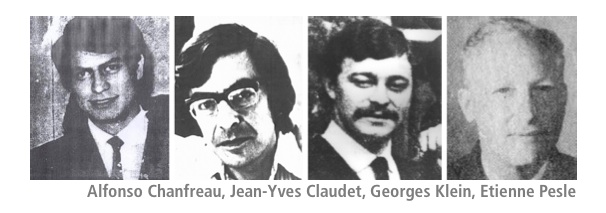
Lionel Mesnard, le 27 décembre 2010
Il s’est ouvert à Paris le 8 décembre
2010 le procès de 14 inculpés chiliens, des
militaires principalement (1), en raison de la disparition de quatre
franco-chiliens par après le 11 septembre 1973: Alphonse
Chanfreau, Georges Klein, Etienne Pesle et Jean-Yves Claudet. Leurs 4
noms sont inconnus, et pour cause, ils ont été
victimes d’un putsch militaire qui a
été mis sous une certaine chape de silence. Tant
il a impliqué pour le Chili une folie meurtrière
et la négation des opinions.
Vendredi 17 décembre 2010 s’est achevé
à Paris le procès d’une infime partie
des exactions de la junte militaire chilienne qui officia de 1973
à 1989. Ce procès aura eu pour mérite
de voir la justice française condamnée avec
fermeté le régime militaire et ses
méthodes extrêmes. 13 des 14 inculpés
chiliens ont été condamnés
à de la prison ferme allant de 15 ans à 30 ans,
sur les 14 inculpés un seul a été
acquitté.
Pendant deux semaines s’est tenu en France le
procès post mortem de la dictature au Chili sous la gouverne
d’Augusto Pinochet et de certains de ses sbires. Il est rare
de découvrir une juridiction pénale comme les
Assises allées plus loin que les demandes du procureur, dont
les condamnations n’excédaient pas 20 ans
d’emprisonnement à l’encontre de
prévenus absents, mais eux bien vivants.
Revenir près de 40 ans en arrière n’est
pas anodin. Il est encore difficile d’expliquer les
conséquences, non seulement humaines, mais
l’impact sur toute une société
d’une histoire criminelle particulière. Elle
conserve encore de nos jours une actualité forte et demande
d’aller au-delà des seuls cas jugés. Il
importe de prendre en compte les mécanismes sociaux et
économiques, le dessous des cartes de l’Histoire,
c’est-à-dire donner à une
époque donnée un contexte propre et des enjeux
spécifiques.
On ne pouvait présumer qu’une juridiction
française franchirait ce cap et favoriserait la tenue
d’un tel procès. Il n’est pas celui
d’une nation entière, mais ce qui est advenu
à 4 personnes de nationalité
française. C’est à ce titre
qu’a été reçue la plainte
contre 19 chiliens compromis dans des actes de barbarie, dont 13 ont
été reconnus coupables (et 5 accusés
ayant décédés depuis). Plus de dix ans
de labeur peut-on présumé pour que se tienne le
jugement des artisans et orchestrateurs de ces 4 crimes.
C’est au sein de la plus haute juridiction criminelle
française, les Assises que se sont retrouvés en
cause plus d’une dizaine d’accusés. Les
acteurs des 4 crimes poursuivis n’ont pas cherché
à se manifester, ni même à se faire
représenter. Ces tortionnaires et ordonnateurs se sont
protègés derrière une loi chilienne
empêchant toute procédure d’expulsion
d’un national. Certains sont morts comme Augusto Pinochet en
décembre 2006 et Paul Shaefer ou Shäfer en 2009 (un
ancien caporal de l’armée nazie, qui a pris souche
ans les années 1960 au sein de la colonie Dignitad, qui fut
un centre de rétention et de torture de la junte). Ils ne
pourront répondre de leurs crimes et nous
éclairer sur les circonstances les ayant conduit
à donner des ordres ou bien à les
exécuter.
Alphonse Chanfreau, Georges Klein, Etienne Pesle et Jean-Yves Claudet
permettent de découvrir ce qui a pu se produire,
même s’ils ne représentent pas
à eux seuls l’étendue des actes de
torture et les séquestrations. Nos quatre hommes de 23
à 49 ans sont représentatifs de cette
génération sacrifiée, et ils ont
été l’objet en France de
procédures juridiques ouvertes en 1998. Ce fut suite
aux demandes du juge espagnol Balthazar Garzon contre
l’ancien dictateur Augusto Pinochet. Il en avait
résulté l’arrestation en
Grande-Bretagne de l’ancien chef de la junte pendant quelques
semaines. Un épisode qui permit par la suite en France le
dépôt d’une plainte. Et qui plus est la
mise à jour d’un motif commun : les quatre
franco-chiliens ont disparu sans que l’on retrouve leurs
dépouilles et demeurent encore aujourd’hui sans
sépultures.
Ces actions en justice auront pour répercussion
l’ouverture d’une enquête trouvant 12 ans
après un prétoire français pour
entendre les familles concernées. Si certaines
procédures ont pu aboutir au Chili contre des
tortionnaires, bon nombre de responsables sont encore en
liberté, et à ce rythme, une majorité
d’entre eux décéderont à
domicile sans avoir à répondre de leurs
participations criminelles. Néanmoins, un des initiateurs
principaux et ancien
bras droit de Pinochet, Juan Manuel Conteras - 81 ans - est
depuis 2005 sous les barreaux au Chili, et se voit condamné
aussi dans la disparition de A. Chanfreau, G. Klein, E. Pesle et J.Y.
Claudet, en France.
Si les responsabilités sont établies en ce qui
concerne certains hauts gradés de
l’époque, le Chili en a-t-il fini avec tous les
tortionnaires ayant agit en leurs noms ? Il semble que la
réponse soit négative, de toute
évidence le travail de mémoire reste à
faire et aux générations nouvelles de se pencher
sur une histoire sanglante qui reste à écrire. Au
moins ce procès permettra t-il un jour d’ouvrir de
nouvelles suites au Chili, c’est au mieux ce que
l’on peut attendre d’un pays
libéré de ses démons.
Un
basculement est intervenu le 11 septembre 1973
Une société entière dans ses
fondements démocratiques s’écroule. Il
y a pour réalité Salvador Allende se suicidant au
sein du Palais Présidentiel de la Moneda, et un pays entier
sombrant dans le fascisme du jour au lendemain.
Sous les ordres d’Augusto Pinochet et suite au coup
d’état du 11 septembre 1973, ce sont 3.000
chiliens qui vont connaître la mort, 30.000 autres vont subir
la torture, et plusieurs dizaines de milliers un exil forcé.
Il n’était pas suffisant de renverser un
président démocratiquement élu,
Salvador Allende, il fallut décapiter toute
l’opposition de gauche.
Que s’est-il produit, qu’est-ce qui a pu pousser
à tel vent répressif ? pourquoi
élimine-t-on une opposition? comment s’impose ou
s’organise un pouvoir dictatorial? pourquoi une nation
semblant stable peut-elle basculée dans l’horreur?
et cerise sur le gâteau, comment une
idéologie d’inspiration purement fasciste va
prendre la direction du pays?
En ces temps pas si lointain, la lecture géopolitique
était scindée en deux empires faisant du Chili
une chasse gardée des Etats-Unis. La haute
bourgeoisie chilienne, c’est-à-dire les
oligarchies locales vont imposer dans les faits une dictature.
L’acharnement de l’opposition dite de centre-droit
et les tentatives de déstabilisation du
gouvernement de l’Unité Populaire
n’auront qu’un seul but, et aura pour
finalité de renverser le pouvoir légal en place.
En 1973, pour les chiliens, il en fut autrement et les condamnations
n’eurent que peu d’échos,
néanmoins elles ont possiblement éviter un bain
de sang plus grand.
Les réformes du gouvernement progressiste de l’U.P
touchèrent directement les richesses minières du
pays et en contrepoint la menace de tarir la manne des profits sonnants
et trébuchants. L’on touchait là,
à des intérêts colossaux, à
l’exemple du cuivre, et de l’importance de
contrôler une ressource cruciale et économiquement
très rentable. Car non seulement la ressource est mise en
valeur, mais elle engraine surtout des recettes, des taxes à
chaque étape de production.
De l’extraction à son conditionnement, cela
suppose que le pays exportateur abandonne une part de cette richesse au
profit d’une industrie tierce et d’une
économie transnationale ou étrangère.
La richesse n’est pas dans la ressource extraite, mais dans
la vente de produits, dont on contrôle au passage les normes
et les flux financiers. Un faible coût de la
matière permet ainsi que s’engrange le maximum de
la plus value au sein du pays qui va conditionner et vendre le produit
fini.
L’objectif visé de la dictature a
été d’annihiler les forces populaires
qui avaient pris le pouvoir en 1970 au Chili. Ce plan
démoniaque visant à renverser des institutions
démocratiques a fonctionné et a
perduré pendant de longues années. Depuis 1990 ce
pays cherche un nouveau souffle, l’on parle même de
transition pour décrire l’après
Pinochet, mais ce qui peut étonner, c’est pourquoi
tant de crimes sont restés impunis ?
Pourquoi en vient-on à décapiter une
génération militante, Qu’est-ce qui a
poussé une partie des Chiliens à choisir le
totalitarisme et les injonctions de l’Empire ?
L’implication de Washington a été
importante, elle n’est pas en soit une surprise. Services
secrets, diplomaties, transnationales étasuniennes ne seront
pas étrangères à la
préparation du coup d’état. Des appuis
financiers ciblés serviront à choisir le chaos et
condamner au silence les forces vives du pays.
Même si 37 années se sont
écoulées depuis le coup
d’état, il reste non seulement à
comprendre, transmettre et mettre en lumière un cataclysme.
Ce qui s’est passé à non seulement
valeur et sens aux yeux des « survivants » ou
rescapés de la mémoire, notamment les familles de
victimes et ceux ayant subit dans leur chaire les exactions du
régime militaire, mais aussi tous ceux qui souhaitent
comprendre ce qui s’est mis en route. Nous amenant de plus
à nous interroger sur ce qui fait lien entre la France et le
Chili ? et pourquoi une réalité au demeurant si
lointaine devient l’objet d’une attention toute
particulière ?
Au delà du jugement sorti à Paris ou au Chili, il
en va du droit international à juger des bourreaux,
à faire respecter une justice sans frontières, et
ne pas laisser des coupables tromper l’ennui. Cette mise en
lumière d’un fascisme questionne. Il
n’est pas sans lien à ce qui s’est
déroulé en Europe dans les années
1930, c’est à cette même
époque que se constitue au Chili un parti
national-socialiste. Cette persistance idéologique a
aujourd’hui pour résultat qu’une partie
de la société chilienne ne souhaite pas aborder
le sujet. Que l’on puisse apparenter le Chili des
années 1970 et 1980 à un état fasciste
n’est pas acceptable, au pire c’est un tournant
économique qui aura permis de faire du Chili un pays
moderne...
Quand
la vision totalitaire
l’emporte
Les sociétés latino-américaines ont
toujours vécu sur un ordre raciste et discriminatoire, qui
plus est elles ont toujours cumulé de très
grandes inégalités sociales, plus une
liberté d’expression réduite et un
terreau favorable au culte sans mesure du chef et des apparats
militaires. Cet ordre de pensée s’est
inspiré dans la droite ligne des théories
racistes et fascistes européennes, il verra la mise en
œuvre des systèmes totalitaires usant de
procédés d’inspiration purement
guerrière et contre ses populations civiles, non seulement
au Chili, mais partout dans la région. Cette lecture des
événements par des ressorts
idéologiques n’est pas le fait du hasard, mais
d’une correspondance certaine à un ordre des
choses.
Peut-on interpréter le suicide de Salvador Allende ?
Qu’est-ce qu’il a poussé
au-delà de son ardeur et de ses combats à mettre
fin à ses jours ? S’est-il douté du
chaos qui allait se produire ? Plus que d’autres, il a pu
à ce sujet se douter et même avoir à sa
connaissance un projet de coup d’état.
Dès sa prise de pouvoir en 1970, les difficultés
seront fortes, et plus il avancera vers certains types de
réforme, plus il connaîtra une opposition
déterminée à
l’éliminer lui et ses partisans.
Qu’a-t-il voulu signifier en se sacrifiant ? Nous
n’aurons jamais la réponse de sa part, et il
serait vain d’y répondre. Un seuil a
été dépassé et à
ce stade toute résistance s’avère
vaine, seule la détention inique et cynique du pouvoir et de
la force l’emporte.
Le 11 septembre 1973, un néo-fascisme a vu jour avec
l’aval de la super puissance et l’appui des
bourgeoisies continentales. Ce que la citoyenneté pouvait
représenter d’embryonnaire en Amérique
Latine voit avec la disparition de la démocratie chilienne
un arrêt net de tout processus
d’émancipation et de progrès social
à l’échelle continentale. Au nom de la
lutte contre le «communisme» tout ce qui
ressemble de loin ou de près à un «
rouge est meilleur mort que vivant », pour
reprendre un type de phraséologie en vogue à
cette époque.
En 1973, deux modèles s’affrontaient à
l’échelle mondiale et toutes contradictions aux
deux systèmes se voyaient réduites au silence. La
question n’est pas de savoir si un modèle
totalitaire l’emporte sur l’autre, mais ce qui a
conduit une nation de l’hémisphère sud
à en accepter les mécanismes et les
dérives. En quoi l’exercice
démocratique est difficile, et qu’à
tout prendre la vision absolutiste finie par dominer les esprits et
balayer sur son passage les fondements de la raison humaine. On ne
brise pas le silence parce que l’on sait, on prend en examen
les sources et l’on essaie de ne pas trop s’y
soustraire.
Seuls les faits ont une importance, et le procès qui
s’est déroulé en France peut avoir des
accents symboliques en l’absence des concernés,
mais il a un caractère important et pointe la
responsabilité de l’état chilien dans
le peu d’empressement à faire connaître
la vérité, et permettre aux familles des victimes
d’enterrer leurs morts, ou simplement faire le deuil
d’un être disparu.
Ce que soulève la question des disparitions, c’est
que le plus souvent le corps ne puisse être
retrouvé, au passage c’est une constante
que
l’on connaît bien en Amérique Latine.
Une pratique toujours très active en Colombie, qui consiste
à faire disparaître les preuves d’un
acte criminel. Pas de corps, pas de sépulture et
l’impossibilité de mettre en évidence
les échelles de responsabilité et les auteurs. Il
n’y a rien d’étrange à
constater, que les mêmes modes opératoires sont
toujours en cours et au service des mêmes idées.
Ce qui nous sépare de faits intervenus, il y a plus de 30
ans, nous pose indubitablement la question de pourquoi donner
à l’histoire une cohérence, et vouloir
rouvrir certaines plaies propres à la
société chilienne ? Cette
perméabilité au terrorisme
d’état, à l’usage de la
force, à la répression des oppositions, nous
ouvre sur le grand livre blanc des souffrances de ce continent
énigmatique et pourtant nôtre, si l’on
se réfère à l’objet monde.
Ce qui s’est passé au Chili en septembre 1973
illustre un pan ce que l’on appelle la « guerre
froide », ou comment à
l’époque l’Amérique du Sud
s’est retrouvée en première ligne de
l’affrontement entre les deux superpuissances du moment. Il
faudrait remonter à l’Ecole des
Amériques créée en 1946 pour
comprendre comment les Etats-Unis vont agir et faire de
l’Amérique Latine une continuité
territoriale militaire et économique.
Prendre en compte la formation des élites militaires
c’est tracer et imprimer une stratégie et par
ailleurs dicter une ligne de conduite stratégique et
politique. Dans le même sillage,
l’industrie nord américaine a besoin des
ressources notamment pour servir ses desseins d’expansion.
Les bourgeoisies locales dans leurs grandes majorités vont
s’y soumettre, tout en favorisant des régimes
dictatoriaux et aider aux investissements étasuniens.
La lutte contre l’Union Soviétique est non
seulement systématique, mais tout ce qui est
associé est combattu sans merci. L’ordre bi
mondial ou bipolaire domine les esprits, peu de place à la
critique, nous vivions un ordre des choses scindé en deux
camps et en dehors d’un ou l’autre
«modèle», les alternatives politiques
furent
plutôt rares d’un côté comme
de l’autre. Et quand Salvador Allende accède en
1970 à la magistrature suprême, il est
d’entrée perçu à Washington
comme un homme à abattre. Il faudra lui imposer à
chaque étape électorale ou de réforme
une tactique visant à empêcher le processus de
transformation citoyen et économique.
Richard Nixon en 1973 est entrain de perdre la guerre au Vietnam, la
même année il est impliqué dans le
scandale du Watergate, on ne pouvait laisser un mouvement qui est plus
est progressiste l’emporter sur le continent, sauf
à faire de Santiago du Chili un contre-exemple. Dans un
monde aussi tranché, les politiques du gouvernement de
gauche n’ont pas servit le dessein expansionniste.
«Une des plus puissantes d’entre elles,
l’ITT Corporation (International Telephone and Telegraph)
possède en 1970, 70% de la Chitelco, la compagnie de
téléphone chilienne, qui se traduit par la
récolte de 153 millions de dollars à
l’époque. L’ITT déverse des
fonds dans les caisses noires du parti républicain ;
impossible pour Nixon de les ignorer. Un membre du conseil
d’administration de l’ITT et ex-directeur de la
CIA, promet un million de dollars supplémentaire
à Nixon en échange d’une «
mise hors d’état de nuire » du nouveau
président socialiste. D’autres multinationales,
tel que Anaconda Copper (cuivre) en firent de
même.» (2).
Si le programme de l’Unité Populaire
n’est plus ni moins un projet « souverainiste
», du moins la charge de défendre ses
intérêts et mieux les répartir. En
s’extrayant du marché et en allant à
contre-courant de ce qu’imposait la machine expansionniste,
il ne resta pour les oligarchies et le département
d’état sous la gouverne d’Henry
Kissinger qu’une solution. Mettre fin à cette
volonté de redistribuer une part des richesses et des
produits à la population chilienne
n’était pas acceptable. Cette politique ne
contribuait en rien aux intérêts de la puissance
dominante.
L’objectif premier de toutes les ambassades
étasuniennes était (et reste) d’assurer
la plus grande plus-value possible et soutenir des investissements en
renforçant la dépendance ou la soumission. Quitte
à en oublier certains principes de liberté et de
démocratie. L’histoire des latinos
américains de nord en sud est intimement liée
à ce qu’ont imposé les pouvoirs
dictatoriaux locaux sous l’ordonnance le plus souvent des
militaires du cru et avec l’aval de la Maison-Blanche et des
milieux industriels.
Une continuité qui a opéré dans les
Caraïbes, en Amérique Centrale et du Sud, et pas un
pays n’a vécu de 1947 à
l’effondrement du mur de Berlin une
démocratie pérenne. Chaque nation a connu sa
période totalitaire plus ou moins longue. Toutes les
dictatures ont laissé une trace, des mémoires
ouvertes et l’espérance d’une
réparation à sa juste mesure.
Notes
:
(1) liste des
inculpés :
- Juan Manuel CONTRERAS SEPÚLVEDA, ancien Chef de la DINA et
ancien Général de l’Armée de
Terre chilienne
- Hermán Julio BRADY ROCHE ancien Commandant en Chef de la
garnison de Santiago
- Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO ancien Colonel de
l’Armée de Terre, Directeur des
opérations et Chef de la Brigade d’Intervention
Métropolitaine (BIM) de la DINA
- José Osvaldo RIVEIRO ancien Lieutenant-Colonel de
l’Armée de Terre
- Marcelo Luís MOREN BRITO ancien Commandant de
l’Armée de Terre
affecté à la DINA
- Miguel KRASNOFF MARTCHENKO ancien Capitaine de
l’Armée de Terre affecté à
la DINA
- Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA ancien Officier au
Régiment de TACNA
- Gerardo Ernesto GODOY GARCÍA ancien Sous-Lieutenant de
l’Armée de Terre, affecté à
la DINA
- Basclay Humberto ZAPATA REYES ancien Sous-Officier de
l’Armée de Terre affecté à
la DINA
- Enrique Lautaro ARRANCIABIA CLAVEL ancien Représentant de
la DINA en Argentine
- Raúl Eduardo ITURRIAGA NEUMANN ancien Responsable du
Département extérieur de la DINA
- Luís Joachim RAMÍREZ PINEDA ancien Commandant
du camp de TACNA,
- José Octavio ZARA HOLGER ancien Officier de
l’Armée de Terre en poste à la DINA
- Emilio SANDOVAL POO ancien militaire de réserve de la
Force aérienne, actuellement chef d’entreprise
à Temuco
(2) Yazmin Fernandez-Acuna veuve d’Humberto Menanteau (Jeune
chilien d’origine française, torturé
à mort par les tortionnaires de la DINA, à la
Villa Grimaldi, Santiago du Chili, le 20 novembre 1975. Humberto
Menanteau avait 24 ans).
|
|
|
"Desaparecidos - Disparus"
un document
réalisé par Nicolas Joxe
En 2008, la FIDH organise une mission au Chili dans le but
d’informer les associations de familles de disparus et la
société chilienne de la tenue en France du
procès
des responsables présumés de la disparition de
quatre
franco-chiliens : Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau et
Jean-Yves Claudet. En se rendant au Chili aux
côtés des
membres de la FIDH, le réalisateur décide de
faire un
film pour comprendre comment et pourquoi ces quatre hommes ont disparu.
|
|
|
|
|
|
|
La
mémoire des survivants
et la révolte des ombres :
les
disparus dans la société chilienne (1973-1995)
|
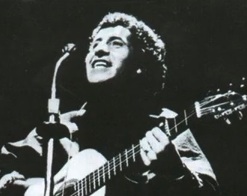
Antonia GARCIA CASTRO, décembre 2010
1 - S'il fallait fixer une date marquant le début du
processus
de démocratisation au Chili, peut- être
faudrait-il opter
pour ce 5 octobre 1988, où le peuple chilien a
été
invité à se prononcer sur l'avenir du
régime
militaire. Ce choix serait moins motivé par l'issue de ce
référendum que par sa mise en œuvre. En
effet, pour
la première fois depuis le coup d'Etat de 1973, deux
conceptions, non pas seulement de l'avenir, mais aussi du
passé
du Chili, se sont opposées ouvertement. Poser la question de
la
capacité des militaires à gouverner le pays ne
pouvait
que solliciter une réflexion plus ample sur la
manière
dont le pays avait été, effectivement,
gouverné
par les militaires.
Cette présence du passé devint, durant les
années
quatre-vingt-dix, un thème majeur du débat
politique,
soutenu par l'interrogation suivante : " Que faut-il
connaître
des pratiques répressives du régime militaire
afin de
consolider la transition démocratique? ". Le fait que la
transition ait été une initiative du
régime
militaire lui-même place le nouveau gouvernement dans une
situation complexe : limité dans son action par des entraves
institutionnelles qui protègent les
intérêts des
forces armées, il ne peut cependant ignorer les
revendications
des secteurs politiques dont il est issu. Or, la thématique
des
violations des droits de l'homme, perpétrées sous
le
régime militaire, a été le ferment de
la coalition
qui remporta les élections du 14 décembre 1989.
2 - Le crime de la disparition-forcée est au cœur
de ce
débat qui cherche à établir ce qu'il
faut retenir
des événements de 1973. Il en est ainsi, parce
que son
existence donna lieu à une organisation qui, dès
1975,
s'opposa publiquement au régime : l'Association des Familles
des
Détenus-Disparus (A.F.D.D.). Ce sont les mères
des
disparus qui, les premières, sont descendues dans les rues
de
Santiago pour demander aux autorités compétentes
où se trouvaient leurs enfants.
Leur prise de parole fraya un chemin de liberté qui fut
progressivement emprunté par d'autres. La lutte des familles
des
disparus devint ainsi un des symboles de la résistance au
régime militaire. Mais surtout, la manière dont
ces
femmes entrèrent dans la vie politique chilienne, modifia
sensiblement la nature du conflit qui opposait les partisans de
l'ancien gouvernement socialiste aux Forces Armées : c'est
au
grand jour et sans armes qu'elles dressèrent, à
la vue de
tous, les images de la disparition-forcée
déjouant ainsi
la stratégie d'invisibilisation du pouvoir5.
3 - Or, si le crime de la disparition-forcée pose
actuellement
un problème au gouvernement démocratique, c'est
moins
parce qu'il est un objet du débat que parce qu'il interroge
la
société chilienne sur la
légitimité
même de ceux qui prennent la parole : comment juger
aujourd'hui
le crime de la disparition-forcée sans porter un jugement
sur la
nature du pouvoir alors en place ? Comment prononcer un jugement si
l'on ne dispose pas, par ailleurs, du pouvoir de le faire ? La
manière dont le débat est posé importe
peut-être plus que l'issue du débat
lui-même car les
mots prononcés seront, quoi qu'il advienne,
légués
aux prochaines générations. Et cette certitude
détermine aussi la manière dont se joue le
rapport de
force opposant ceux qui gouvernent et ceux qui ont gouverné.
Ainsi, la question initiale importe peu si elle n'est pas
accompagnée de cette autre question : " Comment ces
prochaines
générations, se souviendront-elles des
événements de 1973? Comment se souviendront-elles
de ces
hommes et de ces femmes qui en furent les acteurs? ". C'est
là,
peut-être, une des principales victoires des familles des
détenus- disparus : avoir fait de la
disparition-forcée
un miroir où chacun peut se regarder tel qu'il sera aux yeux
des
générations à venir.
Les
paradoxes de la disparition
4 - S'il n'est pas aisé de concevoir le crime de la
disparition-forcée, c'est peut-être parce que sa
principale caractéristique est une absence. Dire d'une
personne
qu'elle " a disparu " ne nous renseigne nullement sur son sort : elle
peut être morte, elle peut être vivante, elle est
considérée comme " disparue " parce qu'un jour
elle n'a
plus été " vue " par son entourage. La
disparition-
forcée suppose toujours l'occultation du corps de la
victime. Et
tant que le corps n'est pas visible, tant qu'il demeure introuvable,
quiconque pratique la disparition n'a pas à
répondre de
ses actes.
Ainsi, c'est l'existence d'un entourage qui donne un sens à
l'utilisation de cette pratique. C'est parce que quelqu'un va constater
la disparition d'un individu, sans pouvoir pourtant la prouver, que la
disparition-forcée peut devenir un instrument du pouvoir.
Entre
1973 et 1990, elle permit au régime militaire chilien
d'exercer
un pouvoir coercitif, sur certains secteurs de la population, tout en
se défendant publiquement de porter atteinte aux droits de
l'homme.
5 - Qui sont les disparus ? Pour la plupart, il s'agit d'hommes et de
femmes appartenant à des organisations politiques (partis,
syndicats, associations) ayant soutenu le gouvernement socialiste. En
tant que tels, ils ont été
désignés comme
étant le nouvel ennemi : " La doctrine marxiste
développe
une conception de l'homme et de la société qui
blesse la
dignité humaine et porte atteinte aux valeurs
chrétiennes
de la tradition nationale ".
La pratique de la disparition- forcée s'inscrit dans la
logique
d'un discours qui cherche à déterminer quelles
doivent
être les valeurs de la communauté nationale, qui
en fait
partie et qui doit en être définitivement exclu8.
Les
partisans du gouvernement socialiste sont, en raison de leur
appartenance politique, perçus par les nouveaux gouvernants
comme étant membres d'une communauté dissidente
et ils
doivent, de ce fait, être à jamais bannis de la
communauté nationale. La pratique de la
disparition-forcée s'intègre donc dans ce
dispositif plus
large par lequel le pouvoir militaire cherche à
légitimer
son action et à jeter le discrédit sur ceux qu'il
réprime : les militants de gauche sont de " mauvais "
éléments ne pouvant que nuire, par leur simple
existence,
à l'ensemble du " corps " national.
Les procédés de la disparition-forcée
sont
particulièrement " adaptés " à cette "
éradication du mal ". En effet, le disparu est souvent un
prisonnier qui n'a pas été reconnu par les
autorités militaires. Conduit dans un centre secret de
détention, son corps est dérobé aux
regards du
monde extérieur et privé de tous ses droits.
L'appropriation radicale du corps du prisonnier permet au pouvoir
militaire de se prétendre absolu, en dévoilant,
en
même temps, l'inutilité de tout acte de
résistance.
Cette dimension est essentielle car l'individu qui disparaît
est,
aussi et surtout, un intermédiaire permettant de dissuader
une
collectivité donnée de s'ériger en
opposition au
pouvoir établi.
En effet, c'est l'entourage de la victime qui subit, à
proprement parler, les effets de la disparition-forcée. Il y
a
tout lieu de croire que la disparition cherchait à
atteindre, en
priorité, l'entourage politique du disparu : n'importe quel
moyen pouvait être utilisé pour soutirer des
informations
à ce prisonnier que personne n'était en mesure de
défendre10 ; il devenait ainsi un pion permettant la capture
d'autres individus qui, à leur tour, pouvaient
être
contraints de participer, plus ou moins directement, à des
arrestations. Mais, cet entourage, organisé politiquement,
n'était pas le seul visé.
La disparition-forcée s'adressait également
à des
inconnus : quiconque était confronté à
la
disparition d'un proche (un parent, un ami, un collègue de
travail, ou encore l'ami d'un ami...) était
engagé
à garder le silence car toute prise de parole pouvait
conduire
au " même " sort. Et c'est là, que la
disparition-forcée apparaît comme une pratique
coercitive
tout à fait particulière, puisque personne ne
savait,
réellement, en quoi consistait ce sort.
L'ombre qui semble ensevelir le corps du disparu affecte son entourage
autrement que la certitude d'un mauvais traitement, ou même,
d'une mort : c'est le doute, provoqué par la disparition
d'un
proche, qui constitue la blessure pour ceux qui demeurent. Mais, si
n'importe quelle connaissance de la victime pouvait être
intimidée par sa disparition, seul son entourage affectif
pouvait éprouver cette blessure. C'est parce qu'ils avaient
appris à vivre avec l'être cher, que les
mères, les
compagnes, les enfants des disparus vécurent
désormais le
moindre détail de la vie quotidienne (un anniversaire qui ne
fut
pas souhaité, une parole qui ne fut plus entendue) comme une
anomalie insupportable. (...) |
|
Lire la suite ou
télécharger :
La mémoire des
survivants (en PDF) |
|
Source : Cultures
& Conflits
http://conflits.revues.org |
|
|
|
|
|
| Chili
: "COUP D'ETAT 1973" |
|

Gabriel García Márquez, année 2002
Nous sommes à la fin 1969. Trois
généraux du
Pentagone reçoivent à dîner quatre
militaires
chiliens dans une villa de la banlieue de Washington. Leur
hôte,
alors colonel de l'Armée de l'air chilienne, est Gerardo
Lúpez Angulo, qui est aussi attaché à
la mission
militaire du Chili aux États-Unis. Ses invités
chiliens
sont des camarades des autres armes. Ce dîner est
organisé
en l'honneur du directeur de l'École d'Aviation du Chili, le
général Carlos Toro Mazote, arrivé la
veille en
visite d'études. Au menu : une salade de fruits et un
rôti
de veau aux petits poix, le tout arrosé d'un vin de la
lointaine
patrie que les sept militaires dégustent, nostalgiques, en
pensant aux oiseaux lumineux des plages du Sud, alors que Washington
naufrage dans la neige. Leur conversation, en anglais, porte sur le
seul sujet qui semble intéresser tous les Chiliens
à
l'époque : les élections
présidentielles du mois
de septembre prochain. Au dessert, un des
généraux du
Pentagone demande ce que ferait l'Armée chilienne si le
candidat
de la gauche, Salvador Allende, gagnait les élections. Le
général Toro Mazote répond alors : "
Nous
prendrons le Palais de la Moneda en une demi-heure, même s'il
nous faut l'incendier ! "
LE
11 SEPTEMBRE 1973 : CHRONIQUE D'UNE TRAGÉDIE
ORGANISÉE
Un des convives était le général
Ernesto Baeza,
directeur de la Sécurité nationale du Chili. Lors
du coup
d'État, c'est lui qui coordonna l'assaut du palais
présidentiel et donna l'ordre d'y bouter le feu. Pendant ces
jours agités, deux de ses subalternes deviendront
célèbres dans la même
journée : le
général Augusto Pinochet, président de
la Junte
militaire, et le général Javier Palacios, qui
participa
à l'attaque finale contre Salvador Allende.
Autour de la table se trouvait aussi le général
de
brigade aérienne Sergio Figueroa Gutiérrez,
actuel
ministre des Travaux publics et ami intime d'un autre membre de la
Junte militaire, le général d'aviation Gustavo
Leigh, qui
ordonna de bombarder le palais présidentiel avec des
missiles.
Le dernier invité était Arturo Troncoso,
aujourd'hui
amiral et gouverneur naval de Valparaíso. Il dirigea la
sanglante purge des officiers progressistes de la marine de guerre,
après avoir entamé le soulèvement
militaire
à l'aube du 11 septembre 1973.
Ce dîner historique fut en fait le premier contact du
Pentagone
avec des officiers des quatre armes des forces armées
chiliennes. Lors des réunions qui suivirent, tant
à
Washington qu'à Santiago, l'accord final fut
scellé : les
militaires chiliens plus proches de l'âme et des
intérêts des États-Unis prendraient le
pouvoir si
l'Unité populaire venait à gagner les
élections.
Cette opération fut planifiée de sang froid,
telle une
simple manœuvre de guerre, sans tenir compte des conditions
réelles du Chili.
Le plan avait été élaboré
d'avance, pas
uniquement sous la pression de l'International Telegraph &
Telephone (ITT), mais aussi pour des raisons bien plus profondes de
géopolitique. Il avait été
baptisé
Contingency Plan. L'organisme chargé de le mettre en marche
était la Defense Intelligence Agency du Pentagone, mais
l'instance exécutrice fut la Naval Intelligence Agency, qui
centralisa et analysa les données des autres agences, y
compris
la CIA, sous la direction politique du Conseil national de
sécurité. Il était normal que le
projet soit
confié à la Marine et non à
l'Armée, car le
coup d'État au Chili devait coïncider avec
l'opération Unitas, ensemble de manœuvres des
unités américaines et chiliennes dans le
Pacifique. Ces
manœuvres avaient traditionnellement lieu en septembre, le
même mois que les élections. Il était
donc naturel
que le sol et l'espace aérien du Chili soient remplis de
matériel de guerre en tous genres et de soldats
entraînés aux arts et aux sciences de la mort.
À l'époque, Henry Kissinger avait
déclaré
à un groupe de Chiliens : " Le Sud du monde ne
m'intéresse pas et je ne veux rien connaître de ce
qui se
trouve plus bas que les Pyrénées ". Le
Contingency Plan
était alors prêt jusque dans les moindres
détails
et il est impensable que Kissinger n'était pas au courant et
que
le président Nixon lui-même n'en sache rien.
Aucun Chilien ne croit que demain c'est mardi.
Le Chili est un pays étroit : 4 270 km de long sur 190 km de
large. Il compte 10 millions d'habitants effusifs, dont deux millions
vivent à Santiago, la capitale. La grandeur du Chili ne
tient
pas tant du nombre de ses vertus que de l'ampleur de ses exceptions.
Ainsi, à l'époque, le cuivre est la seule chose
que le
pays produit avec un sérieux absolu, mais c'est aussi le
meilleur cuivre du monde, et le volume produit est à peine
inférieur à celui combiné des
États-Unis et
de l'Union soviétique.
Le Chili produit aussi des vins aussi bons que les vins
européens, mais les exporte peu, car les Chiliens en boivent
presque la totalité. De 600 dollars, son revenu par habitant
était alors un des plus élevés
d'Amérique
latine ; or, presque la moitié du produit national brut est
partagée entre 300 000 personnes à peine. En
1932, le
Chili fut la première république socialiste du
continent.
Le gouvernement tenta alors de nationaliser le cuivre et le charbon,
avec le soutien enthousiaste des travailleurs. Mais
l'expérience
ne dura pas plus de 13 jours.
Pays sismique, le Chili connaît aussi en moyenne un
tremblement
de terre tous les deux jours, et un séisme
dévastateur
tous les trois ans. Les géologues les moins apocalyptiques
estiment que le Chili n'est pas un pays de terre ferme, mais
plutôt une corniche des Andes, perdue dans un
océan de
brumes, et que tout le territoire, avec ses
salpêtrières
et ses femmes douces, est condamné à
disparaître
dans un cataclysme.
D'une certaine manière, les Chiliens ressemblent beaucoup
à leur pays. Ce sont les gens les plus sympathiques du
continent
; ils aiment se sentir bien en vie et savent l'être autant
que
possible, voire plus. Mais ils ont une dangereuse tendance au
scepticisme et à la spéculation intellectuelle. "
Aucun
Chilien ne croit que demain c'est mardi ", m'a dit un jour un Chilien,
qui n'en croyait rien non plus.
Cependant, même avec cette incrédulité
de fond, ou
peut-être grâce à elle, les Chiliens ont
atteint un
certain degré de civilisation naturelle, de
maturité
politique et de culture qui sont leurs meilleures exceptions. Des trois
Prix Nobel de littérature d'Amérique latine, deux
étaient Chiliens, et l'un d'eux, Pablo Neruda,
était le
plus grand poète de ce siècle. Tout cela,
Kissinger le
savait bien lorsqu'il répondit qu'il ne connaissait rien au
Sud
de la planète. C'est que le gouvernement des
États-Unis
connaissait alors jusqu'aux plus profondes pensées des
Chiliens.
Il les connaissait depuis 1965 lorsque, sans la permission du
gouvernement chilien, il avait lancé une incroyable
opération d'espionnage social et politique : le Plan
Camelot. Il
s'agissait d'une enquête furtive, se servant de
questionnaires
très précis, présentés
à toutes les
couches sociales, à toutes les professions, à
tous les
métiers, jusqu'aux moindres recoins du pays.
L'idée
était de définir, de manière
scientifique, le
degré de développement politique et les tendances
sociales des Chiliens. Dans le questionnaire destinés aux
militaires figurait la question reposée cinq ans plus tard
aux
officiers du dîner de Washington : quelle serait leur
attitude si
le communisme arrivait au pouvoir dans le pays ? La question
était malicieuse. Après l'opération
Camelot,
Washington savait très bien que Salvador Allende serait
élu président de la République.
Ce n'est pas un hasard si le Chili fut choisi pour un tel scrutin.
L'ancienneté et la force de son mouvement populaire, la
ténacité et l'intelligence de ses dirigeants et
les
conditions économiques et sociales du pays, tout cela permit
de
prévoir la tournure des événements.
L'analyse de
l'opération Camelot l'avait confirmé : le Chili
allait
devenir la deuxième république socialiste du
continent,
après Cuba. Autrement dit, le but des États-Unis
n'était pas simplement d'empêcher le gouvernement
de
Salvador Allende pour protéger les investissements
américains. L'idée, à plus grande
échelle,
était de réitérer
l'expérience la plus
atroce, mais aussi la plus productive, que l'impérialisme
ait
jamais menée en Amérique latine : celle du
Brésil.
Doña Casserole se jette à la rue...
Le 4 septembre 1970, comme prévu, Salvador Allende,
médecin socialiste et franc-maçon,
était
élu président de la République. Mais
le
Contingency Plan ne fut pas mis en œuvre. L'explication la
plus
courante est aussi la plus amusante : un fonctionnaire du Pentagone
commit une erreur et demanda 200 visas pour une soi-disant fanfare
navale qui était en fait composée d'experts
ès
coups d'État, dont plusieurs amiraux qui ne savaient
même
pas chanter. Le gouvernement chilien découvrit la
manœuvre
et refusa d'accorder les visas. Cet incident, dit-on, aurait
entraîné le report de l'opération. La
vérité est que le projet avait
été
évalué à fond : d'autres agences
américaines, la CIA surtout, ainsi que l'ambassadeur
américain à Santiago, Edward Korry,
estimèrent que
le Contingency Plan était une opération militaire
qui ne
tenait pas compte de la situation du Chili à
l'époque.
En effet, le triomphe électoral de l'Unité
populaire
n'engendra nullement la panique sociale qu'attendait le Pentagone. Au
contraire, l'indépendance affichée du
gouvernement en
matière de politique internationale et sa
résolution sur
le terrain de l'économie avaient aussitôt
créé une ambiance de fête sociale. Dans
la
première année, 47 entreprises industrielles
furent
nationalisées, ainsi que plus de la moitié du
système de crédits. La réforme agraire
expropria
2,4 millions d'hectares de terres agricoles pour les
intégrer
à la propriété sociale. L'inflation
fut
freinée, le plein emploi fut atteint et les salaires
connurent
une hausse effective de quelque 40%.
Le gouvernement précédent,
présidé par le
démocrate-chrétien Eduardo Frei, avait
entamé la
nationalisation du cuivre. Mais cette opération n'avait
consisté qu'à racheter 51% des parts des mines.
Or, pour
la seule installation minière de El Teniente, le montant
versé était supérieur à la
valeur totale de
la mine. Le gouvernement de l'Unité populaire, quant
à
lui, récupéra, par un seul acte juridique, tous
les
gisements de cuivre exploités par les filiales des
sociétés américaines Anaconda et
Kennecott. Et ce,
sans verser aucune indemnité, car le gouvernement calcula
que
les deux sociétés avaient, en 15 ans,
engrangé un
bénéfice excessif de 80 milliards de dollars.
La petite bourgeoisie et les couches sociales
intermédiaires,
deux grandes forces qui auraient pu alors appuyer un putsch militaire,
commençaient à jouir de
bénéfices
imprévus, et non plus au détriment du
prolétariat,
comme cela fut toujours le cas, mais plutôt sur le dos de
l'oligarchie financière et du capital étranger.
Les
forces armées, en tant que groupe social, ont le
même
âge, la même origine et les mêmes
ambitions que la
classe moyenne. Si bien qu'elles n'avaient aucune raison, ni
même
un alibi, de soutenir un groupe restreint d'officiers putschistes.
Consciente de cette réalité, la
Démocratie
chrétienne non seulement ne parraina pas la conspiration
militaire, mais elle s'y opposa résolument, sachant qu'un
putsch
serait impopulaire même dans ses rangs.
Son objectif était autre : tout faire pour ruiner la bonne
santé du gouvernement et ainsi gagner les deux tiers du
Congrès aux élections de mars 1973. Cette
proportion de
sièges lui permettrait alors de destituer
constitutionnellement
le président de la République. La
Démocratie
chrétienne était alors une vaste formation
politique
ancrée dans toutes les classes, avec une
véritable base
populaire au sein du prolétariat, parmi les petits et moyens
propriétaires paysans et dans la bourgeoisie et la classe
moyenne des villes. L'Unité populaire, quant à
elle,
représentait le prolétariat ouvrier
défavorisé, le prolétariat agricole,
la basse
classe moyenne des villes et les marginaux de tout le pays.
Alliée au Parti national, d'extrême droite, la
Démocratie chrétienne contrôlait le
Congrès,
tandis que l'Unité populaire contrôlait
l'exécutif.
Et la polarisation de ces deux forces allait, de fait, devenir la
polarisation du pays. Curieusement, le catholique Eduardo Frei, qui ne
croit pas au communisme, est celui qui a le plus
bénéficié de la lutte des classes, qui
l'a
encouragée et l'a exacerbée, dans le but de
fâcher
le gouvernement et de précipiter le pays sur la pente de
l'accablement et du désastre économique.
Le blocus économique des États-Unis, en
réponse
aux expropriations sans indemnisations, et le sabotage interne de la
bourgeoisie firent le reste. Le Chili produisait de tout, des
automobiles au dentifrice. Mais l'industrie avait une fausse
identité : 60% du capital des 160
sociétés les
plus importantes était étranger, et 80% des
éléments fondamentaux étaient
importés. De
plus, le pays avait besoin de 300 millions de dollars par an pour
importer des produits de consommation, et 450 millions pour financer le
service de sa dette extérieure. Or, les crédits
accordés par les pays socialistes ne suffisaient pas
à
remédier à la carence en pièces
détachées, car toute l'industrie, l'agriculture
et le
transport fonctionnaient avec du matériel
américain.
L'Union Soviétique dut acheter du blé
à
l'Australie pour l'envoyer au Chili car elle-même en
manquait.
Via les banques d'Europe occidentale et Paris, l'URSS octroya aussi des
prêts importants en dollars. Quant à Cuba, par un
geste
plus exemplaire que décisif, elle offrit un cargo rempli de
sucre. Mais les urgences, au Chili, étaient
incommensurables.
Les joyeuses dames de la bourgeoisie, sous prétexte du
rationnement et des excessives prétentions des pauvres,
sortirent dans la rue faire résonner leurs casseroles vides.
Ce
ne fut pas un hasard, mais, bien au contraire, un fait significatif,
que ce spectacle public de fourrures argentées et de
chapeaux
fleuris ait eu lieu dans l'après-midi où Fidel
Castro
terminait une visite de trente jours qui avait causé un
véritable séisme d'agitation sociale.
La
dernière cueca de
Salvador Allende
C'est alors que le président Salvador Allende comprit. Il
affirma que le peuple détenait le gouvernement, mais pas le
pouvoir. Le phrase était plus amère qu'elle ne
semblait,
mais aussi plus alarmante. Car Allende possédait la fibre
légaliste qui fut aussi le germe de sa propre destruction :
cet
homme qui se battit jusqu'à la mort pour défendre
la
légalité aurait été capable
de sortir de la
Monnaie par la grande porte, le front haut, si le Congrès
l'avait destitué par la voie constitutionnelle.
Rossanna Rossanda, journaliste et femme politique italienne qui visita
Allende à l'époque, trouva un homme vieilli,
tendu, plein
de prémonitions lugubres, assis sur le même sofa
de
cretonne jaune où on retrouvera son cadavre
criblé de
balles, le visage détruit d'un coup de crosse.
Même les
secteurs les plus compréhensifs de la Démocratie
chrétienne étaient alors contre lui. "
Même Tomic ?
", lui demanda Rossana -" Tous ! ", répondit-il.
À la veille des élections de mars 1973
où se
jouait son destin, on donnait 36% des votes à
l'Unité
populaire. Toutefois, malgré l'inflation
déchaînée, malgré le
rationnement
féroce, malgré les concerts de Doñas
Casseroles,
le parti gouvernemental l'emporta avec 44%. Une victoire si
spectaculaire et si décisive que, dans son bureau, sans
autre
témoin que son ami et confident, le journaliste Augusto
Olivares, Allende se mit à danser une cueca en solo. Pour la
Démocratie chrétienne, c'était la
preuve que le
processus démocratique encouragé par
l'Unité
populaire ne pouvait être interrompu par la voie
légale.
Elle manque toutefois de vision et fut incapable de mesurer les
conséquences de son aventure : un cas impardonnable
d'irresponsabilité historique. Pour les Etats-Unis,
l'avertissement était bien plus sérieux que les
intérêts des sociétés
expropriées. Il
s'agissait là d'un précédent
inadmissible de
progrès pacifique des peuples du monde, et notamment les
peuples
de France ou d'Italie, dont les actuelles conditions permettent de
tenter des expériences similaires à celles du
Chili.
Toutes les forces de la réaction intérieure et
extérieure se concentrèrent alors en un seul bloc
compact.
Par contre, les partis de l'Unité populaire, dont les
fissures
internes étaient bien plus profondes que ce que l'on admet
généralement, ne purent se mettre d'accord sur
une
analyse commune du vote de mars. Le gouvernement se retrouva sans
ressources, tiraillé entre ceux qui voulaient mettre
à
profit l'évidente radicalisation des masses pour faire un
saut
décisif dans le changement social, et les plus
modérés qui, craignant le spectre de la guerre
civile,
espéraient arriver à un accord
régressif avec la
Démocratie chrétienne. Avec le recul, on voit
aujourd'hui
combien ces contacts, dans le chef de l'opposition,
n'étaient
que distractions destinées à gagner du temps.
La grève des camionneurs fut le détonateur final.
De par
sa géographie accidentée, l'économie
chilienne est
à la merci du transport routier. Le paralyser, c'est
paralyser
le pays. Or, pour l'opposition, paralyser le pays était
assez
facile, puisque les camionneurs étaient les plus
touchés
par la pénurie de pièces
détachées et se
voyaient en outre menacés par l'intention du gouvernement de
nationaliser le transport avec du matériel
soviétique. La
grève fut maintenue jusqu'au bout, sans répit,
car elle
était financée cash depuis
l'extérieur. La CIA
inonda en effet le pays de dollars, afin de soutenir la
grève
patronale. D'ailleurs, la devise américaine chuta sur le
marché noir, écrivit Pablo Neruda à un
ami
européen. Une semaine avant le coup d'État, il
n'y avait
plus d'huile ni de lait ni de pain.
Dans les derniers jours de l'Unité populaire, avec une
économie effondrée et le pays au bord de la
guerre
civile, le gouvernement et l'opposition tentèrent, chacun de
son
côté, de modifier le rapport de forces au sein des
forces
armées. La manœuvre finale fut parfaite :
quarante-huit
heures avant le putsch, l'opposition réussit à
discréditer les officiers supérieurs qui
soutenaient
Salvador Allende. Après une série de coups de
maître, un à un furent promus tous les officiers
du
dîner de Washington.
Mais ce jeu d'échec politique échappait
désormais
à l'emprise de ses joueurs. Entraînés
par une
dialectique irréversible, ils devinrent eux-mêmes
des
pions sur un échiquier plus vaste, beaucoup plus complexe et
politiquement bien plus important qu'une simple confabulation
consciente de l'impérialisme et la réaction
contre le
gouvernement du peuple. C'était une terrible confrontation
de
classes qui échappait aux mains de ceux-là
mêmes
qui l'avaient provoquée ; une bataille acharnée
entre
intérêts opposés, dont l'issue finale
ne pouvait
être autre qu'un cataclysme social sans
précédent
dans l'histoire de l'Amérique.
L'armée la plus sanguinaire au monde
Dans de telles conditions, le putsch militaire ne pouvait
être
que cruel. Allende le savait. " On ne joue pas avec le feu ", avait-il
dit à Rossana Rossanda. " Celui qui pense qu'au Chili, un
coup
d'État militaire se fait comme dans d'autres pays
d'Amérique, avec un simple changement de garde à
la
Monnaie, se trompe drôlement. Ici, si l'armée sort
de la
légalité, il y aura un bain de sang. " Une telle
incertitude était en fait justifiée
historiquement.
Au Chili, contrairement à ce que l'on a voulu nous faire
croire,
les forces armées sont intervenues dans la politique chaque
fois
que leurs intérêts de classe se voyaient
menacés.
Et ces interventions ont été
accompagnées d'une
énorme férocité répressive.
Les deux
constitutions que le pays a eues en un siècle ont
été imposées par les armes, et le
récent
putsch militaire était le sixième de ces
cinquante
dernières années.
Cette soif sanguinaire de l'armée chilienne est en fait de
naissance. Elle vient de la terrible école de la guerre au
corps
à corps contre les Araucans, qui dura 300 ans. Un de ses
précurseurs se vantait, en 1620, d'avoir tué de
sa main
plus de deux mille personnes en une seule action. Dans ses chroniques,
Joaquín Edwards Bello rapporte qu'au cours d'une
épidémie de typhus exanthématique,
l'armée
sortait les malades de chez eux et les tuait d'un bain de poison afin
d'enrayer l'épidémie. Et pendant la guerre civile
de sept
mois, en 1891, il y eut plus de 10 000 morts en une seule bataille. Les
Péruviens assurent que sous l'occupation de Lima, pendant la
guerre du Pacifique, les militaires chiliens saccagèrent la
bibliothèque de Ricardo Palma. Mais ils ne lisaient pas les
pages ; ils s'en servaient comme papier toilette.
C'est avec encore plus de brutalité que les mouvements
populaires ont été
réprimés. Après
le séisme de Valparaiso, en 1906, les forces navales
liquidèrent l'organisation des dockers en massacrant 8 000
ouvriers. À Iquique, au début du
siècle, une
manifestation de grévistes, fuyant les soldats, se
réfugia au théâtre municipal. Ils
furent
mitraillés. 2 000 morts. Le 2 avril 1957, l'armée
réprima une révolte civile dans un centre
commercial de
Santiago et causa un nombre de victimes qui n'a jamais pu
être
calculé, car le gouvernement enterra les corps dans des
charniers clandestins. Au cours d'une grève à la
mine de
El Salvador, sous la présidence de Eduardo Frei, une
patrouille
militaire ouvrit le feu pour disperser une manifestation, faisant six
morts, dont plusieurs enfants et une femme enceinte. Le commandant
local était un obscur général de 52
ans,
père de cinq enfants, professeurs de géographie
et auteur
de plusieurs ouvrages sur des questions militaires. Il s'appelait
Augusto Pinochet. Ce mythe de légalisme et bienveillance de
cette armée de bouchers a été
inventé dans
l'intérêt de la bourgeoisie chilienne.
L'Unité
populaire l'a maintenu dans l'espoir de faire basculer en sa faveur la
composition de la classe des cadres supérieurs. Salvador
Allende
se sentait toutefois plus en sécurité parmi les
Carabiniers, un corps armé d'origine populaire et paysanne
placé sous le commandement direct du président de
la
République. De fait, seuls les officiers les plus anciens
des
Carabiniers soutinrent le coup d'État. Les jeunes officiers,
eux, se retranchèrent à l'École de
sous-officiers
de Santiago et résistèrent pendant quatre jours,
jusqu'à ce qu'ils furent écrasés sous
les bombes
lancées des avions.
Il ne restera au Chili aucune trace des conditions politiques et
sociales qui ont rendu possible l'Unité populaire. Quatre
mois
après le putsch, le bilan était atroce :
près de
20 mille personnes assassinées, 30 mille prisonniers
politiques
soumis à de sauvages tortures, 25 mille étudiants
expulsés et plus de 200 mille ouvriers licenciés.
Mais le
plus dur n'était pas encore fini.
La
véritable mort d'un président
L'heure de la bataille finale avait sonné. Le pays
était
à la merci des forces
déchaînées par la
subversion. Salvador Allende s'accrochait à la
légalité. La contradiction la plus dramatique de
sa vie
fut d'être un farouche ennemi de la violence, tout en
étant un révolutionnaire passionné. Il
pensait
d'ailleurs avoir résolu le dilemme par
l'hypothèse selon
laquelle les conditions du Chili permettaient une évolution
pacifique vers le socialisme, dans le cadre de la
légalité bourgeoise. L'expérience lui
apprit, trop
tard, qu'on ne change pas un système avec un gouvernement,
mais
avec le pouvoir.
Cette leçon tardive a dû être la force
qui l'a
poussé à résister jusqu'à
la mort dans les
décombres en feu d'une maison qui n'était
même pas
la sienne, un palais sombre, construit par un architecte italien pour
être une fabrique d'argent et qui a fini en refuge d'un
président sans pouvoir. Salvador Allende résista
six
heures durant, une mitraillette à la main, cadeau de Fidel
Castro et qui fut la seule et unique arme à feu qu'il
utilisa
jamais. Le journaliste Augusto Olivares, qui résista avec le
président jusqu'à la fin, fut touché
à
plusieurs reprises et mourut exsangue à l'Assistance
publique.
Vers quatre heures de l'après-midi, le
général de
division Javier Palacios parvint au deuxième
étage,
accompagné de son aide de camp, le capitaine Gallardo, et
d'un
groupe d'officiers. C'est là, au milieu des faux
sièges
Louis XV, des vases chinois peints de dragons et des tableaux de
Rugendas du Salon Rouge, que Salvador Allende les attendait. Il portait
un casque de mineur et était en manches de chemise, sans
cravate. Ses vêtements étaient tachés
de sang. Il
tenait sa mitraillette à la main.
Allende connaissait bien le général Palacios.
Quelques
jours plus tôt, il avait dit à Augusto Olivares
qu'il
s'agissait d'un homme dangereux ayant des contacts étroits
avec
l'ambassade des États-Unis. Dès qu'il
l'aperçut au
détour de l'escalier, Allende l'invectiva : "
Traître ! ",
et le blessa à la main. Allende mourut dans un
échange de
coups de feu avec cette patrouille. Ensuite, tel un rite de caste, tous
les officiers ouvrirent le feu sur le cadavre. Finalement, un
sous-officier lui détruisit le visage d'un coup de crosse.
Le
cliché existe : il a été pris par le
photographe
Juan Enrique Lira, du journal El Mercurio, le seul qui fut
autorisé à photographier le cadavre. Il
était
tellement défiguré qu'on montra le corps dans le
cercueil
à Hortensia Allende, son épouse, mais sans lui
permettre
d'en découvrir le visage. En juillet, il avait eu 64 ans.
C'était un Lion parfait : tenace,
décidé et
imprévisible. Ce que pense Allende, seul Allende le sait,
m'avait dit un de ses ministres. Il aimait la vie. Il aimait les fleurs
et les chiens. Il était d'une galanterie un peu à
l'ancienne, faite de billets doux parfumés et de rencontres
furtives. Sa plus grande vertu fut d'être
conséquent, mais
le destin lui réserva la grandeur rare et tragique de mourir
en
défendant par les balles le machin anachronique du droit
bourgeois ; en défendant une Cour suprême de
justice qui
l'avait répudié mais devait légitimer
ses
assassins ; en défendant un Congrès
misérable qui
l'avait déclaré illégitime mais devait
se plier,
reconnaissant, à la volonté des usurpateurs ; en
défendant la liberté des partis de l'opposition
qui
avaient vendu leur âme au fascisme ; en défendant
tout
l'appareil miteux d'un système de merde qu'il
s'était
lui-même proposé d'annihiler sans tirer un coup de
feu. Ce
drame a eu lieu au Chili, pour le plus grand mal des Chiliens, mais il
passera à l'Histoire comme un
événement qui nous
est arrivé, sans coup férir, à tous
les hommes de
cette époque, pour rester gravé dans nos vie
à
jamais.
Source : Traduction de
l'espagnol : Gil B. Lahout, pour RISAL.
|
|
|
|
|
|
| Escadrons
de la mort, l'école française |

Entretien avec Marie-Monique
Robin (*), décembre 2010
Le
titre
de votre ouvrage, dont vous avez également tiré
un film,
éclaire peu le sujet que vous traitez. Les militaires
français, avec l'accord du gouvernement, ont
développé, d'abord en Indochine, des techniques
de
guerres « antisubversives », techniques qu'ils ont
ensuite
exportées en Amérique latine, et même
en
Amérique du Nord. Vous avez raison, le terme fait
plutôt
penser à l'Amérique latine, mais ce qu'on ne sait
pas,
c'est que le modèle des escadrons de la mort vient de
l'expérience des français en Indochine, et
surtout, en
Algérie.
Aujourd'hui, un certain nombre de travaux intéressants sur
l'histoire coloniale de la France sont publiés. Cependant,
vous
reliez différents contextes, relativement
éloignés, tels que l'Algérie,
l'Amérique
latine, l'Amérique du Nord. Comment avez-vous
commencé
votre enquête ? Comment avez-vous tiré le fil ? Au
début, je travaillais sur l'opération Condor.
Quand j'ai
commencé à me documenter, à prendre
des contacts
avec les chercheurs qui travaillaient sur le même sujet, on
m'a
dit tout de suite : « Oui, c'est très bien, mais
savez-vous que la genèse de l'opération Condor
vient de
France ». J'ai donc commencé à essayer
de
comprendre pourquoi et j'ai complètement changé
de sujet
en remontant jusqu'à l'histoire des guerres coloniales de la
France, jusqu'à la guerre d'Indochine, parce que c'est
là
que tout a commencé.
Votre
livre est composé de deux grandes parties. Une partie sur
les
guerres coloniales et une autre sur l'Amérique latine.
Qu'est-ce
qui se joue pour la France dans cette guerre d'Indochine à
la
sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec tout le mythe de la France
résistante…?
Justement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France vote la
création des Nations unies, elle reconnaît le
droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes… mais
quand la
guerre d'Indochine s commence, elle refuse de trouver une solution
politique pour résoudre ce conflit. Par contre, elle envoie
un
corps expéditionnaire, des militaires professionnels.
Là,
ils se rendent vite compte qu'ils sont plus nombreux que le Vietminh,
qu'ils sont mieux équipés, mais qu'ils
n'arriveront pas
à bout de cette guérilla. Ils s'interrogent donc,
et vont
élaborer le concept de «guerre moderne», qu'ils
appelleront aussi «guerre révolutionnaire» ou
«guerre antisubversive».
Celui-ci est
théorisé par le colonel Lacheroy qui deviendra,
par la
suite, chef de l'OAS et putschiste à Alger.Pourquoi cette
guerre
est-elle moderne, selon eux ? Avant, il y avait un front, il fallait
soit avancer, soit repousser le front. Il y avait un ennemi en uniforme
facile à identifier. Là, il n'y a rien de tout
cela.
L'ennemi est disséminé sur tout le territoire et
il n'y a
pas de front. Ils utilisent le terme de « guerre de surface
». Ils ajoutent à leurs observations une
réflexion
politique dans ce contexte de début de « guerre
froide
».
L'ennemi, le Vietminh, lui, s'appuie sur un appareil
idéologique
de contrôle des populations. C'est ainsi que naît
le
concept de « guerre révolutionnaire ».
Les
militaires français vont par la suite dire à leur
état-major que ce n'est pas la peine d'envoyer des chars,
des
avions, etc., qu'il faut quadriller le territoire contre ce nouvel
ennemi au cœur de la population : l'ennemi interne. Ce peut
être un paysan qui va couper les poteaux
électriques la
nuit ou une femme qui va transmettre un message… Ils
essayent de
convaincre leurs supérieurs. Le colonel Lacheroy demande
à être renvoyé sur Paris pour signifier
l'erreur.
Et ces militaires, « humiliés », selon
eux, en
Indochine, qui passent par la défaite de Dien Bien Phu, par
les
camps de rééducation pour certains d'entre eux,
se
retrouvent tous en Algérie dès septembre 1954.
Pendant cette période, dans ce contexte de «
guerre froide
», le PCF possède une forte influence, au sortir
de la
guerre 39-45, ce qui va exacerber une paranoïa
inhérente
aux militaires.Quand on étudie les archives militaires de
l'École de guerre de Paris ou les revues et documents
disponibles au service historique de l'armée de terre, la
paranoïa est très apparente.Il faut
considérer que,
dans un premier temps, les maquisards communistes ont
été
intégrés dans l'armée par de Gaulle.
Mais, petit
à petit, les militaires se persuadent que le PCF, ce qu'ils
appellent « la cinquième colonne »,
préparent
un coup d'État. Plus encore, tout ce qui se passe dans le
monde
est un travail construit et cohérent pour imposer une
hégémonie communiste. Cela joue beaucoup.
On voit donc des militaires français tels que Lacheroy et
Trinquier qui élaborent une doctrine, qui
écrivent des
livres.Lacheroy écrit beaucoup d'articles. Il
théorise
sur la guerre révolutionnaire et son antidote, la guerre
contre-révolutionnaire. Trinquier, lui, écrira
plus tard.
Mais ce n'est qu'en Algérie que l'on va trouver des textes
sur
les techniques militaires d'élimination du terrorisme ou de
la
subversion. Le rôle des militaires est d'arriver à
démanteler un réseau terroriste. C'est, en fait,
la mise
à jour d'une véritable matrice d'un pouvoir
dictatorial
dont l'une des tentatives est le putsch d'Alger, qui sera par la suite
exporté en Argentine.
Quel est l'état d'esprit de ces militaires qui arrivent en
Algérie ?C'est un département
français, et il
n'est pas question de se faire avoir comme en Indochine. Ils arrivent
avec la rage et appliquent tout de suite la grille de lecture de
l'Indochine. Il s'agit, selon eux, d'un avatar de la guerre froide : le
FLN travaillerait pour Moscou (ce qui est, historiquement,
complètement à côté de la
plaque). C'est une
guerre révolutionnaire et il faut développer de
nouvelles
techniques.
Est-ce
le moment où apparaît la notion d'action
psychologique ?
Non,
elle est apparue en Indochine. Les militaires se sont
aperçus
que le Vietminh devait son pouvoir au contrôle et aux
manipulations qu'il exerçait sur les populations. Ils ont
vite
compris l'enjeu de cette nouvelle forme de guerre. Ils ont
développé des campagnes d'action psychologique,
avec des
tracts, mais surtout des services de santé,
d'alphabétisation. L'idée était de
conquérir l'âme des populations. Mais il est vrai
qu'en
Algérie, le service d'action psychologique aux mains de
Lacheroy, nommé par le ministre des Armées,
prendra
d'emblée une ampleur considérable.
Ils
continuent, au
début de cette guerre, à dire que les
méthodes ne
sont plus adaptées... Et ils obtiennent gain de cause. Le 7
janvier 1957, le gouvernement, qui a déjà
voté les
pouvoirs spéciaux, les confie aux militaires, notamment
à
Massu, chef des parachutistes. C'est important, car cela permet aux
militaires d'être investis de tous les pouvoirs, y compris
des
pouvoirs de police. Ils ont carte blanche. C'est donc cette bataille
d'Alger, de janvier 1957 à septembre 1957, qui va constituer
le
modèle de la guerre antisubversive.
Lors de la bataille d'Alger, Les militaires vont pouvoir appliquer les
mains libres ce qu'ils avaient auparavant
théorisé.Oui,
ils n'ont plus d'entraves. Bigeard dira : « Le FLN posait des
bombes, on ne pouvait pas entrer dans la casbah la nuit parce qu'il
nous fallait un mandat du juge, comment voulez-vous qu'on travaille
dans ces conditions ? ». Avec les pouvoirs
spéciaux qu'ils
obtiennent, ils n'ont absolument plus besoin de passer par la justice.
Ils sont seuls maîtres à bord. Rappelons que la
population
est suspecte et que l'ennemi est interne.
Tout le monde est suspect,
donc le renseignement devient l'arme fondamentale de cette guerre.Qui
dit renseignement dit torture et, quand les torturés sont
morts
ou agonisants, il faut les faire disparaître. C'est le
rôle
d'Aussaresses qui dit : « J'ai créé les
premiers
escadrons de la mort ». C'est la première fois,
dans cette
bataille d'Alger, qu'une armée va développer un
modèle de répression urbaine… en sept
mois. Pour
en revenir aux méthodes, il y a le renseignement, la
torture,
mais il y en a d'autres, le quadrillage des quartiers, de chaque
maison, le contrôle de la population, etc.Si la population
est
suspecte, il faut la contrôler.
C'est le colonel Trinquier qui s'en occupe. Il va devenir le grand
théoricien, en écrivant La Guerre moderne, qui va
être traduit dans toutes les langues et, en quelques sortes,
devenir la bible, le manuel de la guerre antisubversive. Trinquier,
lui, a une idée : il quadrille l'ensemble du territoire avec
des
unités qui agissent partout, sur plan. D'ailleurs,
l'historien
Pierre Vidal-Naquet dira que c'est « une guerre des
capitaines
».
Effectivement, ils commencent tous à
« interroger
», à faire disparaître des gens,
à abattre
les prétendus fuyards, etc. Dès le
début, se met
en place toute une série de pratiques totalement contraires
aux
lois de la guerre. Ajoutons qu'ils abattent les prisonniers, qu'ils
déplacent les populations. À Alger, ils vont
quadriller
la casbah tout entière, cela représente plus de
80 000
personnes. Chaque maison est numérotée ;
à
l'intérieur de chacune, la population est
recensée avec
des fiches qui seront distribuées dans les
différentes
unités de contrôle des quartiers. Tout cela se
passe la
nuit car alors les gens sont censés être chez eux.
C'est en fait toute une réflexion depuis «
l'Indochine
» qui prétend que ce type de guerre se passe la
nuit.Tout
à fait, en Indochine, Lacheroy, n'a cessé de dire
que les
militaires ne sont pas des fonctionnaires de l'armée qui se
couche à dix-neuf heures, mais qu'ils devraient commencer
à travailler à cette heure-là. En
Algérie,
ils ont compris. Bigeard, Aussaresses, etc., disent tous qu'ils
travaillaient la nuit. Ils faisaient des rafles et la
gégène fonctionnait à plein la nuit.
Mais, pour en
revenir au quadrillage, ils débarquent la nuit, ils
regardent la
fiche.
Ils vérifient que les personnes présentes
sont
bien recensées. Toute personne qui n'est pas de la maison
est
embarquée. Quand une personne manque, toute la
maisonnée
est embarquée, torturée, pour savoir
où elle se
trouve. Tout cela va être exporté par la suite, en
Irlande, par exemple. C'est d'ailleurs Trinquier qui sert de
référence dans toute la guerre qui va
être
menée contre l'IRA. Cela sera également
exporté en
Argentine, à Buenos Aires.
Il
y avait également la pratique du retournement de
prisonnier…
Oui,
des militaires comme le capitaine Léger faisait la
tournée des centres de torture en essayant de
récupérer ceux qu'il pensait pouvoir retourner.
Il devait
par la suite diffuser de fausses informations, faire savoir qu'ils
avaient changé de camp et, finalement, faire en sorte que
les
Algériens se massacrent entre eux. Léger dira
dans un des
ses livres que « ce n'est certes pas très moral,
mais
[que] si l'ennemi a cette capacité de s'automassacrer,
pourquoi
s'en priver ». Cette technique du retournement de prisonnier
sera
exportée en Argentine et au Chili. On me dit souvent :
«
Il ne faut pas exagérer, ce ne sont pas les
français qui
ont inventé la torture ».
Certes… La grande différence, c'est que la
torture,
l'interrogatoire, dans les documents officiels, sont
érigés comme une arme principale et
systématique.
Trinquier est le seul à avoir théorisé
cela,
à tel point qu'aujourd'hui encore, pour la guerre en Irak,
ils
ont ressorti Trinquier. Que dit-il? C'est très
simple…
« Le terroriste dans la guerre moderne, par son mode
opératoire, parce qu'il ne porte pas d'uniforme, parce qu'il
pose des bombes dans les lieux publics, ne respecte pas les lois de la
guerre. Il n'y a donc aucune raison de les appliquer. De plus, si j'ai
entre les mains une personne qui peut avoir une information sur un
attentat qui va avoir lieu, j'ai le droit de le torturer et
d'éviter ainsi la mort d'innocents. »
Voilà. C'est
encore une bible pour les militaires en Irak, à
Guantanamo…
Une
autre dimension du conflit est aussi dans la politisation, et
l'idéologisation. Des militaires français vont se
rapprocher du lobby national catholique.
Oui, tous ces arguments techniques s'accompagnent d'un retour aux
sources de la civilisation chrétienne. J'ai en effet
découvert le rôle très important que va
jouer le
lobby national catholique auprès de l'armée,
notamment un
organisme qui s'appelle la Cité catholique,
créé
par un certain Jean Ousset, secrétaire
éphémère de Charles Maurras.
La
Cité
catholique repose sur des cellules censées occuper
l'ensemble du
terrain social à partir de grands groupes professionnels :
enseignants, agriculteurs, militaires, etc., à la Mussolini.
Ils
se réunissent secrètement et travaillent
à la
revue Verbe, dans le but de préparer des arguments, pour
convaincre. Dans l'armée, il y aura à un moment
plus de
deux cents cellules. C'est l'endroit où il y en aura le
plus,
notamment en Algérie.
Il est intéressant de noter que tout ceux qui font circuler
la
revue sont aussi ceux qui sont proches de l'« action
psychologique » et de cette réflexion sur la
«
guerre contre-révolutionnaire ». On retrouvera
encore les
mêmes au moment du putsch et dans l'Organisation
armée
secrète (OAS). Au moment où Témoignage
chrétien, France observateur et L'express commencent, en
France,
à dénoncer la torture en temps réel,
Verbe fait
une campagne de justification théologique de l'utilisation
de la
torture.
Quand vous la lisez, vous avez l'impression d'avoir
à
faire à un argumentaire de l'Inquisition. La Cité
catholique sera dénoncée, cela fera scandale, ce
qui
n'empêchera pas Jean Ousset de créer une filiale
en
Argentine, la Ciudad Católica, et une revue, El Verbo,
autrement
dit, exactement la même chose. Il y envoie pour ce faire un
curé nommé Georges Grasset, un des chefs
spirituels de
l'OAS, un de ceux qui vont organiser la fuite des gens de l'OAS en
Argentine.
Après le putsch et la création de l'OAS, beaucoup
de
militaires vont être condamnés à
mort…Il y
aura à peu près quatre cents militaires
destitués
de l'armée, ce qui est minime par rapport à tous
ceux qui
ont participé au putsch. Quant aux condamnés,
très
peu seront exécutés.
Où
vont passer tous ces gens ?
Lacheroy,
par exemple, raconte comment il passe en Espagne franquiste. Il est
d'abord aidé par la police et des marins pour passer dans le
Sud
de la France. Puis c'est une femme des services secrets
français, le Sdece, qui va lui faire passer la
frontière
espagnole en voiture. Prenons un autre condamné à
mort
nommé Gardes, il prend un voilier et gagne l'Argentine. Ils
sont
bien condamnés à mort, mais personne ne leur
court
après.Les chefs de l'OAS vont donc jouer un rôle
de
conseillers auprès de la dictature argentine, mais il y aura
aussi des assesseurs militaires français…Pour
bien
comprendre, disons que l'École française en
Amérique du Sud commence à l'École de
guerre de
paris. C'est entre 1954 et 1962, quand la théorie de la
guerre
antisubversive est à son apogée, que le nombre
d'officiers étrangers est le plus important.
C'est ainsi que le général Rosas, un Argentin, va
y
passer deux ans, à partir de 1955, et convaincre
l'école
de prendre davantage d'Argentins en formation, et même de
créer une mission militaire française permanente
en
Argentine. Son unique but sera d'enseigner les techniques de la guerre
antisubversive. Cette mission s'installe en 1959 à Buenos
Aires,
au siège de l'état-major. Elle y restera jusqu'en
1981.
Voilà donc le premier pays où la France va
exporter ses
nouvelles techniques.
Au même moment, Kennedy, avant d'être
élu, fait un
voyage d'étude en Algérie, en pleine guerre. Il a
entendu
parler de la théorie et, obsédé par le
communisme,
s'y intéresse. Après son élection, il
demande
à son secrétaire d'État, McNamara, de
contacter
Pierre Messmer, ministre des Armées, pour accueillir aux
États-Unis des experts de la guerre antisubversive. C'est
ainsi
que le général Aussaresses part à Fort
Bragg, le
siège des forces spéciales
américaines. À
l'époque, les Américains étaient dans
une
conception classique de la guerre, ils se préparaient
à
un affrontement avec les Soviétiques. Ce sont les
Français qui introduisent ces nouvelles manières.
On
parle
de l'Argentine, mais d'autres pays ont-ils été
formés à l'École française
dans les
années soixante ?
Oui,
Aussaresses, après son passage aux États-Unis et
à
l'Otan, est envoyé comme attaché militaire au
Brésil de 1973 à 1975, pays qui est, depuis 1964,
une
dictature militaire. Et il forme à plein temps des
militaires
chiliens qui viennent au Brésil. Depuis l'Argentine
également, l'École française
« rayonne
». Elle va former des Uruguayens à Montevideo, des
Péruviens chez eux. Les Français
étaient
installés à Buenos Aires et allaient
où on les
appelait pour distribuer la « bonne parole »
antisubversive
sur tout le continent.
Est-ce
que l'École française est influente au Chili,
pendant la
dictature de Pinochet ? On pense plutôt aux
États-Unis,
à la CIA qui joue un grand rôle.
En
ce
qui concerne le général Contreras, chef de la
Dina, la
police politique de Pinochet, une chose m'a frappée : son
admiration pour l'OAS. Revenons quelques instants sur l'OAS... Un
certain nombre de chefs s'installent à Lisbonne, au
Portugal,
à l'époque de la dictature de Salazar, et
créent
une espèce d'agence de presse bidon qui sert de couverture.
Cette agence loue ses services, envoie des mercenaires, etc. Au Chili,
par exemple, ils encadrent la création d'un groupe fasciste
appelé Patria y Libertad qui va participer à
l'assassinat
du général, loyaliste et démocrate,
juste avant le
coup d'État de Pinochet. Ils vont aussi en Argentine, au
Nicaragua, au Salvador.
Pouvez-vous préciser
implications de l'influence française en Argentine ?
Les Français sont en Argentine en 1957, alors qu'il n'y a
aucune
guérilla, ni parti communiste. Quand la dictature
s'installe, en
1976, tout est en place depuis longtemps. Le quadrillage du territoire
a été fait dès la fin des
années cinquante.
Les militaires vont se comporter comme une armée
d'occupation
dans leur propre pays. Ils vont tout appliquer au pied de la lettre. Y
compris la méthode des « crevettes Bigeard
», qui
consistent à se débarrasser des prisonniers en
les jetant
d'un hélicoptère. Tout est repris, mais de
manière
industrielle. « Les vols de la mort » auront lieu
en
Argentine tous les mercredis avec vingt, vingt-cinq bonshommes
jetés à la mer. Il faut rappeler l'influence de
l'École française dans d'autres pays comme
l'Irlande, le
Rwanda, la Tchétchénie et l'Irak.
Note
:
(*) Marie-Monique Robin, auteure d'un livre et d'un film documentaire
intitulés « escadrons de la mort,
l'école
française ». fruit d'une enquête de deux
ans,
menée en amérique latine et en europe, son
travail
révèle les dessous des guerres
d'algérie et
d'indochine et l'exportation des méthodes des militaires
dans
les dictatures d'amérique latine jusqu'en afrique.
Source : Extrait
de Offensive n°7 Parution: 2005-10-01
|
|
|
|
|
|
| Le
LKP de la Guadeloupe, un mouvement social instructif ? |
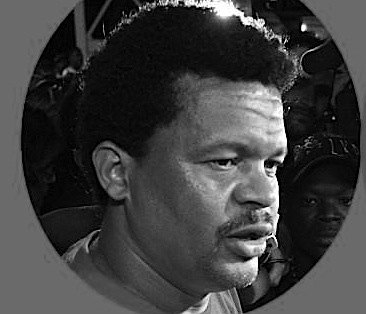
Paméla Obertan, 12 décembre 2010 (*)
Quand on pense à la Guadeloupe, île qui se situe
dans la Caraïbe, la première image qui nous vient
en tête est le sable chaud, les cocotiers et la mer.
Cependant, cette île, qui est aussi une région et
un département français, a
été le théâtre
l’année dernière d’un
mouvement social sans précédent dans son histoire.
En effet, en janvier 2009, l’île a
été paralysée pendant 44 jours de
grève générale.
C'est-à-dire que les magasins, les banques, les
administrations, bref toutes les activités ont
été interrompues. De même, la
circulation était inopérante en raison de la
grève des stations d’essence. Cependant,
malgré toutes ces restrictions, la population a
manifesté son soutien au collectif le Lyannaj Kont
Pwofitasyon (LKP : «collectif contre l’exploitation
outrancière».), à l’origine
du phénomène. Un an après, il nous est
apparu intéressant de revenir sur les enseignements positifs
que l’on peut tirer de ce mouvement.
Ceci nous semble particulièrement pertinent dans un contexte
de crise qui exacerbe les conflits sociaux. Dans un tel cas, il est
courant d’assister à une recrudescence des
mouvements sociaux. Toutefois, ces derniers ne parviennent pas toujours
à établir des rapports de force efficace avec le
pouvoir étatique ou économique.
Voilà pourquoi il est intéressant de comprendre
pourquoi certains mouvements échouent et
d’autrespas. En ce sens, le mouvement social
guadeloupéen, par sa durée et son fort soutien,
peut s’avérer instructif pour les luttes sociales.
Il importe donc de revenir brièvement sur le conflit pour
bien comprendre ce qui s’est passé, ce que nous
étudierons en premier point.
Puis, nous verrons que si ce mouvement a eu tant de succès,
c’est parce qu’il a su tout d’abord
comprendre et tirer parti d’une situation
particulière (partie 2). Il a ensuite
été capable d’adopter une
stratégie originale pour obtenir satisfaction (partie 3).
La
genèse du mouvement LKP
En janvier 2009, l’île a été
paralysée pendant 44 jours de grève
générale.
Le
mouvement
LKP a commencé en Guadeloupe
avec l’augmentation du prix du pétrole
à l’automne 2008. Cette augmentation est
très symbolique pour une île comme la Guadeloupe,
fortement dépendante de cette source
d’énergie et dont le principal moyen de transport
reste la voiture. Ainsi le 5 décembre 2008, l’UGTG
(L’Union générale des travailleurs de
la Guadeloupe), qui constitue l’un des syndicats les plus
populaires de l’île, appela de nombreuses
organisations syndicales à manifester contre
l’augmentation du prix de l’essence.
Elles
répondirent toutes présentes et c’est
ainsi que le 16 décembre 2009, 7000 personnes
défilent dans les rues de Pointe à Pitre
(« capitale » économique de
l’île). Le lendemain, c’est 4000
personnes qui défilent dans les rues de Basse-Terre
(capitale administrative). Les dirigeants du collectif
demandèrent à la suite une rencontre avec le
Préfet, représentant de
l’État. Celui-ci refusa en raison
d’autres obligations prévues ce jour là
(inauguration de l’arbre de Noel des employés).
En dépit, de cette fin de non-recevoir, les organisations
syndicales, bientôt suivies de nombreuses associations,
décidèrent de se rencontrer et
d’élaborer un plan d’action. Ainsi, du
17 décembre 2008 au 20 janvier 2009, tous les syndicats et
de nombreuses associations culturelles, environnementales, ainsi que
des partis politiques se réunirent pour élaborer
une plateforme de revendications communes. L’ensemble de ces
organisations se mirent d’accord pour lancer une
grève générale le 20 janvier 2009.
Entre temps, la situation sur l’essence continua de
dégénérer. En effet, les
gérants de station de service furent très
mécontents à l’annonce de
l’implantation de 13 stations-service automatiques qui
fonctionneraient sans pompistes. Selon les gérants, la
présence de ces stations-service exacerbera la concurrence
et entraînera la suppression de nombreux emplois. Ainsi, les
gérants de nombreuses stations de service
décidèrent de se mettre en grève,
coupant ainsi l’approvisionnement de toute
l’île. On se retrouve alors avec deux
grèves générales qui, pendant un
temps, vont se renforcer mutuellement.
Cependant, très vite le collectif LKP manifesta sa
volonté d’aller au delà de la simple
question de l’essence et se mit à
dénoncer une série de problèmes qui
gangrènent l’île : le chômage,
la cherté de la vie, la faiblesse des salaires, la
progression de la pauvreté, le trop faible nombre de
logements sociaux, la perte des terres agricoles... Sa lutte sort donc
du cadre restreint de la hausse de l’essence et il
prétend lutter contre toutes les
«pwofitasyons» (injustices) dont sont victimes les
Guadeloupéens.
Le mouvement établit ainsi une
large plateforme de revendications composée de 149 points,
dont le plus populaire concerne l’augmentation de 200 euros
pour les bas salaires. Dès le 21 janvier 2009, au lendemain
de la grève générale, il organisa un
« déboulé » important (une
marche, une manifestation en français) importante dans
d’un grand centre commercial et dans
l’aéroport Pôle Caraïbes. Le
LKP réclame aussi l’ouverture des
négociations globales entre l’État, les
collectivités locales, le patronat afin de
débattre de la plateforme de revendications,
qu’ils ont élaboré. Malgré,
le refus des différentes instances, le LKP insiste et finit
par obtenir gain de cause.
C’est ainsi
qu’après
un grand
« déboulé
»
qui a réunit 25.000 personnes,
le collectif arrive au World Trade Center (zone industrielle) pour
rencontrer toutes les parties. Les négociations commencent,
elles sont même retransmises à la
télévision. La population suit alors
attentivement les débats et penche nettement en faveur du
LKP. Cependant, ces rencontres se terminent le 28 janvier 2009 alors
que le Préfet décide, à la demande
d’Yves Jego, le secrétaire
d’État à l’outre-mer, de
rompre les négociations.
Cet évènement n’empêche pas
le LKP de continuer la grève générale.
De nombreux «déboulés» sont
organisés, certains parviennent même à
atteindre le nombre de 65.000 personnes dans les rues : sur une
population de 458.000 habitants (1).
L’arrivée d’Yves Jego, le
secrétaire d’État à
l’outre-mer, le 1er février 2009,
préfigure un retour aux négociations, qui
reprendront le 5 février 2009. Celles-ci vont bon train et
un dénouement paraît s’approcher lors de
la nuit du dimanche 8 février 2009. En effet, la partie
patronale refusait de signer un accord prévoyant
l’augmentation de 200 euros sur les bas salaires si
l’État ne s’engageait pas
lui-même à contribuer lui- même
à ces hausses. Jego semble affirmer que oui, mais il est
rappelé le lendemain en France. Le Premier Ministre
français invalide tout engagement de
l’État dans les augmentations de salaires.
Dès lors, les négociations auront du mal
à aboutir et la situation donne l’impression
d’être sans issues. Néanmoins, le LKP,
fort du soutien massif de la population, décide de continuer
le mouvement et va multiplier les manifestations. Du 16 au 21
février 2009, le mouvement va se durcir et le collectif
incite les Guadeloupéens à réaliser
des barrages dans toute l’île afin de provoquer la
paralysie complète.
|
Lire ou
télécharger la suite du texte :
|
Notes
:
(1) Conseil Régional de la Guadeloupe, « La
Guadeloupe en chiffre » : http://www.cr- guadeloupe.fr/
(*) Paméla Obertan, titulaire d'un Master de droit
européen à l'Université Paris XII, et
d'une maîtrise en droit international à
l'Université du Québec à
Montréal, réalise actuellement une cotutelle de
thèse internationale entre le Québec et la
Guadeloupe. Sa thèse porte sur les mouvements de
contestation à la globalisation du brevet sur le vivant.
Auteur de l’ouvrage : Le brevet sur le vivant: une menace
pour les peuples autochtones?
|
|
|
|
|
|
L’Amérique
latine dans son bicentenaire :
la
construction d’une région
|
 par
José Del Pozo, mise en ligne décembre
2010 (*)
par
José Del Pozo, mise en ligne décembre
2010 (*)
L’année 1810 constitue un anniversaire
important
dans
l’histoire latino-américaine : pour un grand nombre des pays de la
région, il marque en effet le
bicentenaire de la naissance des États nationaux, suivant le
cycle commencé dans le nord par les États-Unis et
plus tard par Haïti. Il est vrai que
l’indépendance proprement dite n’a pas
été déclarée cette
année-là, et que 1810 a été
plutôt le commencement d’un processus qui devait
mener, quelques années plus tard, à la condition
de pays souverains, détachés des
métropoles européennes.
Rappelons brièvement les faits fondamentaux
: en 1808,
suite à l’occupation de l’Espagne par
Napoléon, les colonies dans le Nouveau monde se retrouvent
devant un vide du pouvoir, puisque les autorités avaient
été nommées par un roi
désormais absent. À partir d’avril
1810, d’abord à Caracas et plus tard à
Buenos-Aires, Bogotá et Santiago du Chili s’en
suivit la constitution de Juntes, formées par les notables
des diverses capitales coloniales, censées gouverner les
territoires durant l’absence du souverain, à qui
tous avaient juré fidélité. Mais la
conjoncture sera mise au profit par les nombreux criollos (les
descendants des Espagnols, nés dans le Nouveau monde) qui
depuis un certain temps songeaient à se libérer
de la métropole.
Très vite, les combats vont
éclater entre royalistes et patriotes. Après une
guerre parfois dévastatrice, ce sont ces derniers qui
l’emportent. Entre 1816 et 1822, une série de
nouveaux États nationaux voient le jour. En 1823, les
États-Unis les reconnaissent et en 1825 la Grande-Bretagne
fait de même. La mort dans l’âme,
l’Espagne doit se résigner, mais elle prendra
plusieurs années, voire des décennies
à accepter la nouvelle situation. Faute de moyens et sous la
pression anglaise, le Portugal accepte plus facilement la perte du
Brésil.
Ce processus, ici rapidement esquissé, comporte des
exceptions. Ainsi, Cuba Porto Rico demeurent dans le giron colonial et
font très peu de tentatives afin de suivre
l’exemple des autres domaines espagnols. La faiblesse du
mouvement patriote au Pérou fit en sorte que ce pays fut
libéré essentiellement par les efforts militaires
des troupes venues du Venezuela, de la Colombie, de
l’Équateur, du Chili et de l’Argentine.
Le Mexique suivit un parcours particulier, puisque les patriotes
n’avaient pas gagné la guerre contre les
royalistes.
Ces derniers avaient néanmoins opté
pour l’indépendance d’un commun accord
avec les criollos lorsqu’ils apprirent, en 1821,
qu’une révolution libérale avait
éclaté en Espagne, ce qui menaçait de
bouleverser l’ordre social conservateur.
L’Amérique centrale, contrairement aux autres,
devient indépendante sans guerre, suivant
l’influence du Mexique. Quant au Brésil, il se
sépare du Portugal presque sans lutte, suivant une
chronologie quelque peu différente de celle des colonies
espagnoles, mais dans la même période. Il sera
d’ailleurs la seule ancienne colonie dans le Nouveau monde
à se doter d’un gouvernement monarchique.
Ainsi, une série de nouveaux États nationaux font
leur entrée sur la scène mondiale. Ils
constituent ce que l’on connaît
aujourd’hui comme l’Amérique latine.
Mais ce qu’il importe de souligner, c’est que cet
ensemble de pays n’a pas constitué, loin de
là, un bloc uni et solidaire devant le monde. Cette
unité ne s’est forgée que
péniblement à travers le temps. Pourtant, tout
avait bien commencé. Les luttes pour
l’indépendance avaient été
menées de concert entre les chefs patriotes.
Vénézueliens et Colombiens
s’étaient battus ensemble pour leur
indépendance et, plus tard, avaient joué un
rôle décisif dans la libération du
Pérou, dernier bastion royaliste en Amérique du
Sud.
Les troupes argentines étaient venues à la
rescousse du mouvement patriote chilien, et ces deux pays avaient aussi
envoyé
des troupes
pour contribuer à la libération du
Pérou. À l’époque, une seule
nationalité semblait exister: celle
des Americanos, les habitants du Nouveau
monde. La communauté de langue et de religion, le culte aux
héros qui ne connaissaient pas de frontières
– l’Argentin José de San
Martín au Chili, le Vénézuelien
Simón Bolívar dans plusieurs pays, notamment en
Bolivie, ainsi nommée en son honneur, semblaient autant de
fondements pour une solide unité.
Cette unité est néanmoins vite disparue au profit
des rivalités régionales. Les
expériences unitaires tentées durant les
premières années d'indépendance ont
échoué : la Grande-Colombie, qui regroupait la
Colombie, le Venezuela et l’Équateur,
disparaît en 1830, et la Confédération
de l’Amérique centrale s’effondre en
1838, laissant la place à cinq petits pays : le Guatemala,
le Nicaragua, le Honduras, le Costa Rica et le Salvador. De plus, le
Guatemala subit les pressions du Mexique, qui s’attribua le
Chiapas et réclama d’autres territoires.
L’Argentine eut beaucoup de mal à se doter
d’une structure unitaire : pendant trois
décennies, chaque province disposait de sa propre
armée, ce qui laissait Buenos-Aires seule à
diriger la politique extérieure d’une
Confédération assez
relâchée. De plus, bientôt
éclatèrent des guerres entre pays voisins.
Déjà en 1829, le Pérou affrontait la
Colombie. Plus tard, entre 1837 et 1839, le Chili faisait la guerre au
Pérou et à la Bolivie,
répétant l’expérience
quarante ans plus tard, en 1879. Entre 1865 et 1870, le Paraguay
était décimé suite à la
guerre contre ses trois voisins, le Brésil, l'Uruguay et
l’Argentine. Les pays de l’Amérique
centrale se sont affrontés à plusieurs reprises
tout au long du XIX° siècle (1), et Haïti
occupait militairement durant de longues années la
région qui deviendrait la République dominicaine.
Ces circonstances expliquent l’échec des
tentatives en vue de formuler une politique commune pour
l’ensemble des nouveaux pays, d’abord le
congrès de Panama, tenu en 1826 à
l’initiative de Bolívar, plus tard les deux
congrès de Lima, en 1847 et en 1865. Non seulement ces
réunions ne produisirent pas de résultats
concrets, mais il n’y eut jamais la participation
simultanée de tous les pays invités.
D’ailleurs, les pays de langue espagnole se
méfiaient du Brésil, l’ennemi
ancestral, car il était vu comme la prolongation du
Portugal.
Ceci explique la guerre entre Buenos Aires et le
Brésil entre 1825 et 1828 pour la possession des territoires
à l’est du fleuve Paraná, ce qui
donnera naissance à l’Uruguay comme solution de
compromis. Haïti faisait problème à
cause du fait qu’il
s’agissait
d’un pays gouverné
par des Noirs, à une époque où
l’esclavage n’avait pas été
aboli partout. Ainsi, sur le plan international, il y avait trois
Amériques : l’espagnole, le Brésil et
Haïti. L’expression « Amérique
latine », lancée par les Français pour
justifier l’intervention de Napoléon III au
Mexique, en 1862, ne fit pas long feu.
Au niveau économique, il n’y avait pas des raisons
de chercher l’unité. Il existait certes un
commerce entre les nouveaux pays, suivant
l’héritage colonial. Mais
c’était le commerce avec l’Angleterre,
qui dominait l’économie mondiale et qui ne
s’intéressait pas à faire des
conquêtes territoriales en Amérique latine, qui
constituait l’élément le plus important
dans la nouvelle étape. Chaque pays espérait
aussi recevoir des investissements étrangers pour stimuler
sa croissance.
|
Lire
ou télécharger la suite du texte :
|
Notes
:
Texte
révisé d’une conférence
donnée à l’ambassade du Chili
à Alger, le 30 juin 2010
(*) José Del Pozo est professeur d’histoire
à l’Université du Québec
à Montréal
(1) Sur cette région et les facteurs de sa
désunion, voir l’article de Pierre
Vayssière, « L’Amérique
centrale au XIXe siècle : l’union impossible
», Cahiers des Amériques latines no. 11, 1991, pp.
29-44.
|
|
|
|
|
|
|
Amérique
Latine
et la Colombie en particulier...
Rapport
sut la torture en 2010
|
 par
l’ACAT France, mis en ligne en décembre 2010
par
l’ACAT France, mis en ligne en décembre 2010
(...) L’existence de la torture en Amérique latine
est
liée à l’histoire de ce continentI.
À
l’exception du Costa Rica, tous les pays
latino-américains
ont connu ou connaissent la pratique de la torture.
Utilisée par les dictatures de type « caudillo
» (1)
pour réprimer l’opposition durant la
première
moitié du XX° siècle et
au-delà (Vicente
Gómez au Venezuela, Somoza au Nicaragua, Trujillo en
République dominicaine, Duvalier en Haïti...), la
torture
fut érigée en véritable politique
d’État durant la Guerre froide sous les
régimes
militaires des années soixante à quatre-vingt-dix
fondés sur la doctrine de la «
sécurité
nationale » (2) (Chili, Argentine, Uruguay, Guatemala,
Brésil, Salvador...), ainsi que sous certains gouvernements
démocratiques, comme la Colombie. C’est dans ce
contexte
que plusieurs centaines de milliers de personnes ont
été
assassinées, torturées, victimes de
détentions
arbitraires, de disparitions forcées* ou ont
été
contraintes à l’exil.
À l’exception de Cuba (3), les États
d’Amérique latine connaissent
aujourd’hui des
régimes démocratiques, qualifiés par
certains
observateurs de « démocratures » (4).
Plus de la
moitié d’entre eux a ratifié la
Convention contre
la torture* des Nations unies et la Convention
interaméricaine
pour la prévention et la répression de la
torture. La
majorité ont adopté des législations
prohibant
cette pratique dans leur droit interne.
Le recours à des méthodes violentes, et notamment
à la torture, demeure pourtant très
répandu au
sein des forces de l’ordre. Héritage de
décennies
de dictatures militaires, il est courant que des personnes,
généralement issues de couches
défavorisées
ou marginalisées, soient maltraitées ou
torturées
par la police ou les forces de sécurité
lorsqu’elles sont arrêtées.
Si la lutte contre le communisme a laissé place à
la
guerre contre le terrorisme, les moyens utilisés continuent
de
porter atteinte aux droits de l’homme. La plupart des
États latino-américains se sont dotés
de
législations antiterroristes contraires aux garanties
constitutionnelles en matière de droits et de
libertés.
C’est notamment le cas de l’Argentine, de la
Colombie, du
Salvador, du Pérou, du Paraguay.
Des infractions aux contours flous ouvrent la voie à des
interprétations qui criminalisent la protestation sociale :
des
syndicalistes, des paysans, des étudiants ou des leaders
sociaux
sont fréquemment arrêtés sous couvert
de lutte
antiterroriste et se retrouvent exposés à des
risques de
tortures, de mauvais traitements ou de disparitions
forcées*.
En Argentine, les dispositions de la loi antiterroriste permettent de
réprimer des citoyens ou des organisations critiquant les
autorités ou prétendant exercer une pression sur
le
gouvernement (5).
Au Chili, une centaine d’Indiens Mapuches militant contre
l’exploitation du bois sur leur territoire demeurent
emprisonnés sur le fondement d’une loi
antiterroriste
votée sous le régime de Pinochet. Au
Brésil, au
Guatemala, en Colombie, au Pérou, en Argentine, en Bolivie
ou en
Équateur, les mouvements de paysans ou d’Indiens
protestant contre une mauvaise répartition de la terre et
des
ressources sont violemment réprimés par les
forces de
l’ordre.
Au Mexique, au Guatemala, en Colombie ou au Pérou, le trafic
de
drogue est devenu une source majeure de la violence dont la population
est la première à subir les
conséquences.
L’influence des groupes armés liés au
crime
organisé est telle que ceux-ci font parfois obstacle au
contrôle de l’État sur des pans entiers
du
territoire (Colombie) ou s’imposent comme autorité
de fait
dans des zones marginalisées (favelas au Brésil).
Dans le cadre des offensives menées contre les
narcotrafiquants,
la police et l’armée ont pour usage de recourir
à
la torture pour obtenir des aveux et se rendent responsables de graves
exactions contre la population. Chaque année, au
Brésil,
de nombreux jeunes issus des favelas sont torturés ou trou-
vent
la mort au cours d’opérations
policières contre le
trafic de drogue. Le crime organisé
pénètre les
plus hautes instances de l’État, entretenant une
impunité chronique pour les auteurs d’exactions.
Le recours à la torture demeure très
fréquent dans
les lieux de détention. En 2007, Florentin
Meléndez,
président de la Commission interaméricaine des
droits de
l’homme (CIDH), a indiqué que dans les lieux
privatifs de
liberté, les droits fondamentaux des détenus
continuaient
d’être violés et a relevé la
persistance de
la torture, des mauvais traitements et de la surpopulation
carcérale. Dans la majorité des pays
d’Amérique latine, les systèmes
judiciaires
privilégient la répression et le recours
à
l’incarcération au détriment de
politiques de
prévention, de peines alternatives et de la
résolution
des problèmes sociaux.
L’impunité dont bénéficient
les auteurs des
violations des droits de l’homme contribue à la
persistance du phénomène tortionnaire en
Amérique
latine. Elle résulte aujourd’hui non seulement de
la
corruption endémique qui ronge le pouvoir judiciaire dans de
nombreux États, mais également des
défaillances
des systèmes judiciaires. Le renvoi de nombreuses plaintes
devant des juridictions militaires excluant les crimes de torture,
comme c’est notamment le cas en Colombie ou au Mexique,
constitue
un obstacle de taille au jugement d’agents de
l’État
responsables de violations des droits de l’homme. (...).
La
Colombie en particulier...
LE CONTEXTE
(...) Depuis la fin de la Violencia (1948-1960) (13), la Colombie est
le théâtre d’un conflit armé
interne opposant
les deux principales guérillas d’extrême
gauche (les
Forces armées révolutionnaires de Colombie
–
FARC-EP, et l’Armée de Libération
nationale –
ELN) aux forces gouvernementales et aux paramilitaires (les
Autodéfenses unies de Colombie – AUC) (14). Ces
derniers,
soutenus par les élites économiques, une partie
de
l’armée colombienne et de la classe politique (15)
ont
pour objectifs de chasser les guérillas de leurs zones
d’influence et d’éliminer tout soutien
avéré ou perçu comme tel aux
activités
insurrectionnelles. À ce conflit, se superpose dans les
années quatre-vingt-dix la lutte pour la maîtrise
du
trafic de drogue, lucrative source de financement des
activités
des groupes armés.
Dans les zones de conflit, la population est prise entre deux feux :
les personnes accusées de collaborer avec l’un ou
l’autre camp sont fréquemment menacées,
enlevées ou tuées. Les campagnes de terreur
menées
par les paramilitaires dans les zones sous influence de la
guérilla s’accompagnent de la spoliation de mil-
lions
d’hectares de terres dont les communautés
indiennes et les
afro-colombiens sont les premières victimes (16). Bien
qu’ayant subi de sérieux revers en 2008, les
guérillas continuent de se livrer à des exactions
:
assassinats – parfois
précédés de tortures
– de civils considérés comme des
collaborateurs de
l’armée ou des paramilitaires (17) ;
enlèvement de
personnalités politiques leur servant de monnaie
d’échange avec leurs membres
emprisonnés, ou de
simples citoyens dans le but d’obtenir des rançons
(18) ;
recrutement d’enfants soldats ; usage de mines antipersonnel.
Le
viol est utilisé à grande échelle par
chacune des
parties au conflit comme arme de terreur à
l’encontre des
populations civiles.
Depuis 2002, plus de 15 000 personnes ont péri ou disparu en
raison de leurs activités politiques ou sociales :
assassinats
d’opposants politiques, de défenseurs des droits
de
l’homme, de syndicalistes. La Colombie détient le
record
mondial de syndicalistes assassinés (4 000 en vingt ans).
La politique de « sécurité
démocratique
», lancée par le président Uribe au
lendemain de
son élection en 2002(19) pour regagner le contrôle
du
territoire, ne fait qu’affecter davantage la population
civile,
notamment en l’impliquant directement dans le conflit avec la
création d’un réseau
d’informateurs civils
rémunérés et d’une
armée de «
soldats-paysans ».
L’échec du processus de démobilisation
des groupes
paramilitaires (20) a entraîné
l’émergence de
nouveaux groupes paramilitaires, alors que d’autres ont
simplement poursuivi leurs activités. Les dépositions de
paramilitaires démobilisés, recueillies dans le cadre de la loi
Justice et paix de 2005 (21), ont permis de localiser 2 679 tombes
anonymes et fosses communes dans les- quelles ont été retrouvés 3
131 corps de personnes disparues, dont plusieurs portent des marques
évidentes de torture.
Le Comité contre la torture qualifie la pratique de la
torture
par des agents de l’État et les groupes
armés de
« généralisée ».
Le rapporteur
spécial des Nations unies sur la torture ne s’est
rendu
qu’une seule fois en Colombie, en 1994. Le gouvernement
colombien
refuse de ratifier le Protocole facultatif à la Convention
contre la torture* en faisant valoir que les mécanismes
existants offrent des garanties suffisantes de protection des droits
des détenus.
PRATIQUES DE LA TORTURE
Victimes
En 2009, le Centre pour la recherche et
l’éducation
populaires en Colombie (CINEP) a recensé 63 affaires
(concernant
un total de 181 victimes) dans les- quelles des faits de tortures
avaient été rapportés (22). Les
premières
victimes sont les opposants et les prisonniers politiques (23), les
défenseurs des droits de l’homme, les
journalistes, les
leaders communautaires, les victimes d’exactions commises par
les
paramilitaires revendiquant leur droit à la
réparation,
ainsi que leurs avocats. Sont également ciblés
les
paysans et les membres des communautés indigènes
accusés de fournir des informations à
l’un ou
l’autre des deux camps.
Le 19 février 2009, sept membres de la famille
García
Taicús, Indiens de l’eth-nie Awa, ont
été
enlevés, puis torturés à
l’arme blanche
(oreilles coupées, entailles sur plusieurs parties du corps)
par
un groupe de paramilitaires les accusant d’être des
sympathisants de la guérilla. Ils ont
été
libérés, à l’exception
d’un jeune
homme âgé de vingt ans dont on reste sans
nouvelles.
Le 23 février 2009, dans le hameau El Castillo
(département du Meta), plu- sieurs paramilitaires agissant
sous
couvert de l’armée ont torturé une
paysanne
qu’ils suspectaient de liens avec la guérilla et
ont
tenté de la violer en présence de ses trois
enfants. Le
1er mars 2009, à Chaparral (Tolima), des membres des FARC
ont
torturé, puis assassiné un homme qu’ils
accusaient
d’être un informateur de
l’armée.
Le 14 mars 2009, des militaires de la brigade mobile n° 17 se
sont
attaqués à la communauté de paix de
San
José d’Apartadó (24). Depuis sa
création en
1997, près de 200 de ses membres ont
été
assassinés par des militaires, des para- militaires et par
les
FARC. Lors de cette dernière attaque, des militaires ont
tenté de violer Luz Tatiana Puerta dans le village de
Mulatos
à Antioquia. Ils l’accusaient
d’entretenir des liens
avec des membres de la guérilla. L’homme qui
l’accompagnait, Isaac Torres, a été
pris à
part. Les soldats lui ont mis une machette sur la gorge et ont
menacé de lui crever les yeux. Ces deux personnes ont
été relâchées
après une demi-heure et
ont déposé plainte, en dépit des
craintes de
représailles.
Le 10 septembre 2009, des paramilitaires ont torturé, puis
assassiné Oscar Eduardo Suárez
Suescún, professeur
à l’université de Pamplona, alors
qu’il
enquêtait sur la prostitution clandestine dans la ville de
Cúcuta. Son corps a été
retrouvé dans la
rue à moitié dénudé et la
tête
recouverte d’un sac en plastique attaché avec un
ruban.
Le 26 août 2009, des membres de l’unité
ESMAD
(police antiémeute) ont arrêté, puis
torturé
un étudiant de vingt-quatre ans dans la ville de Bucaramanga
au
cours d’une journée de protestation
d’étudiants et de professeurs. Ces derniers
demandaient la
démission du recteur de l’université
qui
s’était engagé, lors d’une
conversation
téléphonique avec un chef paramilitaire,
à lui
fournir une liste de noms d’étudiants, professeurs
et
travailleurs pour leur appliquer le « plan pistolet
»XV.
Tortionnaires et objectifs
Près de la moitié des actes de torture
recensés en
Colombie sont imputables aux divers groupes paramilitaires –
anciens membres de l’AUC poursuivant leurs
activités
auxquels s’ajoutent de nouveaux groupes illégaux
(Aigles
noirs, Los rastrojos...) – agissant très souvent
de
concert avec la police nationale ou l’armée. Une
partie
importante des actes de torture est directement imputable aux forces de
sécurité : l’armée
(particulièrement
les brigades n° 8, 15, 17, 30, le bataillon
d’infanterie de
la marine fluviale n° 10), la police et les services de
renseignement. Les guérillas, en particulier les FARC-EP,
sont
également directement responsables de tortures (25).
Les tortures perpétrées par l’un ou
l’autre
des deux camps répondent aux mêmes objectifs :
l’obtention de renseignements ou d’aveux sur les
activités ou la transmission d’informations au
camp
adverse. La torture peut être infligée
à la victime
en guise de punition et vise à terroriser les autres membres
de
sa communauté afin de la fragiliser et de rompre les liens
sociaux en faisant régner la loi du silence.
Méthodes
et lieux
Les cas recensés font état de tabassages
extrêmement violents. Le viol et les brûlures sont
également fréquents. Près de la
moitié des
victimes sont assassinées après avoir subi des
sévices, ce qui tend à occulter
l’importance du
fait tortionnaire et à favoriser
l’impunité quasi
totale dont bénéficient les auteurs de tortures.
Plusieurs cas avérés de tortures
perpétrées
par des paramilitaires se sont produits dans des postes de police et
des commissariats. La torture est également
présente dans
les prisons colombiennes, notamment celles de Val- ledupar (Cesar), de
La Modelo de Bucaramanga, de La Picaleña (à
Ibagué
– Tolima) et de Doña Juana (à La Dorada
–
Caldas). En sus de ces lieux que l’on peut qualifier
d’« habituels », des maisons (notamment
de
paramilitaires), des clairières, ou même la
jungle,
peuvent servir temporairement de cadre à la torture.
PRATIQUES
DE LA DÉTENTION
Légalité
des détentions
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de
«
sécurité démocratique », les
détentions massives et arbitraires se sont
multipliées.
Des centaines de personnes ont été
arrêtées
en même temps, puis placées en
détention. En 2008,
les Nations unies se sont déclarées
préoccupées par la persistance des arrestations
massives
et par le recours excessif à la détention
provisoire dans
certaines régions de la Colombie, comme le
départe- ment
d’Arauca. Le rapporteur spécial* des Nations unies
sur la
détention arbitraire, M. El Hadji Malick Sow, a
visité en
2008 des prisons, des casernes militaires et des commissariats de
police du département d’Arauca, ainsi que la ville
de
Cali, où les ONG locales ont signalé le plus
grand nombre
de détentions arbitraires et massives.
Conditions
de détention
Les 139 prisons nationales sont gérées par le
Conseil de
l’Institut national pénitentiaire et
carcéral
(INPEC) dirigé par un général de
l’armée. Le nombre de détenus en 2010
est
estimé à 79 730 pour une capacité
théorique
de 55 000.
Les bâtiments des prisons colombiennes sont
généralement en mauvais état et les
conditions de
vie y sont difficiles. Le budget alloué aux besoins des
prisonniers est insuffisant et il est fréquent que les
familles
des détenus se chargent de fournir leurs proches en
nourriture,
vêtements et produits d’hygiène.
L’insuffisance, voire le défaut de formation des
gardiens
de prison, favorise la violence,
l’insécurité et la
corruption au sein même des prisons. Plusieurs chefs de
cartels
de drogue et des paramilitaires, emprisonnés en vertu de la
loi
de 2005, continuent à gérer leurs affaires depuis
les
centres de détention. Les émeutes sont
fréquentes
et entraînent plusieurs dizaines de morts chaque
année. En
2009, 27 détenus ont trouvé la mort à
la suite
d’affrontements et d’émeutes.
En novembre 2009, lors de l’examen du quatrième
rapport
soumis par la Colombie, le Comité contre la torture*
s’est
déclaré préoccupé par le
recours à
l’isolement* pendant des périodes
prolongées
à titre de punition. Le Comité a par ailleurs
relevé que les plaintes pour tortures et mauvais traitements
en
détention étaient
généralement instruites
par l’autorité disciplinaire et que rares
étaient
celles donnant lieu à l’ouverture
d’enquêtes.
Les conditions de détention des civils ou des militaires
enlevés par les groupes de guérilla (FARC et
ELN),
notamment le fait d’être
enchaîné en
permanence, sont également dramatiques, mais beaucoup moins
documentées et donc plus difficiles à
décrire.
LÉGISLATION
ET PRATIQUES JUDICIAIRES
Condamnation
de la torture en droit interne
La torture est prohibée par la Constitution de 1991 et
incriminée par le code pénal. En vertu de
l’article
178 du code pénal modifié par la loi n°
890 de 2004,
l’infraction de torture est punissable d’une peine
d’emprisonnement comprise entre 128 et 270 mois (soit
vingt-trois
ans) et d’une amende de 800 à 2 000 fois
égale au
salaire minimum en vigueur en Colombie.
Cependant, lorsqu’elle n’est pas
qualifiée
d’infraction pénale de moindre gra-
vité, telle que
les dommages corporels, la torture est souvent qualifiée de
cir-
constance aggravante d’autres crimes
considérés
comme plus graves, tels que l’homicide.
La loi 734/2002 instituant le code disciplinaire unique
complète
la liste des actes constitutifs d’infractions à la
discipline des fonctionnaires d’État en y
ajoutant, entre
autres, la torture, considérée comme une
infraction
très grave passible de révocation et
d’une
incapacité d’exercer une fonction publique
d’une
durée comprise entre dix et vingt ans.
Répression
des auteurs de torture
Lors de l’examen du dernier rapport
présenté par la
Colombie, le Comité contre la torture* s’est
déclaré très
préoccupé par
l’insuffisance des enquêtes pénales
conduites sur
des faits de tortures et par le fait que nombre d’entre elles
ne
débouchaient sur aucune poursuite. En novembre 2009, le
procureur général de la Nation a
mentionné 6 956
enquêtes concernant des faits de torture, mais seules 28 de
ces
affaires (0,4 %) étaient en cours de jugement.
Les crimes de torture, de génocide et de disparition
forcée* sont totalement exclus de la juridiction
pénale
militaire. En vertu du code de procédure pénale,
les
militaires responsables de violations des droits de l’homme
doivent être jugés par des tribunaux civils.
Pourtant,
dans de telles affaires, les militaires demeurent souvent
jugés
par leurs pairs et ne sont que rarement condamnés. En 2008,
le
ministère de la Défense a démis de
leurs fonctions
80 officiers et 213 soldats pour inefficacité, conduite non
éthique, corruption et implication suspectée dans
des
violations des droits de l’homme (26). Ils n’ont
cependant
pas été jugés.
L’impunité reste donc de mise : alors que toutes
les
parties prenantes au conflit ont utilisé la torture, les
commanditaires de ces actes ne sont que rarement traduits en justice.
Les véritables responsables des violences civiles et
politiques
échappent à la justice et seuls les
exécutants
sont punis, encore que de façon non systématique
et
très aléatoire.(...).
Notes
du texte :
1 Le «caudillisme» désigne
une pratique
du pouvoir
politique fondée sur la dictature personnelle d’un
chef
militaire (le caudillo).
2 Ciment des dictatures militaires latino-américaines des
années soixante-dix à
quatre-vingt/quatre-vingt-dix,
cette doctrine reposait sur le concept de « lutte contre
l’ennemi interne » dont certains des
éléments
clés étaient la répression et la
torture. Dans
leur lutte contre le communisme, ces régimes ont
bénéficié du soutien appuyé
des
États Unis dont un des volets consista en
l’enseignement
de méthodes d’interrogatoire, y compris de
méthodes
de torture, à l’« École des
Amériques
». Sur la doctrine de la sécurité
nationale voir
Comblin J., Le pouvoir militaire en Amérique latine.
L’idéologie de la sécurité
nationale,
Jean-Pierre Delarge Éditeur, 1977.
3 En dépit de l’annonce de la
libération de 52
prisonniers d’opinion en juillet 2010, dont seulement cinq
ont
été remis en liberté, la
législation
cubaine continue à ériger l’opposition
politique en
infraction.
4 L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano a
créé le terme « démocrature
» pour
désigner les faibles démocraties nées
au terme des
dictatures latino-américaines des années
soixante-dix et
quatre-vingt.
5 En 2007, plusieurs personnalités, dont le prix Nobel de la
paix Adolfo Perez Esquivel, ont été
placées sous
surveillance en application de la loi antiterroriste.
nombreux pays et crée un terreau fertile au
développement
de la criminalité : émergence des maras en
Amérique centrale, tueurs à gages en Colombie
(sicarios),
gangs de jeunes trafiquants des favelas au Brésil.
13 Cette période de conflits sanglants opposant les deux
partis
politiques traditionnels (conservateur et libéral) dura
jusqu’en 1960 et fit plus de 200 000 morts.
14 La création légale (décret
3398/1965, devenu en
1968 la loi 48, déclarée anticonstitutionnelle en
1989)
de groupes armés de civils intervenant sous
l’égide
de l’armée lors d’opérations
anti-insurrectionnelles est à l’origine de
l’émergence de groupes paramilitaires apparus au
cours des
années soixante-dix comme structures organisées
et
mafieuses, agissant avec la complicité
d’élites
régionales, d’une partie de
l’armée et de
trafiquants de drogue. Les groupes paramilitaires se
fédèrent en 1997 sous la bannière des
Autodéfenses unies de Colombie (AUC).
15 En novembre 2009, 268 parlementaires, 12 gouverneurs, 166 maires et
des dizaines d’autres élus locaux
étaient
l’objet de poursuites judiciaires du fait de liens avec les
paramilitaires. Conseil des droits de l’homme, Rapport du
Haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme
sur
la situation des droits de l’homme en Colombie, A/HRC/13/72,
4
mars 2010.
16 Cette spoliation bénéficie à
l’implantation de projets économiques de
compagnies
colombiennes et de multi- nationales. Voir Human Rights Everywhere
(HREV) et Coordination belge pour la Colombie, Le flux de
l’huile
de palme Colombie-Belgique-Europe, approche sous l’angle des
droits humains, novembre 2006.
17 Au début du mois de février 2009, 17 Indiens
membres
de l’ethnie Awa ont été
assassinés par les
FARC. Les FARC ont reconnu la responsabilité de huit
assassinats. Asociacion de cabildos Indigenas Norte del Cauca, 2
octobre 2009.
18 Cette pratique est toutefois sur le déclin :
d’après Amnesty International, le nombre
d’enlèvements est passé d’un
pic de 3 570 en
2000 à un peu plus de 520 en 2007. Selon une
étude
réalisée en 2010 par une unité
spéciale du
ministère de la Défense, les FARC ont
enlevé 679
personnes entre 1996 et 2009, dont 44 restent encore entre leurs mains
; 44 sont décédées et 14 ont
été
enrôlées de force. Fundación para la
defensa de la
libertad personal (Fondelibertad) Realidad de las víctimas
del
secuestro en Colombia, marzo de 2010. Bogotá abril 2010,
19 Élu le 20 juin 2010, Juan Manuel Santos, ancien ministre
de
la Défense du président sortant, a pris ses fonc-
tions
de président de la République le 7
août.
20 À l’issue de ce processus, le gouvernement
recensait 31
671 « combattants » paramilitaires ayant
déposé les armes. La majorité a
été
amnistiée. Human Rights Watch, Paramilitaries Heirs, the New
Face of Violence in Colombia, février 2010.
21 La loi n°975/2005 prévoyait une peine de cinq
à
huit ans d’emprisonnement pour les combattants confessant
volontairement leurs crimes, y compris pour les auteurs de crimes
contre l’humanité et de disparitions
forcées. Les
dépositions d’environ 1 800 personnes ont
été recueillies à partir de 2005.
Rapport du
Haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme
sur
la situation des droits de l’homme en Colombie op.cit. Le 29
juin
2010, une première condamnation a été
prononcée à l’encontre de deux chefs
paramilitaires
: condamnés respective- ment à trente-huit et
trente-neuf
ans d’emprisonnement pour le massacre de 11 paysans commis en
mars 2000 et le déplacement forcé de 300 familles
; ils
bénéficient cependant de peines alternatives de
huit ans
en vertu de la loi « Justice et Paix ». «
Especial :
Primera condena de justicia y Paz », La Semana, 15 juin 2010.
22 CINEP, Banque de données sur toutes les formes de
violences politiques en Colombie.
23 Près de 4 000 membres du parti politique Union
patriotique,
né des accords de paix avec les guérillas en
1984, ont
été assassinés par
l’armée et les
paramilitaires. Ces dernières années, des
militants du
parti d’opposition PDA ont été
assassinés.
24 Cette communauté de paix, pour laquelle
l’ACAT-France
s’est mobilisée ces dix dernières
années,
regroupe environ 1 500 paysans pacifiques. Ses membres refusent de
prendre parti dans le conflit et interdisent le port d’armes
au
sein de leur communauté, ce qui donne lieu à des
tensions
avec l’armée et le gouvernement.
25 Près de 50 % sont imputables aux groupes paramilitaires,
20 %
à l’armée, 16 % à la police,
6,5 % aux
services de renseignement, 6,5 % aux guérillas. Estimation
faite
sur la base des recensements 2009 du CINEP : CINEP, Noche y Niebla
n°38, 2008 et n°39, 2009.
26 La plupart de ces militaires étaient impliqués
dans
l’assassinat de jeunes issus des bidonvilles de
Bogotá et
présentés comme «
guérilleros morts au
combat ». Ce scandale est connu en Colombie sous le nom de
« faux positifs ». Voir Sottas E., «
Colombie :
“Les faux positifs”, une barbarie travestie
»,
Liberation.fr, 30 juin 2009.
|
|
|
|
|
|
| Cet
espace
d'expression citoyen n'appartient à aucune organisation
politique, ou entreprise commerciale. Le contenu est sous la
responsabilité de son créateur, en tant que
rédacteur.
|
|
|
| Page d'entrée
: |
|
|
|
|
|
|
|
| Courrier
électronique : |
| lionel.mesnard(AT)free.fr |
|
|
| Archives
Amérique
Latine : |
Autres pages
à consulter : |
| Amérique
Latine
de 2005 à 2010 |
Henri
Laborit : L'esprit
du grenier |
| Colombie, Venezuela, Chili, ... |
Un
autre regard : Eduardo
Galeano |
| Archives
La Question "Psy" : |
Sigmund
Freud : Biographie |
| La Question "Psy"? |
Jacques
Hassoun : Biographie,
textes |
| Psyché, Inconscient,
Résilience |
Antonin
Artaud : Bio(s),
textes |
| Archives
Histoire de Paris : |
Média
: Une
télévision bien? |
| Histoires
urbaines et légendes |
Alice
Miller : Mais
qui es donc AM? |
| Origines,
Moyen-Âge, Commune |
Boris
Cyrulnik : Un
homme intègre |
| Archives
Violence et Éducation : |
Chili
: Peuple
Mapuche en danger |
| Éducation
et violence |
Venezuela : Le
retour de l'Histoire |
| Enfermement, droits de
l'Enfant, |
|
|
Dernières
modifications : 14/06/2010 |
| | | |
|
| |